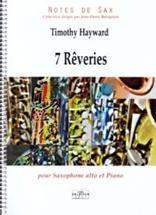L’éducation musicale
Lettre
d’Information – n°64 – Novembre 2012
À
réserver sur l’agenda
Quand Giuseppe Verdi savait se
montrer grand prince
Recensions de spectacles et concerts
Expériences musicales berlinoises
L’édition musicale
Bibliographie
CDs et DVDs
La vie de L’éducation musicale

Carmen, toujours Carmen...

© Wikipedia
Le
plus joué des opéras s'en revient à Bastille, dans une nouvelle mise en scène
signée Yves Beaunesne. Gageons que de ce formidable
récit de passion fatale se dégagera une vision forte. On n'a pas lésiné, en
tout cas, sur le volet musical : Philippe Jordan sera aux commandes, et Anna Caterina Antonacci, puis Karine Deshayes
incarneront la mythique gitane. Pour compléter le carré d'as, Genia Kühmeier, Micaëla, Ludovic Tézier, Escamillo, et Nikolaï Schukoff,
Don José.
Opéra
Bastille, les 4, 7, 10, 13, 20, 22, 25, 27, 29 décembre 2012 à 19H30, et le 16
décembre à 14H30.
Location
: Billetterie 130, rue de Lyon, 75012 Paris ; par tel : 01 92 89 90 90 (et
depuis l'étranger : 33 171 25 24 23) ; en ligne : www.operadeparis.fr
Le Châtelet s'offre de nouveau West Side Story

©Châtelet
La
fameuse production de Broadway de West Side Story
se réinstalle sur les bords de la Seine. On sait de quelle fascinante manière
Léonard Bernstein a mis en œuvre son credo : « raconter une histoire
tragique en employant les techniques de la comédie musicale, sans pour autant
tomber dans le piège de l'opéra ». Il ne faut pas manquer un spectacle parfaitement
huilé, comme on les aime venant d'outre-Atlantique.
Châtetet, du
26 octobre 2012 au 3 janvier 2013, tous les jours à 20 H, sauf le lundi, mais
les 24 & 31/12 ; les samedis et dimanche également à 15H.
Location
: 1, place du Châtelet, 75001 Paris ; par tel. : 01 40 28 28 40 ; en ligne : www.chatelet-theatre.com.
Le Quatuor Diotima
aux Bouffes du Nord : regard croisé Beethoven-Schönberg

©Ircam
Juxtaposer
Beethoven et Schönberg n'est pas nouveau. Daniel Barenboim
s'y est attelé dans le domaine symphonique. Plus aventureux est sans doute de
rapprocher leurs quatuors. Encore plus audacieux, d'y ajouter celui de Pierre
Boulez. C'est le défi que se lance le Quatuor Diotima.
On jouera les quatre derniers du maître de Bonn, les quatre opus de l'auteur de
Pierrot lunaire, et le Livre pour quatuor de Boulez, dans sa version
fraichement révisée, forte de ses six parties, dont la quatrième en création
mondiale.
Concerts
Proquartet au Théâtre de Bouffes du Nord : les 19
(20H30) et 25 (17H) novembre, 2 (17H) et 10 (20H30) décembre 2012.
Location
: 37bis Boulevard de la Chapelle, 75010 Paris ; par tél.: 01 46 07 34 50 ; en
ligne : www.bouffesdunord.com
Les enfants terribles : Philip Glass rencontre Cocteau

©Antiochus
Un
« dance opera » pour quatre chanteurs et
trois pianos, tel est le sous titre de l'opéra de
Philip Glass. Après avoir mis en musique Orphée et La Belle et la
bête, le minimaliste américain
revient vers Jean Cocteau, pour adapter son roman Les enfants terribles.
Une rencontre pas si improbable donc. La production du théâtre de l'Athénée est
signée Stéphane Vérité, qui se propose d'opposer la retenue du jeu des
protagonistes et le merveilleux de la scénographie, pour mieux représenter la
fantasmagorie du rêve et ce qui est ici tragédie de l'innocence.
Athénée
Louis-Jouvet, Les 23, 24, 28, 30 novembre, 1er décembre 2012, à 20 H, et le 27
novembre à 19 H, et 2 décembre à 16 H.
Location
: square de l'Opéra Louis-Jouvet, 7 rue Boudreau 75009 Paris ; par tél : 01 53 05 19 19 ; en
ligne : www.athenee-theatre.com
Written on Skin au
Capitole

©Festival
d’Aix-en-Provence
Pour
ceux qui ne l'on pas vue à Aix cet été, la production de l'opéra de George
Benjamin, donnée à Toulouse est une occasion à ne pas laisser passer. Pour
trois raisons : une musique d'une rare
richesse, au soutien d'un magnifique texte, de Martin Crimp,
d'après une légende occitane du XII ème siècle, une
mise en scène inventive de Katie Barrie, qui tourne le dos à la recherche
spéculative, pour inscrire cette histoire bien dans le réel, entre hier et
aujourd'hui, une interprétation vocale hors pair par trois chanteurs pour la
voix spécifique desquels l'œuvre a été conçue.
Théâtre
du Capitole, les 23, 27, 30 novembre 2012, à 20H, et le 25 novembre à 15H.
Location : Billetterie, Place du
Capitole, BP 41408, 31014 Toulouse cedex 6 ; par
Tél.
: 05 61 63 13 13 : en ligne : www.theatre-du-capitole.
La
Semaine Mozart à Salzbourg

La Mozartwoche de
Salzbourg (24 janvier-3 février 2013) verra Marc Minkowski prendre les rênes de
la direction artistique. Logique aboutissement du parcours d'un chef qui
inscrit le compositeur salzbourgeois au centre de la constellation de ses
musiciens favoris, et dirige dans sa ville depuis plus de quinze ans. On se
souvient d'un mémorable Enlèvement au Sérail. La semaine Mozart fait
figure de festival d'hiver. Le charme est immense, car la cité, souvent
endormie sous un manteau de neige, vit à un rythme bien éloigné de la furia
touristique qui s'empare de la période du festival d'été. L'ambiance y est fort
différente aussi du strict point de vue musical : le public, dont une forte
présence française, y est très averti et concentré sur un ensemble d'évènements
appréciables. Le programme 2103 s'articule autour de l'opéra Lucio Silla,
dirigé par Marc Minkowski, mis en scène par Marshall Pynkoski.
Celui-ci sera mis en perspective avec les contemporains de Mozart, Johann
Christian Bach ou Pasquale Anfossi,
qui ont tous deux écrit sur ce même sujet. En forme de contraste, on entendra des musiques à priori éloignées du
génie local, en réalité pas si différentes dans leur esprit, de Schubert à
Stravinski, en passant par Wagner, de Bizet à Ravel, voire Messiaen et Boulez.
Car au cœur de l'exploration de l'œuvre mozartienne, la Semaine Mozart veut
assumer la diversité et donner une image la plus authentique possible.

©Wolfgang Lenbacher
Musiciens confirmés et jeunes pousses, la
diversité se déclinera tout aussi bien chez les interprètes. Aux côtés des
Wiener Philharmoniker (dirigés par Gustavo Dudamel, Teodor Currentzis et Georges Prêtre), ou de l'Orchestre of the Age
of Enlightenment (Simon Rattle),
et bien sûr, des Musiciens du Louvre Grenoble, on y entendra le Cercle de
l'Harmonie et Jérémie Rhorer, la Capella Andrea Barca
de András Schiff, la Camerata Salzburg avec Louis Langrée,
l'Academy of Saint Martin in the fields,
dirigée par la violoniste Janine Jansen, l'Orchestre du Mozarteum
et Ivor Bolton, ou encore l'Ensemble intercontemporain conduit par George Benjamin. Mais aussi
des formations de chambre, les quatuors Emerson et Diotima,
les Vents français, comme des solistes renommés, tels Pierre-Laurent Aimard, Maria Joăo Pires,
Thomas Zehetmair, Patricia Kopatchinskaja,
Sol Gabetta, Jean-Guihen
Queyras, Alexander Melnikov (jouant le hammerklavier), et des chanteurs, Gerald Finley, Julia Kleiter, Rolando
Villazón,... Les concerts se doubleront également d'expositions, discussions,
conférences introductives et présentations de films.
Renseignements et Location : Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg, Mozart- Wohnhaus,
Theatergasse 2, 5020 Salzburg, Austria
; tel. : 00 43 662 873154 ; Fax : 00 43 662 874454 ; par mail :
www.mozarteum.at ou tickets@mozarteum.at
Jean-Pierre Robert
A
l'auditorium du Louvre en décembre
La programmation de l’Auditorium du Louvre offre, tous les mois, des films, des
quatuors, des jeunes artistes des plus confirmés. Dans la série des opéras
filmés, sera présenté Roméo et Juliette de Gounod, le samedi 8 décembre,
à 18H, mis en scène par Nicolas Joel, en 1994, avec
Roberto Alagna et Leontina Vaduva, superbes. Dimanche
9, à 15H, ne pas manquer Peter Grimes de Britten, avec l’intense
John Vickers et l’exceptionnelle Heather Harper, capté en 1981.
Le jeudi 6 décembre, à 12H30, se produira
le passionnant et surdoué Yan Levionnois,
violoncelliste de la nouvelle génération française. Schumann, Debussy et
Britten seront au programme. La série des « Quatuors à cordes »
présentera, le 5 décembre, le célèbre Quatuor Takács,
dans un programme Schubert, Britten et Dvořák.
Location : Auditorium du Louvre, à la
caisse, sous la Pyramide ; par tel : 01 40 20 55 55; http// info.louvre.fr
Stéphane Loison
***
(Source: Verdi's Aida:
The History of an Opera in Letters and Documents), traduction française
de Michèle Lhopiteau-Dorfeuille)
En mai 1872, après
avoir s’être par deux fois déplacé pour assister à
« Aïda », un certain Prospero Bertani, visiblement
déçu, décida d’écrire une lettre de protestation au compositeur Giuseppe Verdi,
et de se faire rembourser non seulement le spectacle, mais encore toutes ses
dépenses annexes. Amusé, Verdi fit suivre cette lettre à son éditeur et ami, Giulio Ricordi, avec
des instructions très précises. Voici cet échange de correspondance, suivie
d’une promesse écrite du signore Bertani de ne plus
jamais se rendre à aucune représentation d’ « Aïda ».
A la grande
confusion de Bertani, Verdi s’arrangera un peu plus
tard pour faire publier cet échange épistolaire dans plusieurs revues
italiennes.
Verdi à son
éditeur, Giulio Ricordi :
St. Agata, le 10
mai 1872
Cher Giulio,
J’ai reçu hier de Reggio une lettre si amusante que je te la fais suivre, en
te demandant de faire ce dont je vais te charger. Mais voici d’abord la lettre
en question.
Reggio, 7 mai 1872
Très honoré monsieur Verdi,
Le
second de ce mois, appâté par la sensation que votre opéra « Aïda »
semblait faire, je me suis rendu à Parme. Une demi-heure avant le début de la
représentation, j’étais déjà dans mon fauteuil, à la place 120. J’ai admiré le
décor, écouté avec plaisir les excellents chanteurs, et me suis donné beaucoup
de mal pour ne rien perdre du spectacle. A la fin de la représentation, je me
suis demandé si j’étais satisfait. La réponse fut négative. Je suis rentré à Reggio et dans le train du retour, j’ai écouté les avis des
autres voyageurs. Presque tous étaient d’accord pour dire qu’Aïda était une
œuvre des plus remarquables.
J’ai eu
donc envie de l’écouter à nouveau, et pour ce faire je suis retourné à Parme.
J’ai fait des efforts désespérés pour obtenir une bonne place, et il y avait
tant de monde que j’ai du payer 5 lires
supplémentaires pour pouvoir assister confortablement au spectacle.
Je suis
arrivé à la conclusion suivante : l’opéra ne contient absolument rien de
bouleversant ni d’excitant, et si ce n’était pas pour les magnifiques décors,
le public ne resterait pas jusqu’à la fin. Il remplira le théâtre une ou deux
fois encore et ensuite prendra la poussière dans les archives.
Maintenant,
mon cher Signore Verdi, pouvez-vous imaginer mon dépit
d’avoir dépensé 32 lires pour ces deux spectacles ? Sachant – circonstance aggravante – que je
dépends financièrement de ma famille, vous comprendrez que cet argent perdu me
hante comme un spectre. C’est pourquoi je vous demande franchement et sans
détour de me faire parvenir la somme en question. Voici le détail de mes
dépenses :
Le train
aller : 2, 60 lires
Le train
retour : 3, 30 lires
Théâtre :
8 lires
Un
mauvais dîner, à vous dégoûter : 2 lires
Deux
fois : 15, 90 lires
Total :
31, 80 lires
Dans
l’espoir que vous me sortiez de ce mauvais pas,
Sincèrement
vôtre,
Bertani
Mon
adresse : Bertani Prospero,
via St Dominico, n° 5
Tu penses, comme si, pour protéger cet
homme des foudres de sa famille et du spectre qui le hante, je n’étais pas
disposé à lui rembourser la petite somme dont il me parle ! Je te demande
donc, soit par une banque soit par un de tes représentants, de rembourser en
mon nom 27, 80 lires au sieur Bertani. Ce n’est pas
exactement la somme qu’il demande, mais payer aussi son dîner, là pas
question ! Il aurait aussi bien pu manger à la maison !!! Bien sûr il
devra vous remettre un reçu pour cette somme et une note dans laquelle il
promet de ne plus jamais assister à mes nouveaux opéras, pour s’éviter le danger
d’autres spectres et de m’éviter à moi la farce de lui payer un autre voyage.
Réponse de Ricordi à Verdi
Milan, 16 mai 1872,
Cher Giuseppe,
Dès que j’ai reçu
ta dernière lettre, j’ai écrit à mon correspondant à Reggio,
qui a trouvé le signor
Bertani, lui a donné l’argent et obtenu de lui un
reçu. Je copie la lettre et le reçu pour un journal, et je t’enverrai le tout
au plus vite. Combien de fous il y a dans le monde ! Mais tu n’as encore
rien vu, voilà ce que mon correspondant à Reggio m’a
écrit : « j’ai immédiatement fait chercher Bertani,
qui est venu aussitôt. Ayant appris la raison de ma convocation, il montra
d’abord de la surprise puis rajouta « si le
Maestro Verdi me rembourse, c’est qu’il a compris que ce que je disais était
vrai. Il est pourtant de mon devoir de le remercier, ce que je vous demande de
faire de ma part ».
Tu vas voir,
celle-là, c’est vraiment la meilleure !
Enchanté d’avoir
découvert grâce à toi un spécimen rare, je te prie de faire toutes mes amitiés
à la signora Peppina (Giuseppina Srepponi, l’épouse de Verdi)
Giulio.
Note de Prospero Bertani à Giuseppe Verdi
15 mai
1872,
Je
soussigné certifie avoir reçu du Maestro Verdi la somme de 27, 80 lires comme
remboursement de mon voyage à Parme pour écouter « Aïda ». Le Maestro
a compris qu’il était juste que cette somme me soit rendue du fait je n’avais
pas trouvé son opéra à mon goût. En même temps il est entendu que je ne ferai
plus aucun voyage pour écouter aucune œuvre nouvelle du Maestro, à moins qu’il
ne prenne en charge mes dépenses, quelle que soit mon opinion sur son œuvre.
Certifié
par ma signature
Bertani, Prospero.

***
Haut
Cycle Brahms Szymanowski à la salle
Pleyel : Iére partie

Szymanowski
Valery
Gergiev a du flair, et les organisateurs de concerts
de l'audace. Les salles sont quasi pleines pour les deux premiers concerts du
cycle pensé par le chef russe autour de Brahms et de Szymanowski. Réconfortant
! La première soirée réunissait la première symphonie de l'un et de l'autre, et
le premier concerto pour violon du polonais. La seconde, la symphonie N° 2 de
chacun, et l'Ouverture tragique de Brahms. La Première symphonie,
op 15, de Szymanowski (1906) est inachevée, non pas comme celle de Schubert,
mais faute de mouvement lent central. Réclamant un vaste effectif, elle n'évite
pas la boursoufflure au 1er mouvement, « allegro patetico »,
que l'auteur qualifiera de « monstre contrapuntico-harmonique
pour orchestre ». Ses tutti énormes évoquent Richard Strauss, et sa
surcharge peut sembler pesante. Mais s'y profile aussi l'incandescence de
Scriabine. Le second mouvement, marqué « allegretto con moto :
grazioso », n'est pas si gai que cela. Il existe peu de différence avec le
mouvement précédent, et les vagues successives comme les vastes crescendos ne
parviennent pas à dissimuler une veine qui se cherche. La 2ème symphonie, op. 19, est d'une toute autre facture. Si l'on
note encore des influences mêlées de Strauss, de Reger, voire même de Wagner
(dans certaines couleurs orchestrales des cordes et du cor), le discours se
fait plus intégré. Là encore, deux parties seulement, et un traitement de
musique pure. Achevée en 1910, elle sera révisée en 1930. Les forces requises
ne sont pas moins imposantes que dans le précédent opus. Le premier mouvement
offre une rare accumulation de tension, atteignant, par endroits, presque la
saturation. Mais le violon solo y joue un rôle intéressant, dans des pages
chambristes. Le deuxième mouvement est bâti sur le mode du thème et variations.
Celles-ci sont librement traitées, entrecoupées de fugues, comme chez Max
Reger. Des références épisodiques au
thème du premier mouvement semblent lui donner un caractère cyclique. Gergiev se dépense sans compter pour assumer ces musiques,
difficiles d'accès, pour une oreille latine en tout cas. Il se dégage de ses
interprétations une saisissante intériorité orchestrale, en particulier dans la
2ème symphonie, dont il souligne le raffinement sonore. Celui-ci
est encore plus présent dans le 1er concerto pour violon. Cet op. 35, de 1916,
est contemporain de la 3eme symphonie, et conçu comme son frère
jumeau, dans son climat nocturne. Il a peu de choses à voir avec le concerto de
type romantique et virtuose. Il doit beaucoup à son dédicataire, l'illustre
Pavel Kochanski, qui révéla au compositeur une
myriade de traits et d'effets, dont des mélismes envoûtants dans le registre
aigu de l'instrument. Joué d'un seul tenant, quoique muni de trois parties bien
distinctes, ce concerto assume son ambiguïté à la fois structurelle et
thématique. Le soliste n'y lutte pas contre l'orchestre, mais se fond plutôt
dans celui-ci. L'extrême fantaisie d'une trame orchestrale luxuriante est
souvent pacifiée par le soliste. La profusion mélodique trouve son unité grâce
au langage de celui-ci. Szymanowski s'empare d'harmonies impressionnistes et
aboutit à une combinaison de timbres souvent presque voluptueuse. Telle
l'introduction, d'une atmosphère évocatrice des bruits de la nature. Si pas
d'une virtuosité démonstrative, la partie soliste n'en est pas moins d'une
difficulté sévère. Janine Jansen la domine de sa sonorité fluide, tant dans les
sections les plus chargées que lors de la cadence extatique qui précède la fin
de la pièce. Gergiev lui dessine un accompagnement
des plus nuancés. Elle donnera, en bis, le premier mouvement de la Sonate pour
deux violons de Prokofiev, en compagnie du leader du LSO. Beau geste!

©Fred Toulet
Le
Brahms de Gergiev est expansif, d'un ample lyrisme.
On prend son temps dans les arcanes de la pensée du maître allemand. Bien sûr,
dans les deux premiers mouvements de la I ère symphonie, Gergiev
s'attarde sur tel détail, par conviction, et se laisse même aller à de
dangereux ralentissements, au risque de rompre l'unité du discours. A la robustesse
massive est préférée une exploration en règle de la richesse thématique,
l'andante sostenuto poursuivant à cet égard, la voie ouverte par l'allegro
initial. Mais le troisième mouvement est totalement convaincant : ce
« poco allegretto e grazioso », en forme d'apparent scherzo, en
réalité plus proche d'un intermezzo pianistique, genre dans lequel excelle
Brahms, délivre des havres de pure poésie, de vrai bonheur. Le finale, après sa
lente introduction mystérieuse, déploie moult visions prenantes, dont la
mélodie du cor (superbe instrumentiste) et les tempêtes de la section ultime,
rien moins que triomphale. La 2éme
symphonie montre une vision plus cohérente. Ou est-ce l'accoutumance à la
manière ample de Gergiev, mais la fonction, présumée
de pastorale, a rarement été aussi mise en exergue. « Une petite symphonie
gaie, tout à fait innocente » dira son auteur. Certes, là encore, le chef
laisse de côté la manière centrale de bien de ses confrères, Bernard Haitink par exemple, pour se donner du champ et laisser
souplement chanter son orchestre. Mais le résultat est là : expression
dramatique et lyrisme solaire se renforcent l'un l'autre, pour engendrer un jet
souvent inextinguible. Le finale, « allegro con spirito »,
déverse une joie sans mélange, et la coda, fort vigoureuse, en devient
tumultueuse. La gestuelle du chef se fait pourtant plus discrète, plus
intérieure, que dans les pièces de Szymanowski. En tout cas, la plastique
sonore du LSO s'avère d'une prodigieuse efficacité. Comme il en allait dans les
pièces polonaises. Une inusable danse hongroise clôt le second concert, en
fanfare, le maestro lâchant la bride de sa formation. Le partnership
entre celle-ci et le chef ossète est en
passe de devenir un incontournable. Rendez-vous les 15 et 16 décembre prochain,
pour la seconde partie de l'aventure.
Le Bœuf sur le toit fait un malheur à
la Cité de la musique...

© Julien Mignot/Cité de la musique
Une
journée autour de la thématique du Bœuf sur le toit, telle est l'idée du
pianiste Alexandre Tharaud, pour faire revivre ces
années Folles qui le fascinent. Et abolir les barrières entre genres. Le bœuf
sur le toit, c'est un lieu mythique, à la fois cabaret et restaurant chic
parisien, qui du modeste « Gaya » du 28 de la rue Boissy
d'Anglas, émigrera vers d'autres lieux plus vastes, et empruntera son enseigne
au titre du ballet de Milhaud. Témoin de la vivacité de l'activité artistique
et musicale, car on y croisait tous les soirs, aussi bien les musiciens du
groupe des Six, et son génial inspirateur Cocteau, que Stravinski ou Arthur
Rubinstein et autres pianistes à la mode, comme Jean Wiéner,
des artistes de tout poil, Maurice Chevalier, Mistinguett, le peintre Picabia,
etc... Le bœuf sur le toit est aussi un phénomène musical, que Tharaud a voulu faire revivre en mettant sur pied une forme
de marathon de plusieurs concerts, flanqués de manifestations diverses,
cabaret, mini récitals de chansons, films, tables rondes.
Dans
son récital, qui reprenait pour une large part le programme de son disque (voir
ci-dessous), Tharaud se montre imaginatif,
introduisant chaque morceau. Certes, la salle a du mal à se chauffer, sans
doute parce que le lieu ne se laisse pas aisément détourner de son formalisme,
et se prête peu à la liberté que requiert le genre léger. Mais la manière du
pianiste impose peu à peu son rythme et sa verve. L'enchaînement est bien vu,
qui entrecroise morceaux franco américains un brin canaille, pièces de genres,
bâties sur le schéma du fox trot, de Gershwin en particulier, morceaux libérés
de Wiéner, et en même temps, pièces de musiciens
classiques qui cherchent à ne pas faire sérieux. A cet égard, « Je te
veux » de Satie, la figure référente des Six, ou
le « Five o'clock » que Ravel a
inscrit dans L'enfant et les sortilèges, sont des perles. La patte du
pianiste, décidément fort éclectique, hier Scarlatti et Debussy à Ambronay, est évidente à chaque phrase, et on se régale de
ces tunes jazzy réinterprétés par les français, de ce
swing à la parisienne, ravageur, d'une séduction immanquable.

Wiéner
& Doucet ©Volkovitch
Le
deuxième concert, d'orchestre celui-là, rapprochait Milhaud et Gershwin, dans
un chassé-croisé, arbitré par Jean Wiéner. La
création du monde offre un étonnant mélange de musique classique et de
jazz, à travers un effectif singulier, puisé à Harlem, misant sur les vents,
dont le saxophone auquel il revient d'ouvrir la pièce. Les cordes et le piano
sont utilisés comme support rythmique. L'exécution de l'Orchestre National
d'Ile-de-France, sous la direction d'Andrea Quinn, est un brin sérieuse. Même impression dans la Rhapsody
in Blue, dont la faconde restera mesurée, en rapport avec l'approche de Tharaud, qui privilégie une manière plus tournée vers le
classique que franchement jazzy. On ne s'en plaindra pas car une exécution façon
mauvais jazz sombre vite dans la vulgarité. Une autre manière de voir la
musique du temps, on la trouve dans le Concerto franco-américain de Jean
Wiéner, créé en 1924 chez Madame de Polignac. Œuvre
sans prétention, que son auteur ne portait d'ailleurs pas aux nues, elle
oscille entre exercice de style et brillance contrôlée. Mais de belles
échappées, dans le mouvent médian, marqué « Très
lent - Temps de ballade », évitent l'écueil de la banalité chez celui qui,
évoluant auprès des Six, sut ne pas chercher à les imiter. Frank Braley le joue avec élégance et raffinement. Pour conclure,
retour à Milhaud, et à son Bœuf sur le toit, dans sa version
orchestrale, telle que créée en février 1920 à la Comédie des Champs-Elysées.
Les frères Fratellini, célèbres clowns, étaient les héros de ce ballet à
l'argument extravagant. Revenant du Brésil où il avait accompagné l'ambassadeur
Claudel, Milhaud ramène dans ses valises des rythmes inconnus ici, empruntés
aux tangos et sambas du pays de Bolivar, et des sonorités d'instruments
nouveaux, tel le güiro, appareil strié qu'on racle
avec une baguette. Contrastes de climats, profusion mélodique, polytonalité,
procédé du collage, font de ces variations un chef d'œuvre du genre. Chef et
orchestre s'y montent plus à l'aise, et se laissent enfin aller à swinguer
cette musique populaire, qui a depuis des lustres acquise ses lettres de
noblesse dans le répertoire.

© Julien Mignot/Cité de la musique
Pour
conclure en images, Tharaud avait convoqué quelques
amis, l'instant d'un « concert salade ». Pour, comme on disait à
l'époque, « faire un bœuf » : jouer ensemble, s'amuser entre
compères, sans trop savoir où l'on va...A vrai dire, de sketches en scénettes,
de solos en petits ensembles, tout cela répond à une trame pas si invraisemblable
que cela, finement mise en espace par Nicolas Vial, et en lumières par Stéphane
Deschamps. L'incongru répond à l'inattendu, le fine mouche au grivois.
L'atmosphère cabaret est vite établie, et le public répond au quart de tour. Tharaud, en gilet et bretelles, est un maître de jeu pas si
effacé que sa carrure longiligne le laisserait supposer. Ses compères,
comédien, l'inénarrable Gilles Privat, et musiciens, le désopilant ténor Jean Delescluse et l'intarissable Elise Caron, font vite fondre
la glace. Cela va du récit extraordinaire, emprunté à Breton ou Cocteau, à la
chanson au refrain chaloupé, « J'ai pas su y faire ». Il y a aussi
des vignettes déjantées : ainsi « Le Trou de mon quai », joue sur les
mots et les répliques attendues qui ne viennent pas, mais dont les
sous-entendus sont plus parlants que les paroles mêmes, à propos de la
construction du métro parisien. Ou encore « Le Tango
neurasthénique », qui voit un pauvre jeune homme périr, non de tristesse,
mais de la mélancolie consubstantielle à ladite danse. Il finira par se blottir
dans le ventre du piano à queue, tandis que ses compagnons d'infortune
entonnent une forme de requiem hilare. Le morceau « Mon anisette »,
d'un certain Albert Evrard, pourrait bien être le clou du show, qui voit une
fille passablement éméchée renoncer à tout, bijoux, toilettes, baisers même,
plutôt que d'abandonner le plaisir de siroter son petit verre de liqueur
favorite ! Dans le genre duo, « Cinéma », extrait de l'opérette
Madame de Henri Christiné, est pure malice : l'on
y apprend que la salle obscure est un
lieu propice, non à s'abandonner à la passivité de ce que l'écran dévoile, mais
à découvrir auprès de sa voisine ou voisin des choses bien plus captivantes : « Sans
y voir, Que d'chos's on peut savoir, Dans
l'noir! ». Tout cela est mis bout à bout dans un apparent désordre, une
décontraction certaine, à laquelle Alexandre Tharaud
se prêtera encore de bonne grâce pour délivrer quelques morceaux de Schönberg
ou de Satie, ou encore se livrer à des improvisations endiablées.
...comme dans son CD.
« Le
boeuf sur le toit. Swinging
Paris ». Musiques de Clément Doucet, George Gershwin, Walter Donaldson, Cole Porter, Nacio Herb Brown, Maurice Yvain, Alfred Bryan, Emmerich Kalman, Guiseppe Milano, Paul Segnitz,
Jean Wiéner, Howard Simpson, Serge Veber, Darius Milhaud, Maurice Ravel, Moe Jaffe, William
Christopher Handy. Alexandre Tharaud,
piano. Avec Frank Braley, piano, David Chevallier,
banjo, Florent Jodelet, percussion. Madeleine Peyroux, Juliette, Bénabard,
Natalie Dessay, Jean Delescluse,
chanteurs. Guillaume Gallienne, comédien. 1 CD Virgin
Classics : 509999 440737 2. TT.: 67'25.
Une
vraie pépite que ce CD ! Reconstituer en un peu plus d'une heure
l'effervescence des années Folles, et du mythique cabaret « Le bœuf sur le
toit », tel est le challenge en forme de gageure que s'est fixé le
pianiste Alexandre Tharaud. Pari réussi. La surprise
est de taille. Cela commence fort avec « Chopinata »
de Clément Doucet, sur des motifs de Chopin, où la ligne du maître polonais se
voit soudain brisée par un rythme de fox trot, irrésistible. Il en va de même
de « Hungaria », sur des thèmes de Franz
Liszt, ou encore de « Isoldina », inspiré
très librement de la Mort d'Isolde de Wagner : où le fameux chromatisme
s'encanaille de rythmes désopilants, à faire pâlir les fameux quadrilles de
Chabrier ! Tharaud enchaîne avec des morceaux de Jean
Wiéner, bien tournés, d'inspiration jazzy, nantis
d'une inimitable mélancolie claire (« Blues »). Dans « Clement's Charleston », le pianiste se double lui-même
aux onomatopées, « Yes, Aie, Ouille,etc...». Et puis il y a ces pièces de Gershwin, où
la nostalgie le cède à l'abandon. D'autres, en duo, immortalisées par le tandem
Wiéner-Doucet, jouées ici avec l'ami Frank Braley, ouvrent des horizons amusants. Ainsi de « Blue
River » ou « A little slow fox with Mary », qui swinguent fort endiablé. Dans le
registre de la prouesse, Natalie Dessay prête son
concours dans « Blues chanté » de Wiéner,
où la voix se fait trompette bouchée. Côté chansons, Juliette prête une
gouaille teintée de langueur à « J'ai pas su y
faire », de Maurice Yvain, une vision différente dans l'esprit de celle de
Jean Delescluse lors du concert parisien. Et
l'américaine Madeleine Peyroux évoque Cole Porter.
Dans le domaine du sketch, « Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes
? », tiré de l'opérette de Serge Veber, Louis
XIV, est grâce à Guillaume Gallienne,
étourdissant de cocasserie. Hormis les parodies citées, Ravel figure en bonne
place avec son « Five o'clock ». Comme Milhaud,
avec sa pochade « Caramel mou », conversation surréaliste, imaginée
par Cocteau, et alimentée par un Jean Delescluse
ébouriffant, accompagné de percussions façon cirque, et bien sûr, le tango du Bœuf
sur le toit. On ne s'ennuie pas un instant à l'écoute de ces musiques
entraînantes, voire délirantes, auxquelles Alexandre Tharaud
insuffle plus que de l'esprit, une âme.

Quand
Macbeth se décline dans le monde de la finance.
Giuseppe Verdi : Macbeth. Opéra en
quatre actes. Livret de Francecso Maria Piave. Evez Abdulla, Riccado
Zanellato, Iano Tamar, Kathlenn Wilkinson, Dmytro Popov,
Viktor Antipenko, Ruslan Rozyev, Kwang Soun
Kim, Jen-Frazçois Gay. Orchestre et Chœurs de l'Opéra
de Lyon, dir : Kazushi Ono.
Mise en scène : Ivo van Hove.

©Jean-Pierre Maurin
« Macbeth est une réflexion sur
le pouvoir », prévient le metteur en scène Ivo van Hove. Certes ! Et
d'ajouter qu'actuellement le pouvoir ressortissant plus à l'économique qu'au
politique, si Verdi avait composé cet opéra aujourd'hui, il « l'aurait
situé dans le monde de la finance », faisant des sorcières des conseillers
en communication. Beaucoup plus audacieux ! En tout cas, c'est sous cet angle
qu'il s'y attaque à l'Opéra de Lyon. Occasion pour l'illustre maison de
satisfaire à la tendance, si florissante, de relecture orientée des chefs
d'œuvre verdiens. Le coup est tenté avec brio. Mais parvient-il à bien élucider
le sujet ? Le recours massif aux projections vidéo, une des clefs bien connues
de cette approche, donne lieu à des images très mobiles, souvent indéniablement
parlantes. Ainsi de visualiser, tel sur un négatif
photo, ce qui se passe d'ordinaire en coulisses, savoir l'assassinat de Macduff dans sa chambre, et plus tard de Banquo et de son
fils Fléance, méchamment pris à partie dans un
parking sous-terrain. Mais n'est-ce pas trop capter l'attention, au détriment
de l'action littérale, comme il en va encore du foisonnement lancinant de
chiffres tourbillonnant à satiété, ou d'un environnement mouvant de grattes
ciel new yorkais ? Le vaste plateau a du mal à sembler habité durant les
premières scènes, alors que les Macbeth ourdissent leurs sanguinaires projets,
sous l'œil, au demeurant, d'une femme de ménage et de ses balais et torchons.
Ce témoin persistant, on n'en comprend pas trop l'importance dans la suite des
évènements. La direction d'acteurs, d'un grand sens théâtral, fait penser à la
manière de Dmitri Tcherniakov,
quoique sans l'implacable acuité caractérisant le travail du metteur en scène
russe. Mais l'idée de s'appuyer sur le mouvement des indignés pour décrire
l'oppression que vivent les écossais, tient plus de l'anecdote que de la
pertinence dramaturgique. Si la scène chorale du début du 4ème
acte s'avère poignante, largement par son impact musical, qui met en exergue
tel ou tel personnage, le dernier tableau, façon grand déballage de tentes sur
la Plaza del sol, n'apporte
que vision délibérément imposée à la conclusion, du triomphe sur l'oppression,
imaginée par Verdi. Reste que certaines scènes sont fort pertinemment disséquées.
Ainsi celle du somnambulisme, pierre angulaire de l'opéra. Lady Macbeth y
livrera son insondable détresse devant un Macbeth pétrifié d'effroi : elle
semble l'ignorer, s'en rapproche, mais l'évite, et refusera finalement la main
qu'il lui tend. L'aria suivante, d'un Macbeth en proie à une vindicte aussi
forte que vaine, est enchaînée, dans un saisissant raccourci. Se vérifie ce que
Freud avait décrypté (in « Ceux qui échouent devant le succès »,
extrait des « Essais de Psychanalyse appliquée ») : « la dure
instigatrice du crime devient une malade écrasée de remords, et le craintif
ambitieux un forcené sans frein ».

©Jean-Pierre Maurin
La
réussite est plus nette côté musical. Kazushi
Ono obtient de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon une sonorité résolument
verdienne, quant à la couleur et à l'articulation. Les ensembles sont tracés
avec panache, et les climats souvent envoûtants, tel le sentiment palpable de
désolation s'emparant de la scène chorale du IVème acte, déjà citée. Les
tempos mesurés, voire lents, impriment à l'ensemble ce qui peut d'abord
paraître comme de la prise de distance, mais devient vite, au fil de l'action,
volonté de dramatisation. Puisée en majorité dans le vivier des voix venues de
l'Est, la distribution réserve de belles surprises. A commencer par le Macbeth
de Evez Abdulla, originaire
d'Azerbaidjan. Voilà le timbre quasi idéal du baryton
Verdi, ce bonheur du chant d'opéra. Il le pourvoit d'un legato parfait et d'un
souci de respecter les innombrables nuances, notamment le chant « sotto voce », imposées par un auteur qui n'hésitait
pas à munir son premier interprète, Felice Varesi, de
cette consigne éloquente : « Je préférerais que tu serves mieux le poète
que le compositeur » ! La réserve de puissance est substantielle, et
l'interprétation dramatique extrêmement fouillée. Le ténor ukrainien Viktor
Popov est un Macduff de haut vol, qui lors de son
unique air de l'acte IV, déchaîne les applaudissements d'un auditoire
jusqu'alors hypnotisé par les excentricités de la scénographie. La géorgienne Iano Tamar possède la voix âpre et dure que Verdi lui-même
appelait de ses vœux pour incarner sa Lady. Capable de rudes envolées,
maîtrisant aussi un grand raffinement, sa composition est d'une présence toute
intériorisée, sans gestuelle inutilement outrancière, ce que Verdi abhorrait,
là encore. Le Banquo de Riccardo Zanelatto est
justement sonore, dans la lignée des grandes basses italiennes. Le Chœur de
l'Opéra de Lyon assure vocalement et avec une homogénéité louable sa fonction
de troisième personnage principal du drame. Il assume aussi sans barguigner les
partis pris de la régie, quelles que soient les diverses incarnations, des
sorcières en particulier, transformées pour la cause en vindicatives employées
de bureau.
Jean-Pierre Robert.
Riccardo
Chailly, superlatif ! Gewandhausorchester
Leipzig, dir. Riccardo Chailly. Lynn Harrell, violoncelle. Salle Pleyel.

Un des plus anciens orchestre du monde,
dirigé par son chef titulaire, Riccardo Chailly, dans
un programme exclusivement russe, associant le Concerto pour violoncelle n° 2 de Dmitri
Chostakovitch et la Symphonie n° 2 de Sergeï Rachmaninov.
Deux œuvres complexes rarement données en concert, ambigües, mêlant désillusion
et ironie pour la première, joie et mélancolie pour la seconde, nécessitant, de
la part du chef, une lecture particulièrement fine pour éviter de sombrer dans
le caricatural. Le chef italien fut à la hauteur de la tache par l’intelligence
de son interprétation et la justesse de sa réalisation. Le Concerto pour violoncelle n° 2 de Chostakovitch, est une des œuvres
les plus sombres du compositeur, empreinte d’une tristesse et d’une désolation
indicibles, conçue comme une illustration musicale de la mémoire,
le ramenant aux grandes purges staliniennes, bien que composée en 1966,
alors que le compositeur était alors reconnu et fêté comme « Héros du
travail socialiste ». Lynn Harrell sut en tirer
la quintessence par son jeu très intériorisé, tout en nuances, son toucher
subtil et sa sonorité exceptionnelle capable de faire entendre l’inaudible,
notamment dans ses pianissimo d’une rare tenue. Une introspection du soliste à
laquelle répondaient les éclats vifs et virtuoses des vents, ainsi que les
martèlements du xylophone d’une précision remarquable. En deuxième partie, la Symphonie n° 2 de Rachmaninov fut
l’occasion de juger de la qualité et de l’homogénéité exceptionnelles de
l’orchestre, tous pupitres confondus, ainsi que de la direction d’une rare
lisibilité de Riccardo Chailly dans cette œuvre
composée à Dresde, en 1906-1908, alternant lyrisme et mélancolie, cantilène des
bois (clarinette) sonnerie des cuivres (cors) et douceur des cordes, prenant
parfois la forme d’une romance pour orchestre où apparait en filigrane une
sorte de nostalgie tchékhovienne, à la
fois « prémonition et regret des choses
qui s’en vont et meurent doucement… ». Une soirée qui restera dans
les mémoires, un orchestre et un chef d’exception !
Patrice Imbaud.
Julian Rachlin et Itamar Golan à l'Auditorium
du Louvre
Quel beau duo, quelle belle entente. Ces
deux lituaniens se connaissent bien et cela s’entend. Générosité dans
l’interprétation, écoute mutuelle, on joue ensemble, et même si Rachlin était la star de la soirée, il était en osmose avec
le jeu de Itamar Golan, que nous avions déjà entendu,
seul, en récital à l’Auditorium. Julian Rachlin a une brillante carrière depuis plus de vingt ans,
et a joué avec les plus grands orchestres et chefs. Il est un des rares
interprètes qui s’exprime au violon et alto avec autant de talent. C’est le
violoncelle qu’il aurait aimé jouer ! C’est cette sonorité grave qu’il
aime. Alors, il aime la couleur sombre et chaude de l’alto. La création que lui
ont offerte le Louvre et Richard Dubugnon, Violiana pour violon, alto et piano, où il passe du
violon à l’alto, et de l’alto au violon, est une magnifique œuvre, dans
laquelle il a pu développer son jeu pleinement. Le concert avait commencé avec
une œuvre superbe et peu jouée de Britten, Lachrymae,
Reflections on a Song of John Dowland, pour alto
et piano opus 48, qui a électrisé le public.
Le programme proposé était une belle combinaison. Mais peut-être l’ordre
des pièces a-t-il fait que la Sonate en sol majeur op.96, de Beethoven, nous a
paru bien sobre, pour ne pas dire fade, tant nos oreilles étaient pleines de sonorités
originales et colorées. Un duo de choc et une soirée comme sait nous la
proposer Monique Devaux de l’Auditorium du Louvre. Nous aurons le plaisir de
réentendre Julian Rachlin, le 21 février prochain, au
Théâtre des Champs-Elysées avec l’ONF, dans le concerto pour violon de
Mendelssohn, sous la direction de Semyon Bychkov.
Marin
Alsop et Sol Gabetta au
Théâtre des Champs Elysées
©
wordpress.com
Voilà une soirée qui prouve que l'ONF, si
décrié, peut être à la hauteur des œuvres qu’il interprète, lorsqu’il est sous
la baguette d’un chef de caractère, et qui a un discours cohérent. Barber,
Haydn, Chostakovitch, un beau programme, éclectique, qui aurait dû séduire les
vrais amateurs de musique. Mais, hélas, la salle n’était pas totalement pleine.
Heureusement, beaucoup de jeunes étaient présents grâce à la politique
tarifaire menée par Radio France. Qu’est-ce qui a pu rebuter le public ?
Le choix des œuvres ? La maîtrise de la chef d’orchestre ? Le talent
de la jeune violoncelliste ? Cela restera un mystère. Tant pis pour eux,
ils ont raté une très belle soirée musicale et, occasion rare, animée par deux
femmes. L’américaine Marin Alsop, actuellement
directrice musicale du Baltimore Symphony Orchestra,
invitée par les plus grands orchestres
internationaux, est passée de Haydn à Chostakovitch avec une
concentration et une fermeté impressionnante. Le Second Essay
pour orchestre op.17, de Barber, est une belle musique
« hollywoodienne », qui était très bien pour nous mettre dans le
bain. Mais c’est surtout avec la 5éme Symphonie
en ré mineur, Op . 47, de Chostakovitch, que Martin Alsop était à son affaire. Avec une battue toujours en
avance, une manière de diriger, elle arrivait à tenir l’orchestre avec
intelligence. Bon, les cordes faisaient ce qu’elles pouvaient, mais tout cela
avait un sens musical, et le public l’a ressenti. Le Concerto pour violoncelle
N°1 de Haydn, interprété par la star montante de violoncelle, Sol Gabetta, fut un beau moment de virtuosité et de
sensibilité. Dommage que la salle des Champs-Elysées, qui aura toujours une
acoustique déplorable, ne l’ait pas aidée à se faire entendre dans certains
passages pianissimo. Merci d’avoir eu le talent d’avoir réuni ces deux femmes
pour cette soirée.
Kurt Masur et
Lars Vogt interprètent Brahms
©
toutelaculture.com
L’Orchestre National de France aime Kurt Masur, et le public du Théâtre des Champs-Elysées aussi.
Cela s’est senti tout au long de cette soirée Brahms. Kurt Masur,
se déplace lentement, du haut de ses 85 ans. Mais dès qu’il se trouve face à
son orchestre, dont il est directeur musical honoraire à vie, sans partition,
il le dirige de main de maître, et l’orchestre le suit. Pourtant, le premier
mouvement du Concerto pour piano et orchestre n°1 en ré mineur, opus 15, ne
donne pas satisfaction, ni à l’écoute, ni au pianiste Lars Vogt. Il est attaqué
mollement et avec une mise en place plus qu’approximative. Lars Vogt essaye
tant bien que mal d’y insuffler un peu plus d’énergie – il a l’habitude de
diriger de son piano – et ne se gêne pas. Masur,
caché par le piano, reste hiératique. Heureusement, les deux autres mouvements
du concerto, grâce principalement aux qualités « athlétiques » du
pianiste, entraînent l’orchestre à trouver un bon tempo. Le deuxième, plus
pianistique, et le troisième, survolté par le jeu de Vogt, font que le public
ovationne le pianiste. Avec la symphonie N° 2, op. 73, même problème : un début un peu brouillon, un
deuxième mouvement où l’on se cherche, puis un troisième et quatrième
magnifiques. Le public, là aussi, remercie vivement Masur.
L’orchestre est heureux d’être entre les mains tremblantes, mais précises, de
ce chef à la carrière « énorme ». On ne peut pas le lui reprocher.
Stéphane Loison
***
Haut
Le Ring de Barenboim-Cassiers
atteint Siegfried
Richard
WAGNER : Siegfried. Drame musical en trois actes. Deuxième journée du
festival scénique « Der Ring des Nibelungen. Poème du compositeur. Lance
Ryan, Peter Bronder, Terje Stensvold, Johannes Martin Kränzle,
Mikhail Petrenko, Irène Theorin, Anna Larsson, Rinnat Moriah. Staatskapelle Berlin, dir. Daniel
Barenboim. Mise en scène : Guy Cassiers.

©Monika Rittershaus
La
Tétralogie du Staatsoper de Berlin en arrive à sa
troisième partie, Siegfried. Comme constaté précédemment, c'est
l'orchestre qui tient la vedette. Les sonorités que Daniel Barenboim
tire de la Staatskapelle de Berlin sont rien moins
que glorieuses. De bout en bout, la coulée sonore est somptueuse, extrêmement
travaillée dans sa dynamique, comme déjà constaté lors des deux précédentes
journées (cf. NL de 12/2010 et de 5/2011) : un pppp,
à la limite de l'audible pour introduire le Ier acte, mais une farouche battue
à l'orée du IIIème. L'équilibre entre épique et lyrisme penche ici plutôt vers
le second, bien sûr. Passé le déchaînement haletant de la forge, Siegfried
n'est-il pas le moment pastoral du Ring ? Celui où l'évocation de la nature est
à son plus flatteur ? Il y a, bien sûr, les « Murmures de la forêt »,
non sollicités ici pour faire poétique, mais pas seulement. Combien d'autres
pages envoûtantes, tel ce sentiment de solitude qui s'empare de l'atmosphère,
après que Siegfried eût réglé son compte à Fafner,
puis à Mime. La patine de l'orchestre de la Staatskapelle
de Berlin atteint une dimension exceptionnelle, témoin du travail de fond mené
par le chef depuis des années. L'imposant duo final, avant sa péroraison
fiévreuse, aura mêlé en une rare alchimie moments de tendresse et de désespoir.
Une grande interprétation musicale décidément. Les chanteurs composent, là
encore, un plateau enviable. Le Siegfried de l'américain Lance Ryan est
décomplexé, et à cent lieues d'une tradition qui se voudrait pittoresque. Beau
héros, grand et fort, d'un incroyable naturel, voire dégingandé dans l'allure,
en particulier lors de la discussion oiseuse avec Mime. Sans fard, il l'est
tout autant vocalement, libérant une voix généreuse, lancée à pleins poumons
dans le chant de la forge, au risque d'un débordement de l'intonation. La ligne
de chant, qui fait penser à la ductilité italienne plus qu'au fort gabarit
wagnérien, se fera plus canalisée à l'acte suivant, et affrontera le duo final
sans vergogne. Le personnage tortueux de Mime, Peter Bronder
en fait un parangon vocal et théâtral. Justement nuancé, et bien différencié de
son héros protégé, sans succomber à l'outrance d'une composition grotesque. Terje Stensvold, le Wanderer, démontre, s'il en était besoin, combien les pays
du Nord sont un formidable réservoir de voix, apte à assurer la pérennité de la
vocalité wagnérienne : une voix de baryton-basse bien timbrée, possédant à la
fois assurance, plénitude et clarté, pour affronter les torrents du maître de
Bayreuth, mais aussi les nuances que celui-ci exige de son dieu défraîchi, lors
de l'échange avec Mime et la séance des questions inversées. Mais pourquoi
diable le gnome s'entête-t-il à poser ses trois questions, sur le même mode que
celui de l'inconnu, puisqu'il sait avoir affaire à plus fort que lui ?
L'abandon de la lutte, lors de l'ultime passe d'armes avec l'intrépide
Siegfried, est pitoyable, et l'interprète sait exactement l'illustrer. Johannes
Martin Kränzle répète son Alberich
justement teigneux, mais pas histrion, et la voix a cette noirceur haineuse qui dépeint ce sinistre
personnage. Mikhail Petrenko
apporte à Fafner toute la « sombritude »
de sa basse profonde, et Anna Larsson prête à
l'apparition d'Erda, au dernier acte, une aura de
grandeur. Il en va de même de la Brünnhilde de Irène Theorin, qui, justement, ne lâche pas trop tôt la voix :
l'échange avec Siegfried et le début du duo resteront mezza voce, à l'aune de
la détresse de la femme désormais dépouillée de ses attributs de déesse. Le
finale sera, bien sûr, grandiose, Barenboim libérant
toute la force incantatoire de son orchestre, au soutien de deux voix hors
normes.

©Monika Rittershaus
La
régie de Guy Cassiers est fidèle à ce qu'elle était dans les deux premiers
volets, d'une grande lisibilité. La
composante visuelle reste essentielle, pour illustrer un monde onirique, faite
de projections, le décor construit étant désormais réduit à sa plus simple
expression : un enchevêtrement métallique au Ier acte, un monticule quelque peu
encombrant, et délicat à escalader par ses deux protagonistes, lors de la scène
finale. Tout ici gravite dans un monde virtuel, façonné par la lumière, portant
l'accent sur le milieu naturel : une forêt grisâtre, de laquelle se détachent
quelques silhouettes, dont celle du Wanderer, muni de
son large chapeau à visière, l'intense rougeoiement de la scène de la forge,
avec ses incrustations d'éclats de métal, l'univers glacé d'un autre endroit de
la forêt, endormie dans un nuit profonde,
visualisés en gris métallique, lors de la confrontation entre le Wanderer et Alberich, au début de
l'acte II, ou encore la fascinante hésitation entre ombre et lumière, lors des
« Murmures », et l'apparition fantastique d'Erda
au début du III, qui semble venue des tréfonds, par une illusion de dilatation
de l'espace. Dans une pièce où les dialogues sont essentiels et prennent le pas
sur l'action, la direction d'acteurs est précise, et ne se dépare jamais du
souci d'expliciter simplement. La figure de Mime est ainsi est fouillée,
quoique sans s'appesantir sur l'anecdote, ou du moins, juste sur ce qu'il faut
pour illustrer un texte dont il n'est guère aisé d'échapper à la composante
naturaliste. Cassiers revient à ce qui avait fait l'originalité de L'Or du
Rhin, le recours à des figures dansées, pour composer des groupes
évocateurs ou souligner tel trait. Ainsi de l'attaque du dragon Fafner, qui de l'état de projection fantasmée, passe à
celui de masse effrayante, visualisée par une immense toile à pigmentation
animale, manipulée par quelques fantassins de l'horreur, ou encore de ce groupe
s'affairant autour du héros, alors que Mime s'entend à rien moins que lui
couper la tête : cinq danseurs, chacun muni d'une épée, réplique de Notung, forment d'étranges circonvolutions, avant de
figurer derrière lui une étoile de David. On les retrouvera à l'acte suivant,
précédant l'invincible jeune homme s'en allant braver l'univers, et dans son
insouciance, Wotan même, ou ce qui reste du dieu déchu. Belle idée aussi de
faire paraître sur scène l'Oiseau, sous la forme d'une belle jeune fille, prête
à guider le héros et à l'aider à démêler le vrai du faux, comme encore Fafner, qui dans un ultime sursaut de lucidité, saura
laisser libre cours à l'invincibilité de la jeunesse.
Récital Bernarda
Fink à la Petite Philharmonie

©Stefan Reichmann
En
ces temps de pression médiatique, presque éhontée, un récital de la chanteuse Bernarda Fink est un vrai bonheur. Car celle-ci ne se
compte pas au nombre des stars au palmarès envieux, et ne souhaite d'ailleurs
pas y figurer. Non, les qualificatifs qui viennent à l'esprit sont la musique
pure et l'intelligence du texte. Simplement, et combien sûrement. Son
programme, à la Kammermusiksaal, réplique, en plus
réduit, de la Philharmonie, convoquait Schumann, Mahler et Dvořák.
De quoi expliciter les qualités d'un timbre chaud et ductile, et d'une interprétation
toujours pénétrante. Moins célébré que L'amour et la vie d'une femme, le
cycle des Six poèmes d'après Nikolaus
Lenau, op. 90, date de 1850. Une étrange mélancolie en émane, qui les situe
dans l'esprit du Liederkreis, notamment dans
l'avant dernier, « Einsamkeit » (Solitude),
d'une douleur contenue, ce que renforce le long soliloque du piano. La mélodie Requiem,
op 90a, fait office d'épilogue, bouleversante, où une femme pleure et prie. La voix de mezzo-soprano de Bernarda Fink lui autorise Dvořák,
et ses tonalités sombres. Ainsi les Quatre Lieder de l'op. 2 et, plus encore,
le quatuor des Lieder Im Volkston, op. 73
(dans le ton populaire), tirés de poèmes slovaques et tchèques. Si l'op. 2,
composé en 1881/1882, contemporain des Légendes pour orchestre, reste
encore d'une expression simple, quoique la liberté métrique y soit notable,
déjà se profilent de subtils accents proches de la musique populaire. Le 3ème lied, « Mon cœur est souvent empli de douleur »,
annonce l'invocation à la lune, fameux air de l'opéra Rusalka,
ce que l'interprète rappelle avec conviction. L'op 73 est plus élaboré dans son
esthétique vocale, alliant raffinement de la versification et authenticité
populaire. Il est le pendant vocal des Danses slaves pour orchestre. A
la naïveté des textes répond une poésie profonde. Bernarda
Fink en livre la pureté et la fraîcheur. Les pièces de Gustav Mahler la
trouvent naturellement à l'aise. D'abord, dans le lied de jeunesse, « Frühlingsmorgen » (Matin de printemps), dont la
délicate broderie du piano est plus qu'un hommage à Schumann, ou dans deux
extraits du Knaben Wunderhorn.
La ballade « Das irdische
Leben » (La vie terrestre) construit tout un petit drame, au-delà d'une
naïve idylle, un « conte cruel », quasi lugubre, d'une inexorable
progression, parsemé d'âpres dissonances. L'approche est dans le ton populaire,
qui multiplie les manières archaïques et fait dominer le diatonisme. « Das himmlische Leben » (La
vie céleste), dont le matériau sera repris au finale de la IVème symphonie, conduit l'auditeur au paradis : un éloge de la
musique, empli de joie et de tendresse. Le concert se conclut avec les Lieder
eines fahrenden Gesellen (Chants du compagnon errant), composés en
1884/1885. Préfiguration des Wunderhorn Lieder, et de
leur ton populaire, ces quatre chants, de leurs émotions à fleur de peau et
leur joliesse textuelle, distillent pourtant des abîmes de lyrisme. Le sombre,
le nonchalant le cèdent au tragique (3ème lied) et au lugubre, évocateur d'une
insondable tristesse (dernier morceau). Mahler est déjà ici à son plus
poignant, dans ce qui passe pour ses premiers joyaux dans le domaine du Lied. Bernarda Fink aborde ces climats envoûtants avec une
simplicité naturelle, que son pianiste, Anthony Spiri,
pare des plus belles sonorités. Deux mélodies de Schumann, en bis, dont le
poétique « Das Sandmann »
(Le marchand de sable), achèvent une soirée décidément placée sous le signe
d'une musicalité consommée.
Les Berliner
en terres baroques

Pour
un de leurs concerts d'abonnement, les Philharmoniques berlinois accueillaient,
cette fois dans le grande salle de la Philharmonie, le
chef Andrea Marcon, spécialiste, entre autres, de
Vivaldi. L'occasion de s'aventurer en des terres peu fréquentes pour eux.
Divisée en deux parties, la soirée proposait d'abord plusieurs pièces
instrumentales du Prete rosso.
Marcon fait le choix d'en donner de peu connues, puisées
dans la vaste production des « concerti con molti
istromenti », manière de mettre en valeur les
qualités des premiers pupitres de l'orchestre. Ainsi le concerto grosso, RV
562a, pour violon solo, deux hautbois, deux cors, timbales, cordes et basse
continue, offre-t-il une brillante introduction en fanfare, un second
mouvement, marqué « grave », en forme de largo hypnotique, et une
belle cadence du violon solo dans l'allegro final. Le jeu du Konzertmeister Andreas Buschatz
est immaculé, même si l'accompagnement de Marcon
paraît un peu lymphatique. Le concerto RV 576, « per Sua Altezza Reale di Sassonia », pour violon solo, hautbois solo, deux
flûtes traversières, basson, cordes et
basse continue, fait partie de l'ensemble des concertos écrits pour l'orchestre
de Dresde, et constitue un hommage au Roi Frédéric Auguste II. Il emprunte sa
virtuosité violonistique au célèbre vénitien Johann Pisandel.
Ses deux mouvements extrêmes seront très enlevés par Andrea Marcon
qui choisit, ici comme ailleurs, de ne jouer ni carré ni heurté, comme bien de
ses confrères, au risque de paraître un brin terne. Le hautbois de Albrecht Mayer partage la vedette avec le violon. Il
revient à Emmanuel Pahud de mener au triomphe le
concerto RV 439, dit « La Notte », un des
plus célèbres morceaux vivaldiens : son alternance lent-vif, au fil de ses six
parties, est un constant ravissement pour l'oreille, relevé par la sonorité
éthérée de la flûte traversière, ou « flûte douce ». Celle de Pahud embellit le texte à chaque phrase, en particulier au
second largo, sous-titré « Il sonno » (le
songe). Cette première partie se clôt sur le concerto RV 569, pour violon solo,
deux hautbois, deux cors, basson, violoncelle, cordes et basse continue, tiré
aussi du répertoire de Dresde : une combinaison aussi originale que séduisante,
surtout sous les doigts de tels solistes. Changement d'atmosphère avec le Gloria,
RV 589, une des grandes partitions sacrées de Vivaldi. Écrite pour les
demoiselles de l'Ospedale della
Pietá, entre 1713 et 1715, elle comprend douze
parties contrastées. Elle s'orne de deux solistes, soprano et mezzo-soprano.
Qui dit Venise, dit aussi théâtre, et donc opéra. La partition de Vivaldi
n'échappe pas à cette proximité, dans l'instrumentation, trompettes et hautbois
voisinent avec les cordes, comme pour ce qui est de la distribution des
numéros, chœurs, duos, arias solos, enfin dans le climat qui y règne :
mouvements joyeux, au début notamment, car y domine l'allégresse de l'hymne au
créateur, puis section pathétique lors du solo de l'alto au « Domine Deus
Agnus Dei », sur le contrepoint du chœur, voire, peu avant, la quasi
sensualité de la section, en forme de sicilienne, du « Domine Deus Rex Coelestis ». On est là dans le baroque triomphant, ce
que la double fugue finale achèvera de souligner. Vivaldi ne s'y montre pas
parcimonieux. L'interprétation de Andrea Marcon est inspirée, sans excès là encore, profondément
pensée. Le RIAS Kammerchor apporte une sûre pureté
vocale aux diverses interventions chorales, tout comme les deux solistes, Lisa Larsson et Marina Prudenskaja.
Quant à l'orchestre, dans une formation restreinte, il est suprêmement raffiné
et sonne comme si Vivaldi était son ordinaire. De nouveau, ses solistes,
Albrecht Mayer en particulier, brillent magnifiquement.
Jean-Pierre Robert
***
Haut
FORMATION
MUSICALE
Joelle
ZARCO & Valérie ROUSSE : L’oreille
en boucle. Une approche de l’oreille harmonique par le sensoriel. Cahier
d’exercices. Vol.1. 2 vol (cahier de l’élève – corrections) – 1 CD.
Lemoine : 29070 H.L.
Comment dire mieux que les auteurs le
projet de cet ouvrage : « Dans le processus d'apprentissage il est un
écueil que nous avons tous un jour rencontré : comment former une oreille
harmonique ?! Bien sûr, il existe bon nombre d'élèves possédant une oreille
naturelle et qui se développe sans rencontrer de réelles difficultés... mais
les autres ? Tous ceux qui n'ont pas l'habitude de chanter, tous ceux pour
qui une hauteur de son ne correspond à rien, et qui paniquent dès qu'ils ont un
crayon à la main et une portée vierge devant les yeux ?
C'est en pensant à ces élèves-là que nous
avons décidé de proposer une approche plus douce, presque
"homéopathique" à travers un travail au départ uniquement sensoriel
puis, au fil des ouvrages, une progression dans le codage jusqu'à aboutir au
"Saint Graal" des musiciens : "repiquer" un accord en temps
réel ! ».
Comment ne pas faire sien ce projet ?
Et il faut dire qu’il est mis en œuvre par deux pédagogues qui manifestement
connaissent le problème. Ajoutons que cet ouvrage pourra être utilisé avec
profit par des élèves en difficulté et livrés à eux-mêmes, enfants ou adultes.
Le CD permet vraiment un travail personnel tout à fait progressif. Bien sûr, il
est indispensable de ne sauter aucune étape : le travail « acquis par
acquis » est tout à fait indispensable.

Christian
BELLEGARDE : Au fil de l’écriture. 70
textes en 3 recueils des accords de trois sons aux styles d’auteurs. 2ème
recueil. 1 vol textes, 1 vol réalisations. Billaudot :
G 9303 B et G 9304 B.
Nous avons recensé dans notre lettre 61 de
juillet dernier le premier volume de cette collection. Le deuxième est consacré
aux basses et chants donnés sur les notes étrangères et aux chorals dans le
style de J.S. Bach. Rappelons que ce genre de travail n’a de sens que s’il est
fait, comme le rappelle l’auteur, avec « l’oreille intérieure ». Ce
n’est pas en appliquant des règles, aussi nécessaires soient-elles, qu’on
progresse en musique. La matière ici fournie mérite d’être étudiée et… apprise
par cœur. L’oreille intérieure est nourrie d’abord par la mémoire, ne
l’oublions pas !


ORGUE
Johann
Sebastian BACH : Chaconne pour violon adaptée au grand-orgue
par Henri Messerer (1838-1923). Delatour :
DLT1267.
On aime… ou on n’aime pas ! Mais on ne
peut s’empêcher de reconnaître que cette transcription a été fort bien réalisée
par celui qui fut pendant cinquante ans le titulaire du grand Cavaillé-Coll de
l’église Saint-Charles de Marseille.

PIANO
Albert
LAVIGNAC : Galop-Marche à 8
mains sur un seul piano. Lemoine : 26512 H.L.
Cette joyeuse pièce de 1898 a été depuis
quelques années abondamment jouée (voir You tube). Et il faut bien dire qu’elle
n’engendre pas la mélancolie ! Les éditions Lemoine en donnent ici une
nouvelle gravure tout à fait adaptée, y compris, bien entendu, pour les
« tournes ». Ce sera une bonne occasion de faire faire à nos
pianistes de la musique d’ensemble. Ne nous y trompons pas, ce n’est pas
vraiment facile… mais tellement réjouissant ! A jouer sans modération.

Olivier
d’ORMESSON : Quatre miniatures pour
piano. Assez difficile. Delatour : DLT1972.
Bien que constituant un tout, ces quatre
miniatures peuvent se jouer séparément.
Brèves et énigmatiques, elles créent une ambiance sonore faite de
résonnances entretenues mais aussi de staccatos rigoureux. On aura intérêt pour
les interpréter à méditer les titres évocateurs qui leur donnent tout leur
sens.

VIOLONCELLE
Francine
AUBIN : Concerto pour
violoncelle et piano. Fin de 3ème cycle. Sempre
più : SP0013.
Cette œuvre de près de trente minutes
comprend trois mouvements et se déroule dans un langage lyrique très
intéressant. Un court extrait peut être écouté sur le site des éditions où l’on
peut également consulter trois pages de l’œuvre.

CONTREBASSE
Daniel
MASSARD, Véronique LAFARGUE : Balades
en duo. 11 pièces faciles pour 2 contrebasses. Combre :
C06752.
Trois parties dans ce recueil : Carrousel – Danses italiennes – Chansons
russes. On voit par là que le propos des auteurs est de susciter l’intérêt
des élèves par la variété des caractères. Ils y réussissent pleinement. Ces
onze petits tableaux sont fort bien écrits et fort agréables à entendre. Voilà
de quoi encourager les jeunes contrebassistes.

FLÛTE
Ernesto
KÖHLER (1849-1907) : La Perle du
Nord pour flûte et piano. Restitution : Philippe Lesgourgues.
Fin de 2ème cycle. Sempre più :
SP0024.
Poursuivant sa politique de remise au jour
d’un répertoire méconnu de la fin du XIX° siècle, cette maison d’édition nous
propose cette Perle du nord lyrique à
souhait comportant un Andante sostenuto qui s’enchaine avec un Adagio melanconico puis après une cadence avec un Allegro moderato
et se termine par un vivo con bravura tout en
triolets endiablés. Cette œuvre d’un compositeur aujourd’hui surtout connu des
flûtistes pour ses ouvrages pédagogiques mérite vraiment de sortir de l’oubli.

Wilhelm
POPP (1828-1903) : Petit
vaurien pour flûte et piano. Deuxième cycle. Restitution : Philippe Lesgourgues. Sempre più :
SP0025.
De la même époque que la précédente, cette
pièce-ci est plutôt une fantaisie destinée à mettre en valeur la virtuosité du
flûtiste. Malgré l’inévitable passage romantique, elle est surtout pleine
d’entrain et fait honneur à son titre. Les interprètes pourront s’en donner à
cœur joie.

HAUTBOIS
Henri
MESSERER (1838-1923) : Lied pour
hautbois et piano. Niveau moyen. Delatour :
DLT1293.
Très lyrique, cette œuvre s’inscrit dans
l’orbite de César Franck qui fut un de ses modèles. Modéré et très expressif,
c’est le caractère que l’auteur donne à sa pièce même si des élans plus
fougueux l’animent à certains moments. C’est en tout cas une musique attachante
et qu’il convient de redécouvrir.

CLARINETTE
Charles
BALAYER : Ebony breath pour
quintette de clarinettes. Niveau moyen. Delatour :
DLT1993.
Cette ballade à la fois charmante et
mélancolique est écrite pour 3 clarinettes en sib, cor de basset (ou à défaut, clarinette basse) et clarinette
basse. Un chorus en forme de bossa-nova fait dialoguer les deux premières
clarinettes. Ajoutons que le site permet maintenant d’entendre en les suivant
sur la partition un certain nombre de pièces dont celle-ci. Voici une
initiative très intéressante des éditions Delatour.

SAXOPHONE
Timothy
Hayward : 7 Rêveries pour
saxophone alto et piano. Niveau moyen. Delatour :
DLT0927.
Le monde de Timothy Hayward côtoie aussi
bien le classique, le baroque que le jazz. C’est le cas de ces sept rêveries
qui offrent des caractères très divers, et qui se révèlent plus séduisantes les
unes que les autres. Ces pièces, si elles ont été conçues pour de jeunes
saxophonistes qui en tireront le plus grand profit, méritent de figurer au
répertoire des saxophonistes pas seulement en herbe.
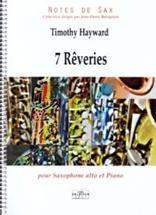
Michel
CHEBROU : Joliton pour saxophone alto et piano.
Préparatoire. Lafitan : P.L.2395.
Cette jolie romance se déroule dans une
atmosphère qui rappelle les salons du XIX° siècle, ce qui n’est pas une
critique, bien au contraire. Il faudra que l’interprète fasse preuve d’un
phrasé sans mièvrerie ainsi que de beaucoup de distinction. Ce n’est pas si
facile…

Francis
COITEUX : Le cortège des fourmis pour
saxophone alto et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2404.
Nos petites fourmis sont bien
espiègles ! Leur marche, d’abord tranquille va s’accélérant. Cette fois,
le joli son devra être accompagné d’une agilité certaine dans les notes
répétées. Quoi qu’il en soit, voilà une pièce pleine de charme et
d’espièglerie.

Fabrice
LUCATO : Mon premier saxo pour
saxophone alto et piano. Débutant. Lafitan :
P.L.2361.
Voici une bien
agréable manière de débuter le saxophone. De forme ABA, cette jolie pièce
bénéficie d’un discret mais dialoguant accompagnement de piano facilement
abordable par un jeune pianiste. Qu’y a-t-il de mieux que d’inciter les élèves,
dès le début de leurs études, à la musique de chambre ?

TROMPETTE
Gérard
LENOIR : Va d’un bon pas ! pour trompette sib ou ut ou cornet et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2222.
Voici un titre qui rappelle une chanson
scoute « La belle fille », la fille en question étant la route… Le rythme
de cette joyeuse marche rappelle d’ailleurs celui de la chanson !
Réminiscence ou pas, cette marche est bien entraînante et le jeune trompettiste
ne risque pas de s’endormir en route.

Gilles
MARTIN : Trompettuoso ! pour
trompette sib ou ut, ou cornet ou
bugle sib et piano. Fin de premier
cycle ou début deuxième. Lafitan : P.L.2387.
Après une introduction de quatorze mesures
andante, la trompette se déchaîne littéralement pour terminer dans un
« jazzy » en « ternaire » qui « balance » comme
il convient ! Cette pièce fait donc preuve d’un caractère certain que
l’interprète devra assumer « trompettuoso » !

Michel
NIERENBERGER : Remember Toulouse pour trompette ou cornet ou
bugle et piano. Fin de premier cycle. P.L.2410.
Il n’est pas interdit de penser que le
titre a un rapport direct avec le dédicataire, professeur au CRR de Toulouse…
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une œuvre à la fois délicate et exigeante
comportant de nombreux changements de caractère et de mouvement, et qui fait
également la part belle au piano, véritable partenaire. C’est quasiment une
véritable œuvre de concert… ou d’examen !

André
TELMAN : Le Génie malicieux pour
trompette ou cornet ou bugle et piano. Fin de premier cycle. Lafitan : P.L.2543.
On ne sait si le jeune trompettiste goûtera
les malices du génie. Il aura en tout cas fort à faire, mais pour un résultat
bien agréable à entendre. Tantôt taquin tantôt tendre, notre génie ne manque ni
de grâce ni de charme.

TROMBONE
Benoît
BARRAIL : Le chemin des vacances pour
trombone et piano. Débutant. Lafitan : P.L.2408.
Le titre suggèrerait de faire jouer plutôt
cette pièce en fin d’année… C’est en tout cas joli, musical, pas simplet, et ce
n’est pas facile de composer des pièces pour débutants. Voici cependant une
jolie réussite qui devrait combler le jeune tromboniste.

Rémi
MAUPETIT : Si j’avais des ailes pour
trombone et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2462.
Il est difficile, en voyant ce titre, de ne
pas chantonner : « Si j’avais des ailes, de petites ailes… » en pensant à Ouvrard. En fait, il n’y a sans doute aucun
rapport ! Cette jolie pièce un peu chaloupée devra être jouée avec
beaucoup de grâce et de légèreté. Et
pour cela, mieux vaut penser à Kate qu’à Ouvrard !

COR
André
GUIGOU : Evocation pour cor en
fa ou mib
et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2416.
Commençant par un moderato soutenu dans la nuance piano, cette « évocation » évolue vers un
« tempo più vivo » beaucoup plus agité dans des rythmes plus heurtés,
et se termine par une sorte de fanfare. Beaucoup de variété, donc, dans cette
pièce qui demande au corniste de jouer de toutes les ressources de son
magnifique instrument.

Charles
BALAYER : Du Jazz encore et en
cor ! pour 4 cors en fa et piano (ou section
rythmique). Assez difficile. 1 vol. 1 CD. Delatour :
DLT1992.
Cette pièce de jazz swing à 5/4, est
composée d’un thème récurrent et de chorus écrits mais qui peuvent être
également improvisés. Le CD contient à la fois l’œuvre intégrale, le play-back
et un bonus qui est Á cors parfaits, recensé
ci-dessous. Très agréable et intéressante à entendre, cette œuvre, malgré sa
difficulté, qui est certaine, devrait faire le bonheur des ensembles de cors.

Charles
BALAYER : Á cors parfaits pour 4
cors en fa et piano (ou section rythmique). Assez difficile. 1 vol. 1 CD.Delatour : DLT1552.
Cette fois, c’est du jazz-rock que nous
propose cet auteur. Disons tout de suite que la main gauche du piano peut être
jouée par une guitare basse. Le CD est composé de l’enregistrement intégral et
du play-back et d’un bonus qui n’est autre que la pièce recensée ci-dessus.
Chaque corniste possède son chorus écrit, mais qui peut être aussi improvisé.
C’est une pièce exigeante mais bien intéressante par son côté nostalgique.

Pascal
PROUST : Le petit Kopprash. 25 études pour cor de moyenne difficulté
d’après les Etudes op. 5 et 6 de
Georg Kopprash. Sempre
più : SP0039.
Pascal Proust a retravaillé pour le cor
moderne 25 des nombreuses études écrites pour le cor au début du XIX° siècle
par ce corniste et compositeur, en même temps que brillant pédagogue. Ajoutons
qu’elles peuvent toutes être transposées dans les tonalités les plus usitées (mib, ré, sol…). On ne peut qu’encourager
cette pratique si formatrice !

François
BRÉMOND : 1er solo pour
cor avec accompagnement de piano. Restitution : Pascal Proust. Niveau 3ème
cycle. Sempre più : SP0029.
François Brémond
(1844-1925) fut avant tout un instrumentiste. Il composa essentiellement des
pièces pédagogiques. Ce 1er
solo en est un excellent exemple. Comportant à la fois des passages
brillants et d’autres plus tendres, il se présente en fait comme un
mini-concerto en trois mouvements : un Allegro moderato, un Andante et un
Final. Toutes les possibilités de vélocité et d’expression de l’instrument y
sont tour à tour sollicitées. Voici une pièce fort
intéressante aussi bien pour une audition que pour un examen.

Jean
Baptiste MOHR : 3ème solo op. 8
pour cor avec accompagnement de piano. Restitution : Pascal Proust. Niveau
3ème cycle. Sempre più : SP0028.
J.B. Mohr (1823-1891)
est également essentiellement un instrumentiste. Ce mini-concerto comporte
quatre mouvements : Maestoso, Larghetto à 6/8 en forme de Sicilienne, puis
un Allegretto, et se termine par un Allegro maestoso. C’est une musique très
tonique et qui ne manque pas de charme. L’interprète pourra y déployer toutes
ses possibilités à la fois techniques et expressives.

MUSIQUE
D’ENSEMBLE
Charles
BALAYER : Funny jazzy pipes pour quintette à vent.
Assez difficile. Delatour : DLT 1261.
Flûte, hautbois, clarinette cor et basson,
après exposition d’un thème écrit sur un rythme de « middle swing »,
se partagent des « chorus » écrits. Le tout se termine par un
« stop chorus en tutti. Inutile de préciser que cette pièce pleine
d’entrain n’engendre pas la mélancolie.

Charles
BALAYER : Ti bout créole pour
quatuor de flûtes et piano (ou section rythmique). 1 vol 1 CD. Delatour : DLT 0926.
De niveau assez difficile, ce quatuor,
écrit sur un thème de biguine lente, est composé de chorus écrits mais qui
peuvent être aussi improvisés. La quatrième flûte sera de préférence une flûte
en sol. En cas d’interprétation avec section rythmique, la main gauche du piano
sera jouée par la contrebasse. Le CD comporte à la fois la pièce et le
play-back ainsi que deux pièces éditées également par les éditions Delatour. Ajoutons
que cette œuvre un peu nonchalante est vraiment pleine de charme.

MUSIQUE
CHORALE
Daniel
Roth : Missa Festiva
« Orbis Factor ». Compositeurs
Alsaciens Volume 28. Delatour : DLT1979.
La messe « Orbis
Factor » qu’on alternait avec la « Missa de Angelis »…
Quel plaisir de la retrouver dans ce solennel écrin que lui a réalisé Daniel
Roth. Si la partition s’épanouit dans un environnement grandiose, avec dialogue
entre l’orgue de chœur et le Grand Orgue, elle trouvera aussi sa place dans des
vaisseaux plus modestes, les deux parties d’orgue pouvant être réunies.
L’intégralité de la Messe grégorienne se retrouve donc, chantée en alternance
par le Chantre, l’assemblée et le chœur et commentée par de brèves interventions
du Grand Orgue. A quand un enregistrement de cette œuvre tout à fait
intéressante et pleinement dans l’esprit du Grégorien, donnée récemment au
Festival de Masevaux en première audition en Alsace ?

JANÁČEK :
Mša glagolskaja
(Messe glagolitique) Voix et piano. Bärenreiter :
BA 6862-90.
L’édition de cette œuvre magistrale et qui
comporte plusieurs versions était une gageure que les éditions Bärenreiter se sont efforcées de relever avec succès. La
préface en décrit les difficultés et les solutions apportées. On se réjouira
donc d’avoir désormais cette édition critique pour exécuter cette œuvre de tout
premier plan. Le conducteur est en vente mais le matériel d’orchestre est en
location.

Davide
PERRONE : Beata pour 3 sopranes,
sopraniste ad lib. Ou soprano solo et mezzo-soprane. Delatour : DLT1262.
Composée à partir d’une pièce grégorienne
de l’Hymnaire de Nevers de 1239, cette œuvre, même si elle demande évidemment
des chanteurs expérimentés, n’est cependant pas très difficile. Elle déroule un
discours polyphonique qui s’épanouit jusqu’à un tutti final en crescendo pour
terminer par un fortissimo sur octaves et quinte. L’ambiance grégorienne est
omniprésente.

ORCHESTRE
D’HARMONIE
Christian
ESCAFFRE : Marche de la Garde
d’Honneur en l’honneur de l’avènement de S.A.S le prince Albert II de
MONACO pour orchestre d’harmonie. Moyenne difficulté. Delatour :
DLT2072.
L’auteur n’est autre que le chef de la
fanfare des carabiniers de Monaco. Cette œuvre fut donc composée tout
spécialement pour l’avènement du Prince. Elle a évidemment un caractère
solennel, conforme à l’évènement et cite d’ailleurs l’hymne national
monégasque.

André
ISOIR : Tango pour orchestre
d’harmonie. Arrangement et orchestration de Christian Escaffre.
Delatour : DLT0877.
Nous avons rendu compte, dans la lettre 63
d’octobre 2012, de l’arrangement pour contrebasse de cette même œuvre. Elle
convient fort bien à un orchestre d’harmonie et a été fort bien arrangée et
orchestrée par le chef de la fanfare des Carabiniers de Monaco.

Daniel Blackstone.
• Sylvie DOUCHE
(éd.) : Maurice EMMANUEL: Amphitryon.
Musique de scène d’après Plaute. Paris, Presses de l’Université Paris-sorbonne (http://pups.paris-sorbonne.fr), Coll. Musique-écritures/Études, 2012,
213 p. -22 €.
Le compositeur Maurice Emmanuel
(1862-1938), spécialiste notamment de musique grecque, était souvent mentionné
par Jacques Chailley dans ses cours. C’est le mérite de ses enfants,
Marie-Noëlle et Dominique, d’avoir remis le matériel d’archive qui, selon
Sylvie Douche, « fut d’un secours inestimable dans l’élaboration de cet
ouvrage, tout comme les documents relatifs à Roland Barthes qui, grâce à
Michel Salzedo, ont pu être exploités ». Après
R. Barthes, J. Chailley s’était à son tour investi dans le « Groupe de
Théâtre antique de la Sorbonne » fondé par G. Cohen, pour faire revivre le
théâtre médiéval sous tous ses aspects avec Les Perses, tragédie d’Eschyle, puis Amphitryon, comédie latine de Plaute (mort à Rome en 184 av. J.
C.). La musique de scène de M. Emmanuel restée inédite fait l’objet de la
présente édition par S. Douche ; elle relate la genèse de l’œuvre, précise
les données d’analyse de la partition « habilement dosée » et
« remplissant son rôle dramatique », sans oublier les « gestes
théâtraux significatifs » à l’appui de nombreux exemples. Les textes de
la version de concert établi par J. Chailley (p. 43-48) et de la version scénique
(p. 49-102) sont étayés de 6 documents iconographiques du plus haut intérêt (conservés
au Département des Arts du spectacle, BnF). Le
lecteur trouvera également des extraits de presse relatifs à Amphitryon, ainsi que les choix
éditoriaux à partir de deux exemplaires (l’original et celui du copiste M.
Jacob) et le relevé des variantes. La partition est reproduite (p. 136-188)
avec grand soin (saisie musicale informatique : Andriana
Soulele). Ce remarquable volume, à l’initiative de S.
Douche, comblant une lacune dans les domaines littéraire antique, théâtral,
scénique et musical, mérite les plus vifs éloges.

Édith Weber.
***
Haut
Ariane
CHARTON : Debussy.
Gallimard. Collection Folio, Biographies. 10,8 x 17,8 cm. 335 p, 8,10 €.
Voici une très belle biographie, à petit
prix, qui va à l’essentiel ! Passionnante de bout en bout, parfaitement
écrite, très bien documentée, étayée par des citations et une correspondance
pertinente, judicieusement choisie. Un texte clair, quelques illustrations, des
notes et références bibliographiques
abondantes auxquels s’ajoute un
catalogue des œuvres intégré dans une chronologie succincte. Un livre
indispensable en cette année 2012 où l’on célèbre le 150e
anniversaire de la naissance de Claude Debussy (1862-1918).

Patrice Imbaud.
Musique et Arts plastiques :
interactions. Actes du séminaire doctoral et postdoctoral réunis et édités par Michèle
Barbe et Laure Bazin Carrard. Université
Paris-Sorbonne, Observatoire Musical Français (http://www.omf.paris-sorbonne.fr ), Série : Musique et Arts plastiques, n°8,
2011, 220 p.
Ce 8e Volume de La Série Musique et Arts plastiques, créée à
l’initiative de Michèle Barbe, représente un témoignage éloquent des activités
très variées de son séminaire doctoral et postdoctoral : Musiques et arts plastiques :
interactions. Il aborde des recherches dans la longue durée (XVIe-XXe
siècles) et traite des œuvres concernant un vaste espace géographique allant de
l’Europe et la Russie jusqu’à la Chine et aux États-Unis. La démarche intradisciplinaire fait appel à l’esthétique comparée, à la
traduction intersémiotique et aux représentations plastiques de la musique, à
travers des objectifs comparatiste, analytique et
herméneutique. Présentés autour de trois axes de recherche : « esthétique
comparée », « traduction intersémiotique » et
« iconographie musicale », ces Actes
regroupent 13 articles très denses, d’auteurs français et étrangers abordant
aussi bien le jeu de la cithare Qin (chinoise) que des problématiques musicales
autour de Claudio Merulo, Vincent d’Indy, Francis Poulenc, Beethoven (dans
l’œuvre de Ceri Richards), Berlioz,
Stravinski… ; des peintres : Matisse, Fantin
Latour ; des édifices : Palais
Farnèse… ; ou des mouvements d’idées : Romantisme, Cubisme…, que des
concepts de « combat », de « perception visuelle et
picturale ». Le contexte iconographique (notamment de représentations
d’instrumentistes d’Ian Vermeer, gravures de Fantin Latour) est très révélateur de l’ampleur de la démarche, de
même que les Tableaux synoptiques. De très utiles résumés (bilingues) et un Index imposant contribuent également à
l’intérêt de ces axes des recherches transdisciplinaires, actuelles et
d’envergure internationale. La perceptibilité et l’intelligibilité des œuvres
plastiques, poétiques, musicales se trouvent renforcées par ces contributions
placées, entre autres, selon l’expression de M. Barbe, sous le signe de
« la traduction d’un art par un autre ».

Édith Weber.
Agnès TERRIER & Alexandre DRATWICKI : Le surnaturel sur la scène lyrique, du merveilleux
baroque au fantastique romantique. Préface de Jérôme Deschamps. Editions
Symétrie & Palazzetto Bru Zane. Série Musique
romantique française, 17x24 cm, 360 p, 81,60 €.
« Le merveilleux d'opéra est un 'vrai'
monde qui n'existe pas », remarque, en forme de paradoxe, Catherine Kintzler. Fruit de deux colloques organisés par l'Opéra Comique et le Centre de musique romantique française Palazzetto Bru Zane, cet ouvrage se propose d'analyser
l'influence du surnaturel sur la scène d'opéra. Qu'il s'agisse du merveilleux
de l'époque baroque ou du fantastique célébré par le romantisme, le surnaturel
a pour dessein de distraire le public, à la fois dans les sujets traités et
dans la manière de les représenter sur scène. A première vue, les notions
d'étrange, de fantastique, de merveilleux, paraissent proches. Et pourtant, question
définition, les différences ne sont pas négligeables. Ainsi, le fantastique,
qui a vocation à impressionner le spectateur, n'est pas nécessairement lié au
terrifiant. S'il nous vient pour beaucoup de la littérature allemande, et a
pour acte fondateur musical Der Freischütz de
Weber, sa formulation, en France, peut revêtir des formes bien différentes,
comme dans Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach ou Robert le Diable
de Meyerbeer. Le merveilleux baroque, enfanté dans les fastes de l'opéra
italien, révèle plusieurs visages. Selon la distinction opérée par Marmontel,
il peut être naturel, c'est à dire tout droit sorti des lois naturelles, un
tremblement de terre par exemple, ou bien surnaturel, c'est à dire par excès,
l'impossible étant représenté comme possible, comme il en est de l'homme qui a
perdu son ombre. L'effet de stupéfaction est, en tout cas, un dénominateur
commun, surgissement de l'inexplicable, provoquant la sensation de surprise
chez le spectateur, peut-être même de connivence. L'ouvrage, coordonné par
Agnès Terrier et Alexandre Dratwicki, s'attache, à
partir des contributions d'éminents spécialistes de la chose lyrique, à couvrir
une vaste période, du théâtre de foire au début du XX ème
siècle, et à mesurer la représentation lyrique du surnaturel à travers quatre
thématiques : ses sources, notamment littéraires, puisées en particulier chez
Walter Scott, Charles Nodier ou E.T.A. Hoffmann, ses principes identitaires
esthétiques, ses modalités de mise en œuvre scénique et musicale, ce qui
englobe la mise en scène et la représentation décorative, et enfin ses
formulations, au demeurant fort éclectiques, chez des compositeurs tels que
Gounod, Massenet, Gustave Charpentier et Offenbach, sans oublier Berlioz, qui a
incontestablement ouvert la voie au genre. Le fantastique musical, qui se
développe en France à partir de 1830, n'est sans doute que l'héritier du
merveilleux idéalisé par l'époque baroque. Son immanquable attrait ne cessera
pas, dès lors, de fasciner. Car selon les auteurs, « Le surnaturel, sous
la forme du merveilleux ou du fantastique, se rend indispensable autant au
déploiement des formules de spectacles réclamées par la société urbaine qu'à
l'expression subtilement variée de la vie moderne de l'âme ». Un livre
aussi enrichissant que passionnant.

Jean-Pierre Robert.
***
Haut
« Mission ». Agostino STEFFANI :
extraits des opéras Alarico il Baltha, Servio Tullio,
Niobe, regina di Tebe, Tassilone, I trionfi del fato,
Arminio, La Superbia
d'Alessandro, La Libertá contenta, La
lotta d'Hercole con Acheloo, Le rivali concordi, Henrico
Leone, Marco Aurelio. Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. Avec Philippe Jaroussky, contre ténor. Coro della Radiotelevisione svizzera. I
Barocchisti, dir. Diego Fasolis. 1 CD Universal Decca : 478 4742. TT.: 80'28.
Pour son nouveau disque événement, Cecilia
Bartoli défie la recherche musicologique et sort de l'ombre un compositeur
inconnu : Agostino Steffani (1654- 1728), personnage
mystérieux, aux multiples visages. Le musicien, qui fit carrière surtout en
Allemagne, fut aussi diplomate, voire espion, courtisan, homme d'église encore.
Fin linguiste, il était extrêmement cultivé. Approché par les grands de la
sphère politique, il sera médiateur dans bien des causes mêlant le séculier et
le régulier, jusque dans les arcanes vaticanes. Ceci explique sans doute la
« gimmick » entourant le CD, dans laquelle Bartoli s'illustre en
prélat, et mène enquête incognito. Mais peu importe, car la découverte musicale
est de taille. Entre Cavalli et Haendel, qu'il influença, Steffani
déploie un style qui mérite qu'on s'y arrête : une écriture vocale très
précise, une ligne mélodique qui donne toute leur importance aux vents, puisant
autant à la manière italienne qu'au style français. Ses arias, généralement
courtes, précédées d'un bref récitatif, mettent on ne peut plus en valeur la
voix, et de la manière la plus extrême possible. On l'a déjà pointé, mais cela
se vérifie encore, Bartoli, comme nulle autre aujourd'hui, permet de donner une
juste idée de l'incroyable brio vocal qui anime ces compositions de l'époque
baroque. De la même autorité naturelle avec laquelle elle sait assurer la
défense et l'illustration de la faconde bel cantiste
du XIXème. Défiant toute typologie, de la colorature
suraiguë au grave bien timbré, flirtant avec le contralto, la voix dispense une
intarissable beauté. La stupéfiante maîtrise du souffle, dans les tempos lents
en particulier, libère un legato généreux, proche de l'étreinte. Et puis il y a
chez elle un art inné de raconter une histoire, aussi brève qu'elle soit,
provoquant une séduction irrésistible. On reconnaît là la « bête de
scène » qu'elle sait être sur les planches. Au fil de quelques 25
morceaux, parfaitement inconnus pour la plupart, Bartoli dédie à ses admirateurs
une succession de joyaux. Que ce soit dans le registre de la bravoure,
vocalisant à perdre haleine, comme lorsqu'elle se mesure à la trompette, ou
dans l'expression de la douleur, caressant le mot, alors que soutenue, par
exemple, par la douce flûte. Qu'il s'agisse de lancer de guerriers accents ou
de distiller une joie malicieuse. L'amour passion, qu'on a rarement perçu livré
avec une telle ardeur, voisine avec l'abandon quasi hypnotique, ou l'élégiaque
le plus expansif, proche d'harmonies séraphiques, comme dans cet extrait de Niobé,
regina di Tebe. Quatre
duos avec Philippe Jaroussky augmentent encore
l'adrénaline, car le timbre cristallin du contre-ténor s'enlace avec celui
miraculeusement ambré de la chanteuse. Dans un autre extrait du même opéra, sur
les mots « ma flamme, mon ardeur », la passion amoureuse côtoie la
sensualité, pages dignes du finale du Couronnement de Poppée, Diego Fasolis, lui aussi suprêmement engagé, et ses Barocchisti, offrent plus qu'un accompagnement : ces fins
musiciens, d'une sensibilité étourdissante, façonnent, pièce après pièce, le
plus évocateur des écrins, faisant éclore des couleurs éperdues et dispensant
des ambiances magiques, là encore d'une séduction sonore à nulle autre
pareille. Pour l'île déserte assurément !

Wolfgang Amadeus MOZART : La Finta
Giardiniera. Opéra en trois actes. Livret de
Giuseppe Petrosellini. Sophie Karthäuser,
Jeremy Ovenden, Alex Penda,
Marie-Claude Chappuis, Nicolas Rivenq, Sunhae Im, Michael Nagy. Freiburger
Barockorchester, dir. : René Jacobs. 3 CDs
Harmonia Mundi : HMC 902126.28. TT.:
80'12+74'46+30'11.
Voici une nouvelle interprétation de La Finta Giardiniera qui
bouscule les schémas établis. Car il s'agit de la version posthume,
instrumentée par un inconnu, et donnée à Prague, en 1796. Par rapport à la
version originale, de Munich (1774), on a affaire à une réorchestration «
moderne », c'est à dire au goût de l'époque, et donc proche du style
tardif de Mozart, celui de La Flûte enchantée et de La Clémence de
Titus. Aux termes d'une étude fouillée, René Jacobs en souligne les
différences, en particulier dans la manière d'étoffer les parties de cordes, et
de développer substantiellement celles des vents, outre l'introduction notable
de la clarinette, permettant plus de coloration expressive. Combien aussi on
constate une « émancipation » de certains instruments, la flûte, le
basson, les altos. Et comment la réorchestration induit une autre perspective
de la trame dramatique, particulièrement sensible dans les premières scènes de
l'acte III, dont le côté farce est bien plus senti que dans la partition de
1774. Jacobs pense aussi que quelque chose rapproche le librettiste Petrosellini et l'illustre Da Ponte, tous deux hommes de
théâtre accomplis. Les ensembles prennent une autre allure, tel les finales des
actes I et II, et bien des airs acquièrent une plastique différente, ne
serait-ce que du fait de l'adjonction des vents. Autrement dit, un Mozart de
jeunesse mis à la mode du Mozart du Requiem. De fait, la richesse du discours
est frappante, offrant une plénitude insoupçonnée. La direction extrêmement
vivante, énergique même, du chef belge le démontre à chaque morceau. L'urgence
dans les finales est palpable, les différentes sections articulées avec un
souci de faire ressortir leurs brusques changements de climats. La beauté
instrumentale du Freiburger Barockorchester
ajoute au plaisir. L'empathie avec ses chanteurs, toujours primordiale chez
Jacobs, confère aux situations dramatiques un poids réel, dans cette histoire
d'identités cachées et de marivaudage, proche de la comédie. Ainsi de l'aria de
Sandrina, au IIème acte, avec ses syncopes
rageuses, qui se prolonge dans un récitatif et se conclut en une cavatine
presque haletante. Sophie Karthäuser s'y montre une
mozartienne accomplie, d'une extrême sensibilité dans le phrasé, et d'une
sincérité d'intonations jamais en défaut. Une grande interprétation. Ses
consœurs, Alex Penda, admirable Arminda,
Sunhae Im, diablesse et futée Serpetta,
et Maris-Claude Chappuis, souverain Ramino, notamment lors de son air de fureur, soutiennent le
challenge. Le ténor Jeremy Ovenden, qui se fait une
spécialité de chanter avec les grands que sont Jacobs ou Harnoncourt, offre
élégance de timbre et de phrasé, sans compter une verve intarissable. Les
basses sont de la même eau : Nicolas Rivenq est un
Podestat non caricatural, loin du barbon atrabilaire, et Michael Nagy un Nardo d'une joyeuse faconde. Une mise en scène discrète,
mais efficace, insérant des interventions parlées, à la Goldoni, parachève la
réussite. Une découverte, au-delà de la pure musicologie, dont la caution de
René Jacobs, assure de la validité.

François COUPERIN : Les Nations, La
Françoise, L'Espagnole, L'Impériale, La Piémontoise. Sonades et Suites de simphonies
en trio. Les Ombres, direction artistique : Margaux Blanchard, Sylvain Sartre.
2 CDs Ambronay : AMY035. TT.: 51'+54'56.
Européen avant l'heure, François Couperin a
dans ses Nations, cherché à glorifier la France, l'Espagne, l'Allemagne
et l'Italie. Ces pièces, ou ordres, sont construites selon le même schéma : une
sonate en trio, suivie d'une succession de danses, à la française, de six à
huit selon le cas, elles-mêmes extrêmement variées, et débutant toujours par
une allemande. « Les Nations sont un seul geste : la réunion ultime de
toute l'œuvre de François Couperin, de sa plus tendre jeunesse à sa plus mûre
expérience » soulignent les responsables artistiques de cette nouvelle
interprétation. L'originalité de ces pièces est de juxtaposer des morceaux de
facture différente, requérant un effectif instrumental modulé, de l'intimisme
de trois ou quatre musiciens à la force de l'ensemble de la formation, dont la
distribution n'est d'ailleurs pas immuable. Pour contraster les climats. La
sonate introductive alterne ainsi lent et vif, le cas échéant avec des étapes
de transition, tel ce curieux « repos », dans le cas de l'Espagnole.
L'allemande est toujours marquée « sans lenteur ». La sarabande se
vit « tendrement » ou « gravement », car elle est expansive,
offrant toutefois des épanchements mesurés. La courante et son double
alternent, d'une part, le trio de flûte, hautbois, clavecin et basse, d'autre
part, l'ensemble des cordes (L'Espagnole, La Piémontoise),
ou l'inverse dans le cas de L'Impériale. La bourrée est gaieté sautillante,
sans trivialité, plus loquace dans son double. La gigue surenchérit dans le
balancement preste, mais, là encore, avec retenue. On est frappé par l'art de
traduire les diverses manières, dans un style qui ne se départit pas d'une
élégance toute gallique, et par une finesse du trait qui n'est pas préciosité.
Si La Françoise est toute grâce et clarté, l'Impériale est éclatante,
préfigurant la manière de l'école de Mannheim. Tandis que La Piémontoise déploie une vivacité toute italienne : ses
« airs » sont un clin d'œil à la patrie du chant. Chacune possède son
lot de particularités : ainsi du duo de flûtes dans la gavotte de L'Espagnole,
d'une douceur de jeu enchanteresse, ou de sa passacaille finale,
« noblement et marqué », proche d'une danse de cour. L'Impériale
s'achève, curieusement, par un court menuet. L'ensemble Les Ombres offre le nec
plus ultra de l'art de la jeune génération des baroqueux : une lecture
extrêmement imaginative dans le choix de l'instrumentation et des ornements,
pas en reste d'énergie quant au phrasé, pour vivifier les infinies combinaisons
conçues par Couperin. Ils disent se référer « au principe de varietas », introduit par le théoricien Johannes Tinctoris, visant à diversifier l'interprétation par la
variété de rythme, de tons et de mouvements. Le fini instrumental est
considérable, l'accent toujours élégant, l'approche empreinte de légèreté, loin
de toute affectation. Le vrai goût français en somme.

Michelangelo FALVETTI : Il Diluvio universale. Dialogue
à cinq voix et cinq instruments. Texte de
Vincenzo Giattini. Fernando Guimaräes, Mariana Flores, Matteo Bellotto, Evelyn Ramirez Munroz, Fabian Schofrin, Magali
Arnault, Caroline Weynants, Thibaut Lenaerts, Benoît Glaux. Keyvan Chemirani, percussions.
Chœur de Chambre de Namur. Cappella Mediterranea, dir. Leonardo García Alarcón. 1
CD Ambronay : AMY026. TT.: 64'35.
Une heureuse découverte que ce
« Déluge universel », de Michelangelo Falvetti
(1642-1692), créé en 1682, à Messine, où celui-ci occupait les fonctions de
maître de chapelle de la cathédrale. Entre oratorio et drame sacré, l'œuvre
traite l'épisode tragique de l'Ancien Testament, du déluge de pluie que Dieu,
las de l'attitude méchante et corrompue de l'homme, laisse s'abattre sur la
terre pendant quarante jours et quarante nuits, épargnant Noé, sa famille et
les animaux, embarqués dans l'arche. Quatre parties la divisent. « Au
ciel », en forme de prologue allégorique, voit la Justice divine dicter sa
loi aux éléments. « Sur la terre » est dominée par la figure
imposante de Dieu qui, s'adressant à Noé, lâche cette terrible sentence :
« je veux donner la mort à ceux qui ont abusé de la vie ». Volet
central, « Le déluge », introduit par une symphonie de tempête,
effrayante, donne la parole à la Mort (contre-ténor) et au lamento de détresse
insistant du chœur, d'abord chanté, puis psalmodié, presque parlé, dans un
climat cataclysmique. Tout en contraste, apparaît le sursaut poignant de la
Nature humaine, qui s'interroge sur pareille vindicte. Mais la Mort triomphe,
dans une surprenante allégresse. La dernière partie, « Dans l'arche de
Noé », voit l'apaisement, la lumière retrouvée, l'arc en ciel de paix. Un
rythme quasi dansé conduira à une péroraison grandiose en forme d'action de
grâce, d'hymne à la vie. La composition musicale est d'une étonnante variété,
rencontrant un texte aux vertus dramatiques certaines : symphonie extrêmement
vivante, récitatif cantando, dans le droit fil des
motets polyphoniques, portant l'accent sur les paroles, airs originaux dans la
forme et les ornements, chœurs très élaborés dans une recherche d'effets de
timbre particuliers. Leonardo García Alarcón et sa
Cappella Mediterranea en proposent une exécution
follement imaginative dans les choix instrumentaux. L'emphase portée sur les
percussions, qui souvent introduisent l'orchestre, ajoute un climat
d'ingénieuse improvisation. Il en va tout autant de l'achalandage vocal, d'une
diversité peu commune. Le Chœur de Chambre de Namur comme le brelan de jeunes
solistes, apportent une singulière intensité à une pièce qui n'attendait que
pareille débauche d'émotions pour revenir à la vie. Voilà, encore une fois, de
quoi tordre le cou au préjugé tenace qui voudrait que toute œuvre tombée dans
l'oubli le soit du fait d'un faible intérêt.

Henry PURCELL : Fantazias & In Nomines. Les Basses Réunies,
dir. Bruno Cocset. 1 CD AgOgique : AGO007. TT.: 50'22.
Les « fantaisies pour violes »
appartiennent à la part la plus secrète de la musique de Henry Purcell.
Composées en 1677 et en 1680, elles n'étaient pas destinées à être publiées. Ce
qui en dit long sur l'esprit quasi désintéressé du musicien à leur égard. Elles
sont écrites pour un concert de violes, c'est à dire
une petite formation constituée de violes de gambe et des violons, complétée,
le cas échéant, par un clavecin. Elles marquent l'apogée et la fin d'une
tradition instrumentale développée en Angleterre, au XVII ème
siècle, et représentée en particulier par Matthew Locke. Elles ont presque un
caractère anachronique, par leur forme et le choix des instruments. Courtes, de
3 à 4 minutes seulement, elles revêtent une plus ou moins grande ampleur
dynamique, selon qu'elles sont à trois, quatre ou cinq voix, voire pour deux
d'entre elles, dites « In Nomines », respectivement, à six et sept
voix. Ces dernières empruntent au plain-chant d'une messe de John Taverner. Bien qu'elles soient, en général, sur le versant
contemplatif, certaines d'entre elles sont plus animées, dans leur seconde
partie, comme les fantazia 6 et 7, particulièrement,
et la 11ème,
encore plus, avec son rythme de danse, l'instrumentation étant rehaussée du
violone (contrebasse). Quelques traits originaux les distinguent. Ainsi de la fantazia « Upon One
note » (sur une note), celle de « la » en l'occurrence, scandée
et répétée tout au long du morceau, tel un discret son de cloche.
L'interprétation de l'ensemble Les Basses Réunies, sous la houlette de Bruno Cocset, se place dans la lignée de celle de Jordi Savall, par sa clairvoyance pour la reconstitution de ce
qu'était un consort de violons au XVIIème. Par sa
sensibilité aussi, dans le choix des tempos et le travail sur les timbres
contrastés des violes de gambe et des violons, rendu plus aisé par le fait que
tous les instruments, à l'exception du violone, ont été réalisés par le même
luthier, Charles Riché. Dès lors, l'aspect recherche
pure, auquel fait penser cet éloge du contrepoint dans ce qu'il a de plus
complexe, ne s'avère pas mélancolique, encore moins austère. Au contraire, la
sonorité des cordes ouvre de singulières perspectives, que celle du clavecin,
également cordé en boyau, agrémente d'une teinte discrètement triste, ici
magnifiquement joué par Bertrand Cuiller.

George ONSLOW : Quatuors à cordes op.10 n°
2, en ré mineur, op. 9 n° 3, en fa mineur, op.21 n°3 en mi bémol majeur.
Quatuor Ruggieri. 1 CD AgOgique : AGO006. TT.: 69'52.
La musique de chambre de Onslow sort peu à peu de l'ombre, en particulier ses
quatuors. Après les interprétations des Diotima
(Naïve), c'est au tour du Quatuor
Ruggieri de révéler de nouvelles visions. Sur instruments anciens, donc
sur des cordes de boyau, cette fois, et pour deux premières au disque, les
quatuors op. 21 n°3 et op. 10 n°2. Ce dernier et l'op. 9 n° 3, chacun tiré
d'une série de trois, sont des compositions de jeunesse (1813/1814), et
s'inspirent de Haydn et de Mozart. Elles se signalent par la clarté de
l'écriture et l'ingéniosité de l'harmonie, notamment dans le menuetto, bâti dans le premier cas, sur un air populaire
auvergnat. La sûreté dans la manière de contraster les mélodies est tout autant
notable (andante con variazioni, bien chantant au
thème, dans le second cas, et une superbe rythmique au finale agitato). Œuvre
plus tardive (1822), et dernier d'une vaste production, le quatuor op. 21 n°3 marque un changement dans l'approche, plus dramatique, chez
un compositeur qui va bientôt se consacrer à la scène lyrique. L'allegro
maestoso présente un mode déclamatoire qui pourrait préfigurer un air d'opéra.
Le menuet est tourbillonnant et plein d'esprit. Au larghetto méditatif, dont
Berlioz admirait les sombres sonorités, fait pendant un finale extraverti, de
mélodie facile, sans autre prétention que divertissante. Issus de l'ensemble
des Talens Lyriques, les jeunes du Quatuor Ruggieri
livrent des exécutions sensibles et recherchées, d'une musique difficile à
appréhender si l'on s’en tient aux exigences minutieuses du compositeur pour ce
qui est du choix des tempos et des nuances. L'équilibre auquel ils parviennent
est à porter au crédit d'un souci de fidélité à l'esprit plus qu'au texte.

Wolfgang Amadeus MOZART : Concertos pour
piano et orchestre N° 9, en mi bémol majeur, K 271, « Jeunehomme »,
et N° 21 en ut majeur, K 467. The
Cleveland Orchestra. Mitsuko Uchida, piano et direction. 1 CD Universal Decca :
478 3539. TT.: 62'28.
Poursuivant son exploration des concertos
de Mozart, Mitsuko Uchida
aborde deux pièces majeures, les 9 ème et 21 ème. Dédiée à une certaine Mlle Jeunehomme,
en réalité Jeunamy, fille du danseur Noverre, le
concerto K 271, est le premier des grands. Il est empli de surprises et d'inspirations,
dépassant le simple talent, pour révéler le génie. Il s'ouvre par un coup
d'audace, l'entrée du piano aussitôt après la fanfare de l'orchestre. La
profondeur de l'andantino, dans son introduction orchestrale et l'entrée du
piano sur un thème douloureux, l'inscrit dans le tragique opératique. Même si
tempéré par des trilles d’une réelle douceur, il s'épanche tout au long de la
cadence, celle écrite par Mozart, véritable concentré de souffrance. Le rondo
presto contraste, passant des larmes au rire, du tragique au buffa le plus léger, enlevé, avec de grands moments
d'excitation, même si la première de deux cadences est, dans son tempo de
menuet, en complète rupture. Le 21 ème concerto, K
467, de 1785, est bien différent de son indissociable compagnon, le 20 ème, K 466 : la tonalité d'ut majeur, dans sa clarté,
emporte la composition dans un autre univers, même si parcourue d'ombres. Ce
que la vision retenue de la pianiste renforce dans le maestoso initial, un peu
austère. L'andante voit s'épanouir une des plus belles inspirations mélodiques
de Mozart, avec ses cordes en sourdine et son thème d'une mélancolie poignante
sur une dissonance des bois. Là encore, la douleur est à nu, ce que le vivace
assai final balaie, de sa belle énergie. La conception de Mitsuko
Uchida est plutôt sévère, grandiose à l'orchestre, où
l'on prend son temps, très classique au clavier. Celui-ci est raffiné, sans
afféterie, et finalement peu féminin, dans la douceur du toucher, là où ses
consœurs n'hésitent pas à jouer plus véhément. Voilà des exécutions
impeccables, certes non routinières, mais auxquelles il manque un zest de
fantaisie, et sans doute quelque imagination, comme dans les cadences, de son
cru, du 21ème concerto. Le partenariat avec l'Orchestre
de Cleveland révèle son excellence, ainsi que déjà démontré dans les précédents
CD de la série.

Félix MENDELSSOHN : L'œuvre pour
violoncelle et piano. Sonates N° 1 en si bémol majeur, op. 45, et N ° 2 en ré
majeur, op. 58. Variations concertantes en ré majeur, op. 17. Albumblatt. Romance sans parole en ré majeur, op. 109. Gary
Hoffman, violoncelle. David Selig, piano. 1 CD La
dolce volta : LDV05. TT. 62'13.
Mendelssohn s'est peu livré au genre de la
musique de chambre. Ses pièces pour violoncelle et piano sont quasi absentes
des concerts et du catalogue enregistré. Deux sonates et quelques pages
isolées, de quoi former la matière d'un CD. Les sonates offrent une
construction classique, équilibrée. La première (1838), possède un intimisme
presque schubertien, et ses trois mouvements organisent un dialogue alerte
entre les deux partenaires. Le foisonnement thématique, quoique maîtrisé, de
l'allegro, laisse place à un travail raffiné, finement rythmé, à l'andante, et
à un finale éloquent, bien chantant au violoncelle, pour une conclusion toute
en douceur. La seconde (1843), est plus exubérante dans ses quatre parties bien
contrastées. Son vivace initial est extrêmement séduisant dans l'urgence du
cheminement et le rôle flatteur dévolu au violoncelle. L'allegretto scherzando est
délicatement agité. L'adagio, après une longue introduction arpégée du piano,
offre au violoncelle une belle cantilène suave, d'abord en forme de choral,
puis s'engageant dans un récitatif passionné, qui s'affirme dans une ample
montée, pour s'achever calmement. Une attaca
introduit le molto vivace final, fougueux, sautillant de joie. Les quelques
pièces isolées montrent les mêmes caractéristiques d'équilibre, en particulier
les Variations concertantes op. 17, qui dévoilent déjà des traits originaux, tels
les pizzicatos du cello sur un accompagnement scandé
du piano, et des oppositions dynamiques. La Romance sans parole op. 109, la
seule dédiée à cette formation d'un genre autrement bien représentée au seul
piano, est riche et pudique. Vainqueur du 3ème concours Rostropovitch de violoncelle de la Ville de
Paris, en 1986, Gary Hoffman offre une sonorité ample et poétique, au soutien
de ce qu'il considère comme des « œuvres parfaitement écrites, et
physiquement jouissives ». Le piano de David Selig
est la fluidité même, et d'une grande sensibilité lyrique. Un remarquable duo.

Bedřich SMETANA : La
Fiancée vendue. Opéra en trois actes. Livret de Karel Sabina. Dana Burešová, Tomáš Juhás, Jozef Benci, Ales Vorácek, Gustáv Beláček, Lucie Hilscherová, Svatopluk Jirků, Jaroslav Březina, Kateřina Knežihová, Ondrej Mráz. BBC Singers. BBC Symphony Orchestra, dir. Jiri
Bĕlohlávek. 2CDs Harmonia Mundi : HMC 902119.20. TT.:
64'29+71'47.
Terminée en 1866, La Fiancée vendue devra attendre 1870 la
création de sa version définitive, en trois actes, avec les fameuses danses qui
en feront la fortune. Au point peut-être d'en occulter les autres
caractéristiques, un lyrisme chatoyant, une robuste gaieté qui se teinte de
verve amusée, empruntant d'ailleurs autant à l'opéra allemand, voire italien,
qu'aux sources spécifiquement slaves. Ce que des présentations récentes ont
heureusement mis en lumière. A partir d'un fait divers
pittoresque, mais bien ficelé par le librettiste Karel Sabina, Bedřich Smetana a créé là le modèle de l'opéra léger
tchèque. Après de nombreuses péripéties, autour d'épousailles arrangées par un
marieur patenté, qui littéralement « vend » la mariée, tout finira
bien : le chœur des habitants du village peut entonner la morale du conte :
« l'amour fidèle est vainqueur ». Les versions au disque de l'opéra
ne sont pas si nombreuses. Aussi celle-ci est-elle la bienvenue. D'autant que
bâtie sur un cast entièrement tchèque, elle sonne
d'une authenticité certaine, loin de toute veine folklorique banale. Le chef
Jiri Bělohlávek est la cheville ouvrière de
l'entreprise. Nul, mieux que lui, ne possède les ressorts de cette composition,
mêlant récitatifs et airs, et les arcanes de mélodies qui sourdent et se
développent avec naturel. Sans parler des accents enivrants, bien au-delà de
toute couleur locale, des danses, le furiant
endiablé, la polka entraînante, la skočná
ébouriffante. Sa direction est on ne saurait plus contrastée. Le ton est donné
dès l'ouverture, rapide, d'une vraie urgence, avec ses ruptures tranchées. Le « drive »
restera soutenu, ne laissant décidément pas de place à la mélancolie, déployant
un indéniable sens théâtral. Comme dans les passages clés, le septuor du
dernier acte, par exemple. L'orchestre de la BBC répond avec flamme et la
section des vents apporte cette brillance qui capte l'attention. De la
distribution, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle se dépense sans
compter, seule la Marenka, Dana Burešová,
paraît un peu mûre pour incarner la jeune villageoise amoureuse, la voix
laissant percer quelque dureté, qui s'estompe cependant en seconde partie. Le Jenik est sympathique, ni falot, ni apprêté, doté d'un
timbre joliment héroïque. Le Kecal, dont le nom
signifie, dans la langue tchèque, aussi bien marieur que jaspineur, comme le démontre son air d'entrée, est bien
sonore, en particulier dans les passages aigus du rôle, et pourvu de notes bien
senties dans l'extrême grave. Le Vasek ne cherche
pas à être benêt, même si la voix n'est
pas assez différenciée avec celle du primo ténor. Les BBC Singers,
bien qu'au nombre de 24, sonnent comme s'ils étaient cent ! Belle prise de son
de concert, brillante et présente.

Georges BIZET : Carmen. Opéra en
quatre actes. Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d'après la nouvelle de
Prosper Mérimée. Edition de Fritz Oeser. Magdalena Kožená, Jonas Kaufmann, Genia Kühmeier, Kostas Smoriginas, Christian Van Horn, Andrè
Schuen, Christina Landshamer,
Rachel Frenkel, Jean-Paul Fouchécourt,
Simone del Savio. Chor der Deutschen Staatsoper Berlin. Berliner Philharmoniker, dir. Simon Rattle. 2 CDS EMI Classics :
50999 4 40285 2.TT.: 71'41+78'06
Cette nouvelle version de Carmen a
été captée live à la Philharmonie de Berlin, tout juste après les
représentations scéniques du Festival de Pâques de Salzbourg 2012. Son
principal atout est l'orchestre, le Philharmonique de Berlin, capté comme
jamais, dans sa transcendante beauté. Il n'est que d'écouter la sonorité de la
flûte pour s'en convaincre. La direction de Simon Rattle
flatte des couleurs inouïes. Elle est on ne peut plus contrastées : accents
hyper brillants, accélérations fulgurantes, coups de boutoir sur certains
accords finaux, ou au contraire, climats ressortissant à une impalpable
douceur, lyrisme diaphane (entr'acte du IIIème acte). Le tempo est
souvent très rapide, pour l'ouverture notamment, à l'entr'acte du dernier acte,
qui en rappelle la thématique, ou encore dans certains chœurs : celui des cigarières, au Ier acte,
est si boulé que le texte en devient incompréhensible. Mais cette prise de
risque est parfaitement maîtrisée, plus encore qu'à la représentation
salzbourgeoise de l'été dernier : l'urgence dramatique est là, palpable. La
distribution ? Dans un domaine où l'on raisonne en termes de pléthore, et
forcément par comparaison, la Carmen de Magdalena Kožená
surprend. Ce n'est là ni la voix naturelle sombre, ni le tempérament de feu
qu'on associe à la fameuse gitane. Si le frisson n'est pas toujours au rendez-vous,
du moins aucune faute de goût ne vient déparer l'interprétation, et la diction,
même parlée, est un quasi sans faute. Les airs sont irréprochables (une
séguedille un brin lascive, sur un orchestre retenu, un air des cartes
justement fataliste, idéalement accompagné, là encore). La scène finale est
jouée sans pathos. Tout sauf le cliché de la femme fatale, en somme. Son José,
Jonas Kaufmann, unit avec doigté lyrisme et héroïsme. Des falsettos enchanteurs
(fin du duo avec Micaëla, ou de l'air « de la
fleur »), une ligne de chant immaculée, tout simplement unique, parent une
interprétation à faire presque oublier tous ses rivaux. Une entrée en matière
un peu maniérée est vite oubliée, et le cri de révolte « adieu pour
jamais » du III fait frémir de plaisir esthétique. La scène finale est, de
son côté, d'un vrai pathétisme. La Micaëla de Genia Kühmeier n'est ni fluette
ni apprêtée. Une vision qui donne au personnage tout son poids. Le bât blesse,
et lourdement, avec l'Escamillo de Kostas Smoriginas : timbre
voilée, qui ne projette pas et le contraint à détoner dans l'air fameux, défaut
d'articulation et de legato, diction impossible. Les autres rôles vont du bon,
le Remendado, Jean-Paul Fouchécourt,
au peu acceptable, le Zuniga, tandis que les deux
amies Frasquita et Mercedes sont bien peu typées.
Curieux choix aussi que celui de la version Oeser,
avec dialogues, mais raccourcis (air du toréador juste après celui des sistres,
absence du personnage de l'éclaireur pour introduire la scène de Micaëla, au III ème acte, et son
air « Je dis que rien ne m'épouvante »). Son bien piètre élan
dramatique à plus d'un endroit, et le peu de transition entre scènes, laissent
souvent sur sa faim. Autre regret : l'absence du texte dans la plaquette du CD.
Le plus joué des opéras a pourtant encore à trouver du public, ici et ailleurs.

Piotr Iliych
TCHAÏKOVSKI : Symphonies N° 1 « Rêves d'hiver », N°2 « Petite russiennne », N° 3 « Polonaise ». London Symphony Orchestra, dir. Valery Gergiev. 2 CDs
LSOlive : LSO0710. TT.: 78'02+47'56 .
Sans bénéficier de l'aura des trois
suivantes, les trois premières symphonies de Tchaïkovki
forment une somme musicale de premier plan, surtout lorsqu'interprétées avec la
force de conviction qu'y met Valery Gergiev. Hommage
à la patrie russe, elles dévoilent déjà le mélodiste et ce qui, chez le
musicien, perce derrière toute musique, le sens du drame. Contrairement à la trilogie
finale, qu'unissent des liens forts et une même idée du fatum, les trois
premières sont plus disparates dans leurs climats. La symphonie N° 1, sous-titrée
« Rêves d'hiver », est toute mélancolie rêveuse, dans l'évocation de
paysages russes, plus idéalisés que décrits. La deuxième doit son nom aux
thèmes ukrainiens qui la traversent, celui qui, au premier mouvement, est
énoncé au cor puis au basson, un autre ornant la marche staccato du deuxième,
et la chanson, dite de « La grue » qui, au finale, subira mille
métamorphoses. La troisième symphonie doit son titre, un peu excessif, de
« Polonaise », à la danse qui se développe à l'allegro con fuoco final. Valery Gergiev en
propose des interprétations intensément vécues, d'autant que saisies dans
l'immédiateté du concert. Des visions burinées aptes à traduire combien
Tchaïkovski est un orchestrateur-né, et un musicien proche du théâtre. On y
trouve déjà ces modes typiques que sont les figures circulaires, les
progressions héroïques, les répétitions travaillées, le recours à des thèmes de
danses (finale de la 1 ère, alla tedesca de la 3 ème). Gergiev élargit le spectre
dynamique, souvent considérablement, ce que la reproduction sonore, dépourvue
de tout phénomène de compression dynamique, traduit avec exactitude : l'énergie
farouche voisine avec le calme contrôlé, les forte fiers côtoient
d'évanescents pianissimos, sans que jamais la spontanéité du discours ne
soit entamée. Il ne cherche pas à faire joli, mais plutôt à jouer vrai, même
lorsque l'inspiration vient à fléchir (finales de la 1ère
et de la 3ème). Les parentés avec d'autres grands russes
apparaissent souvent flagrantes, comme la mélopée mélancolique, digne de
Moussorgski, qui fleurit dans le deuxième mouvement de la « Petite russienne ». Le grotesque, si partie prenante de
l'univers russe, n'est pas fardé. Ainsi du scherzo fantastique de la
« Polonaise », d'une verve méphistophélique. Il bâtit une atmosphère,
de beau lyrisme nordique dans la première, se teintant d'une légèreté aérienne
au scherzo, avec ses figures syncopées, qui feront florès dans les futurs compositions du maître. Les effets d'amplification
sonore du discours atteignent quelque chose de fiévreux dans le scherzo de la
deuxième, si original par son débit irrégulier et ses pirouettes des bois dans
l'aigu. Il raconte toujours une histoire, même dans l'abstraite troisième, où
Tchaïkovski s'oriente vers un langage plus objectivé et universel, encore que
la thématique ne puisse échapper entièrement à la composante russe.
L'inventivité mélodique est soulignée partout et sans cesse. Avec le LSO, il
dispose d'une phalange de tout premier ordre.

Claude DEBUSSY : Préludes, Livre I, Livre
II. Philippe Bianconi, piano. 1 CD la dolce volta: LDV07. TT.: 74'38.
Comme les Images, mais plus encore,
les Préludes constituent un échantillonnage de la pensée debussyste. Une
pierre définitive aussi à l'édifice de réforme de l'art pianistique. La
concision, la variété de ces 24 pièces ne cessent de fasciner, d'émouvoir.
Philippe Bianconi le dit : le retour vers Debussy est
indispensable « pour retrouver ce naturel, cette sensualité extraordinaire
des timbres ». Debussy qui admirait Chopin, puise à l'infini dans la
liberté formelle qu'autorise ce genre musical. « Le mystère de l'instant »,
dira Jankelevith, ou « ce qui fuse, jaillit sans
cesse, apparaît-disparaît, c'est à dire apparaît pour disparaître et disparaît
pour reparaître ». L'approche de Bianconi est
hédoniste : la poésie profonde, non point vaporeuse, mais justement structurée,
sans pour autant sombrer dans un modernisme que d'autres éprouvent nécessaire
de mettre en avant. Un subtil équilibre en tout cas, obtenu grâce au respect
scrupuleux des indications, elles-mêmes minutieuses, du musicien, en termes de
caractère ou d'ordre métronomique. Un art de maîtriser l'atmosphère aussi : la
mélancolie de « Des pas sur la neige », l'angoisse sous-jacente de
« Ce qu'a vu le vent d'ouest », vraie scène dramatique, le halo de
mystère entourant « La cathédrale engloutie », qui évoque un paysage
abyssal, celui de la légende d'Ys. Le pianiste souligne combien est prégnant le
côté sombre des Préludes, même dans les pièces qui paraissent lumineuses. Le 2ème
Livre est plus abstrait, car le travail sur le timbre y est plus sagace, comme
il en est du 2ème Livre des Images d'ailleurs. La
fragilité, la fugacité des climats y est plus étonnante encore. Ainsi « La
Puerta del Vino » ne joue-t-elle pas des contrastes extrêmes
d'ombre et de lumière ? Pour Bianconi,
« Canope » est « une méditation sur la mort peut-être, sur la
vanité très certainement ». Cette abstraction de musique pure, se poursuit
dans « Les tierces alternées ». La correspondance entre les deux
Livres ne laisse pas de surprendre. La grâce de « La fille aux cheveux de
lin » rencontre la poétique diaphane de « La terrasse des audiences au
clair de lune ». L'humour caché de « La sérénade interrompue »
trouve son équivalent dans « Général Lavine-eccentric »,
d'un humour dévastateur. Même au seuil de la modernité, Debussy se plaît à
livrer des tournures archaïsantes, comme dans « Bruyères ». Une
interprétation perspicace, qui bénéficie d'une prise de son livrant
l'immédiateté d'un large spectre sonore. Fascinant !

Jean-Pierre Robert.
Luz de
Alva. Chansons espagnoles du début de la
Renaissance. RAMÉE (stephanie@outhere-music.com ). RAM 1203. TT : 66’ 29.
Ce florilège de chansons espagnoles du
début de la Renaissance, à l’époque des Rois catholiques, est lumineusement
interprété par l’Ensemble La Morra (fondé en 2000) : Arianna Savall, Petter Udland Johansen, Corina Marti (codirection), Michal Gondko
(codirection), Tore Eketorp, chacun chantant et
jouant de plusieurs instruments anciens : vihuela
de mano (convenant parfaitement pour accompagner des
chansons polyphoniques, vihuela à archet, guiterne... Ils mettent leur musicalité et leur technique
au service de la musique espagnole représentée par J. Dalza,
Fr. Della Tore, J. Ghiselin,
P. de Escobar, J. del Encina… 23 pièces fort
attachantes, calmes, langoureuses, allantes, ponctuées à la percussion… :
un régal pour l’oreille.

Johann Sebastian BACH : Ach süsser Trost ! Leipzig Cantatas. PHI (stephanie@outhere-music.com ). LPH 006. TT : 67’ 24.
Ph. Herreweghe occupe une place importante
parmi les spécialistes des Cantates de J. S. Bach, à côté de H. Rilling, N. Harnoncourt, G. Leonhardt et G. Chr. Biller qui
ont, chacun, leur conception esthétique : baroquisante, voire romantique…,
se répercutant à la fois sur l’expression, les tempi ou encore le choix des
effectifs. À la tête du Collegium Vocale Gent qu’il a
fondé en 1969, Ph. Herreweghe recherche avant tout la fraîcheur et la pureté du
chant baroque. Ce CD propose 4 Cantates autour des thèmes : consolation,
souffrance, affliction, tristesse, inquiétude…, et extraites du premier cycle leipzicois (1723). Les Cantates 25 : Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, 46 : Schauet doch und sehet, ob
irgendein Schmerz sei et 105 : Herr, gehe nicht ins
Gericht mit deinem Knecht reprennent la structure traditionnelle :
chœur d’ouverture, récitatif, aria, récitatif, aria, choral. Les Récitatifs et
Airs sont bien structurés. Précisons que le texte du Choral conclusif de la
Cantate 25 : Ich will alle meine Tage rühmen, 12e strophe du Choral de J. Heermann,
chanté sur la mélodie (de Pierre Davantès) véhiculant
le Psaume huguenot 42 : Ainsi qu’on
oye le cerf bruire, est harmonisé homosyllabiquement ;
le chœur en rend bien le caractère décidé.
Il en est de même dans la Cantate 46, le choral conclusif : O grosser Gott von Treu
est davantage dans l’esprit luthérien : clair et bien prononcé, avec des
brèves transitions instrumentales. Toutefois, l’interprétation semble quelque
peu manquer de l’intériorité typiquement luthérienne, peut-être en raison du
tempo ou du paysage vocal. Quoi qu’il en soit, ces Cantates de Leipzig sont
dignes d’intérêt et retiendront l’attention des discophiles.

Licht und Schatten. Musik zum Verweilen für Flöte und Harfe. GALLO (www.vdegallo-music.com ). DVD 1377. TT :
77’ 40.
Déjà à l’époque de Mozart, l’association
flûte et harpe était très appréciée. Cette réalisation porte en exergue ces
vers de Victor Hugo : « Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut
taire, la musique l’exprime », et c’est bien ce que démontrent Fabienne Sulser (Flûte) et Ruth Jahnke
(Harpe), en parfaite connivence avec le double titre de ce disque : Licht und Schatten et Musik zum Verweilen,
c’est-à-dire : Lumière et ombre
et mot à mot : Musique sur laquelle
s’attarder. Les œuvres sélectionnées se rattachent aux époques baroque,
classique, romantique tardive et moderne, allant de Bach, Pergolèse, Mozart et
J. G. H. Backofen (mort en 1830) à M. Tournier (mort
en 1951), E. Bloch (mort en 1959). Beau programme d’arrangements et de musiques
dépouillée, discrète, intime, calme… Lumières et ombres à ne pas manquer.

Vanessa
HIDDEN chante Les anges musiciens. SOLSTICE
(www.solstice-music.com ). SOCD 276. TT : 61’ 43.
Ce disque regroupe une vingtaine de
mélodies et d’airs de musiciens français, par exemple : Jacques Offenbach,
Gabriel Fauré, Érik Satie, André Messager, Reynaldo Hahn et, plus proche de nous, Maurice Yvain… et de
compositeurs étrangers : Oscar Strauss (Valse), Kurt Weill… C’est, en
fait, l’œuvre de Francis Poulenc : Les
anges musiciens qui a donné le titre à cette production « à succès »,
à mi-chemin entre mélodies savantes et légères, tour à tour sentimentales ou
comiques. Les thèmes abordés sont variés : amour, nostalgie, détresse,
griserie… Les titres sont éloquents : La
Diva de l’Empire, Sorcière ;
descriptifs : Le jardin, Yes ! (particulièrement animé) ou
encore L’heure exquise inégalable,
comme d’ailleurs l’interprétation motivée de Vanessa Hidden
(Soprano) accompagnée en souplesse par Marcus Price (piano). En
perspective : de savoureux moments de détente et de bonne humeur.

Les
plus belles Prières du Jazz. That’s Jazz Prayers. JADE (www.jade-music.net). CD 699 769 – 2.
TT : 50’ 58.
Les éditions JADE poursuivent leur
Collection très prisée « Les plus belles prières de la chanson
française » ; la présente réalisation concerne le jazz, avec des
œuvres très représentatives de Louis Armstrong, Duke Ellington, mais aussi Mahalia Jackson et de l’incontournable The Golden Gate Quartet.... Les amateurs retrouveront avec bonheur les grands
succès : Nobody knows the Trouble
I’ve seen, The Battle of Jericho,
Down by the Riverside ;
découvriront the Sinner’s Prayer de Ray
Charles et God bless The Child
de Billie Holiday. Ils seront aussi sensibles à l’imprégnation religieuse noire américaine avec Hallelujah (Ella Fitzgerald) et The Lord’s Prayer (Dina Washington, avec orchestre et chœur),
datant de 1950. Quinze pièces parmi lesquelles ils reconnaîtront aussi les
mélodies traditionnelles : Adeste fideles en latin ou encore Silent Night, Holy Night. Nul ne restera
insensible à cette confrontation historique faisant revivre les grandes voix du
jazz religieux au XXe siècle : That’s Jazz Prayers indeed.

Un Noël baroque. RICERCAR (www.outhere-music.com ). RIC 329. 3 CD. TT : 3h 57’.
Sous le titre général : A Baroque Christmas (Noël baroque), est regroupée une compilation
de Noëls traditionnels pour chœur,
orgue et ensemble instrumental : allemands (S. Scheidt, D. Buxtehude, M. Weckmann, H. Schütz, J. S. Bach), italiens (A. Corelli, F.
Caccini, G. Bassano, T. Merula), anglais (W. Byrd) et
français (E. du Caurroy, J.-F. Dandrieu, H. Du Mont,
L.-C. Daquin). Accompagnés d’un imposant texte de
présentation, les 3 CD sont interprétés par des Ensembles bien connus : Vox luminis, Ricercar Consort, La Fenice et Les Agrémens (Jean Tubéry), le Chœur de Chambre de Namur, Akadêmia
(Françoise Lasserre)… par des organistes Bernard Foccroulle,
Freddy Eichelberger… et des solistes prestigieux.
Voici presque 4 heures d’enregistrement permettant de célébrer Noël en écoutant
des pages célèbres (en 5 langues) : par exemple : Puer natus in Bethlehem, Angelus ad Pastores ait,
Es ist ein Ros entsprungen, Wie schön leuchtet der Morgenstern (Brillante étoile du matin), Où
s’en vont ces gais bergers ?, Lullaby, my sweet little
Baby, Nascere dive puellule… ;
des pièces d’orgue : Pastorale
en Fa Majeur (BWV 590) de J. S. Bach,
Noël X (Grand jeu et duo) et Noël (en récit, en taille…) de L.-Cl. Daquin… ou encore des œuvres plus développées avec chœur et
orchestre. Coffret incontournable pour célébrer Noël dans l’atmosphère baroque.

J. S. BACH : Kantaten
zu Advent BWV 36, 61, 62. RONDEAU PRODUCTION
(www.rondeau.de ). ROP 4040. TT : 69’ 28.
Rondeau Production a, dans une perspective
comparative, eu raison d’associer ces 3 Cantates qui, toutes, exploitent le
Choral Nun komm, der Heiden Heiland, paraphrase
allemande de Martin Luther d’après l’Hymne de Saint Ambroise de Milan, mort en
397 : Veni Redemptor gentium. Ce remarquable CD appartient à la Collection
regroupant des Cantates du Cantor de
Leipzig, selon le déroulement de l’Année liturgique. Le présent disque concerne
l’Avent, avec l’annonce de la venue du Rédempteur. Les Cantates 61 (décembre 1714) et 62
(décembre 1724) sont éponymes, mais présentent des structures et des paroles
différentes. La paraphrase chantée allemande Nun komm, der Heiden Heiland — par rapport à l’incipit chanté latin Veni Redemptor gentium —, contient un monosyllabe
supplémentaire : Nun,
signifiant : « maintenant », ce qui a entraîné le dédoublement
de la première note de la mélodie multiséculaire. Ces deux Cantates, bien
connues, sont réunies avec la Cantate
36 : Schwingt
freudig euch empor (décembre 1731) qui commence précisément par le
choral Nun komm, der Heiden Heiland. Ces trois
Cantates, composées à Weimar et Leipzig, sont enregistrées par le célèbre Thomanerchor et le prestigieux Orchestre du Gewandhaus de cette ville et placés sous la baguette si
précise du Cantor Georg Christoph Biller qui leur confère tout leur sens, le
relief souhaité, l’attente et la joie caractéristiques du temps de
l’Avent : encore une version de référence à l’actif de l’éditeur et des
interprètes, tous leipzicois.

Les
plus beaux Noëls du Jazz. That’s Christmas Jazz. JADE (www.jade-music.net). CD 699 770 – 2. TT : 56’ 49.
Dans sa Série bien connue « Les plus
beaux… (Les plus belles…) », les Éditions JADE
proposent une brève Anthologie de chants de Noël appartenant au fonds
traditionnel « jazzifié » et au répertoire contemporain. Les
discophiles écouteront avec intérêt, voire surprise : O Tannebaum (Mon beau sapin) par Nat King
Cole (1960) ; Silent Night, Holly Night (Voici Noël, ô douce
nuit) de Mahalia Jackson (1955). Ils retrouveront
avec plaisir les grands succès : White
Christmas (Louis Armstrong…, 1949 ; Sidney Bechet, 1958) ; Santa Claus is coming to town (Frank
Sinatra, 1947), Boogie Woogie Santa
Claus (Lionel Hampton et son Orchestre, 1950), Santa Claus Got Stuck
In My Chimney (Ella
Fitzgerald…, 1950) ; Blue Christmas
(Miles Davis et Gil Evans, 1962) ; des chants faisant allusion à la
Nativité, à Harlem, au paysage hivernal, à la neige… ; sans oublier
l’incontournable Amazing Grace (Mahalia
Jackson, 1947). De quoi varier et diversifier le répertoire lors des fêtes de
Noël.

Édith Weber.
Jean-Sébastien
BACH : Inventions et Sinfonies : Marie-Ange
LEURENT et Eric LEBRUN, orgue Grenzig de
Saint-Cyprien-en Périgord (France). 1 CD Bayard Musique : 04813. TT.: 53'58.
Ce très beau CD est
une véritable découverte ! Nous n’avons sûrement pas oublié les inventions à 2
et 3 voix de Bach que tout apprenti pianiste a étudiées dans son enfance.
Conçues par leur auteur comme une méthode pédagogique pour rompre les jeunes
élèves au jeu simple à deux voix, puis « à savoir s’y prendre correctement
et aisément avec trois parties obligées », et « acquérir l’art du cantabile et l’avant-goût de la
composition », ces pièces deviennent, par la magie de l’orgue, de
véritables joyaux ! Ces transcriptions pour orgue, effectuées avec talent
par Eric LEBRUN et Marie-Ange LEURENT, leur confèrent en effet un relief, une
couleur, une grande variété dans le choix des timbres et des jeux, révélant
ainsi la grande portée artistique de ces très belles pages que nous ne
considérions que comme de simples études. Les quinze Inventions et les quinze Sinfonies que Bach avait groupées par tonalités chromatiques
ascendantes majeures et mineures (excluant toutefois les tonalités les plus
difficiles) préparent déjà à l’étude du Clavier
bien tempéré (où figurent toutes les tonalités). Nos deux interprètes ont
préféré ici les classer par « temps liturgiques », selon leurs
tonalités, commençant par mi b
majeur, symbole de la Sainte Trinité. Même si ce n’était pas là le dessein de
Bach, l’idée proposée est intéressante. De plus, il est certain que le duo
réputé formé par Eric LEBRUN et Marie-Ange LEURENT contribue, grâce à ce bel
enregistrement exécuté sur le superbe instrument de l’Abbatiale de
Saint-Cyprien en Périgord, à éclairer d’une lumière nouvelle une des multiples
facettes du génie du grand Cantor.

Francine Maillard.
***
Haut
Passer une publicité. Si
vous souhaitez promouvoir votre activité, votre programme éditorial ou votre
saison musicale dans L’éducation musicale,
dans notre Lettre d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me
contacter au 01 53 10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
Laëtitia Girard.
l.girard@editions-beauchesne.com
Projets d’articles sont à
envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Livres, partitions et CDs
sont à envoyer à la rédaction de l’Education musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale