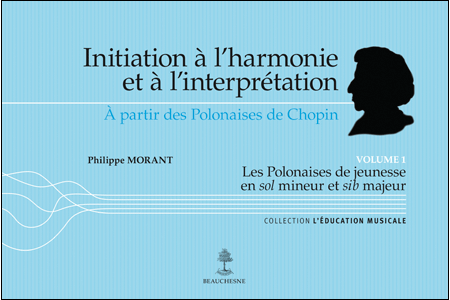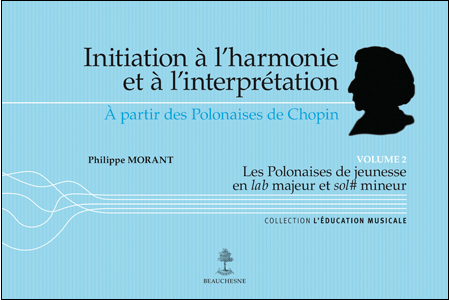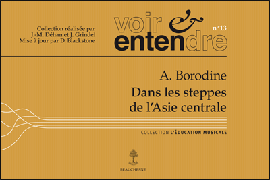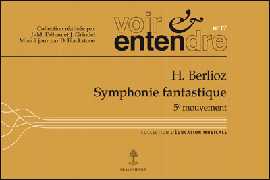PAROLES D'AUTEUR : BOHUSLAV MARTINU OU L’EXIL PERMANENT
PROPOS PARTAGÉS : BERTRAND CHAMAYOU, UN PIANISTE DANS SON TEMPS !
FESTIVALS! NOHANT, BEAUNE ET LES AUTRES ...
LE FESTIVAL DE VERBIER : EXCELLENCE ET PEDAGOGIE AU SOMMET
L'AGENDA
4 / 9 – 16 / 10
Le Festival de Laon : « Variations symphoniques »

Le thème choisi pour la 28 ème édition du festival de Laon « Variations
Symphoniques » veut focaliser sur la diversité des répertoires proposés
autour de 6 grands concerts d'orchestre et d'un large panorama de la pratique
symphonique, mais aussi sur une pluralité de formations : Orchestre
Philharmonique de Radio France, Orchestre National de Lille, Orchestre de
Picardie, Orchestre Français des Jeunes, et bien sûr, Les Siècles. Une
orientation essentielle du festival est aussi de l'ancrer dans une action
territoriale visant la jeunesse. Ainsi pour la première fois, la Symphonie des
Siècles, atelier départemental d'orchestre symphonique proposé aux élèves des
conservatoires et écoles de musique de l'Aisne, se produira-t-elle au festival
sous la direction de François-Xavier Roth, en conclusion de son second stage de
travail annuel. Le festival de Laon est en effet un acteur régulier des
initiatives pédagogiques initiées par l'ADAMA
(Association pour le développement des activités musicales dans l'Aisne) en
direction du secteur scolaire, des pratiques amateurs et de la formation,
notamment à travers le Schéma départemental de développement des enseignements
artistiques. Un partenariat est désormais mis en place aussi avec l'Association
« les Concerts de Poche », permettant de proposer à des publics de
quartiers en difficulté des ateliers préparatoires au concert. Au-delà d'une
simple série de concerts, le festival représente donc un outil nécessaire du
projet de développement musical et culturel du département de l'Aisne.
Au nombre des concerts, qui
seront donnés pour la plupart à la Cathédrale de Laon, on peut citer, outre la
Symphonie des Siècles (4/9,17H) et l'Orchestre Français des jeunes (9/9,
16H30), L' Orchestre Philharmonique de Radio France
dirigé par Mikko Franck avec le celliste Edgar Moreau (24/9, 20H 30), Les
Siècles et François-Xavier Roth (29/9, 20H30) ou l'orchestre National de Lille
dirigé du piano par Christian Zacharias (7/10, 20H30
, Soissons, cité de la musique et de la danse). Deux autres évènements non
symphoniques complètent le programme : un récital du pianiste Kit Amstrong (16/9, 20H30 Laon, Grand Théâtre) et un concert du
quatuor Voce (2/10, 16H, Maison des Arts et Loisirs de Laon).
Renseignements et réservations :
Office du tourisme du Pays de Laon, Place du Parvis, 02000 Laon ; par tel. : 03
23 20 87 50 ; en ligne :
www.festival-laon.fr
17 / 9 – 16 / 10
Paysages anglais et italiens au Festival Terpsichore

Pour sa troisième édition, le Festival
Terpsichore qui se propose à la fois de valoriser un patrimoine musical peu
connu et de jouer dans des lieux historiques de la capitale, revisitera des
répertoires majoritairement anglais et italiens, en passant par un Grand Tour
musical à travers l'Europe du XVIII ème siècle. A
l'occasion du 30 ème anniversaire du Capriccio Stravagante, des concerts de l'Ensemble seront présentés
conjointement avec le Collegium Vocale Gent ainsi
qu'avec l'ensemble vocal belge Vox Luminis et Lionel
Meunier. Deux festivals sont partenaires de la manifestation : celui de Saintes
et celui d' Utrecht.
Ainsi le concert intitulé « The Grand
Tour », associera-t-il masques et musiques (Marais, Rameau, Vivaldi, Bach
ou Telemann) pour savourer des correspondances musico-littéraires à travers un
récit de voyage dans les grandes villes de France d'Italie ou d'Allemagne (17
et 18/9, 16H Salle Erard). L'Ensemble Masques et la violoniste Cécilia Bernardini illustreront le théâtre
musical de Telemann (17/9, 20H30 Salle Erard). De même que les Anthémes et les Fantaisies de Purcell le seront par le
Capriccio Stravagante et le Collegium
Vocale Gent dirigés par Skip Sempé (26/9, 20H30, Église Saint-Louis-en-l'Île).
L'Huelgas Ensemble de Paul Van Nevel présentera le
recueil « The Eton Choirbook », livre de
chœur de la période des Tudor (6/10, 20H30, Temple de Pentemont).
Le concert « Venezia Stravagantissima
» sera prétexte à entendre les œuvres de Monteverdi, Gabrielli,
Vecchi et leurs contemporains pour une soirée
musicale offrant canzone, musiques de danse, madrigaux et transcriptions
instrumentales de ces derniers (10/10, 20H30, Église Saint-Louis-en-L'Île).
Le festival se conclura avec l'Ensemble Résonances pour un programme de musique
de la dynastie des Tudor, « The Teares of
Muses » (15/10, 16H, Salle Erard), Les Voix Humaines et le ténor Charles
Daniels pour un récital d'œuvres de frères Henry et William Lawes
(15/10, 20H30, salle Erard) et enfin le Capriccio Stravagante
Viols et le luthiste Thomas Dunford qui découvriront
le recueil des « Lachrimae » de John
Dowland (16/10, 16H. Salle Erard).
Renseignements et billetterie : par tel. : 01
86 95 24 72 ; en ligne : www.terpsichoreparis.com ou info@terpsichoreparis.com.
21, 23, 25, 27, 30 / 9 & 7, 9 / 10
The Turn of the Screw
à l'Opéra du Rhin

Le saisissant opéra de Benjamin
Britten, The Turn of the Screw
(1954, Venise), si peu joué, revient à l'affiche grâce à l'Opéra du Rhin.
Inspiré de la nouvelle d'Henry James, cet opéra de chambre narre l'histoire
trouble de deux enfants, Miles et Flora, en apparence ''normaux'', adoptant peu
à peu un comportement étrange, envoûtés qu'ils sont par le fantôme de deux
anciens domestiques. La jeune gouvernante fraichement installée pour en
surveiller l'éducation va connaître un chemin d'enfer : l'écrou dramatique se
referme sur elle. Par une musique d'une fabuleuse précision due à un effectif
instrumental restreint, Britten installe un terrible suspense où l'implicite
est érigé au rang de principe dramaturgique pour traiter de l'innocence de
l'enfance, pervertie, de l'ambiguïté des rapports entre adultes et enfants, de
l'enfermement de six personnages s'enfonçant dans la détresse. On attend
beaucoup de la mise en scène de Robert Carsen dans un
opéra proche du huis clos, et de la direction musicale de Patrick Davin à la tête de son Orchestre symphonique de Mulhouse.
Opéra du Rhin à Strasbourg les
21, 23, 27 et 30 septembre 1016 à 20H et le 25/9 à 15H, puis Mulhouse/La
Filature, les 7 (20H) et
9/10 (15H)
Réservations :
Opéra de Strasbourg : 19, Place Broglie, BP 80320, 67008 Strasbourg cedex ; par
tel. : 03 68 98 51 80.
La Filature/Mulhouse, 20, Allée Nathan- Katz,
68090 Mulhouse cedex ; par tel.: 03 89 36 28 29 .
En ligne : caisse@onr.fr
22 - 25 / 9
Quatre x Quatre : un festival de quatuors à Rouen

Quintessence de la
musique classique, le quatuor à cordes est l'objet d'un nouveau festival à
Rouen fin septembre ! Dans l'écrin acoustique que constitue désormais la
Chapelle Corneille, les meilleurs ensembles du moment, toutes générations
confondues, se succéderont sans relâche. De Haydn à Bartók, de Mozart à Webern,
en passant par Ravel ou Debussy, c'est à un panorama général du genre
chambriste que le public est convié. On y entendra successivement les Diotima (Webern, Schubert ''Rosamunde''
et Bartók N°5 ; 22/9), les Cambini (N°1 de Gounod,
Mozart et Haydn ; 23/9). Une première journée nonstop, le 24, réunira les Van Kuijk (Kurtag, Debussy et Ravel,
14H), les Zaide (Beethoven op. 18/3, Bruckner Intermezzo,
Franck,17H), et une soirée de luth donnée par Thomas Dunford,
20H). Une seconde journée, le 25, présentera le Quatuor de l'Orchestre de
l'Opéra de Rouen (Haydn op. 77/2, Brahms op. 51/1 et Webern, 11H), les Arod (Mozart 14 ème, Bartok N°3 et Beethoven op. 132, 14H30), enfin les Danel (Mendelssohn op. 80, Schubert ''La jeune fille et la
mort'', Weinberg N°16, 17H30). Quatre jours pour les quatuors, le Festival
Quatre x Quatre, co-réalisé avec l'Opéra de Rouen
Normandie, devrait ravir les amateurs et les autres en ce début d'automne
normand.
Chapelle
Corneille, Rouen, du 22 au 25 septembre 2016, horaires variables.
Réservations : Billetterie de l'Opéra de
Rouen, 7 rue du Docteur Rambert, 76000 Rouen ; par tel. : 02 35 98 74 78 ; en
ligne : billetterie@operaderouen.fr
28 / 9, 11 & 12 / 10
Les Surprises créent Les Éléments

©Amélie
Pialoux
L'Ensemble Les
Surprises entame une tournée au cours de laquelle sera présentée leur
dernière création : Les Eléments,
vaste opéra-ballet composé à quatre mains par André Cardinal Destouches et
Michel Richard Delalande.
« Après le travail sur les opéras de Rebel et Francœur, je souhaitais poursuivre la démarche d'adaptation
d'ouvrages lyriques en versions « d'opéras de salon ». En effet,
cette pratique qui peut aujourd'hui nous surprendre était très courante aux
XVII et XVIII siècles. Cela permettait de déplacer les opéras dans
des lieux plus petits, et l'on pouvait ainsi jouir des dernières œuvres à la
mode dans un cadre plus familier que celui de l'Académie royale de musique de
Paris.
Les Éléments fut un des opéras les plus prisés durant
le XVIII siècle, repris et
arrangé à de nombreuses occasions. À partir des diverses sources qui nous sont
parvenues aujourd'hui, j'ai souhaité reconstituer une version de salon de cette
œuvre ; les trois chanteurs passant tour à tour des rôles principaux aux
chœurs. L'effectif choisi ici permet de représenter les couleurs instrumentales
de l'orchestre français, tout en restant dans une dimension soliste. On ne
s'étonnera pas non plus de la présence d'instruments tels que la viole de gambe
ou le théorbe, qui disparurent de l'orchestre de l'opéra probablement autour de
1730, mais continuèrent à être grandement appréciés dans les cours royales
et les milieux bourgeois », souligne
le chef Louis-Noël Bestion de Camboulas.
L'œuvre, qui sera
donnée trois fois, sera interprétée par l'Ensemble Les Surprises (Hasnaa Bennani, soprano,
Eugénie Lefebvre, soprano, Étienne Bazola, baryton,
Joan Vercoutere, danse) dirigé du clavecin par
Louis-Noël Bestion de Camboulas,
et mise en scène par Édouard Signolet.
Festival d'Ambronay, le 28 septembre 2016 à 19H (toutes les infos sur ce lien), puis au Festival de Pontoise,
le 11 octobre à 20H30 (toutes les infos sur ce lien) et enfin à l'Auditorium du
Louvre, le 12/10 à 20H.
29 / 9 - 6, 8, 9 / 10
Pré rentrée à l'Opéra
Comique

DR
L'Opéra Comique et
le Musée d'Orsay s'associent dans un spectacle commun autour de l'exposition « Spectaculaire Second Empire. 1852 -1870 » (du 27
septembre 2016 au 16 janvier 2017 au Musée d'Orsay).
Une façon d'illustrer leur parenté : inaugurées à quelques mois d'intervalle à
la fin du XIXe siècle, la salle Favart et la Gare d'Orsay
présentaient la même heureuse conjonction entre modernité technique et
raffinement décoratif. Les patrimoines présentés aujourd'hui dans leurs murs respectifs
déploient les richesses du siècle romantique, animé de courants artistiques
divers, de tensions entre art officiel et modernité et de rencontres inédites
entre les arts. Invité à coproduire un spectacle musical à l'auditorium, l'Opéra Comique a imaginé une soirée éclectique qui rend
justice au foisonnement théâtral que favorisa le régime de Napoléon III. Ainsi
le spectacle est-il construit autour d'Offenbach, le chantre et le compositeur
favori du Second Empire, dont la redécouverte de son chef-d'œuvre oublié Fantasio
marquera l'ouverture de la saison 2017 de l'Opéra Comique.
Un dîner avec Jacques, opéra bouffe d'après Jacques Offenbach : au cours d'un souper dans un salon de la haute
société du Second Empire, où tout n'est que paraître, des convives exaltés par
la sensualité de la bonne chair abandonnent progressivement leurs masques pour
laisser libre cours à leurs fantasmes, au rythme jubilatoire de la musique
d'Offenbach. Au menu : Geneviève de Brabant, Madame l'Archiduc, La Rose
de Saint-Flour, La Princesse de Trébizonde et autres morceaux
choisis du grand Jacques. La direction musicale sera assurée par Julien Leroy
qui dirigera Les Frivolités Parisiennes, et la mise en scène par Gilles Rico. A
noter que le programme sera repris au Théâtre de Bastia le 7
janvier 2017 et à au Théâtre Impérial de Compiègne, le 20 janvier, dans le
cadre des Folies Favart.
Auditorium du Musée d'Orsay, les 29 septembre et
les 6, 8 octobre 2016
à 20H et le 9/10 à 16H.
Renseignements et
réservations : au musée d'Orsay ; par tel.: 01 53 63
04 63 : en ligne :
www.musee-orsay.fr/fr/info/contact/demande-concernant-lauditorium.html
30 / 9, 2, 4, 7, 9, 11 / 10
Béatrice et Bénédict à Toulouse

Berlioz, Shakespeare... une
conjonction qui ne saurait être que fructueuse. Et qui l'est encore en ces
années 1860 où le vieux maitre s'amuse à écrire un opéra-comique sur Beaucoup
de bruit pour rien, un projet caressé de longue date. L'œuvre sera créée au
théâtre de Baden-Baden en 1862. C'est une comédie douce
amère mais pleine de vie à l'aune de son ouverture emplie de verve, qui
la résume. Si elle frise à certains moments l'exubérance, la musique nourrit
quelque tendresse à l'image des deux héros qui se chamaillent mais ne peuvent
vivre l'un sans l'autre. Librement adapté par Berlioz lui-même, non sans
conservatisme, le texte du grand Will n'en livre pas moins une amusante
digression réaliste sur l'amour et ses illusions. La nouvelle production du
Capitole est confiée à Richard Brunel et sera dirigée par Tito Ceccherini. La distribution est prometteuse.
Théâtre du Capitole, les 30 septembre, 4, 7, 11 octobre 2016 à 20H et les 2
et 9/10 à 15H.
Réservations : billetterie : place du
Capitole, BP 41408 Toulouse Cedex 6 ; par tel.: 05 61
63 13 13 ; en ligne :
service.location@capitole.toulouse.fr
4 / 10
Musiques anglaises à Notre-Dame de Paris

Benjamin
Britten / DR
La nouvelle saison musicale des
concerts de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris s'ouvrira sur des œuvres
de Benjamin Britten et Ralph Vaughan Williams et plongera l'auditeur
dans l'univers grandiose et solennel de l'Angleterre du XXe
siècle. La Maîtrise Notre-Dame de Paris au grand complet, accompagné d'Yves Castagnet au grand orgue, jouera sous la direction d'Henri
Chalet. Benjamin Britten, personnalité marquante et incontournable du XX ème siècle, et grand représentant d'un nouvel élan musical,
a fortement marqué la culture britannique. Il sait, comme peu de compositeurs,
sublimer ce talent anglais de l'adéquation entre la ligne mélodique idéalement
écrite pour la voix et la force du texte. Seront joués : Hymn
to the Virgin, Jubilate Deo en
Do, Rejoice in the lamb,
Jubilate Deo en Mi bémol. Autre grande œuvre de
la musique pour chœur à (re)découvrir, la Grande
messe à double chœur, a cappella de Ralph Vaughan Williams (1872-1958),
éblouira de sa pureté harmonique et du sentiment sincère et jubilatoire de ce
compositeur dans une musique so british ! On
entendra aussi Lux Aerterna d'Edward Elgar
(1857-1934) et The Lamb de John Taverner
(1944-2013).
Notre-Dame de Paris, le 4 octobre 2016 à 20H30.
Réservations : Accueil de la Cathédrale Notre-Dame de Paris ; par
tel. : 01 44 41 49 99. www.musique-sacree-notredamedeparis.fr
6, 7 / 10
Les musiques du baroque méridional

A l'occasion des 30 ans de l'Orchestre Les
Passions, une manifestation d'envergure aura lieu à Toulouse et à Montauban
autour des Musiques du Baroque méridional, comportant trois volets :
deux concerts d'œuvres de Jean Gilles (1868-1705) et d'Antoine-Esprit Blanchard
(1696-1770), un colloque universitaire organisé par le laboratoire LLA-Créatis de
l'Université Jean-Jaurès de Toulouse et enfin des rendez- vous publics
dans les deux villes autour d'une exposition « Les Maitres du Baroque
méridional » à la Bibliothèque municipale de Toulouse (15 septembre-15
octobre) et d'une autre sur la musique baroque au Conservatoire de Montauban
(aux mêmes dates).
Le colloque universitaire sur « Musique,
Culture et Identités dans les provinces du Sud Ouest
de la France, XII ème-XVIII ème
siècles » dont les travaux se concentreront sur les pratiques musicales
dans la vie culturelle publique et privée des provinces de Languedoc et de
Guyenne d'alors, réunira plusieurs grands experts de Musique baroque française,
sous la présidence d'honneur de Gilles Cantagrel (6
& 7 octobre). Les deux concerts des 5 et 6 octobre, respectivement, au
Temple des Carmes à Montauban (20H) et à la Cathédrale Saint Étienne de
Toulouse (20H30), seront l'occasion d'entendre l'emblématique Requiem de
Jean Gilles et les deux motets Magnificat et In excitu
Israël d'Antoine-Esprit Blanchard, objet des récentes recherches
musicologiques du chef de l'Orchestre Les Passions, Jean-Marc Andrieu. Ces
œuvres seront également interprétées par le chœur Les Éléments dont le
directeur est Joël Suhubiette.
Réservations : festival international TLO/Odyssud,
22 bis rue des fleurs, 31000 Toulouse ; par tel : 05 61 33 76 80 ; en ligne : www.toulouse-les-orgues.org
Temple des Carmes et Conservatoire de Montauban: Grand'Rue Sapiac, 82000 Montauban ; par tel : 05 63 22 19 78.
Autres liens : De l'orchestre : www.les-passions.fr De l'Université
Jean Jaurès laboratoire LLA-Créatis, 5 Allée Antonio
Machado, Toulouse : http://lla-creatis.univ-tlse2.fr
Jean-Pierre Robert.
***
PAROLES D'AUTEUR
Bohuslav Martinů (1890-1959) ou l'exil
permanent(1)
Si l'homme naissait
cinquantenaire, dans l'épanouissement de l'âge, il n'y aurait pas de poésie. Et
comme ils seraient rares ceux qui atteindraient l'enfance !
Vítězslav
Nezval (1900-1958)
Au terme d'une longue
filiation dont l'origine remonte à Bedřich Smetana (1824-1884),
Martinů (1890-1959) apparaît telle une figure fort surprenante. Pour la
première fois dans l'histoire de la musique tchèque, un compositeur vivra la
plus grande partie de son existence à l'extérieur de sa patrie. Certes, Antonín
Dvořák (1841-1904) a passé quelques années à New York (1892/95) mais cela
n'est en rien comparable avec l'existence que son cadet a été obligé de subir. Une question,
peut-être iconoclaste, se pose dès l'abord : Martinů, être d'une
extrême sensibilité, est-il encore Tchèque dans son langage ; autrement
dit, est-il le successeur naturel de la triade Smetana-Dvořák-Janáček(2) ? D'aucuns attestent qu'il a été le
compositeur tchèque le plus important au XXe siècle. Il est certain
que, s'il a quitté son pays qu'il aimait profondément, c'est à cause des
dramatiques événements qui ont secoué son siècle.
Dès l'abord, l'étude de son parcours, de même
que l'écoute de son œuvre, s'avèrent complexes. De ce fait et eu égard à
l'important catalogue de sa musique ainsi qu'à la multitude enchevêtrée
d'épisodes qui concernent le cours de sa vie, je me limiterai à quelques faits
et partitions que j'estime caractéristiques.

Bohuslav Martinů en 1943 © Bohuslav Martinů
Centrum Polička
1890/1923 –
Enfance et apprentissages
Bohuslav – fils du cordonnier Ferdinand
Martinů (1853-1923) et de Karolina Klimešová (1855-1944) – est né à
Polička, en Bohême, au cœur de la paradisiaque Vysočina, le 8
décembre 1890, l'année au cours de laquelle Dvořák a commencé la
composition de son Dumky-Trio. Pietro Mascagni (1863-1945) avait composé
son fameux Cavalleria Rusticana (1889) qui connaîtra, d'ailleurs, un
immense succès en Bohême. Dans le même temps, le chancelier Otto von Bismarck
(1815-1898) était renvoyé par l'Empereur, départ qui allait marquer le début de
la « paix armée » en Europe. Sur une autre planète de l'esprit, le
grand psychologue William James (1842-1910) publiait The Principles of
Psychology établissant, de la sorte, sa discipline telle une science
autonome.
Polička était alors une charmante
bourgade, témoin d'une riche culture historique hussite(3) et dotée d'un théâtre permanent, l'un des
plus importants de Bohême. Les artisans, verriers et drapiers, y vivaient
heureux. Polička n'était distante que de seize kilomètres de Litomyšl, la
ville natale de Smetana et de la mère de Bohuslav. Ce lieu, empreint par la
poésie, allait frapper la fervente imagination de cet enfant doté d'une grande
fragilité psychologique. La musique fera très vite partie de sa vie. Dès l'âge
de sept ans, il prenait des cours de violon chez un certain Josef
Černovsky avant d'étudier auprès du premier violon de l'orchestre local,
Antonín Růzha.
Le 21 janvier 1904, Jenůfa
(1894/1903) de Janáček était créé au Deutsches Nationaltheater de Brünn
[Brno]. Dvořák s'éteignait à Prague le 1er mai suivant, à l'âge
de soixante-trois ans. Avec ce merveilleux compositeur, la tradition tchèque
qu'il avait sublimée et forgée après Smetana allait connaître une autre forme
de destinée. Janáček, indéniablement, suivait son propre cheminement pour
le moins largement incompris.
Le 19 août 1905, Bohuslav jouait pour la
première fois en tant que soliste. C'était à Borová, un village tout proche. Il
fut même cité par le journal local Jitřenka. Il fallait absolument
faire fructifier ses dons. Pour cela, Prague et son Conservatoire devaient
constituer un objectif malgré les frais importants que cela occasionnerait. Au
cours de l'été, le jeune garçon fut présenté au professeur Jan Mařák
(1870-1932). Les dons instrumentaux de Bohuslav étaient si évidents que
quelques personnalités locales entreprenaient aussitôt de solliciter les
autorités en ces termes :
Un soir, dans la salle du Conseil municipal de Polička, parmi les jeunes
musiciens de quinze ans, il y avait Bohuslav Martinů […] qui joua
plusieurs pièces de violon. Sa première apparition en public stupéfia, dans le
vrai sens du terme, tous les connaisseurs. Dans sa chétive et modeste
silhouette, nous rencontrâmes le rare talent d'un futur artiste, un futur
maître du violon. Dieu lui fit don d'un talent qui pourra le mener loin vers le
but qu'il désire atteindre, ou le conduire au pire s'il veut […] déjouer les
attaques de l'indifférence publique vis-à-vis de sa situation sociale et
financière. […] Il est indéniable que le devoir du public est de garantir à ce
pauvre garçon ce que son père, si méritant, est incapable, dans sa pauvreté, de
faire pour lui. Ceci n'est pas le fait de quelques individus qui voudraient
imposer leur point de vue aux autres, mais surtout celui du professeur
Mařák qui, ayant entendu l'enfant jouer, découvrit son immense talent et
lui promit pleine assistance pour ses études dans sa classe du Conservatoire de
Prague. […] Il promit de le préparer lui-même pour le concours. L'enfant n'a
pas suivi, jusqu'ici,
d'enseignement à proprement parler, mais simplement quelques rudiments, et ce
qu'il sait jaillit de lui-même comme un art de pur cristal. Il est entièrement
autodidacte. […] Pour ces raisons, nous faisons appel à votre honorable
assemblée pour mesurer toutes ces circonstances et accorder une assistance
charitable au talent du jeune garçon …(4).
Quelle touchante pétition. Une bourse de 100
florins était généreusement accordée. En septembre 1906, Bohuslav, « petit
visage chétif et modeste », ayant réussi brillamment le concours d'entrée,
commençait ainsi ses études de violon au Conservatoire de Prague. Pourtant, le
compositeur était déjà très présent en lui. Le passé praguois, contre toute
attente, allait le désespérer. C'est en cela qu'il se détachera progressivement
de la tradition suscitée par le fondateur Smetana. En d'autres termes, pour le
jeune Martinů, Libuše – l'ancêtre mythique de la dynastie des
Přemyslides et du peuple tchèque en général – ne revêtait pas de
signification particulière. Les règles imposées dans la capitale vont étouffer
cet esprit épris de liberté. Pour commencer, il décide qu'il ne sera pas
violoniste, au grand dam de ses protecteurs. Il préfère vivre sa vie et faire
partie d'un orchestre d'amateurs. Dans le même temps, la rupture avec
Polička était consommée. Les siens ne comprenaient pas. En réalité, ils ne
pouvaient pas admettre une telle attitude qu'ils jugeaient pour le moins
arrogante après tous les sacrifices consentis.
Bohuslav s'était lié d'amitié avec le
violoniste Stanislav Novák (1890-1945) avec lequel il mena une vie assez
désorganisée au regard de ses professeurs et de ses parents. Ils lisaient
ensemble les textes du dramaturge suédois Johan August Strindberg (1849-1912)
et du romancier polonais Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940) tout en
rêvassant sur les bords de la Vltava.
En 1908, Bohuslav assiste à la première, en
allemand, de Pelléas et Mélisande (1893/1902) de Claude Debussy (1862-1918),
« la plus grande révélation de sa vie ». Bien des commentateurs ont
pensé que cette musique allait véritablement déterminer son esthétique. Qu'il
soit permis d'en douter.
Après un début catastrophique au
Conservatoire, il décide de s'inscrire dans la classe d'orgue où il entre le 15
septembre 1909. Pourquoi ce revirement et le choix d'un instrument qui ne
comptera guère pour lui en tant que compositeur ? Parce que son
enseignement était aussi dédié à la composition. Mais cela fut encore un échec qui
aboutit à son exclusion du Conservatoire, pour « négligence
incorrigible », le 4 juin 1910. Ses parents obtempérèrent néanmoins et
l'autorisèrent à demeurer à Prague où il vivra libre et heureux mais pauvre. Sa
création est, en dépit de tout, singulièrement stimulée en cette année 1910 à
tel point qu'il juge bon de commencer déjà à numéroter ses œuvres, l'opus 1
étant Smrt Tintagilova (« La Mort de Tintagile ») H. 15,
d'après l'écrivain belge Maurice Maeterlinck (1862-1949). Cette partition lui
avait été inspirée par une adaptation du texte pour le Théâtre de marionnettes
de l'association Mánes, du nom du peintre Josef Mánes (1820-1871). En effet, la
tradition des marionnettes était et reste très vivante en Bohême. Elle
fascinait, à juste titre, le jeune Martinů. L'attitude envers le
patrimoine tendait cependant à changer d'où la dualité, parfois antithétique,
qui va se tisser dans l'esprit de Bohuslav entre le folklore et l'attirance
pour un monde plus large. La fin d'une époque était encore marquée par la
disparition de personnalités aussi emblématiques que l'écrivain, poète et
journaliste Svatopluk Čech (1846-1908) et de l'éminent professeur de
littérature Jaroslav Vrchlický (1853-1912). Et, en 1912, paraissait l'étonnant
et drolatique Brave soldat Švejk de Jaroslav Hašek (1883-1923). La même
année, le compositeur académique Vítězslav Novák (1870-1949), alors
président du jury de l'examen d'État, accordait enfin, après le lui avoir
refusé, son diplôme d'aptitude à l'enseignement du violon à Bohuslav. Après
1913, il est nommé second violon de la Philharmonie Tchèque dont les rangs
seront clairsemés par la mobilisation.
Martinů passera la terrible période de la
Grande Guerre (1914/18) à Polička sans produire autant que les années
précédentes. Il avait réussi à se faire réformer de manière un peu douteuse. De
plus, sa réputation était entachée. Ses proches ne l'estimaient plus après
l'avoir porté aux nues. Finalement, à leurs yeux, il n'était qu'un petit
professeur de violon de l'école de garçons locale. Toutefois, sa Česká
rapsódie H. 118 (mai-juin 1918), pour orchestre, chœur et orgue, fortement
influencée par le discours de l'auteur dramatique Alois Jirásek (1851-1930),
lui apportera une consécration officielle. Le 24 janvier 1919, elle sera même
donnée pour la seconde fois en présence du Président Tomáš Garrigue Masaryk
(1850-1937). Pendant cette sombre époque, il a heureusement fait la
connaissance de gens tout à fait remarquables, le pasteur Vladimír Čech et
son épouse, dans le proche village de Borová. Il prit alors conscience, à leurs
côtés, de la culture hussite à l'origine de la Réforme luthérienne. Sa Česká
rapsódie pour baryton, chœur, orchestre et orgue en est l'expression
musicale la plus accomplie avec le cantique Svatý Václave qui en
constitue la trame principale.
Le 28 octobre 1918, la République de
Tchécoslovaquie était proclamée. Martinů organise à Polička un
« Concert solennel pour célébrer la déclaration de l'État tchèque et
honorer ses légionnaires » avec des partitions de Dvořák et Tchaïkovski
(1840-1893).
L'année 1919 se présente sous de meilleurs
auspices grâce à une tournée de l'Orchestre du Théâtre national, alors dirigé
par l'intransigeant Karel Kovařovic (1862-1920), avec le chœur d'hommes de
Prague, celui, fameux, des Instituteurs moraves auxquels s'ajoutaient le
Quatuor de Bohême. Ce voyage les conduisait à Londres, Paris et Genève. Et,
Bohuslav allait enfin être titularisé en tant que second violon de la
Philharmonie Tchèque menée de façon extraordinaire par le grand Václav Talich
(1883-1961). Au cours des trois années passées au sein de cette prestigieuse
phalange, Martinů eut la révélation, le 5 janvier 1922, de l'étonnant
répertoire des madrigalistes anglais par les English Singers. L'art de
William Byrd (ca 1540-1623), Thomas Morley (1557-1602), Thomas Weelkes (ca
1576-1623) et Orlando Gibbons (1583-1625) l'enchanta.
La liberté de leur polyphonie me causa un réel plaisir. C'était très
différent de la polyphonie de Bach. Quelque chose d'entièrement neuf pour moi.
En même temps ces madrigaux avaient des caractéristiques qui me rappelaient le
folklore tchèque(5).
Quelle intéressante révélation de la part de
ce compositeur dont les attirances étaient multiples sinon contradictoires.
Pour l'heure, il n'avait qu'un seul désir en tête, quitter son pays tout neuf
pour rejoindre Paris.
1923/36 – Paris
C'est par un jour de novembre 1923 que
Bohuslav descendait du train, gare de l'Est. Le 15, il sonnait chez Albert
Roussel (1869-1937), au 57 de l'avenue de Wagram. Mais il allait bientôt
découvrir que ce qui se passait à Paris ne convenait pas à son état d'esprit.
En effet, entre Prague et la capitale française que de différences de fond
malgré certaines attirances esthétisantes. En définitive, que venait-il
chercher chez Roussel dont il ne connaissait alors probablement que Le
Festin de l'araignée (1912) et Le Poème de la forêt (1904/06). Il y
répondra par la suite en ces termes :
Je suis arrivé avec mes partitions, avec mes plans, mes projets, avec une
multitude, un chaos d'idées et c'est lui qui m'a indiqué, toujours avec
justesse et avec une précision qui lui était propre, le chemin qu'il faut
suivre, tout ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait rejeter. Il a réussi à
mettre de l'ordre dans mes pensées, mais je n'ai jamais su comment il y est
arrivé. […] Tout ce que je suis venu chercher à Paris, je l'ai trouvé chez lui,
et de plus, son amitié a toujours été le plus précieux réconfort(6).

A Paris, en 1938 ©Památnik Bohuslav
Martinů
Dans le même temps, Martinů découvrait Igor
Fyodorovich Stravinsky (1882-1971) et plus spécialement ses archaïques et
barbares Noces (1914/17), « scènes chorégraphiques russes avec
chant et musique ». En dehors de la musique, son existence parisienne
était limitée du fait de son peu de ressources. Il s'imposait une certaine
discipline ce qui n'était pourtant guère dans son caractère. Généralement, il
travaillait le matin, consacrant l'après-midi à des promenades. Sa quête
féminine, si essentielle pour lui, finit par se concrétiser un beau jour qu'il
assistait à un spectacle du cirque Medrano, à Pigalle. C'était un dimanche
après-midi, le 10 novembre 1926. Elle se nommait Charlotte Quennehen
(1894-1978), issue d'une famille modeste et ne connaissant rien à la musique.
Cette rencontre allait radicalement changer leurs vies respectives. Il
l'épousera le 21 mars 1931 à la mairie du IIe arrondissement de
Paris nonobstant les réticences de sa mère. En effet, cette relation sera assez
compliquée pour toutes sortes de raisons plus sentimentales qu'artistiques. Par
ailleurs, de solides et curieuses amitiés s'étaient nouées avec d'autres
étrangers de Paris, le Roumain Marcel Mihalovici (1898-1985), le Hongrois Tibor
Harsanyi (1898-1954) et le Suisse Conrad Beck (1901-1990) (7). Ils constituaient de la sorte la future « École de Paris »
si peu homogène et cohérente.
La mort de Leoš
Janáček, à Ostrava, le 12 août 1928, mettait un terme à un long itinéraire
que Smetana avait inauguré à sa façon. Janáček est non seulement unique
dans l'histoire de la musique tchèque et morave mais il l'est également pour
toute l'histoire de la musique. Son farouche besoin d'indépendance, sa capacité
à créer un langage si spécifique tout en s'enracinant dans un folklore aussi
juste que compris font de lui un génie et une personnalité singulièrement
attachante(8). Je ne pense pas que
Martinů, bien plus inconstant, puisse bénéficier a posteriori du même traitement malgré ses immenses qualités
humaines et esthétiques.
Les années suivantes –
malgré un contexte difficile personnel et général – seront consacrées à de
nombreuses nouvelles partitions, à des voyages, à une soif de découvertes
jamais démentie. Toutefois, l'argent manquait selon ses dires contradictoires,
il fallait manger, se loger. En dépit de ces problèmes, il refusera le poste de
directeur du Théâtre national de Prague à la suite du décès d'Otakar
Ostrčil (1879-1935). Il aurait certes préféré enseigner la composition au
Conservatoire à la succession de Josef Suk (1874-1935). C'est dans cet esprit
qu'il écrivait à un fonctionnaire du ministère de l'Instruction publique, Josef
Schieszl (1876-1970) :
Vous m'avez promis de m'aider […] J'espère
que votre opinion sur moi n'a pas changé et que vous avez toujours confiance
dans mon travail. […] J'ai le droit de demander en raison du bilan de mon
travail et des succès obtenus dans des conditions très difficiles …(9).
La réponse à cette requête manifestait, de
toute évidence, l'expression sous-jacente d'une grande hostilité de l'élite
musicale praguoise à l'endroit de Martinů jugé tel un rebelle. Il sera
davantage apprécié à Brno, la ville de Janáček. Cette déception
n'empêchera pas l'élaboration d'un projet important dès le printemps
1936 : son opéra lyrique en trois actes et cinq tableaux, Juliette.
1936/41
– Incertitudes et drames
En réalité, Bohuslav
est tiraillé entre Prague et Paris, deux villes au demeurant si différentes
sinon opposées. La première est un décor de théâtre qui, malheureusement, sera
saccagé au cours du XXe siècle jusqu'à sa tardive renaissance vers
la fin du même siècle ; la seconde a toujours entretenu un rapport ambigu
avec l'imagination. La difficulté intérieure du compositeur est étrangement
relative à ce type de dilemme. Il est intéressant de lire un peu ce qu'a écrit
Pierre-Octave Ferroud (1900-1936) à son sujet :
On le croit à Paris, il est à Prague. On le croit à
Prague, il est à la campagne. […] Cet homme qui composa sous la dictée de
quelque génie impérieux et pressé et qui a à son actif tellement d'œuvres de
musique de chambre, d'orchestre, de théâtre et de ballet, ce fantaisiste qui à
l'égard de la vie, semble avoir adopté le jeu désinvolte d'un personnage de
Musset, et néanmoins, se tient en contact avec l'actualité la plus immédiate, tout comme s'il faisait profession de bel esprit, vous pourriez croire qu'il
ne cède qu'à son propre caprice. Point du tout, car le monde qu'il ignore,
l'entoure de prévenances et d'attention, et l'accable de commandes sans qu'il
parvienne à comprendre, dans son ingénuité, comment sa notoriété s'est étendue
à ce point(10).
En 1930, Martinů
avait assisté, au Théâtre de l'Avenue(11), à une représentation de Juliette, ou la Clé des songes du jeune
dramaturge Georges Neveux (1900-1982). Ce fut un authentique scandale,
invraisemblable à ce point de nos jours. Martinů a été touché. Et Neveux
de raconter :
Un jour, je reçus de lui un pneumatique dans lequel il
faisait semblant de me demander l'autorisation de mettre Juliette en musique(12).
Une telle attitude a,
au début, fortement déplu à Neveux qui avait déjà été sollicité par Kurt Weill
(1900-1950). Mais une rencontre entre les deux hommes acheva de convaincre
l'auteur dramatique tant la musique de Bohuslav l'a ému.
Bohuslav a parfaitement compris et sa musique apportait
une dimension nouvelle que je n'avais pas entrevue(13).
L'action, étrange, se
déroule dans un rêve où Michel Lepic (ténor) cherche à retrouver Juliette
(soprano) qu'il avait jadis rencontré. L'influence du Surréalisme semble évidente.
L'opéra sera dédié au très estimé Václav Talich qui le créera au Théâtre
national de Prague le 16 mars 1938 dans un contexte mondial extrêmement tendu.
C'était une période détestable pour les Tchèques. Adolf Hitler (1889-1945)
venait d'annexer l'Autriche cinq jours auparavant après la démission du
chancelier Kurt Alois Josef Johann Schuschnigg (1897-1977) et son remplacement
par le nazi Arthur Seyß-Inquart
(1892-1946). L'annexion sera plébiscitée le 10 avril suivant. Dès son retour à
Paris, Bohuslav écrira une belle lettre à Talich si révélatrice de sa
psychologie et dont voici quelques extraits :
Très cher Ami,
Mon habitude est plutôt de taire mes sentiments mais,
cette fois-ci, je crois que je ne t'ai pas assez remercié pour Juliette. Et je ne sais même pas si jamais je pourrai
te dire combien je te suis reconnaissant de tout ton travail, de ta
compréhension et de la joie avec laquelle tu as porté cette œuvre à la scène.
Je suis tellement heureux d'être parvenu avec ton aide, à ce que j'ai toujours
cherché, c'est-à-dire toucher l'âme de l'œuvre qui est tellement cachée que
seul un vrai artiste arrive à la deviner. […] exprimer cette chose fragile et
secrète dissimulée dans l'art et dans la poésie, qui se dérobe à tout contact
sauf de la part de ceux qui la cherchent, en ont besoin pour vivre et la
considèrent comme le don le plus précieux de leur existence …(14).

Juliette ou
la Clé des songes à
l'Opéra national de Paris, acte III
Mise en scène de Richard Jones ©OnP
Dans l'intervalle, en 1937, Paul Hindemith (1895-1963) s'était opposé au
dodécaphonisme d'Arnold Schönberg (1874-1951) et avait proposé une autre voie
dans son Unterweisung im Tonsatz
(« Traité de composition »). Il semble bien que Martinů n'ait
pas eu de contact direct avec le premier. Quant au second, il a laissé son
compatriote Alois Hába (1893-1973) s'en enticher. Son cher maître, Albert
Roussel, s'était éteint, à Royan, le 23 août, âgé de soixante-huit ans.
En juin 1938,
Bohuslav est à Londres pour le Festival de musique contemporaine de la SIMC
puis il passera son dernier été en Tchécoslovaquie. En septembre, il se trouve
à Schönenberg en Suisse. Le contexte historique est loin d'être favorable avec
les désastreux accords de Munich du 29 septembre, générateurs des futurs drames.
Le 15 mars 1939, les troupes allemandes entrent en Bohême et occupent Prague.
Le 3 septembre suivant, l'Angleterre, puis la France, déclarent la guerre à
l'Allemagne. Et, le 30 novembre, l'Armée rouge attaque la Finlande.
La création, à Bâle,
le 9 février 1940, par Paul Sacher (1906-1999), de son magistral Double Concerto pour deux orchestres à
cordes, piano et timbales H. 271 (1938), lui apportera, au milieu de cette
tourmente, un certain réconfort. Il l'avait d'ailleurs composé dans le très
reposant Schönenberg, à l'orée de la forêt, celle des contes à la manière des
frères Grimm. De même que la création parisienne, le 19 mai, par le remarquable
Pierre Fournier (1906-1986) et Rudolf Firkušný (1912-1994) de son énergique Première Sonate pour violoncelle et
piano H. 277 (1939). Mais, au cours du printemps, les Allemands s'approchent de
Paris. Sur le conseil de Firkušný, Martinů et son épouse prendront le
parti de fuir vers le sud de la France. Ils seront à Aix-en-Provence au début
du mois de septembre. Leur objectif était néanmoins d'atteindre Marseille.
Cependant, la cité phocéenne était interdite à certains étrangers dont Bohuslav
faisait précisément partie. Il figurait même sur la liste noire. Après de
nombreuses péripéties, il finit par obtenir son visa pour l'Amérique. En
attendant, il trouva une distraction à Noël en se rendant au cinéma pour y voir
La Fille du puisatier (1940) de
Marcel Pagnol (1895-1974) avec Fernandel (1903-1971). La même année, un film
plus engagé – The Great Dictator (« Le Dictateur ») – de Charlie
Chaplin (1889-1977) était produit aux États-Unis. Enfin, le 8 janvier 1941, le
couple Martinů quittait Marseille, à trois heures du matin, non sans une
certaine tristesse voilée d'inquiétude. Le voyage serait encore très fastidieux :
Cerbère, Barcelone, Madrid et Lisbonne où l'attente sera interminable. Le 21
mars, ils embarquaient à bord du SS
Exeter. Une nouvelle aventure commençait.
1941/46
– L'exil
Les Martinů
arrivaient à New York le 31 mars 1941, dans cette ville où, à la fin du siècle
précédent, Dvořák avait dirigé le Conservatoire. Bohuslav allait y
rencontrer de nombreux compatriotes. Lui et sa musique y étaient déjà bien
connus grâce aux chefs d'orchestre Serge Koussevitzki (1874-1951) et George
Széll (1897-1970).
J'étais accueilli ici comme un grand compositeur ;
j'étais vraiment surpris, on m'a photographié de tous les côtés, on a fait une
réception pour moi, enfin c'était gentil. […] Ici, il y a vraiment un Nouveau
Monde, des choses surprenantes pour qui sait regarder et j'en ai plein les
yeux. […] Les orchestres sont d'une perfection qu'on ne peut même pas imaginer,
la musique en abondance aussi mais pas la musique moderne …(15).

Bohuslav
Martinů avec Serge Koussevitzki à New York en 1941 / DR
Il fait tout de même la
connaissance de compositeurs « modernes » tels que Bernard Wagenaar
(1894-1971) et Leopold Mannes (1899-1964). À cette époque, il lit aussi Der Untergang des Abendlandes (« Le
Déclin de l'Occident ») (1916) du philosophe allemand Oswald Spengler
(1880-1936) qui l'impressionne. Le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise
surprise de la base navale américaine Pearl Harbor contraint les États-Unis à
entrer dans le conflit. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie leur déclarent
la guerre. Martinů encaisse le choc.
L'année 1942 est
notamment marquée par la composition de la Première
Symphonie, H. 289(16) (mai/septembre),
vaste musique d'une grande densité mélodique et rythmique. Le poignant Largo, chant funèbre, est d'une grande
beauté. En cela, Martinů a véritablement été stimulé par la haute qualité
de l'Orchestre de Boston qu'il valorise singulièrement dans son discours. Il
s'installait ensuite à Middlebury, dans le Vermont, une « région belle
comme nos Vosges ». C'est aussi à cette époque qu'il fréquenta quelque peu
Aaron Copland (1900-1990). Il allait aussi séjourner au bord de la mer, à
Manomet, Massachusetts, là même où les pèlerins du Mayflower avaient débarqué en 1620. Cet environnement si favorable
lui permet de terminer en paix sa Symphonie particulièrement tchèque. Créée le
13 novembre, à Boston, elle est dédiée à Natalie Koussevitzky (1880-1942), la
seconde épouse du chef d'orchestre. Serge avait écrit lors de la découverte de
cette partition :
Après la première répétition de votre symphonie, je ne peux
m'empêcher de vous dire ma profonde admiration, de ma part et de celle de tout
l'orchestre, pour votre œuvre incomparable qui revêt une beauté particulière
et, pour moi, une signification spéciale(17).
La merveilleuse
rencontre avec Albert Einstein (1879-1955) a indéniablement constitué l'un des
événements humains et intellectuels les plus importants dans la vie du
compositeur. Le pianiste français Robert Casadesus (1899-1972) le lui avait
présenté. Bohuslav était convaincu que le savant n'avait pas seulement apporté
une nouvelle physique mais aussi et surtout « certaines manières de
penser ».
Pour autant,
Martinů ne se plaisait pas à New York. Il regrettait Paris. En 1942, il
enseigne la composition à Tanglewood, dans le Massachusetts, ce qui allège un
peu son état dépressif. Il a véritablement le mal du pays. Mais lequel ?
De surcroît, son couple a tendance à battre de l'aile eu égard à une certaine
inconstance de sa part. Heureusement, Koussevitzky est toujours présent à ses
côtés tant il est convaincu par son génie. À la fin de la guerre, au sommet de
sa gloire, il commence par accepter un poste de professeur de composition au
Conservatoire de Prague. Finalement, il passera encore les sept années
suivantes aux États-Unis. En août 1945, il avait écrit à Polička :
J'étais décidé de rentrer et de mettre à disposition tout
ce que je sais, bien qu'ici je pourrais avoir des postes de premier ordre, mais
j'ai toujours composé pour mon pays. Je n'ai pas beaucoup de vos nouvelles,
mais d'après ce que je sais, j'ai l'impression qu'on ne compte pas trop sur moi
et je ne vois pas assez clairement la situation pour décider de ce que je
pourrais faire. Je pense que ceux qui sont restés et ont souffert, doivent être
préférés, mais d'un autre côté, j'ai fait un grand travail pour la République
[tchécoslovaque]. D'ailleurs, vous me comprenez et plus tard je vous donnerai
des détails. En aucun car je n'ai l'intention de revendiquer quoi que ce soit
mais je veux rentrer et joindre mes forces à l'œuvre commune(18).
1946/53
– Tensions et doutes
En janvier 1946,
Bohuslav change encore d'avis en acceptant un poste de professeur de
composition à l'école de musique de Berkshire. Koussevitzky le lui avait
proposé. Il finira par laisser partir Charlotte toute seule pour l'Europe
pendant un certain temps. L'ambiance émanant de son étrange et instable Cinquième Symphonie H. 310 (1946),
dédiée à la Philharmonie Tchèque(19), traduit effectivement tous les scrupules plus ou moins
amers qui l'animaient alors. Un grave accident finit par se produire dans la
nuit du 25 juillet. Il emprunta une terrasse dépourvue de balustrade et fit une
chute de trois mètres. Il finira heureusement par s'en sortir évitant le pire,
c'est-à-dire une paralysie totale. Son état d'esprit, en revanche, sera loin de
s'améliorer. Sans cesse, il différera le retour au pays. Une lettre au pianiste
Josef Páleníček (1914-1991) atteste de son agacement :
J'ai l'impression que vous avez de mauvaises informations
et que vos conclusions ne sont pas tout à fait justes. Pourquoi je ne veux pas
rentrer chez moi ? Ici, je peux vous assurer que j'étais un des premiers à
préparer mes valises pour le départ. J'attendais seulement qu'on m'appelle et
qu'on m'offre quelque chose et quand, après longtemps, la question est venue du
consulat demandant si j'étais prêt à accepter ma nomination au Conservatoire
[de Prague], j'ai dit oui. J'étais prêt immédiatement mais jusqu'à maintenant,
je ne sais rien du statut de cette invitation sauf que j'étais nommé professeur
provisoire …(20).
En réalité,
Martinů ne sait plus où il en est professionnellement et sentimentalement
et il tergiverse. Seul son travail de compositeur semble le satisfaire
puisqu'il ne cesse de produire. Quoi qu'il en soit, il n'occupera jamais la
chaire de composition du Conservatoire de Prague. Elle sera finalement
attribuée à Václav Dobiáš (1909-1978). Le couple Martinů, entre-temps
« reconstitué », finira par quitter l'Amérique le 22 juin 1948 alors
que les grèves communistes perturbent la France depuis 1947. De son côté,
Richard Strauss (1864-1949) composait ses émouvants Vier letzte Lieder. Impossible de rentrer en Tchécoslovaquie car
ainsi que le lui répétaient ses amis, il ne pourrait pas
« ressortir ». Les Communistes avaient pris le pouvoir le 24 février
1948 par un coup de force qui aggravait considérablement la « guerre
froide ». Envers et contre tout, la solution professionnelle ne se
trouvait qu'à New York où il allait bien falloir rentrer après avoir passé
l'été en France et en Suisse, à Pratteln, dans le Canton de Bâle-Campagne, chez
les Sacher. Il était effectivement nommé professeur à l'Université de
Princeton. Pendant ces turbulences, il ne composait plus vraiment. Le retour
dans sa terre natale n'a pas pu se produire pour de multiples raisons, à la fois
musicales et idéologiques. Tout d'abord, sa forte personnalité et son talent
ont empêché sa nomination pour de mesquins motifs de pure jalousie. Par
ailleurs, l'idéologie soviétisante
s'est employée à en faire un « ennemi » par définition sans trop
savoir ce que cela pouvait recouvrir en l'occurrence.
En 1950, Bohuslav
écrivait au musicologue autrichien David Ewen (1907-1985), établi aux
États-Unis, ses pensées fort intéressantes sur la musique dite
« contemporaine » :
Je crois que la musique contemporaine est plus menacée
par ses efforts pour se justifier elle-même par des analyses et des
explications ; comme si elle craignait de ne pas sembler assez
« actuelle » ou « moderne ». Tout cela peut engendrer une
disposition d'esprit ne favorisant aucunement le compositeur dans le
développement libre de ses idées, et ne peut que le limiter dans la possibilité
de s'exprimer pleinement, entièrement et honnêtement. Jouant toujours sur les
mots « moderne » et « actuel », nous entravons nous-mêmes
le processus créateur, qui dans sa substance, est assez mystérieux et
compliqué. Courir à tout prix après la nouveauté, ce n'est sans doute pas un
bon système. Cela n'a absolument rien de commun avec le désir de chercher une
nouvelle expression musicale. Cette nouvelle expression musicale devrait se
fonder sur le sujet, devrait résulter de la personnalité et de l'expérience du
compositeur et non pas des moyens techniques peu habituels. Les moyens
techniques sont l'affaire privée de l'artiste. La technique découle de l'œuvre
et non le contraire. La musique n'est pas une affaire de calculs. L'impulsion
créatrice est comme la volonté de vivre, de se sentir vivant. Dans le monde
complexe de changements sociaux et de chaos politique, il est plus important
que jamais de ne pas obscurcir notre intention artistique. Nous devrions
maintenir nos idéaux purs et nos convictions fermes, maintenir la foi
artistique qui représente notre vie, notre travail et parle en leur nom. C'est
de quoi le compositeur devrait s'occuper, et non du jeu inutile des mots(21).
Sages paroles à
méditer, en effet. Elles restent valables.
L'idée de s'établir à
nouveau en Europe, et cette fois définitivement, ne cessait de le travailler.
La vie aux États-Unis lui pesait. En mai 1953, il quittait provisoirement sa
terre d'exil.
1953/59
– Difficile coda
Il lui reste six
années à vivre. Sa Sixième Symphonie,
« Fantaisies symphoniques » H. 343 (1951/53), plus inquiète, dédiée
au chef d'orchestre strasbourgeois Charles Münch (1891-1968) pour le soixante-quinzième
anniversaire de l'Orchestre de Boston, marque le début d'une autre époque. Il
la pensait à l'origine comme une « Nouvelle Symphonie Fantastique ».
Nice fut sa retraite suivante. Son épouse raconte :
Après le repas, il allait en ville avec le trolley-bus
[…] il s'installait à la terrasse de son bistrot favori et demandait son café …(22).
C'est dans cette
atmosphère d'étrange quiétude qu'il a passé deux années, de septembre 1953 à la
fin juillet 1955. Au printemps 1954, Martinů admire, à Arezzo, en Toscane,
les huit fresques de Piero della Francesca (ca
1416-1492). Elles ont été une magnifique source d'inspiration pour sa partition
orchestrale conçue à Nice entre le 20 février et le 13 avril 1955. Il s'agit
d'un véritable itinéraire spirituel qui, des ténèbres, aboutit à un hymne
empreint de lumière et de paix. Rafael Kubelik (1914-1996) dirigera la création
à Salzbourg, le 26 août 1956, à la tête de la Philharmonie de Vienne.
L'Oratorio Gilgameš H. 351 (1954/55) date en partie
de ce séjour niçois. Cette musique si évocatrice requiert un récitant, soprano,
ténor, baryton et basse, un chœur mixte, 2 flûtes, 2 clarinettes, 3 trompettes,
2 trombones, timbales, 3 percussionnistes, piano, harpe et cordes. L'Épopée de Gilgamesh, issu de la culture sumérienne, est l'un des plus
anciens textes conservés. La partition est en trois parties : Gilgamesh, La Mort d'Enkidu et Invocation.
Gilgamesh (baryton) règne sur la cité d'Erech. Le ténor Enkidu lui est opposé
en tant que héros innocent. Il va mourir. Bouleversé, Gilgamesh n'aura de cesse
de chercher le secret qui, en réalité, est le Mystère. Dans la troisième
partie, le dieu Enlil, l'un des principaux de la mythologie sumérienne,
exaucera le vœu de Gilgamesh en redonnant vie à l'esprit d'Enkidu (basse). La
question essentielle est posée mais restera finalement sans réponse. C'est un
sommet dans l'histoire de la musique et de la pensée.

La maison
natale de Bohuslav Martinů à Polička / DR
Martinů
rencontre à Antibes l'écrivain crétois Nikos Kazantzákis (1883-1957), l'auteur
d'Alexis Zorba (1946), à l'origine de
Řecké Pašije (« La Passion
grecque ») H. 372 (1954/57) (23), une partition complexe laborieusement
élaborée. Puis, toujours lors de son séjour à Nice, il reçoit les beaux vers du
poète Miloslav Bureš (1909-1968) de son cher Polička. Ils ont été à
l'origine de sa cantate Otvírání studánek
(« L'Éveil des sources ») H. 354 (1955) terminée en seulement dix
jours tant cette poésie l'a autant stimulé que profondément touché. Tout le
folklore de sa terre natale s'y exprimait de manière très simple. Le 27
novembre 1955, Arthur Honegger s'éteignait, à Paris, à l'âge de soixante-trois
ans. Il était le seul membre du « Groupe des Six » qui avait vraiment
trouvé grâce à ses yeux.
C'est contre toute
attente que, en octobre 1955, le couple Martinů rentrait à New York,
Bohuslav ayant accepté un poste au Curtis
Institute of Music de Philadelphie. Il vivra très mal cette époque bien que
sa musique y fut largement appréciée. Sa Sixième
Symphonie – déclarée la meilleure symphonie de l'année – sera jouée
vingt-huit fois au cours de la saison 1955/56. N'y tenant plus, Bohuslav et
Charlotte reviennent à Paris en mai 1956. Le mois suivant, ils sont chez leurs
amis et protecteurs Sacher à Schönenberg. Et, en septembre, Bohuslav rejoint l'American Academy of Music de Rome en tant que professeur. Charlotte, qui
l'irrite toujours autant, est encore, patiente, à ses côtés. Le fidèle George
Széll, alors à la tête de l'Orchestre de Cleveland, allait le solliciter.
Martinů s'intéressa donc à l'arrivée des pèlerins en Nouvelle-Angleterre
telle qu'elle a été racontée par le premier gouverneur, William Bradford
(1590-1657). Skála (« The
Rock ») H. 363 (1957) exprime ses émotions, en souvenir de ce grand
évènement, avec une force particulière.
Entre juin 1957 et
février 1958, ses Paraboles H. 367,
en forme de triptyque, attestent d'une volonté d'approfondissement
philosophique indéniable. Elles sont influencées par l'aviateur Antoine de
Saint-Exupéry (1900-1944) et Georges Neveux. En cela, Martinů se situait
dans la lignée de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) qui ne voyait pas
le primat de l'esthétique comme le fondement de l'imagination. Par ailleurs,
Martinů était singulièrement intéressé par la pensée du Morave Edmund
Husserl (1859-1938), fondateur de la phénoménologie. Le 12 novembre 1957,
Bohuslav s'installe définitivement en Suisse. Il y reçoit de nombreux visiteurs
dont l'immense pianiste Clara Haskil (1895-1960), très proche de sa
sensibilité. Le 24, Paul Sacher crée Gilgameš
à Bâle.
La santé de Bohuslav
commençait à se dégrader à la fin de 1958. Il sera opéré à l'hôpital de
Liestal, dans le Canton de Bâle-Campagne, le 14 novembre. Le 15 janvier
suivant, il met un point final à La
Passion grecque. Dix jours plus tard, l'Opéra de Wiesbaden représentera Juliette telle une tragédie. Bohuslav,
bien que surpris par la mise en scène, assista en toute joie à cette reprise.
Son état ne lui permettra plus d'entreprendre tous les voyages qu'il aurait
aimé faire. En revanche, son ardeur de compositeur ne se tarissait point. Il
travaillait, entre autres, à ses énergiques Variations
sur un thème populaire slovaque pour violoncelle et piano, H. 378 (1959).
Et, l'œuvre émouvante des toutes dernières semaines, en juin, sera La Prophétie d'Isaïe, H. 383 (1959),
cantate pour soprano, contralto, baryton, chœur d'hommes à quatre voix, alto,
trompette, piano et timbales. Il s'agit de la mise en musique de terribles
fragments des chapitres 24(24) et 21(25) du Livre d'Isaïe dans sa traduction
anglaise. Le musicologue israélien, le Docteur Peter Gradenwitz (1910-2001),
directeur des Éditions musicales israéliennes à Tel-Aviv, lui avait commandé
cette partition. Le compositeur suisse Willy Burkhard (1900-1955) avait, lui
aussi, composé un oratorio (1936) (26) d'après les textes
du plus grand prophète biblique. L'effroi qui se dégage de cette Prophétie est
peut-être à mettre en perspective avec la disparition, à Polička, le 17
mai, de sa sœur Marie, tant aimée, et qui l'avait profondément affecté. L'un de
ses derniers visiteurs, bouleversé, a été Josef Páleníček qui l'incita à
revenir au pays. Bohuslav en fit la promesse avec la plus grande sincérité
pensant pouvoir se remettre.
Par ailleurs, l'année
1959 fut marquée par Die Blechtrommel
(« Le Tambour ») de Günter Grass (1927-2015) dans lequel l'auteur
revenait sur les sombres années du nazisme. Le 3 avril, le dalaï-lama fuyait en
Inde tandis que Mao Zedong (1893-1976) devenait président du Parti en Chine. En
France, le 8 janvier, le général de Gaulle (1890-1970) prenait ses fonctions de
président de la République. De son côté, le 30 juin, souffrant d'un cancer de
l'estomac, Bohuslav Martinů entrait une fois de plus à l'hôpital de
Liestal. Le 2 juillet, il était autorisé à revenir dans son cher Schönenberg.
Le 8 août, il retrouvait sa chambre de l'hôpital où il s'est éteint le 28, à 19
h 30. Il fut inhumé dans la propriété de Maja (1896-1989) et Paul Sacher. Il
avait demandé à Charlotte de reposer auprès de ses parents. Son corps sera
enterré une seconde fois, le 27 août 1979, au cimetière familial de
Polička.
Au terme de cet
itinéraire volontairement concis, quelques réflexions s'imposent tant la
personnalité de ce compositeur apparaît complexe. Bien que resté toute sa vie
profondément Tchèque, il a été un exilé permanent y compris dans son propre
pays qui n'a pas voulu de lui. Sa musique y a toutefois été abondamment jouée
malgré les atteintes inqualifiables des obscurs apparatchiks du régime.
Il composait avec une
grande facilité, révisant rarement. Il était indifférent à l'exécution de sa
musique. Sa réception l'intéressait encore moins. Il était un esprit tout à
fait indépendant, unique en son genre. Il aimait la solitude et se plaisait
donc à s'isoler volontairement afin de se concentrer essentiellement sur son
travail de créateur.
Martinů n'a
jamais perdu son accent. Malheureux en Amérique, il a résisté à toute influence
dans ce pays qu'il n'a jamais aimé. Sa valorisation spécifique du concerto grosso n'a pas fait de lui ce que
d'aucuns nommeraient inconsidérément un « néo-classique » mais, tout
au contraire, l'a aidé à se libérer des totalitarismes esthétisants du XXe
siècle. Le fait qu'il ait été un réfugié a aussi forgé
son caractère tout en préservant en lui ses racines, ses propres sources qu'il a toujours tenues en éveil comme l'a si bien défini le
regretté Guy Erismann (1923-2007).
James Lyon.
(1) Guy ERISMANN, Martinů un musicien à l'éveil des
sources, Arles, Actes Sud, 1990 – Id.,
La musique dans les pays tchèques,
Paris, Fayard, 2001 – Brian LARGE, « Martinů, Bohuslav », in The New Grove, London, Macmillan
Publishers Limited, 1980, t. 11, p. 731-735 – Jan SMACZNY, « Martinů,
Bohuslav », in The New Grove, Oxford,
Oxford University Press, 2001, t. 15, p. 939-945.
(2) Leoš Janáček (1854-1928).
(3) Relative au Réformateur Jan Hus (1369-1415).
(4) Cité par Guy ERISMANN, p. 30-31.
(5) Cité par Guy ERISMANN, p. 62-63. À partir d'une interview
donne en 1942 à la Radio américaine.
(6) Cité par Guy ERISMANN, p. 72.
(7) Natif du Canton de Schaffhouse, il a vécu à Paris entre 1923
et 1932. Puis, il a été le Directeur musical de Radio-Bâle (1938/66).
(8) James LYON, Leoš
Janáček, Jean Sibelius, Ralph Vaughan Williams. Un cheminement commun vers
les sources, Paris, Beauchesne, 2011.
(9) Cité par Guy ERISMANN, p. 137.
(10) Cité par Guy ERISMANN, p. 146.
(11) Ancienne salle de théâtre parisienne située 5 rue du Colisée
dans le VIIIe arrondissement.
(12) Ibid., p. 150.
(13) Ibid., p. 151.
(14) Cité par Guy ERISMANN, p. 170.
(15) Ibid., p. 209-210.
(16) Selon le catalogue établi par Harry Halbreich.
(17) Cité par Guy ERISMANN, p. 221-222.
(18) Ibid., p. 237.
(19) Initialement dédiée à la Croix Rouge.
(20) Cité par Guy ERISMANN, p. 258.
(21) Cité par Guy ERISMANN, p. 297-298.
(22) Cité par Guy ERISMANN, p. 285.
(23) Révisée entre 1957 et 1959 (H. 372b).
(24) Maux que Dieu a résolu
d'envoyer à la terre pour punir les péchés. Le jour des vengeances du Seigneur
sera terrible.
(25) Babylone
ruinée par les Mèdes et les Perses. Prophétie contre l'Idumée et l'Arabie.
(26) Das
Gesicht Jesajahs.
***
PROPOS PARTAGÉS
Bertrand Chamayou,
un pianiste dans son temps !
C'est dans un café bruyant à deux pas de chez
lui dans le Paris du Faubourg Montmartre qu'il m'a donné rendez-vous deux jours
à peine après lui avoir adressé un courriel ! Chaleureux, décontracté, un
habitué du café ; mais où personne ne sait exactement qu'il est un artiste
demandé dans le monde entier, qu'il a gagné des victoires de la musique à la
télévision et qu'il est « booké » jusqu'en
2021 !

©Marco Borggreve
Vous
acceptez beaucoup d'interviews, pourquoi encore une nouvelle : rien de nouveau
dans votre actualité ?
La vérité c'est que je refuse très rarement
une interview sauf si ce sont des hurluberlus qui en demandent. Mais, j'ai lu
votre mail, l'Éducation Musicale, c'est très bien, et je me suis dit trouvons
un moment, c'est tout ! Je ne suis pas du genre à rechigner à faire des
interviews, ou qu'on me filme, qu'on m'enregistre. Autant pour les concerts je
suis très sélectif, autant là j'ai plaisir à échanger. En général, je commence
à m'entretenir avec la personne pour savoir à qui j'ai affaire : si vous ne
m'étiez pas sympathique peut-être vous auriez une interview plus succincte ;
mais apparemment nous avons pas mal de choses en commun. Elle s'annonce donc de
bonne augure…
Il suffit
d'aller sur internet pour connaître votre vie : vous avez fait une superbe
interview pour France Culture. Mais il y a une question qu'on ne vous a jamais
posée, je crois : jouez-vous pour être aimé ou simplement pour jouer de la
musique ?
Effectivement on ne me l'a jamais
posée ! Je ne sais pas si je peux répondre définitivement. Si j'étais
consensuel je dirais : pour jouer de la musique. Mais à la vérité, je pense
qu'on a envie d'être aimé. Évidemment, le fait de monter sur scène c'est quelque
chose d'antinaturel. Être regardé par deux mille personnes, moi ça me fout un
trac pas possible, je suis dans tous mes états et souvent je me dis : pourquoi
je fais ce métier ? la musique me procure une énorme jouissance à la maison,
tout seul, je n'ai besoin de personne. Monter sur scène, on peut se poser la
question du pourquoi ? Et il y a une évidence : c'est d'être aimé ; donc je
dirais oui aux deux ! C'est très curieux, car lorsque j'étais petit, je ne
me destinais pas à une carrière de pianiste, je ne me projetais pas tellement
dans la musique. J'ai fait de la musique par accident. Personne dans ma famille
n'était musicien, je n'avais pas un désir particulier. C'est vraiment par
hasard que j'ai pris des cours de piano ; parce qu'il y avait une dame qui donnait
des cours non loin de chez moi ; j'avais des copains qui y allaient, et j'ai
suivi le mouvement. Je me suis pris au jeu. Et quand j'ai envisagé de commencer
à rêver à une éventuelle carrière professionnelle, ce qui m'attirait c'était la
composition. J'étais passionné par les musiques contemporaines les plus ardues,
Boulez, Stockhausen. Elles me plaisaient. Quand j'avais onze, douze ans,
j'avais envie de faire ce genre de musique. Là je ne sais pas si c'était un
vrai désir d'être aimé, parce qu'il y a des manières plus simples de toucher un
large public. Si on joue du Chopin on touche plus facilement une partie de
l'auditoire ! Curieusement, j'ai un peu fui ça : je n'ai pas pris
l'autoroute, j'ai plutôt pris les chemins de traverse. Je ne suis pas non plus
dans un désir absolu de me vendre. Il y a en tout cas une autre manière du
désir d'être aimé.
Dans de
nombreuses interviews vous parlez souvent du rapport au public, qu'il soit près
de vous, le besoin de le sentir.
Oui c'est une relation un peu maso parce que
j'ai très peur de la présence du public. Je pense que cela vient de mon enfance
quand je m'imaginais compositeur derrière une feuille de papier et ne pas être
directement en action ; ''performer'' finalement. Nous parlions de cinéma avant
de commencer cette interview. Spontanément je me serais bien vu derrière une
caméra plutôt que devant. Je me retrouve comme une personne actrice en quelque
sorte. C'est antinaturel pour moi, je le répète : cette relation avec le public
est très curieuse. Je ne peux pas en faire abstraction, je ne joue absolument
pas pareil avec le public que tout seul chez moi. Et en même temps - c'est
pourquoi je dis que c'est terriblement maso, parce qu'il me terrifie - j'ai
envie d'être aimé de lui et je suis assez galvanisé par ça ! Il faut que
je brave cette peur, cette angoisse et j'essaye en même temps de captiver cet
auditoire.
Aimez-vous faire des
enregistrements en direct ?
Mon premier disque a été fait en public, cela
ne m'a pas posé de problème. J'ai fini par faire des disques en studio parce
que j'aime travailler le côté laboratoire. Mais un fois fini, je me dis que
j'aurais dû le faire en direct ! Sans la présence du public je manque un
peu d'énergie. C'est ce côté funambulesque qui me donne des ailes quand même.
Il faut créer un vrai discours, ne pas se perdre dedans, trouver une unité, un
sens dramatique. Vous êtes tellement obligé de le faire en direct. C'est comme
si quelqu'un vous prenait à la gorge et vous disait : tu n'as pas le
choix ; on n'a qu'une fois, on brûle toute son énergie. C'est impossible
d'atteindre cet état là en studio, même s'il y a un public invité.
Vous parlez de
récital. Comment faites-vous avec orchestre ?
Si,
si, c'est pareil !
Vous parliez de ne
pas faire carrière dans la musique...
Pas
du tout !
N'y-a-t-il
pas une œuvre ou un musicien qui vous ont déclenché cette envie de jouer devant
un public ?
J'étais fasciné par les pianistes. Je suis de
Toulouse [*1981]. Il y avait un très beau festival de piano, « Piano aux
Jacobins, ». C'est là que j'ai entendu du piano pour la première fois,
avant même d'en jouer. C'est là où j'ai joué pour la première fois plus tard
quand j'avais quinze ans. C'est un lieu très important pour moi et quand
j'étais petit, j'ai pu entendre des pianistes de la génération précédente, Arrau, Kempff, Richter, Magaloff,
Cziffra. J'étais très admiratif et sans doute je me suis pris à rêver d'être à
leur place ; mais je n'y croyais pas du tout.
La
plupart des comédiens en voyant un acteur se disent : c'est ça que j'ai envie de
faire !
Moi ce n'était pas aussi clair. D'abord pour
moi c'était la composition. Je ne me disais pas forcément que j'allais être
musicien, j'étais à Toulouse, c'est une grande ville, j'étais un très bon élève du
Conservatoire. Mais être adulé dans mon conservatoire ne prouvait pas que
j'avais l'aptitude à faire quelque chose. Je savais que j'étais doué, d'après
mes professeurs ; mais bon, ce qui a été un déclic, c'est justement un pianiste
qui s'appelle Jean-François Heisser que j'avais
entendu en récital. Il m'avait impressionné. Je l'avais vu par hasard en
Provence où je passais mes vacances avec mes parents. C'était les débuts du
festival de la Roque D'Anthéron dans les années 80.
C'était une sonate de Beethoven ; et il est venu en tant que membre du jury
pour mon examen de sortie à Toulouse. J'étais très impressionné de jouer devant
lui et j'ai été surpris le lendemain quand le Conservatoire a appelé ma maman
pour lui dire que ce monsieur voulait me rencontrer. Je suis allé avec elle le
voir et il m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec le piano et
que j'aille travailler au Conservatoire de Paris ! J'étais très flatté et
en même temps c'était une espèce de douche froide parce que, tout d'un coup,
moi qui étais dans mon petit cocon avec ma famille, qui allait à l'école, etc... il fallait que je prenne une décision parce qu'on me
disait : tu as quelque chose à faire là-dedans, et qu'on me parlait d'aller à
Paris…J'avais 13 ans, c'était un peu tôt. A l'époque, c'était Air Inter : une à
deux fois par mois je prenais mes billets avec ma mère, puis progressivement
tout seul. J'allais rendre visite à Heisser, prendre
des cours.
A 16 ans j'ai déménagé à Paris et j'ai
intégré le Conservatoire dans sa classe. C'est ce qui m'a mis sur les rails.
J'ai suivi une bonne fée. Ensuite il m'a conseillé de travailler avec Maria Curcio qui avait été sa professeure à Londres, grand
professeur de grands pianistes comme Martha Argerich,
Radu Lupu ou Pierre Laurent Aimard.
Je n'ai fait que suivre des signes. A chaque fois tout s'est bien emboîté. Vers
18, 19 ans, au Conservatoire, je donnais quelques petits concerts, mais je
n'étais pas du tout, comme les autres, à me dire : je vais faire de grands
concours internationaux et je vais être un grand pianiste ! Je voyais des
gens très forts. Pourquoi moi ? Donc je me bougeais pour faire des tonnes
de trucs. Je suis allé voir des compositeurs, certains que j'ai aimé, d'autres
moins. J'ai fait des premières de jeunes compositeurs. J'ai rencontré des
jeunes de mon âge, comme Gautier Capuçon. On était au
Conservatoire tous ensemble et on faisait de la musique de chambre. Je me suis
mis à jouer des duos, des trios, des quatuors. C'est ainsi que je suis arrivé
dans des festivals, à Deauville par exemple. Et j'ai commencé ma carrière comme
ça, comme accompagnateur de chanteurs, comme musicien de chambre. Je faisais un
peu de solo, beaucoup de musiques contemporaines. J'ai même fait la classe de
pianoforte. J'ai essayé de faire un max de trucs quoi !
Et comment ont réagi
vos parents face à cette aventure ?
J'ai des parents formidables : mon père aime
beaucoup le piano, ma mère était artiste dans l'âme, très fan d'art plastique
contemporain en particulier. Cette sensibilité de création d'aujourd'hui me
vient un peu d'elle. On allait souvent dans des musées d'art contemporain. Mon
père, lui, venait d'une famille plus bourgeoise, il était plus attiré par le
piano ; il avait des disques d'Horowitz et d'autres pianistes de cette époque ;
donc il a une certaine fierté évidemment à cet accomplissement dans le piano.
Quand petit je suis allé au Conservatoire, ils ne m'ont jamais entravé, ils
n'ont jamais eu le côté singe savant. Ils venaient aux auditions et restaient
poliment dans un coin. De temps en temps, ils faisaient un petit film : j'ai
une sonate de Berg quand j'avais 12 ans, c'est rigolo ! S'il y a un jour
un doc sur moi, je publierai cet extrait pour rigoler ! Ils ne m'ont
jamais poussé et lorsque je suis monté à Paris, ils ne m'ont pas fait de misère
en disant : il faudrait mieux que tu sois médecin ! J'ai un très bon équilibre.
Ils ont eu un peu peur évidemment, ils ont parlé avec Jean François Heisser qui leur a dit que leur enfant pourrait faire
quelque chose dans la musique.
Et la
composition ?
A mon grand regret, je l'ai mise de côté. J'y
pense très très régulièrement. Je me dis que ce n'est
pas trop tard, qu'un jour il faudra que je me remette là-dedans. Mais il
faudrait que je dégage du temps, que j'arrête quelques mois pour remettre un
processus en route.
Combien de concerts
faites-vous par an ?
Un
peu trop, il y a des moments où je fatigue, j'en fais 120 par an !
C'est énorme !
C'est trop ! Je refuse. Je pourrais
jouer tous les jours ! Actuellement il y a beaucoup de demandes. C'est
peut-être une phase. Dans dix ans plus personne ne voudra de moi !
Vous êtes à la
mode !
C'est
ça ! J'en profite, mais je fais attention. J'ai eu plusieurs phases. J'ai
eu une phase avec un problème à la main droite…
C'était comme Béroff ?
Cela s'est enclenché comme lui mais j'ai réussi
à guérir le problème dans l'œuf, et ça m'a ennuyé pendant quatre ans ! Il
y a une année où je n'ai pas joué du tout ! Cela était une étape très très bonne pour ma tête ! Là, je joue beaucoup, je
sais, c'est une façon aussi de me prouver que j'en suis capable. C'est une
phase. Je sais que je ne continuerai pas à ce rythme-là, à jouer toujours la
même chose jusqu'à la fin de mes jours.

©Festivalberlioz.com
On
parle beaucoup de vous en ce moment et de vos enregistrements, et en bien. Vous
aimez la musique contemporaine, Boulez par exemple, mais que pensez-vous de la
musique d'aujourd'hui, plus tonale ?
Il y a des compositeurs que j'aime beaucoup
dans cette mouvance, Thomas Adés par exemple. Je ne
fais pas de distinguo sur tonal/pas tonal. J'ai pris la décision de passer des
commandes. J'ai un projet avec Radio France de trois commandes de concertos.
J'espère qu'il va se mettre en place. Et puis des pièces en solo que je vais
essayer d'insérer dans des récitals. Il faut que les interprètes soient courageux
aujourd'hui, moi le premier. Je ne l'ai pas été assez. Je fais des choses plus
consensuelles assez originales, Les Années de Pèlerinage en entier par
exemple. Mais j'aimerais travailler sur la musique d'aujourd'hui comme vous
dites car le terme de musique contemporaine ne me plait pas beaucoup ; comme le
terme de musiques actuelles me déplait aussi. Je ne comprends pas très bien ces
classifications. Il est évident que quand on entend du heavy
metal, ce n'est pas la même chose ; mais je
ne vois pas l'intérêt de faire des cases pop, rock. Dans la peinture ils ne le
font pas.
A
propos de pop, on a un compositeur en commun qu'on aime tous les deux, c'est
Frank Zappa !
J'adore
Zappa ! C'est marrant !
C'est à cause de
Boulez que vous l'auriez découvert ?
Comment
savez-vous ça ? Parce que j'en ai rarement parlé !
Désolé,
je prépare un peu mes interviews, et connaître Zappa ce n'est pas courant chez
un jeune pianiste classique !
Il existe un ouvrage d'analyse des œuvres de
Zappa qui va bientôt être publié et j'ai fait une préface parce que c'est un
musicien que j'aime énormément ! Il est à cheval entre plusieurs styles :
c'est une légende plus connue dans le rock mais qui a écrit des choses
symphoniques aussi !
C'est assez hard
comme musique ?
Souvent complétement barrée ! Quand
j'étais gamin, c'était Prince et Jackson qui tenaient le haut du pavé, mais
j'étais plus attiré par Prince. Je suis allé écouter son dernier concert à
Paris ! Je ne connaissais pas encore Zappa et je raconte dans la petite préface
que j'ai faite, comment je l'ai connu. Lorsque j'avais 12, 13 ans, j'étais
assez fan de rock et mon coiffeur jouait de la guitare électrique. Il avait un
groupe et on parlait des musiques qu'on connaissait : moi des compositeurs
contemporains comme Berio ; j'essayais de lui expliquer à quoi ça ressemblait,
et lui de son groupe de rock. A un moment donné je lui parle de Boulez et il me
dit : est-ce que tu connais Zappa ! Cela me disait vaguement quelque chose
et il me dit que Boulez a commandé une œuvre à Zappa et que Zappa est un
compositeur impressionnant ! Je me dis qu'il doit confondre :
Boulez-Zappa, il a dû prendre ses rêves pour des réalités ! A l'époque on
n'avait pas internet pour chercher. Je ne suis pas vieux, mais j'ai passé toute
mon adolescence sans internet ! Je
n'avais donc pas d'information. J'ai demandé autour de moi : soit Zappa,
personne ne le connaissait, soit Zappa-Boulez, il y avait un problème. C'était
sûrement une ânerie ! Et petit à petit je me suis mis à écouter du Zappa.
Mais cette histoire n'était pas résolue et c'est bien plus tard, quand j'ai eu
internet, et que j'ai tapé Zappa-Boulez, que j'ai vu qu'ils avaient fait un
projet ensemble et que j'ai connu l'historique de ce projet ! C'est donc
grâce à mon coiffeur que j'ai connu Zappa !
Vous
avez entendu le disque. J'ai eu la chance d'entendre l'œuvre interprétée !
Ce n'est pas ce que je préfère ! J'ai
rencontré Esa-Pekka Salonen
qui a monté « 200 Motels » et il m'a dit que c'était le projet le
plus dingue qu'il ait réalisé !
https://www.youtube.com/watch?v=W7eUWh9sI7k
C'est la musique d'un
film complétement délirant !
Il est mort quand j'avais 15 ans et je n'ai
pas eu la chance de le voir en concert ! Les « Mothers
Of Invention » c'est génial ! Même les musiques un peu plus
consensuelles comme « Apostrophe », j'adore ça ! Il se fout des
Beatles. Il avait un projet avec John Lenon. C'est un
type génial. J'aime énormément ce genre de musicien !
https://www.youtube.com/watch?v=zXP_pr7np-o
On ne
va pas parler de Liszt, de Schubertiades, de Fauré. Vous vous
êtes pas mal exprimé autour de ces musiques et de vos disques.
J'aimerais revenir sur ces musiques d'aujourd'hui.
Oui ce n'est pas une posture : ces mots
tonal, atonal, c'est réducteur ; c'est vraiment noir blanc. C'est plus
compliqué que cela dans certains cas. Moi je m'en fous et ce n'est pas histoire
de dire que j'aime tout le monde ; pas du tout. Il y a des trucs que je
déteste, et dans le classique et dans la musique contemporaine. Ce n'est pas si
c'est tonal ou pas, ou si c'est quelqu'un qui a fait l'IRCAM. Il y a des gens
qui m'intéressent, des œuvres que je n'aime pas, de même que des œuvres
classiques. Parfois on ressort des opéras baroques que je trouve plus
qu'ennuyeux. A côte de ça, il y a des merveilles. Et c'est valable dans tous
les domaines, en l'occurrence dans la musique contemporaine. Je n'ai aucune
posture boulézienne ou anti. Je trouve que Boulez est un type très intéressant
avec des choses que je conteste…
Quand j'étais tout petit, j'ai commencé à
composer de la musique tout de suite : j'avais six mois de piano, je composais
des petites mélodies, toutes simples au début, puis très vite au bout de deux,
trois ans, j'ai eu un certain niveau de compréhension des partitions, je me
suis intéressé aux musiques modernes. D'abord ça été Ravel, Debussy, Prokofiev,
Bartók, Stravinski, et je me souviens d'une des premières révélations : c'était
un copain qui était plus avancé que moi et qui avait une partition de Messiaen.
Quand j'ai vu tous ces accords ultra compliqués, j'ai été attiré par ça.
J'étais attiré par l'inouï, en fait, et dans tous les domaines. C'était un
petit côté mégalo, démiurge, je ne sais pas ; mais je sais que j'étais fasciné
par les tours les plus hautes, par toutes les innovations technologiques,
etc... J'étais très fasciné par la notion d'évolution. J'ai vu ensuite des
partitions pour orchestre de Messiaen, avec des percussions extra européennes,
je trouvais cela génial. Après j'ai connu les élèves de Messiaen, Boulez,
Stockhausen, et la musique électronique. Tout ce côté exploration, cela m'a
fait rêver toute mon enfance. Aujourd'hui quand j'entends ce genre de musique,
il y a des choses plus ou moins bien, mais je ne suis pas dans une posture
snob, du style vous ne comprenez rien. Il y a des œuvres qui me secouent. Je
suis allé écouter deux fois « Prometheus »
de Nono à la Philharmonie. Je suis sorti transporté ! « Le Requiem
pour un jeune poète » de Zimmermann, ça me bouleverse. C'étaient mes héros
quand j'étais gamin. Je suis très ouvert à la musique en général, à la pop, par
exemple. J'ai découvert, quand j'étais adolescent, la musique américaine aussi.
Vous êtes de votre
temps !
Oui, je pense et je déplore que dans la
musique classique on ne soit pas assez de notre temps ; c'est mon grand
problème ! Il y a un phénomène, avec lequel j'ai joué aussi : en
interprétant du Liszt, j'ai joué sur les deux tableaux.
Avec Liszt vous
faites un tabac !
Oui bien sûr, mais je n'ai jamais voulu
orienter le programme vers des pièces acrobatiques. J'ai fait des grands cycles
qui se terminent par la Troisième Année de Pèlerinage. C'est le Liszt
méditatif, de la fin. Cela fait un tabac parce que c'est le côté marathon ;
mais je n'aurais joué que la Troisième année, les gens auraient dit : qu'est-ce
que c'est que ce truc, quoi ! Alors que c'est à mon avis la plus belle.
J'essaye en jouant tout le cycle d'être explicatif : cela commence par le
côté romantique, brillant, et puis petit à petit on va vers le désincarné, le
métaphysique, le voyage intérieur. C'est ce qui me plaît de communiquer au
public. J'estime ne pas avoir été assez courageux dans
la programmation, mais ce n'est pas facile avec des producteurs qui mettent de
l'argent sur vous de dire : Scriabine ; ils ont peur. Ils pensent que vous
allez vider la salle. C'est compliqué, c'est un cercle vicieux parce qu'on
n'habitue pas les gens à s'intéresser à la nouveauté. Et moi j'aime les choses
nouvelles ! Beaucoup de musiciens se mettent en empathie avec le public en
disant qu'il faut qu'il entende ce qu'il connait ! Jouer de la musique du
passé au prisme d'aujourd'hui, on a beaucoup souffert d'une certaine évolution.
La musique a d'abord été à la cour, puis l'apanage des salons aristocratiques,
et le phénomène nouveau au XXème siècle c'est le concert public qui s'élargit
de plus en plus. Mais c'est un public très choisi. On voit tout le tollé qu'il
y a eu du fait de déménager la Philharmonie à la Porte de Pantin. C'est quand
même incroyable !
Avez-vous fait des
récitals dans cette salle immense ?
Non, j'ai fait des concerts avec orchestre.
La programmation est très chouette, je suis très content que cela existe, c'est
un premier pas. Quand on voit que des gens envoient des lettres d'insultes en
disant qu'ils ne mettront jamais les pieds dans ce quartier, etc..
Il est évident qu'on a un public conservateur qui ne veut entendre que de la
musique du XIXème siècle ou éventuellement du XVIII ème !
Même Debussy, ça commence à être chaud ! Si on reste là-dedans, on est
mort ! Je vais continuer à jouer ce répertoire, mais on a besoin d'être
créatif. Jouer ce qui se fait, même avec des ratés qui tombent à côté. Je suis
entré dans quelque chose qui me plaît beaucoup : faire des récitals, des
concertos, de droite à gauche. Mais par rapport à votre première question,
faire cela pour plaire, oui un peu ; mais jouer le Premier Nocturne de
Chopin, ça non, ça me fatigue! Plaire oui, mais en
apportant ce qui m'excite. Faire un récital entièrement Ravel au Théâtre des
Champs-Elysées, c'était un peu ambitieux ; mais c'était archi plein !
L'année prochaine, je fais de la musique un peu plus contemporaine. J'ai un
copain, Jean Frédéric Neuburger, qui a écrit une
œuvre pour moi. Je vais jouer un compositeur anglais qui est décédé il y a peu
de temps qui s'appelle Jonathan Harvey. Je vais essayer de m'impliquer
là-dedans. On me pose toujours des questions sur Liszt et Schubert, et je suis
très content de parler avec vous de ce qui m'excite le plus !
Alors à quand une
composition pour Neuburger ?
Je
vous tiendrai au courant !
https://www.youtube.com/watch?v=cwL4nSb9am8
Propos recueillis par
Stéphane Loison.
***
LE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE

DR
« L'Art peut sembler
dérisoire au regard de la violence qui frappe notre monde », écrivait
Bernard Foccroulle, directeur général du Festival
d'Aix dans sa préface à la programmation de l'édition 2016. Parole éminemment
responsable au vu des évènements récents. « Il nous offre la matière
mémorielle, la créativité et la force d'utopie dont nous nous avons besoin pour
survivre aux déflagrations et inventer un futur différent », poursuit-il. Pour peu qu'un spectacle, d'opéra, de
concert, soit conçu comme autre chose qu'un simple divertissement. Le programme
croisait des destins de femmes singuliers, de Mélisande, sans doute le
personnage central du drame lyrique de Debussy, Bellezza,
figure essentielle de l'oratorio Il Trionfo de
Haendel, Fiordiligi encore qui tente de préserver un
espace de constance dans le dramma giacoso Così Fan tutte
de Mozart. Le
festival présentait aussi le deuxième volet de l'œuvre dramatique de Stravinski
avec le couplage révélateur d'Oedipus Rex
et la Symphonie de Psaumes. Un grand parmi les grands, Esa-Pekka Salonen dirigeait ce
spectacle comme Pelléas et Mélisande à la tête
de l'Orchestre Philharmonia de Londres, un choc
sonore rare. Car entre Stravinski et Debussy, son cœur ne balance pas : il les
chérit tous les deux. Comme toujours, les mises en scènes (Krysztof
Warlikowski, Peter Sellars,
Katie Mitchell) revisitent les œuvres de fond en comble, nous appelant à la
réflexion. A ce compte, celle du Mozart reste problématique : la lecture de Così fan tutte due à Christophe Honoré laisse plus que
perplexe.
Un anéantissement programmé de La Beauté
Georg Friedrich HAENDEL : Il Trionfo del
Tempo e del Disinganno.
Oratorio en deux parties. Livret du cardinal Benedetto Pamphili.
Sabine Devielhe, Franco Fagioli,
Sara Mingardo, Michael Spyres.
Christine Angot. Le Concert d'Astrée, dir. Emmanuelle Haïm. Mise en scène : Krysztof
Warlikowki. Théâtre de l'Archevêché.

©Pascal
Victor/ArtcomArt
Premier oratorio d'un jeune
Haendel de 22 ans, Il Trionfo del
Tempo e del Disinganno
(Le triomphe du Temps et de la Désillusion), écrit à Rome en 1707, montre une
patte musicale d'envergure, au point qu'il réutilisera plus d'une
aria dans ses compositions ultérieures (« Lascia
la spina » en particulier) et n'hésitera pas à le remanier par deux fois.
Quoique dans le droit fil des oratorios romains en deux parties de musiciens
comme Carissimi, Scarlatti ou Caldara, sur des sujets religieux tirés des
Écritures ou de sujets allégoriques, Haendel en renouvelle la facture. Pour
contourner l'édit papal d'interdiction de jouer de l'opéra, on s'en tiendra à l'« oratorio volgare », qui
chanté par des castrats, permet de représenter un schéma dramatique. Car la
pièce contient bel et bien une action, même si resserrée : la tentation en
règle à laquelle Bellezza (La Beauté), occupée aux
éphémères bienfaits dispensés par Piacere (Plaisir),
est soumise par Tempo (Le Temps) et Disinganno (La
Désillusion) qui lui font comprendre la fragilité de son apparence et la
finitude de sa destinée. Convaincue, elle décide de se consacrer à Dieu et
renonce à une existence vaine et éphémère. C'est à un jeu cruel que le
librettiste, le cardinal Benedetto Pamphili, esthète
et musicien à ses heures, convie le spectateur, que la musique de Haendel embellit
grandiosement. Fidèle à sa manière allusive, le
metteur en scène Krysztof Warlikowski
réserve à La Beauté un véritable parcours d'enfer. Dans l'environnement formel
et froid d'une sorte de salle de cinéma parée de quantité de fauteuils
moelleux, traversée d'une galerie en verre dans laquelle opèrent tour à tour un
danseur éphèbe se trémoussant en mesure et une théorie de pin
up aux figures ravageuses, il inscrit le cheminement tumultueux de son
héroïne, déjà fortement empreinte de pessimisme dès les premières répliques :
une jeune femme droguée, que rien ne semble tenter autant que la satisfaction
de distractions immédiates et futiles. Car Plaisir, sorte de hippie bon chic
bon genre à lunettes noires, semble s'ennuyer ferme malgré son statut d'agitateur
patenté. En face d'eux, deux vieux sorciers, Le Temps et La Désillusion, sont
affairés à compiler des archives et rédiger des missives pour on ne sait quels
destinataires. Le jeu entre les deux barbons et la belle, d'abord sur le mode
badin, sera vite sans merci, les ''vieux'' ringards n'hésitant pas à la
malmener et à se montrer plus qu'insistant dans le langage. Bien sûr, Bellezza ne résiste pas longtemps à pareil pilonnage,
malgré les tentatives, un peu vaines, de Piacere, et
se réfugie dans une manière de Mater dolorosa pour se consacrer à la sainte
cause : « J'espérais trouver le bonheur dans le vérité » avait-elle
lancé en début de seconde partie devant le corps inanimé du jeune éphèbe. Warlikowski, qui au passage semble régler ses comptes avec
la puritaine Église de sa Pologne natale, assume que cette pièce dogmatique
conduit à « la destruction d'une jeune femme, à un anéantissement dans la
mâchoire du Temps et du Désenchantement ». Et balaie d'un revers de main
la fraîcheur et l'insouciance de la jeune personne. Tout semble joué d'avance :
une terrible mélancolie poussant à l'abolition programmée de l'être. C'est là
une vision on ne peut plus désespérée, ne laissant que peu de place à la joie,
dont la froideur de la présentation imagée concourt à renforcer le caractère
inéluctable ; à la différence de la version plus haute en couleurs de Jürgen Flimm donnée à Zürich et à Berlin (cf. NL de 3/2012).

Bellezza (Sabine Devielhe)
& Piacere (Franco Fagioli)
©Pascal
Victor/ArtcomArt
Ses interprètes le suivent sans
barguigner car la direction est millimétrée et, comme toujours chez ce
régisseur, réserve un résultat hautement théâtral. Les arias da capo sont
vécues jusqu'à l'extrême substance, les ensembles pareillement travaillés tel
le duo Bellezza-Piacere en première partie, dune beauté spectrale. Il faut dire que distribuer Sabine Devieilhe et Franco Fagioli tient
du génie, et en une telle forme vocale, du miracle musical. Elle, soprano
jaillissant, émaillé de notes aiguës d'une déconcertante aisance, pas éthéré
cependant comme le montre le premier air de le seconde partie
avec hautbois obligé, émouvante à force de désespérante vraie fausse humilité ;
lui, méconnaissable dans son costume ajusté, nimbant de son timbre si riche
moult arias glorieuses, dont un « Lascia la
spina » d'anthologie parce que pensé de l'intérieur. Les deux autres ne le
cèdent en rien : Michael Spyres, Tempo, déploie un
ténor large, sur le versant
héroïque, et personnifie parfaitement le regard terre à terre du
personnage, costume noir austère en deuxième partie ; Sarah Mingardo,
Disinganno, mezzo taquinant le contralto, souvent
dans des tempos lents et habités, vielle fille revêche et enjôleuse tout à la
fois. Un quatuor sans doute idéal aujourd'hui. Emmanuelle Haïm connait sa
partition pour l'avoir déjà dirigée en concert et enregistrée (Warner classics) : sa direction respire ce vrai bonheur qui n'est
pas toujours dispensé sur scène : si le débit est lent, au début notamment,
l'effluve est toujours irrésistible. Car comme elle le souligne, il règne
« une extraordinaire vitalité » dans cette musique du jeune Haendel,
qui transparait à chaque aria ou ensemble. Le concert d'Astrée offre des cordes
chatoyantes et des bois étincelants. Et on admire les solos concertants de violon,
de hautbois et surtout d'orgue lors de la fameuse sonate préludant l'aria de
Plaisir, d'une poétique extrêmement raffinée.
Quand la violence malmène la musique de Mozart
Wolfgang Amadé
MOZART : Così fan tutte. Dramma giocoso
en deux actes. Livret de Lorenzo da Ponte. Lenneke Ruiten, Kate Lindsey, Sandrine Piau,
Joel Prieto, Nahuel di Pierro, Rod Gilfry. Cape Town Opera Chorus. Freiburger Barockorchester, dir. Louis Langrée. Mise en scène : Christophe Honoré. Théâtre de
l'Archevêché.

Quintette des
adieux (Ier Acte) ©Pascal Victor/ArtcomArt
Les relectures de opéras de Mozart sont
toujours périlleuses. Celle de L'Enlèvement au sérail à Aix, l'an
dernier, s'avéra problématique. Celle de Così fan
tutte, cette fois, l'est tout autant. Le procédé de la transposition n'est
pas nécessairement à rejeter. Et il en est de fort réussies qui ajoutent
quelque chose à la perception qu'on peut avoir d'une œuvre qui n'a sans doute
jamais livré tous ses secrets. Ainsi en fut-il, dans Così
précisément, du regard porté par Michael Haneke à La
Monnaie de Bruxelles. Christophe Honoré se veut tout aussi radical, et ne l'est
peut-être pas tant que cela. L'action est transportée dans une colonie
italienne sous l'ère mussolinienne, dans la lointaine Érythrée. Les colons
mâles qui s'ennuient ferme, même avec leurs payses, imagent un pari stupide
pour passer le temps, et peut-être en remontrer aux autochtones question
audace. Pour illustrer cette vacuité, un prologue, avant l'Ouverture, fait
entendre le son éraillé d'une vieille rengaine au phonographe à pavillon, et
voir quelque débauche d'un des européens avec une jeune noire. La compagne de
cette dernière, qui cherche à s'interposer, est jetée à terre. On a saisi le
message : sexe et violence seront les maitres mots du spectacle. Une violence
étalée ou rentrée, toujours présente dans les attitudes et postures : de la
part des deux colons bien sûr, mais pas seulement. Car la réciprocité vaut pour
les locaux qui s'ils sont malmenés chez leurs femmes par les italiens, ne se
privent pas non plus de tarabuster une Despina qui ne
demande peut-être que cela. Le tour gratuit que prend le fameux pari de
l'épreuve de la fidélité des deux filles n'est pas sans questionner les locaux
qui contemplent d'abord, mais n'entendent pas en rester là. Car un des traits
de cette présentation est de ne pas limiter le jeu à six personnages, mais de
l'inscrire, au-delà même des deux scènes de chœurs du départ des amants-soldats
et de la noce finale, dans un mouvement plus général, celui de la foule des
autochtones. Cela ne serait pas gênant si ce n'est que la chose alimente un
propos connoté, racial bien sûr. Honoré crânement affirme qu'« avec
ce Così rejouant une histoire coloniale comme
tragédie et comme farce », il a « l'intuition » de pouvoir « apporter
au livret de Da Ponte une attention nouvelle, inconfortable et
stimulante ». Inconfortable, certes : quelque chose qui n'est pas éloigné
de Sade et de son Histoire de Juliette ou la prospérité du vice.
Stimulante, on en doute : le mode sadique, bien distinct du parodique, conduit
à un sentiment de malaise plutôt, à un phénomène de trop plein, pire de
longueur. Et ajouter que la pièce « peut s'écouter comme un flux ténébreux
qui prospère avec plaisirs, avec tous les plaisirs », c'est prêter au librettiste
comme au compositeur de savantes intentions. Qu'il y ait dans Così autre chose qu'une farce au premier
degré, mais une vraie tentation des cœurs, dont on sait les intermittences,
cela va de soi. De là à en conclure à une apologie du vice, il y a un pas. Le
plus piquant est qu'Honoré se cale dans les didascalies, ne renonçant ni à la
pantalonnade charlatanesque de Despina – en
infirmière ici – ni à son travestissement en grand Mamamouchi, en guise de
notaire. Et que la place de celle-ci reste peu exploitée, en tout cas pas jusqu'au bout de
l'idée ; car à part ses parties de jambes en l'air avec un jeune noir, ladite
reste peu délurée. A la différence d'Alfonso qui perdant sa caquette de
philosophe, traduit l'ardente soif du vicieux obsédé. La transformation des
jeunes gens en albanais les voit apparaître en guerriers Dubats,
sévère métamorphose qui en ajoute à la violence ambiante. Qui appert dans les
attitudes et gagne jusqu'au chant : chaque air se voit bardé de témoins plus ou
moins voyeurs, en rendant la dramaturgie parfois indigeste tant elle est
soulignée. Ainsi du « Per pietà » de Fiordiligi,
gagné par la fantasque attitude de Ferrando après
qu'il eut été jeté dans ses bras par une femme noire qui s'est donc pris à ce
jeu sadique. L'environnement décoratif ne rachète rien, misérabiliste comme
souvent. Non, Così fan tutte n'est pas
une saga de sexe, mais un théâtre d'amour.

Acte II : Ferrando (Joel Prieto) et Dorabella (Kate
Lindsey)
©Pascal Victor/ArtcomArt
La musique dans tout cela ? Même si prise à contre pied de ce qui est vu, son pouvoir est heureusement
préservé. Car Louis Langrée déploie un raffinement
exemplaire tant dans la symphonie que dans l'accompagnement des airs et
ensembles. Les sonorités du Freiburger Barockorchester, souvent chambristes, ne sont nullement
sèches et la petite harmonie sonne d'une belle fraicheur, comme les cordes
d'une fragilité, d'une sensibilité à fleur de peau. Septième personnage de
l'opéra, l'orchestre ne traduit pas l'infidélité, encore moins la hargne du
sexe, mais une effusion constante de tendresse, une nostalgie du bonheur, la
douceur du sentiment même s'il est illusoire, et le sentiment si juste des
faiblesses du cœur et des sens, qui peut aller jusqu'au pathétique. Cela, la
direction le traduit, en divorce total avec la mise en scène, dans bien des
situations ou ensembles. Ainsi du « quintette des adieux », miracle
d'équilibre, ou du trio « soave sia il vento », débuté ici
en coulisses pour prospérer visuellement de manière empesée. Le sextuor vocal
est de qualité sans être exceptionnel. Seule Sandrine Piau
répond au qualificatif de chanteuse mozartienne accomplie. Les deux jeunes gens
sont bien contrastés. Joel Prieto
est un Ferrando un peu juste de gabarit et Nahuel di Pierro un Guglielmo
typé et vocalement assuré. Rod Gilfry campe un
Alfonso de stature, cynique au second degré. La Dorabella
de Kate Lindsey, après un début peu assuré, prend son envol dès le premier air,
l'agité « Smanie implacabili »,
et sa pèche de fille libérée, un brin perverse, relève
les autres airs et ensembles. Plus affirmée ici est sa conversion au nouveau
statut de femme libérée. Lenneke Ruiten
donne de Fiordiligi, qui occupe une place essentielle, au point de
demeurer seule en scène à la fin de la pièce, un portrait savamment buriné. Les
deux airs sortent du lot, dont « Per pietà», mené
par Langrée à un tempo étonnamment lent, laissant à
l'interprète tout loisir d'en détailler les arabesques et les sauts
d'intervalles vertigineux ; sans parler
de la gestique qu'on lui impose. ''Mixed bag'' donc, comme bien souvent chez
Mozart ces temps...
Sous le regard d'Antigone : Oedipus Rex
& La Symphonie de Psaumes
Igor STRAVINSKY; Oedipus Rex. Opéra-Oratorio d'après Sophocle. Livret de Jean
Cocteau traduit en latin par le cardinal Jean Danielou.
Texte parlé : adaptation d'après Sophocle par Peter Sellars,
traduite en français par Alain Perroux et Vincent Huguet. Symphonie de Psaumes. Joseph Kaiser, Violeta Urmana, sir Willard White, Joshua Stewart. Pauline
Cheviller, récitante. Laurel Jenkins, danseuse. Orphei
Drängar, Gustaf Sjökvist Chamber Choir, Sofia Vokalensemble.
Philharmonia Orchestra, dir.
Esa-Pekka Salonen. Mise en
scène : Peter Sellars. Grand Théâtre de Provence.

Créon (Willard
White) harangue la foule de Thèbes ©Vincent Beaume
Poursuivant le cycle des œuvres scéniques de
Stravinski, Peter Sellars présentait Oedipus Rex suivi de la Symphonie de
Psaumes. Il imagine de narrer l'histoire d'Oedipe
du point de vue de sa
fille Antigone qui en pressentant le cours, commente les événements ou les mime
jusqu'à leur tragique issue, suite à l'errance du roi vers Colone
après qu'il eut été chassé de Thèbes. Le rapprochement des deux pièces devient
alors une évidence, la symphonie décrivant les derniers instants du roi déchu :
« un mendiant aveugle errant de pays en pays, mené par ses deux filles
Antigone et Ismène » (Peter Sellars). A priori
improbable, le couplage fait dès lors sens. Pour ce faire, Sellars
a imaginé un texte parlé à partir de Sophocle. On est loin du rôle du récitant
de la création parisienne de 1927, conçu par Jean Cocteau - que Stravinski
devait plus ou moins rejeter sur le tard. En tout cas l'aspect pompeux, pour ne
pas dire pompier, du récit de liaison annonçant au spectateur les événements
est évacué au profit d'une prose fluide et théâtrale. Et les divers épisodes
d'une pièce fragmentée s'articulent en un tout cohérent. Oedipus
rex ne passe pas pour la plus abordable des
partitions de l'auteur du Sacre : une succession de monologues s'inscrivant
dans un continuum choral incantatoire. On a souvent fustigé sa froideur,
pourtant recherchée par les auteurs, son caractère hybride qui mêle plusieurs
modes (parlé et chanté) et la référence à divers styles, sans parler de son
expression en latin, « une matière non pas morte, mais pétrifiée, devenue
monumentale et immunisée contre toute civilisation » (''Chroniques de ma
vie'') ; tous procédés aptes à provoquer sinon un malaise, du moins une incompréhension
chez l'auditeur.

Oedipe (Joseph Kaiser)
entouré d'Antigone et d'Ismène ©Vincent Beaume
Rien de tel ici. La lisibilité de
l'approche saute aux yeux dès les premières répliques. Celles du chœur d'hommes
que Sellars place à juste titre au centre de son
propos, non comme une masse informe et figée, mais telle une assemblée
d'individus soudés par une même idée, au cœur de la pièce, tour à tour
acclamant ou exigeant, glorifiant ou vociférant. Une ensemble
qui à l'inverse des personnages épisodiques (à l'exception d'Oedipe), n'est en aucun cas statique. Sellars
les a imaginés en personnages de tous les jours, vêtus majoritairement de bleu,
travaillant leurs réactions en utilisant un langage des signes si familier chez
lui. Cela se vit comme une chorégraphie d'un esthétisme peu commun : attitudes,
mouvements lents ou vifs, épousent les péripéties du drame, surtout par
l'expression des mains et des bras, liés ou déliés, debout ou assis, par
exemple en tailleur autour du roi, tels ses fervents disciples, ou criant leur
rage bras tendus lors de la harangue de Créon. Ils sont le décor même de la
pièce. Qui est vécue dans un espace immaculé d'un blanc aveuglant ou légèrement
tamisé, avec pour seuls accessoires sept sièges totémiques au premier plan. Les
personnages du drame s'inscrivent sans hiatus dans cet environnement : Oedipe d'abord qui assure les entendre, tente de les
rassurer et peu à peu est vécu comme le responsable du malheur qui s'abat sur
Thèbes, dévorée par cette histoire mortifère de prophétie d'enfant tuant son
père et épousant sa mère, de meurtrier qui n'est autre que le roi lui-même. Les
interventions de Créon, de Tiresias ou du Messager
prennent un relief étonnant, faisant démentir leur caractère habituellement
limité, leur participation devenant plus essentielle. Même celle de Jocaste,
d'ordinaire si empesée et forcée, prend sa naturelle place au sein de ce fort
ordonnancement théâtral. A la fin, le chœur se referme sur Oedipe
comme pour mieux signifier qu'il est désormais rejeté, chassé de la ville. La
Symphonie de Psaumes prend alors le relai (après un entracte dont on aurait
pu se passer, pour rendre le continuum encore plus évident) : « Qui a
pitié d'Oedipe ce soir ? » s'interroge Antigone.
Oedipe muet et ingambe parcourt le fond du plateau,
soutenu par ses deux filles dont l'une se livre à une danse évanescente au
milieu du chœur avant une sorte de mise au tombeau, symbolisant les derniers
instants du roi déchu, et une fin chorégraphiée, objet du troisième mouvement,
conçue par Stravinski comme « une danse extatique de joie autour de la tombe ».
Outre qu'il rencontre l'idée même du compositeur, l'effet est médusant. Les
trois ensembles choraux réunis, dont deux finlandais et un bulgare, sont d'une
formidable précision et agissent comme des solistes. Ceux-ci sont plus
qu'irréprochables, Joseph Kaiser au premier chef, Oedipe
alliant force et résolution, de sa voix de ténor ductile se jouant de aspérités
d'un rôle ingrat, Willard White, sous les traits fort différentiés, même
vocalement, de Créon, Tirésias et du Messager, parangon de force, et Violeta Urmana qui prête sa grande voix à Jocaste et une allure
royale. La réussite musicale doit pourtant l'essentiel à Esa-Pekka Salonen qui ne cache pas
son empathie pour ces pièces. Et tire du Philharmonia
Orchestra des sonorités proprement envoûtantes, dans le registre des bois tout
particulièrement, pour un rendu clair et engagé.
Mélisande, l'inimaginable rêve
Claude DEBUSSY : Pelléas et Mélisande.
Drame lyrique en cinq actes et 12 tableaux. Livret d'après la pièce éponyme de
Maurice Maeterlinck. Stéphane Degout, Barbara Hannigan, Laurent Naouri, Franz-Josef Selig,
Sylvie Brunet-Grupposo, Chloé Briot,
Thomas Dear. Cape Town Opera Chorus. Philharmonia
Orchestra, dir. Esa-Pekka Salonen. Mise en scène : Katie Mitchell. Grand Théâtre de
Provence.

Acte I Première
scène ©Patrick Berger/ArtcomArt
Attention chef d'œuvre ! On a vu beaucoup de
productions de Pelléas et Mélisande, et
des plus accomplies, que ce soit en adoptant la clé de lecture symboliste (Ponnelle, Braunschweig) ou en se
plaçant sur le terrain plus naturaliste (Vick, Nordey, Martinoty), voire une
manière suggestive, comme impressionniste (Wilson). Mais, cette fois, le drame
lyrique de Debussy connait une autre dimension car nous est ouvert le livre de
l'imagination. La régisseuse Katie Mitchell, à qui l'on doit déjà à Aix Written on Skin (2012) et Alcina
(2015), nous immerge dans un univers onirique, perçant peut-être le secret de
cette œuvre unique. Elle souligne combien la pièce de Maeterlinck, à l'origine
du drame musical de Debussy, doit au théâtre de Tchékov,
et comme « son étrange atmosphère provient de forces inconnaissables qui
créent un étrange malaise, une légère anxiété.» Car on
a affaire, selon elle, à un symbolisme ''surréaliste'' qui dépasse et
transcende tout réalisme. Cette histoire d'échange triangulaire entre une femme
et deux hommes n'est-elle pas en fait celle de la première, objet des attentes,
des projections que font sur elle les deux autres ? D'où l'idée de la concevoir
à travers le regard de Mélisande, personnage omniprésent, vivant lui-même, ou
racontant par son double, les événements qui se passent ou vont se produire.
Formidable pari qui unit la construction dramaturgique depuis le prélude où on
découvre Mélisande en robe de mariée blanche affalée sur le lit de sa chambre,
jusqu'à l'épilogue qui la retrouve dans la même position comme se relevant d'un
rêve sans doute cauchemardesque. A cette première idée, Mitchell en ajoute une
autre, tout aussi osée : celle de jouer les interludes entre scènes, dont on
sait que Debussy les a ajoutés à la demande du directeur de l'Opéra Comique pour pallier la difficulté de mettre en place
les décors. Une extrême fluidité s'installe alors dans une œuvre
« constamment en mutation », dépourvue de tout cloisonnement entre
tableaux, voire entre actes eux-mêmes. Il se passe des choses peut-être essentielles durant ces moments d'apparent répit
qui, si on y regarde de près, ne sont pas neutres musicalement car concluant un
tableau et annonçant le suivant. C'est donc par l'appréhension qu'en a
Mélisande que le drame s'inscrit, ici dans la vaste demeure d'Arkel où cinq personnages sont retenus dans leur vie
quotidienne : la salle à manger, la chambre, la piscine désaffectée et
défraichie - qui tient lieu de fontaine des aveugles -, une galerie miteuse en sous sol - en guise de grotte en bord de mer-, un attique,
un antichambre exigu, lieu de tous les apartés, et un escalier en colimaçon
vertigineux qui recueille bien des échanges furtifs ou ce baiser de
remerciements donné sur le front du petit Yniod par
un Golaud satisfait de la manigance de voyeurisme
qu'il lui a imposée. Tous lieux qui se font et se défont par un habile
mouvement de translation latéral. Pas d'extérieur donc mais une série
d'instantanés ou de longs échanges dedans, comme pour mieux signifier combien
les personnages sont enfermés, emprisonnés même, dans ce château d'où
« l'on ne voit jamais le ciel ».

Golaud (Laurent Naouri), Yniod (Chloé Briot) et le spectre
de Mélisande
©Patrick Berger/ArtcomArt
D'une fabuleuse cohérence, cette lecture
découvre d'étonnantes perceptions : la première rencontre entre Pelléas et Mélisande, dans la piscine délabrée, transmet
une insondable tristesse, à l'aune de la gaucherie du garçon face aux
entreprises de la jeune femme. Le tableau de la tour et de la chevelure se
jouera dans la chambre et sur le lit même dans des positions bien évocatrices.
Des scènes cardinales sont complétement revisitées ; dont on donnera trois
exemples : le tableau de la lecture de la lettre par Geneviève (acte I, scène 2),
dans la salle à manger regroupant alors Arkel à qui
on lit la missive, mais aussi une Mélisande qui voit ce qui se dit et se
prépare ; l'arrivée de Pelléas donne lieu à un jeu de
scène d'une étonnante liberté : le double de Mélisande ne s'attache-t-elle pas
à son cou ! Le tableau durant lequel Golaud fait
épier par Yniold les deux supposés amants restera un
moment d'anthologie. On sait cette scène peu aisée tant la ficelle est grosse
et la réalisation musicale délicate : l'antichambre dont une lucarne donne sur
la chambre à coucher où « Petite mère a allumé sa lampe », découvre
un grand escabeau sur lequel Golaud hisse l'enfant
terrorisé - comme retenu par le spectre de Mélisande -, tandis que de l'autre
côté de la cloison les deux protagonistes d'abord interdits, se dévêtent pour
apparaître complètement nus. Vu du dedans, ce tableau prend un tour encore plus
insoutenable. Le premier tableau de l'acte IV encore : où sont réunis à table
autour d'Arkel l'ensemble des cinq protagonistes pour
un repas plutôt frais, dont un Golaud effondré de
douleur. Qui lors des terribles invocations « Absalon, Absalon... »
devient fou furieux, d'une violence incontrôlée, sous les yeux terrifiés de
l'enfant et la compassion de Geneviève qui tente de consoler un Pelléas désorienté. Les transitions entre scènes sont tout
aussi révélées, souvent par le prisme des interludes : Mélisande à qui des
servantes passent l'anneau au doigt pour se parer (Inter. entre
les scène 1 & 2, acte I), la rencontre furtive entre Pelléas
et Mélisande pour convenir du dernier rendez-vous à la fontaine des aveugles,
le baiser de Golaud à l'enfant dans l'escalier, alors
que le double de Mélisande est bien présent. La continuité peut s'entendre
entre actes aussi : entre les Ier et II ème, où la
chanson médiévale de Mélisande sera délivrée dans l'antichambre où s'est clôt
l'acte précédent. D'autres scènes sont réévaluées comme celle d'Yniold et de « la pierre lourde », peut-être pas
aussi banale qu'il n'y paraît : le gamin voit défiler les ''petits moutons''
qui ne sont autres que les membres de sa famille yeux bandés ; tout comme les
trois mendiants de la scène de la grotte avaient pour nom Geneviève, Golaud et Arkel - idée déjà
retenue naguère par Jean-Pierre Ponnelle. Bien sûr,
tout cela va très loin et prend ses aises avec les didascalies, comme
l'attitude de Mélisande qui n'est pas aussi énigmatique que souvent ; fruit
d'une approche là aussi réévaluée du personnage : la jeune femme qui a déjà un
passé, propulsée dans la nébuleuse opaque d'Allemonde,
n'est sans doute pas aussi ''innocente'' qu'on le pense. « Une personne très
manipulatrice, qui précipite les événements », selon Salonen.
Mais la vision fait tant cohésion qu'on reste subjugué par le tour de force
consistant à donner vie à ce qui est si fragile dans les destinées humaines,
sans tomber dans la facilité ou frôler le naturalisme.

Stéphane Degout & Barbara Hannigan
(Acte IV) ©Patrick Berger/ArtcomArt
D'autant que l'interprétation atteint le
sublime grâce au naturel des attitudes et gestes comme de la déclamation qui
n'a jamais parue si proche du langage parlé, sans parler d'une attention
musicale pénétrante. A commencer par Barbara Hannigan,
superbe actrice et voix inextinguible. L'identification au personnage de
Mélisande est totale chez une musicienne qu'on sait rompue à la modernité. Pas
de physique souffreteux, mais jeune belle femme en possession de tous ses
moyens de séduction. Une interprète à laquelle sont demandées des prouesses
physiques peu ordinaires. Une approche toute en nuances dans une diction
irréprochable. Enfin une musicalité que bien de ses consœurs peuvent dès lors
lui envier. Quelle remarquable prise de rôle ! Stéphane Degout
renouvelle sa perception de Pelléas à travers la
lecture de Mitchell : un jeune homme coincé, peu à peu déniaisé par Mélisande,
qui reste cependant d'une parfaite élégance ; une voix claire de baryton Martin
au mâles couleurs, considérée comme idéale pour le rôle. Laurent Naouri lui
aussi approfondit son interprétation, déjà légendaire, de Golaud
avec des accents encore plus vrais (le dialogue avec l'enfant, les échanges
froids avec Pelléas lors de la scène des souterrains
et de celle qui suit, d'un détachement qui fait froid dans le dos ; comme plus
tard à l'endroit de Mélisande sur le « parce que c'est l'usage »,
délivré dans un mezza voce effrayant). Franz-Josef Selig
donne d'Arkel un portrait tout aussi sincère, sans
affectation ni nonchalance, et la basse sait sonner dans le forte. La
Geneviève de Sylvie Brunet-Grupposo est un modèle de
style et de voix puissante, alors que la régie confère à cette partie une place
déterminante puisque le personnage est présent durant bien des scènes. Enfin,
grâce au parti de renoncer à faire jouer Yniold par
un jeune garçon, ce qui est musicalement peu tenable, Chloé Briot
donne de celui-ci une interprétation d'une vérité étonnante, tant scénique que
vocale. Un quintette frôlant l'idéal. Grâce à la main plus qu'aidante d'Esa-Pekka Salonen. Sa lecture s'avère
d'une rare clarté et le Philharmonia n'y est pas pour
rien ! Rarement a-t-on entendu une telle fraîcheur inonder cette musique, une
telle sonorité magique s'emparer de l'espace, un tel équilibre interne
s'instaurer entre phrasé soutenant les chanteurs et continuum symphonique ; au
point de laisser primer à l'occasion l'orchestre ; mais s'en plaindra-t-on ?
Car il est des passages où l'orchestration debussyste reste si chargée qu'elle
laisse peu d'espace au chant. Une mémorable expérience !
Jean-Pierre Robert.
***
FESTIVALS! : NOHANT, BEAUNE ET LES AUTRES...
Quatre
jours de bonheur à NOHANT

Nohant, lieu charmant à l'étymologie limpide
si je puis dire (nohant, comme noue ou noe, trahit un rapport avec l'eau : il qualifie un pré assez
bas pour être régulièrement inondé). Mais surtout lieu-culte puisque c'est dans
ce petit village (réuni à partir de 1822 à la commune de Vic sur St-Chartier)
que Marie Aurore de Saxe - fille naturelle de Maurice de Saxe - acheta, à la
Révolution, au gouverneur de Vierzon, un petit domaine. Là où grandit sa petite
fille, Aurore, qui deviendrait un jour George Sand ! Là enfin que la
grande romancière recevrait ses nombreux amants, dont Frédéric Chopin, qui y
restera sept longs étés, et y composera une grande partie de son œuvre (notez
le caractère prémonitoire du nom du hameau à l'est de Nohant sur la carte
Cassini - vers 1740 - La Chopinerie » !).
L'authenticité du lieu (la maison, restée
dans la famille jusqu'à la mort de la petite fille de George Sand, Aurore
Dudevant en 1961, a subi peu de modification) inspira la création en 1966 d'un
festival, qui fêtait donc cette année son cinquantenaire.
Durant quatre jours, j'ai pu assister avec
bonheur aux divers concerts, conférences, lectures et masterclasses programmés avec soin par le président du festival,
Yves Henry, et son directeur artistique Jean-Yves Clément. Depuis une vingtaine
d'années, les manifestations s'étalent sur deux périodes : Les week-ends
de juin, et une semaine entière en juillet (du 21 au 27 cette année). Vantons
tout de suite le caractère familial de cette semaine, dû à la variété des
manifestations proposées, et à la sympathie des intervenants.

DR
Conférences
La dernière des trois conférences auxquelles
j'ai pu assister, proposée par Jean-Yves Clément, portait sur une association
en apparence antinomique : Glenn Gould et le romantisme. A l'occasion de
la sortie de son livre Glenn Gould ou le
Piano de l'Esprit, le docteur en philosophie tentait de montrer, en
élargissant la signification de l'adjectif « romantique », en quoi
l'engagement intellectuel et affectif du grand pianiste canadien, ses
interprétations très inspirées de Beethoven et Brahms pouvaient permettre de
lui attribuer une telle étiquette. L'occasion pour le public de voir ou
entendre plusieurs extraits significatifs de ses interprétations.
La première des deux conférences proposées
par le grand chercheur chopiniste Jean-Jacques Eigeldinger m'a particulièrement
intéressé. J'ai toujours défendu l'idée que deux des œuvres (de publication
tardive) qu'on attribuait à Chopin (la Valse en la mineur et le Nocturne
en ut mineur) étaient beaucoup trop simples structurellement et
harmoniquement pour être de la plume du maître polonais. Voilà que Jean-Jacques
nous livre sa découverte : ces deux pièces avaient été publiées, dès 1847,
sous le nom de Charlotte de Rothschild - au milieu de deux autres, de
facture et thématique fort similaires ! Ainsi le professeur Chopin avait
dû simplement « aider » sa belle élève à formuler ses idées
mélodiques (puisqu'on reconnaît dans le manuscrit son écriture) !
La seconde intervention de Jean-Jacques
Eigeldinger portait sur la découverte de quatre dessins de main de Maurice Sand
(qui, comme on le sait, était un élève d'Eugène Delacroix), qui semblent
représenter la sinistre du compositeur polonais !
Lectures
A trois reprises, durant ces quatre jours,
furent proposées, en parallèle aux œuvres pianistiques, des lectures de textes
d'auteurs divers (George Sand ou ses proches). Inutile de dire combien magique
était - comme à son habitude - l'intervention de Marie-Christine Barrault,
attendant le public « aux quatre coins » du jardin, lors d'une
ballade nocturne à la lumière des bougies et au son du groupe folklorique
« les Gâs du Berry ». Non moins émouvante la lecture partagée de la
correspondance entre George et Flaubert, par deux acteurs (anciens élèves du
créateur du festival, Jean Darnel), Gabriel le Doze et Anne Plumet, entrecoupée
de pièces de Chopin jouées par Yves Henry sur le pianino Pleyel ayant appartenu
à l'auteur de la Mare au diable.
Enfin, le couple - devenu célèbre - François-René Duchâble et Alain Carré
alternèrent également missives et œuvres de compositeurs divers. La déclamation
très théâtrale (trop à mon goût) du directeur du festival des Lumières y
était avantageusement contrebalancée par la « justesse de ton »
du grand pianiste.
Masterclasses
On pourrait imaginer que les masterclasses soient suivies, comme de
coutume, surtout par des étudiants pianistes et professeurs. Or ce qui est
remarquable ici, c'est que toute la petite ville de La Châtre (puisque c'est
dans le magnifique petit théâtre de cette commune qu'il se déroule) semble
assister à ce rendez-vous quotidien ! Il faut dire qu'Yves Henry mène
« piano-battant » ces trois heures matinales : muni d'une caméra
qui permet de projeter la partition, il sait habilement prodiguer ses conseils
à la fois en direction des pianistes en herbe sélectionnés pour l'exercice, et
du public, qui paraît avoir suivi, au cours des années successives, une formation
digne d'un critique avisé. Doit-on présenter Yves ? Titulaire d'un nombre
impressionnant de prix du CNSM de Paris, j'ai eu la chance de le connaître
alors qu'il achevait, à 17 ans, sa formation de pianiste dans l'établissement.
Quel claque pour le jeune homme que j'étais (nous avons le même âge) qui
rêvait, après son Bac, de devenir concertiste, de voir qu'un garçon achevait sa
formation alors que j'allais, moi, la débuter ! On ne dira jamais assez
combien les études musicales doivent être entreprises tôt pour qui se destine à
la profession de musicien ! Non, je ne connais aucun grand concertiste,
des Duchâble aux Capuçon et autres Luisada, qui n'ait débuté l'instrument à
l'âge où d'autres jouent à la poupée et aux petits soldats. Il y a une grande hypocrisie
dans les discours qui pourraient laisser à penser qu'on peut mener une grande
carrière en débutant tardivement.
Il m'a fallu personnellement toute l'amitié
et les encouragements des Cziffra, Trouard, Loriod et Badura-Skoda pour que je
n'abandonne pas l'idée de faire du piano mon métier. Mais auparavant, j'avais
trouvé en Jacqueline Dussol un professeur lucide et merveilleux. Et c'est
précisément dans son petit studio de la rue de Moscou, où elle enseignait, que
j'ai rencontré Yves ! Je pense sincèrement que l'immense talent de cette
grande dame du piano (dont elle possédait une connaissance très très
intuitive), disparue trop tôt, avait créé chez lui ce terrain favorable qui lui
permettrait ensuite de progresser sous la houlette de Pierre Sancan ou Aldo
Ciccolini ! Elle nous a inculqué à tous deux le caractère primordial de
l'enfoncement dans le clavier dont j'ai encore entendu parler l'autre
matin ! A la lecture de l'Art du
piano de Sviatoslav Richter, que Jacqueline recommandait absolument, elle
avait conçu l'idée d'une identité de vue parfaite avec Neuhaus, le pédagogue
qui forma tous les grands de l'École russe. Quant au grand Badura-Skoda,
j'ignore si Yves l'a côtoyé autant que moi, mais c'est à croire, vu
l'importance que ce dernier accorde au travail sur instrument ancien.
Sur la scène du théâtre de la Châtre trône en
effet un Pleyel de 1847, sur lequel les apprentis pianistes peuvent jouer,
comprenant mieux, à travers l'enfoncement et les sonorités très particulières
de l'instrument, comment il convient d'aborder les œuvres de Chopin. Car c'est
bien en connaissant parfaitement le toucher d'un piano de l'époque de Mozart,
de Schubert, de Beethoven, que Paul Badura-Skoda arrive à rendre cette
authenticité du discours musical sur un piano moderne. Qu'on ne s'y trompe
pas : les compositeurs cités auraient éprouvé une joie sans concession
s'ils avaient pu entendre le son étincelant et charpenté d'un Steinway ou d'un
Yamaha ! Et il faut un certain « courage » pour écouter de
nos jours les versions sur Hammerklavier
des sonates de Beethoven par le pianiste viennois. Mais quelle science des
tempi, du legato, de la pédale, de l'harmonie ! Cette dernière est
évidemment aussi le point fort d'Yves, puisqu'il est actuellement professeur en
la matière au CNSMP ! Et c'est toujours, comme devraient le faire tous les
concertistes ( !), à partir de constatations d'ordre harmonique, qu'Yves
explicite l'interprétation de chaque passage d'une œuvre. Pour ceux qui
souhaitent avoir une idée de l'importance de l'harmonie dans
l'interprétation, je recommande la
collection L'Initiation à l'harmonie et à
l'interprétation à partir des Polonaises de Chopin dont les deux premiers
volumes sont parus aux Éditions Beauchesne.
Les concerts
Le nombre élevé d'artistes invités, lié à
cette diversité des manifestations culturelles dont je parlais, donne, me
semble-t-il, à ce « Nohant Festival Chopin » la légitimité d'un
miroir de l'évolution de l'interprétation et de la réception de Chopin dans le
temps. Non pas, bien sûr, en écoutant des artistes reconnus comme François-René
Duchâble, dont le style intemporel ne prête pas à discussion ! Mais après
avoir entendu de nombreux jeunes (dont pas mal de lauréats des derniers
concours Chopin), j'ai cru nettement apercevoir les horizons vers lesquels se
tournait l'interprétation des œuvres du polonais en ce moment.
A chaque époque ses marottes, ses
obsessions : cela a déjà été établi en ce qui concerne Frédéric, par
exemple dans un livre, auquel j'ai eu l'honneur de participer : L'interprétation de Chopin en France
(sous la direction de Daniel Pistone, Paris, Honoré Champion, 1990). A chaque
nouvelle étude, on peut faire le constat - au-delà de l'empreinte personnelle
de chaque individualité marquée - d'un consensus qui comporte ses qualités et
ses défauts.
Ce
que je retiens de l'orientation actuelle ?
-
une
recherche extrême dans la sonorité, particulièrement dans la volonté
d'atteindre des pianissimi inouïs ;
-
un
parti pris de rendre apparente la moindre modulation ou le moindre détail
harmonique ;
-
une
jouissance de la puissance des pianos actuels ;
-
une
connaissance et une mémorisation des œuvres remarquables (sauf pour l'un des
pianistes, Julien Brocal, qui
n'atteindra la concentration que lorsque ses gestes incontrôlés et perturbants
le lui permettront)
-
une
manière de timbrer la mélodie qui ne laisse aucun doute quant à la préséance de
la main droite.
Voici pour les qualités.
Les
défauts, qui, à mon goût, forment le revers de la médaille :
-
une
palette sonore assez déficiente, qui oublie d'exploiter, entre les extrêmes, la
diversité dynamique très importante des instruments actuels. Heureusement que
la qualité des pianos rend la tonitruance de ces fortissimi audible ! Pourtant les quadruples forte d'un Dang Thai Son résonnent encore
dans ma trompe d'Eustache !! Cela dit j'ai largement préféré son
interprétation de Chopin à celle de Ravel : l'esprit de la musique
française est-il si différent de celui du romantique mazovien pour qu'un grand
pianiste comme Dang se fourvoie à ce point dans la compréhension de l'auteur
des Jeux d'eau ?
-
le
refus de mener une phrase à son climax (combien d'incises merveilleusement
mises en relief chez Charles Richard-Hamelin, qui avortent avant
« d'atteindre l'étoile », choisissant pour les notes ultimes une
préciosité qui nous renvoie directement à la fin du XIXe siècle).
-
la
faiblesse de certaines basses et contrechants, trahissant une main gauche qui
semble avoir opté pour le destin du Masque de fer (chez Ronald Noerjadi
par exemple) !
Bref,
comment comprendre ce paradoxe : dans le contexte inégalé de la présence
de grands spécialistes comme Jean-Jacques Eigeldinger, ou Irène Poniatowska
(que je regrette beaucoup de n'avoir pu entendre), comment accepter que les
meilleurs artistes du moment oublient à ce point les paroles du maître, telles
qu'elles furent rapportées par ses élèves, et qu'on peut résumer en quelques
concepts :
-
varier
sa palette sonore entre le quadruple piano et le mezzo-forte, mais ne jamais
taper.
« Dans
l'exécution, il faut déployer un son ample, plein et rond ; se servir de
gradations infinies dans l'échelle des nuances, qui vont du pianissimo au
fortissimo, mais en évitant absolument de tomber dans un murmure indistinct
pour le pianissimo, tout comme dans le fortissimo d'asséner des coups qui
blesseraient un oreille sensible »
-
Confier
à la main gauche le rôle du chef d'orchestre d'opéra : un déroulement imperturbable dans son agogique, et qui
laisse « le chanteur » - la main droite en général, mais n'oublions
pas qu'il existe aussi des barytons et des basses ! - s'exprimer
librement, avec un rubato qui proscrit la contagion !
« Dans
le maintien du tempo Chopin était inflexible, et beaucoup seront surpris
d'apprendre que le métronome ne quittait pas son piano. Même dans son tempo
rubato tant décrié, une main – celle qui a la partie accompagnante – continuait
à jouer strictement en mesure, tandis que l'autre – celle qui chante la mélodie
– libérait de tout le carcan métrique la vérité de l'expression musicale ;
soit qu'elle retarde indécise, soit qu'animée d'une sorte de véhémence
fiévreuse, elle anticipe, comme quelqu'un qui s'enflamme en parlant. »
-
Et
par-dessus tout cela, le plus difficile à conserver : la SIMPLICITÉ, que
Chopin considérait comme le but ultime de l'étude pianistique.
« La
dernière chose, c'est la simplicité. Après avoir épuisé toutes les difficultés,
après avoir joué une immense quantité de notes et de notes, c'est la simplicité
qui sort avec tout son charme, comme le dernier sceau de l'art. Quiconque veut
arriver de suite à cela n'y parviendra jamais ; on ne peut commencer par
la fin. Il faut avoir étudié beaucoup, même immensément pour attendre ce
but ; ce n'est pas une chose facile. »
Comment ne pas être, par exemple, surpris par
la frilosité des interprètes qui nous donnent encore, en 2016, des Mazurkas
comme s'ils n'avaient jamais lu le livre d'Eigeldinger :
« Ce doit être en 1845 ou 1846 que je
m'aventurai un jour à lui faire la remarque que, jouées par lui, la plupart de
ses Mazurkas semblaient notées non à 3/4 mais à 4/4 du fait qu'il s'attardait
avec insistance sur la première note de la mesure. Il le nia énergiquement,
jusqu'à ce que je lui aie fait jouer une Mazurka tandis que je comptais tout
haut à quatre temps, ce qui jouait parfaitement. Il expliqua alors en riant que
c'était le caractère national de la danse qui se trouvait à l'origine de cette
particularité. A entendre jouer Chopin, le plus remarquable était qu'on avait
l'impression d'un rythme à 3/4 tout en entendant une mesure binaire. Naturellement
tel n'était pas le cas de chaque Mazurka, mais de beaucoup pourtant. » (lire aussi l'anecdote de la venue de
Meyerbeer).
Un peu comme si le concert du Nouvel an à
Vienne continuait à nous donner les valses de Strauss dans le style d'André
Verschueren !
Conclusion
Non,
je n'ai pas complètement rencontré, lors de ces quatre merveilleuses
journées à Nohant, le Chopin qui hante mes heures depuis ma prime jeunesse, ce
Chopin adversaire absolu de l'afféterie, de la brutalité, celui sous les doigts
duquel chaque pièce paraissait improvisée, susurrée. Et pourtant, il se montre
dans chaque recoin de cette bâtisse illustre et de son jardin, ce génie pour
lequel mon imagination d'adolescent traça un jour ces lignes acrostiches :
Formidable génie au cœur
pur et fragile
Rien ne m'émeut plus
que les accents fébriles
Et la féroce amertume
qui animait ton style.
Doux héros de mes
rêves juvéniles
En qui j'ai découvert
le bonheur facile,
Rien n'est plus beau
que ces pages graciles,
Inimitables
chefs-d'œuvre nés de sombres idylles.
Chaque fois que mes
mains, jamais assez agiles,
Cherchent ton cœur
dans cet ingrat morphil ;
Hallucinations
cruelles : je crois voir ton profil.
O ! Beau génie,
beau génie qu'on mutile !
Pourquoi fallait-il
donc que cette maladie vile,
Immonde vautour, des
ténèbres servile,
Nous privent à jamais
de ton âme infantile !
Il
faudra donc revenir à Nohant ; et guetter l'âme de « Chip Chip »
dans les bosquets et dans la persévérance des interprètes ! Merci Yves
Henry, de nous offrir ce cadeau, chaque été renouvelé !
Philippe Morant.
A BEAUNE : La fine tragédie de Didon et Enée
Henry PURCELL: Dido
and Eneas. Opéra en trois actes. Livret de Nahum Tate. Marc-Antoine
CHARPENTIER : Actéon. Pastorale en musique ou
opéra de chasse. Vivica Genaux, Yaïr Polishook, Daniela Skorka, Anat Edri,
pauline sikirjji, Jean-François Novelli, Mark Milhofer, Etienne Bazola, Mathieu
Montagne, Paul Crémazy. Les Talens Lyriques, dir. Christophe Rousset. Version
de concert.

©Festivaldebeaune
Ouvrant sa saison dans la magnifique cour des
Hospices, sous une nuit étoilée, le Festival de Beaune présentait Didon et
Enée de Purcell. Christophe Rousset, un habitué des lieux, en était
l'artisan, à la tête de ses Talens Lyriques. L'unique opéra de Purcell conserve
une part de mystère quant à ses origines : créé pour un pensionnat de jeunes
filles de Chelsea ou imaginé pour le pur divertissement du roi Charles II ? Les
plus récentes études tendent à privilégier cette seconde explication. Autre
élément intéressant : le rapprochement avec la musique française. Le futur
Charles II d'Angleterre vécut longtemps en exil en France où il se prit de
passion pour les œuvres des musiciens de l'époque, qu'il introduit dès son
retour outre Manche, comme Marc-Antoine Charpentier. Quoi qu'il en soit, Didon
et Enée reste une pièce à part et offre bien d'autre singularités. Son extrême concision
d'abord : trois actes enchaînés, d'une durée totale de moins d'une heure ; un
effectif instrumental réduit tout comme sa distribution vocale ; une trame
mêlant tragique et comique, héritée du masque de cour anglais, pour conter
l'histoire bien connue du désamour de la reine de Carthage et de son ingrat
héros appelé à fonder Troie. L'interprétation de Rousset est intéressante en ce
qu'elle est empreinte d'une sobriété qui tend à gommer les excès de bien des
lectures britanniques : dans les passages dits comiques par exemple, telles les
interventions de la Sorcière ou Magicienne, dont le rôle est confié ici à un
baryton, et non à une mezzo comme souvent. Le caractère sarcastique d'un
passage comme « Appear, Appear at my call » sera volontairement peu
souligné : foin des imprécations nasillardes de la dame. De même que celles des
deux autres sorcières. Il en résulte un continuum tragique plus cohérent. L'orchestre
est très clair, ce que favorise l'acoustique feutrée de la cour des Hospices.
Ouverture, ritournelles et danses sont pensées avec goût et les musiciens de
Talens Lyriques jouent raffiné. Et on admire le continuo évocateur comme le
beau clavecin de Francesco Corti. Tout comme l'idée de composer le chœur de
l'ensemble des solistes, ce qui gagne en intensité. Vivica Genaux, qu'on
n'associait pas forcément à la partie de Didon, en donne un portrait de classe
: noblesse d'accents, déclamation elle aussi nantie de sobriété, ornementations
vocales irréprochables. Le premier air « Ah! Belinda, I am prest » (Ah!
Belinda, je suis oppressée), comme le célèbre lamento final culminant sur
« Remenber me » impressionnent par leur juste émotion. L'Enée du
baryton israélien Yaïr Polishook, un nom nouveau, est tout aussi frappé au coin
de la mesure, voire de la retenue dans l'arioso purcellien. Leur duo est frappé
au coin de la retenue. Des autres protagonistes, on retiendra la Belinda de
Daniela Skorka, d'une grande fraicheur, le Spirit du ténor Jean-François
Novelli, la sorcière d'Etienne Bazola et le marin de Mark Milhofer.
Ce dernier est la figure centrale de la
Pastorale Actéon de Marc-Antoine Charpentier, qui ouvrait la soirée.
Choix judicieux, car outre la simultanéité chronologique, l'année 1684, les
deux œuvres partagent une même idée de raffinement orchestral et de subtilité
dramatique. Actéon a été écrit pour Mlle de Guise, protectrice du
musicien, et cette mini tragédie, tirée du livre III des Métamorphoses d'Ovide,
sur la destinée infortunée d'un jeune homme insouciant qui surpris à épier
Diane et ses compagnes se baigner dans une source, se vit transformer en cerf,
annonce déjà en ses six scènes la profondeur de David et Jonathas. La
musique en est élégante, comme le Prélude et le chœur des chasseurs et, plus
tard, l'interlude avant la scène 5, d'une grande affliction. La fin chorale
sonne comme un requiem. Superbe interprétation de Rousset et de ses forces
instrumentales et vocales, dont le haute-contre Mark Milhofer, fort émouvant
dans sa fervente déclamation.
Jean-Pierre Robert.
Bertrand Chamayou à l'ombre des platanes de la ROQUE D'ANTHÉRON

©Marco Borggreve
René Martin, l'infatigable initiateur du
Festival de la Roque d'Anthéron a choisi d'ouvrir la 36 ème édition par un
concert de musique française. Avec Bertrand Chamayou en soliste et l'orchestre
national de Lyon dirigé par Andris Poga. Debussy, Ravel, Fauré et Saint
Saens : la palette des couleurs est irréprochable. La Petite Suite de
Debussy nous met en bouche, quatre mouvements qui nous mènent successivement
« en bateau », « en cortège » pour s'accomplir dans un
menuet puis un ballet. Musique composée en 1889, soit six ans avant l'invention
du cinéma, elle préfigure ce que seront les musiques de film trente ans plus
tard. Des glissandos de cordes légers et des thèmes imagés qui s'enchaînent
comme Les fêtes galantes de Verlaine qui les auraient inspirés.
Puis arrive Bertrand Chamayou et sa frêle
silhouette. Jouer le Concerto en sol de Ravel, un des morceaux
« monuments » du XX ème siècle relève du défi. Il a été joué maintes
et maintes fois, on l'a entendu si souvent. Mais Bertrand Chamayou nous
entraîne immédiatement dans son sillage. Il faut un toucher aérien pour
reproduire les envolées arachnéennes du premier mouvement, qui démarre pourtant
sur un coup de fouet, mais aussi un sens acéré du rythme pour faire
« swinguer » les clins d'œil au jazz cher à Ravel. Le pianiste
réussit à faire sonner son piano entre fougue et langueur et le faire briller
avec la prestance imposée par une telle
partition, comme le notait Prokoviev à propos de ce concerto. Dans la cadence
et avec une rare élégance, Bertrand Chamayou ne se prive pas de balayer le
clavier d'amples arpèges ponctués de trilles ; des trilles raffinés, véritables
mélodies croisées par la main gauche avec de petites notes malicieuses et
piquées comme des sauts de moineaux avant que ce premier mouvement noté
Allegremente se termine majestueusement sur une gamme tonitruante. Pour
l'adagio Assai, deuxième mouvement du concerto, le plus connu, le pianiste doit
se glisser dans un habit familier qui sied au public, il exige la perfection.
D'abord, la mélodie s'étire sur de longues et lentes mesures, c'est un pur
hommage à Mozart (à Haydn aussi). De la
main droite, Bertrand Chamayou fait chanter avec délicatesse le thème de cette
fausse valse mélancolique pendant que la main gauche marque le temps sans
fioritures jusqu'à ce qu'un long trille, de ces trilles parfaitement maîtrisés
où le pianiste excelle, introduise l'entrée de l'orchestre qui reprend le thème
pianissimo comme une longue complainte, en même temps que le pianiste
l'illustre avec un subtil équilibre entre orchestre et solo par des montées et
des descentes de triples croches virtuoses..
Lorsqu'on questionnait Ravel sur cette longue
phrase qui coule et semblait avoir été écrite d'un seul jet, le compositeur
s'exclamait : « qui coule, qui coule ! mais ce mouvement
je l'ai écrit deux mesures après deux mesures, j'ai failli en
crever ! » Le dernier mouvement presto porte bien son nom, il se joue comme une
véritable course poursuite entre le piano et l'orchestre. S'y entrelacent des
échos de rag-time, de Gershwin, des bruits mécaniques, des bribes de musique de
corrida où Bertrand Chamayou réussit à dompter les glissandos des cuivres et
parvient, grâce à ses accords puissamment plaqués, ses gammes et ses arpèges
galopants, à magnifier la partie du piano en donnant à ce concerto tout le
brillant et le faste qu'il exige pour être plus qu'une œuvre divertissante.
Ravel avait raison de préciser, par opposition avec le Concerto pour la main
gauche, que le Concerto en sol n'est pas qu'un concerto pour la main
droite. Bertrand Chamayou nous l'a prouvé
Avant le deuxième concerto, petite incursion
orchestrale chez Gabriel Fauré avec Masques et Bergamasques, une musique
de scène sur un livret de René Fauchois. Beaucoup de charme dans la direction
d'orchestre d'Andris Poga de cette polyphonie élégante ; et si Fauré se
défendait d'être du côté des impressionnistes – « je n'aime pas le
flou », disait-il -, l'image est omniprésente dans cette musique puisque
l'œuvre fut inspirée par un décor de Watteau. Ravel reconnaissait avoir subi
fortement l'influence de Saint-Saëns dans l'écriture de ses concertos. Bertrand
Chamayou enchaîne justement Ravel avec le Cinquième Concerto de
Saint-Saëns dit « l'Égyptien », une des dernières œuvres du
compositeur. Le premier mouvement tout en contrastes, passe d'un thème très
calme et chantant à des variations qui vont crescendo. Le pianiste y déploie
progressivement toute son énergie avec une belle économie de gestes et une
aisance naturelle sous laquelle se cache une vraie sensibilité! Si le premier
mouvement n'est pas très égyptien, le second, Saint-Saëns l'aurait écrit à Louxor
en entendant un chanteur nubien sur une felouque, un chant qu'il aurait noté
sur sa manchette ; ce qui donne lieu à quelques mesures orientales et un thème
pentatonique si caractéristique des mélodies du moyen Orient. Encore une fois
après ce thème paisible, l'Orient devient virtuose et très figuratif avec des
larges touches naturalistes, impressionnistes et impressionnantes où se coule
sans effort Bertrand Chamayou avant que les images s'estompent au milieu des
grillons et des grenouilles du Nil qu'évoquera Saint-Saëns. Dans le final
aussi, le compositeur nous assène le bruit des hélices du navire, qui se
traduisent en roulements où les arpèges du
piano se mêlent aux tutti de l'orchestre avant de se convertir en un
second thème qui s'achève sur une belle chevauchée montante du piano où
Bertrand Chamayou se complaît avec délices jusqu'aux deux accords de la fin.
Quel dommage que, presque tout au long de ce concerto, la belle énergie du
piano ait quelque peu été étouffée par la mainmise des quatre cors et des deux
trombones dont les tutti ont couvert trop souvent la virtuosité et les nuances
du piano. Mais quel plaisir d'entendre cette musique, un soir d'été, parmi les
platanes centenaires de la Roque d'Anthéron, loin des bruits de la ville et de
la fureur.
Jean-François Robin.
Les MUSICALES DE NORMANDIE : Un festival pas comme les
autres

Antony
Hermus©Marco Borgreeve
Pour sa onzième édition, Les Musicales de
Normandie affichaient crânement les différences qui en font un festival pas
comme les autres… Une manifestation musicale qui a choisi délibérément
l'excellence artistique, à la fois dans le choix des programmes comme dans
celui des interprètes de renommée internationale, ainsi que la mise en valeur
du patrimoine normand, souvent exceptionnel
comme les abbayes romanes de Jumièges ou Saint Georges de Boscherville,
pour n'en citer quelques unes…..Des spécificités qui en perpétuent tout le
charme et l'intérêt. Pas moins de 25 concerts dans des lieux patrimoniaux les
plus remarquables de Normandie, une programmation extrêmement variée, étalée
sur les mois de juillet et d'août, se développant autour de trois axes, la
musique vocale, le répertoire romantique français et les musiques du monde,
dans un constant souci de s'ouvrir au plus large public, en collaboration cette
année avec les Promenades Musicales en Pays d'Auge, préludant ainsi dans
le domaine musical à la naissance de la grande région Normandie.
Le concert d'ouverture, dans l'église
d'Ourville en Caux datant du XVIe siècle, convoquait Beethoven (Symphonie n° 1 & n° 2) et
Saint-Saëns (Mélodies inédites) dans
une curieuse succession voyant se succéder un mouvement symphonique exécuté par
l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie sous la direction d'Antony Hermus et
une mélodie du compositeur français chantée par le ténor Mathias Vidal… Bien
qu'on sache qu'une telle organisation de concert était fréquente à l'époque
romantique, on ne peut s'empêcher de penser qu'une telle fragmentation nuit à
l'unité des deux œuvres et au ressenti de l'auditeur ! Le témoignage
historique frise ici le non sens musicologique quand on connait l'importance de
la liaison entre les différents mouvements, notamment dans la Deuxième
symphonie. Ces deux symphonies de Beethoven marquent clairement la transition
entre époque classique et époque romantique. Si l'on y ressent de façon patente
l'influence de Haydn et de Mozart, elles portent indiscutablement les prémisses
du souffle beethovénien qui se confirmera dans la Troisième symphonie (Symphonie héroïque). La première symphonie
composée en 1799-1800, à l'âge de trente ans, marque la stabilisation de
l'effectif orchestral (bois et cuivres) et surtout l'apparition du scherzo
remplaçant le menuet mozartien. La Deuxième, composée en 1801-1802, frappe par
sa gaieté, son énergie et son optimisme d'autant plus étonnants que le
compositeur commence à ressentir les premiers signes de sa surdité invalidante.
Au plan de l'interprétation, on notera la direction très engagée et très
dynamique du chef néerlandais parfois au détriment des nuances manquant de
subtilité ; une lecture de la partition assez convaincante toutefois avec un
phrasé très cantabile, voire galant et une belle cohésion de l'orchestre avec
une mention spéciale pour la flûte et le hautbois solo. Les « mélodies
inédites » de Saint-Saëns (Désir
d'amour, Plainte, Papillons, Enlèvement, Rêverie, L'attente) retrouvées
grâce au remarquable travail du Palazzetto Bru Zane appartiennent à un corpus
plus important de 19 mélodies et participent par le biais de l'élégante mélodie
française au combat contre le « vacarme wagnérien », lutte qui
agitera la musique française pendant le XIXe siècle par l'intermédiaire de la
Société nationale de musique dont Saint-Saëns fut le directeur, en compagnie de
Franck, Massenet ou Fauré. Mathias Vidal donna de ces mélodies une
interprétation digne d'éloges par la qualité de sa diction, la clarté de son
timbre et la sincérité de sa narration, remarquablement soutenu par l'Orchestre
de l'Opéra de Rouen ayant à cœur de faire valoir toute la beauté et la richesse
de l'orchestration.

Marie-Josèphe
Jude ©Thierry Cohen
Le deuxième concert, quant à lui, se
déroulait dans la très belle et très intime salle du Baillage à Cany-Barville.
Un programme conçu de façon particulièrement intelligentesoulignant l'étroit
syncrétisme entre musique et littérature au XIXe siècle, toutes deux réunies
dans un même projet esthétique, ainsi que les relations ténues existant entre
musique et mémoire. Quoi de plus pertinent alors, pour illustrer cette
collaboration, que la Sonate de Vinteuil qui parcourt les différents tomes de
la Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il est désormais bien établi que
cette fameuse sonate fictive dont Swann
entend le thème dans le salon des Verdurin est la Sonate pour violon et
piano de César Franck dont Proust s'inspira pour en faire le support
emblématique de la mémoire. Elle représente pour Proust un idéal esthétique qui
libère les différentes formes de la mémoire. Dans le roman elle évoque, pour
Charles Swann, son amour tumultueux pour
Odette de Crécy, elle constitue un lien avec le passé, prise de conscience
d'une réalité oubliée. A l'inverse de sa relation amoureuse et bien après la
rupture, elle exprime la stabilité de la mémoire, elle lui offre un asile et
lui donne l'occasion de revivre le passé
oublié.
Pour Proust, la musique nous ouvre à un
univers éternel, inaccessible à l'intelligence, échappant au temps, qui permet
d'exprimer ce que le langage ne peut
exprimer. Les rapports entre mémoire, amnésie et musique remontent à la
préhistoire de l'homme puisqu'avant d'accéder au langage, puis à l'écriture,
l'homme a commencé par chanter, cette oralité
ne pouvant perdurer que grâce à la mémoire qui en assure la
transmission. L'histoire personnelle, et son écho dans le souvenir, est l'une
des bases de l'image que la psychanalyse freudienne se donne de la psyché. Une
représentation dynamique du temps, distinguant le temps naturel de l'instant,
celui du désir et le temps formel des horloges, celui de la durée, permet de rendre compte d'un grand nombre de
procédés observés dans le domaine de la
mémoire, sans oublier le destin, l'éternité, le temps hors du temps. Le temps
de l'instant nous est aussi nécessaire que le temps formel, le premier est le
temps du désir, à son acmé il est le temps hors du temps, le second est le
temps de la mise en séquence, de la pondération des rapports de durée, du
contrôle et de la critique de l'affect. Ces traces mnésiques, nées de l'affect,
peuvent être réactivées par des expériences ultérieures, souvenirs conscients
ou inconscients, mais également remises en place par le « moi » qui
est une instance liée en grande partie à la conscience et qui vise à maintenir
un état d'équilibre, tant il est vrai que notre passé influence la manière dont
nous vivons notre présent. Cette petite phrase de la sonate de Vinteuil
confirme que l'art est plus puissant que l'amour, fugace et à jamais perdu. Par
la petite phrase de la Sonate de Vinteuil Proust explicite la pensée de
Schopenhauer, exprimé dans Le Monde comme
Volonté et comme Représentation, selon laquelle la musique est un vecteur
préférentiel nous permettant d'accéder au monde des Idées, faisant correspondre
Volonté et Représentation dans une abstraction qui nous fait échapper au temps.
Pour ce concert centré autour de la Sonate de
Vinteuil, Jean Michel Verneiges reprend de façon exhaustive dans les différents
tomes de la Recherche, les autres
sources d'inspiration proustiennes possibles comme la Sonate n° 1 de Saint-Saëns ou encore la Sonate n° 1 de Fauré. C'est à un parcours entre ces différentes
sources, en résonance avec des passages judicieusement choisis de la Recherche que se construit ce concert
magnifiquement interprété par Marie-Josèphe Jude au piano, François-Marie
Drieux au violon et la captivante Karine Texier comme récitante. Une soirée
magnifique dont on se souviendra, c'est le moins qu'on puisse faire !
Un très beau programme. A suivre (musicales.normandie@gmail.com).
Patrice Imbaud.
D'enrichissantes
expériences à CLASSIQUE AU VERT

SR9 Trio / DR
Comme chaque année le Festival Classique au
Vert offre tous les week-ends du mois d'août de belles surprises ! Samedi
13, c'était le Trio SR9, trois jeunes percussionnistes auréolés de prix, -
Alexandre Esperet, Nicolas Cousin, Paul Changarnier - qui ont eu le culot de
monter un trio de marimbas ! Le problème est qu'il n'existe pas de réelles
compositions pour ce genre de formation. Qu'à cela ne tienne, ils ont fait des
transcriptions intelligentes du répertoire classique. Entouré d'une végétation
luxuriante et ensoleillée, on a pu entendre ces timbres si exceptionnels de cet
impressionnant instrument qui se monte et se démonte comme des legos. Face à
leurs trois marimbas, ils ont interprété à leur manière un extrait de la Suite
anglaise BWV 811, la Sonate en trio BWV 525 et l'Ouverture Française BWV 8113a
de JS. Bach, trois Romances sans parole op. 67 de Mendelssohn, et Scherzo,
Tango, Valse des Fleurs, Ragtime de Stravinsky. Le Trio SR9 a fait entendre des
sonorités étonnantes, tantôt suaves, tantôt abruptes, inconnues, des couleurs
inédites et envoûtantes. Dans le parc deVincennes, cette musique, pourtant
européenne, nous transportait ailleurs dans les Amériques du sud, l'Afrique, où
cet instrument est né ! Était-ce du Bach, du Mendelssohn ? La Valse,
le Ragtime, était-ce du Stravinsky ? Ces compositeurs se sont inspirés
d'autres compositeurs, d'autres musiques en leur temps pour créer la leur. Le
Trio SR9 n'a-t-il pas conçu sa propre musique en s'inspirant eux-aussi de ces
compositions ? Le bis d'ailleurs nous a ramené vers le jazz, la musique de
la transposition, de l'improvisation par excellence, comme était celle du
baroque en son temps ! Le trio a interprété à sa manière une musique dont
s'est inspiré Gershwin pour écrire Porgy And Bess. « I Got Plenty
O' Nuttin' ». « Je n'ai plein
de rien » dit cet extrait; Alexandre, Nicolas, Paul, eux, sont pleins de
tout. Ils sont jeunes, courageux, magnifiques, ont du talent à revendre. Vivement
que des compositeurs leur écrivent des œuvres à part entière. Ils ont
enregistré un disque d'après Bach, riche en inventions, chez Naïve. Pour mieux
les connaître : sr9trio.com.
https://www.youtube.com/watch?v=Io2752yA0Ko

DR
Le lendemain, une autre surprise nous
attendait : un orchestre d'amateurs, réunion de plusieurs instrumentistes
d'orchestres amateurs sous la baguette du jeune et talentueux chef d'orchestre
Marc Hajjar. Au programme : La Simple Symphony de Benjamin Britten, la
Première symphonie de Sergei Prokofiev et la Première suite du Tricorne de
Manuel de Falla. La Simple Symphony a été composée à partir de bribes de
thèmes qu'avait écrits Britten ; elle fut jouée la première fois par un orchestre
d'amateurs, belle coïncidence ! De
nombreux extraits de cette symphonie ont été utilisés pour des génériques de
télévision, pour la musique du film « Mauvais Sang » de Léos Carax et
le fameux mouvement pizzicato pour le film « Moonrise
Kingdom » de Wes Anderson.
L'interprétation était de bonne tenue. La Symphonie n°1 de
Prokofiev, osons le dire, est mal foutue, on la nomme classique par sa
structure, on est plus proche de Haydn ou même par moment de Beethoven. On
n'est pas loin d'une pochade mais le second degré est si éloigné qu'on a plutôt
l'impression d'une œuvre ratée! Alors comment interpréter cette
partition ? On sentait l'orchestre pas très à son aise ; quand on ne
part pas sur le bon pied, il est compliqué de se rattraper. Avec Le Tricorne, l'orchestre était plus dans
ses cordes et Marc
Hajjar a su le faire sonner juste. Le public en redemandait ! C'est une belle aventure de
mélanger ainsi, et pour un jour, des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer
ensemble mais qui aiment la musique. C'est bien le sens du mot ''amateur''.
Dommage qu'en Province il n'y ait pratiquement pas de ce genre d'orchestre.
Mais les problèmes de la culture en France et de la musique en particulier, ne
sont plus à l'ordre du jour de nos politiques !
Stéphane Loison.
Une Schubertiade au FESTIVAL DE LA VÉZÈRE

Amaury Viduvier, Denis Pascal & Camille Poul / DR
Un peu avant Brive, vous quittez l'autoroute,
vous traversez Alassac, vous continuez la route sur quelques kilomètres, vous
traversez un joli pont ancien qui enjambe la Vézère et vous arrivez au
Saillant. Là dans les anciens communs de ce charmant château a été aménagée une
salle de concert : c'est l'un des sanctuaires du Festival de la Vézère qui
chaque été, irradie de musique cette Corrèze profonde. La salle est comble de
spectateurs locaux et de vacanciers, venus écouter une Schubertiade en cette fin de mois d'août. Le lieu se prête bien à
ce genre de réunion, telle que les voulait Schubert, on se sent plus entre amis
qu'au spectacle. Et la musique que nous sommes venus entendre, celle de
Schubert évidemment, a le pouvoir étonnant de faire planer sur l'auditoire
comme une espèce de fraternité, un mystère qui ne se résoudra que dans le
plaisir absolu d'avoir écouté quelques œuvres inoubliables.
Si l'Arpeggione, cet instrument entre violoncelle et guitare a disparu, car très difficile à
jouer, la Sonate Arpeggione est
restée un classique de Schubert. Un classique de l'émotion devrait-on ajouter
tellement les attaques, les reprises de thème et les variations sont d'une
pureté et d'une subtilité qui pénètrent le cœur et l'âme. Autant dire que les
interprètes doivent plus vivre cette musique qu'en restituer simplement la
partition. Le duo Denis Pascal – Marie-Paule Milone prend du plaisir à jouer,
l'émotion est immédiate, elle dure jusqu'à la fin et rien ne la gâche, pas même
ce papier de bonbon qu'une spectatrice s'obstine à déplier. Malgré son titre
bucolique, « Le Pâtre sur le rocher » est une pièce de salon qui
trouve parfaitement sa place dans cette Schubertiade.
Lied pour soprano, clarinette et piano, il fut commandé à Schubert par une
amie cantatrice pour exprimer un large éventail de sentiments. Voilà qui
convient exactement à Camille Poul, une jeune soprano qui nous révèle avec
quatre Lieder, une voix splendide et une belle élégance, puissante au timbre
chaleureux et varié qu'on aura certainement l'occasion de réentendre dans des
grandes œuvres et de grands rôles, de Mozart à Poulenc. Avec Le Lied « Le
Pâtre sur le rocher », entre la clarinette et la voix un jeu virtuose s'établit
avec une rare délicatesse et la clarinette double le chant quand elle ne le
précède pas. Les pianissimos et la belle sonorité d'Amaury Viduvier sont à
l'image des petits vertiges de l'escalade du berger dans les rochers, des aigus
parfaits de la voix de Camille Poul aux graves de la clarinette. Beaux sursauts
d'un vrai romantisme.
Dans le Troisième Impromptu, on ne reprochera pas à Denis Pascal cette tendance à
l'épanchement romantique si fréquent dans cette œuvre. Il la joue simplement,
fidèlement et les incursions de ses graves parmi les arpèges sont riches et
font de cette pièce l'invitation à la rêverie telle que la voulait Schubert.
Avec le Notturno pour violon, violoncelle
et piano et le Trio en mi bémol
majeur Schubert atteint les sommets de sa musique de chambre. D'ailleurs
les cinéastes, de Stanley Kubrik à Michael
Haneke ne se sont pas privés de puiser dans ces morceaux pour illustrer
leurs films. Le violon d'Alexandre Pascal vient planer sur le trio, l'ensemble
est homogène, l'alternance entre le mineur sombre, le majeur rayonnant et
l'éternelle relance entre les instruments fait chanter la poésie avant de
mourir dans un souffle proche de la détresse. Il s'agit des dernières œuvres de
Schubert déjà très malade. A propos de cette soirée, parlons de convivialité :
le lieu est beau, il fait parfaitement sonner la musique. Il faut espérer qu'un
festival comme celui-ci, au programme mêlant concerts et opéras, ait les moyens
de perdurer longtemps encore. La musique a besoin de s'ancrer partout dans la terre de France.
Jean-François Robin.
***
LE FESTIVAL DE VERBIER : EXCELLENCE ET PEDAGOGIE AU SOMMET

DR
Dans les montagnes valaisannes, à quelques
1500 mètres, se niche un festival qui cultive décidément sa différence : le
Verbier Festival se permet d'afficher les plus grands noms de la galaxie
classique - de Yuja Wang à Gregory Sokolov, de
Leonidas Kavakos à Gautier Capuçon,
des Ebène à Michael Tilson Thomas, de Bryn Terfel à Nina Stemme, ...- et de réunir trois orchestres de jeunes. Pour
conjuguer d'une part, l'excellence, et d'autre part, une expérience pédagogique
unique. A moins que celle-ci ne conduise naturellement à celle-là. Il règne
dans la station une atmosphère de travail, non pas fébrile, mais décontractée :
la petite station au pied de sommets impressionnants et encore enneigés bruisse
telle une ruche. Verbier, c'est d'abord une Academy.
Dès le début, il y a 23 ans, l'idée a été de faire du festival un lieu
d'échange entre grands maîtres et jeunes talents. D'où la création d'une
académie pour violonistes, altistes, cellistes, pianistes mais aussi
chambristes et chanteurs d'opéra, formés par leur ainés, solistes de renom. La
'' génération Verbier '' était née et des personnalités telles Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou, Yuja Wang ou le Quatuor Ebène en sont quelques fleurons.
Les professeurs ont pour nom cette année, entre autres, Tabea
Zimmermann, Pamela Frank ou András Schiff. Le dialogue des générations est au cœur de la
démarche en vue de partager une passion commune. Verbier c'est aussi, et
naturellement dans le droit fil de cette démarche pédagogique, trois orchestres
de jeunes qui en quelque sorte procèdent les uns des autres : le Junior
Orchestra, Le Verbier Festival Orchestra et le Verbier Festival Chamber Orchestra. Au centre de la constellation, le
Verbier Festival Orchestra (une centaine d'instrumentistes âgés de 18 à 29 ans,
issus des meilleurs conservatoires, formés par leurs ainés, notamment des
musiciens du MET Opéra de New York) et qui a pour directeur musical Charles Dutoit ; lequel secrète le Chamber
Orchestra, formation marquant une sorte d'aboutissement du processus. En amont,
le Junior Festival Orchestra, sous la houlette de Daniel Harding, recrute des
musiciens entre 15 et 18 ans. Ces jeunes pousses (57 cette année de 18
nationalités dont 2 Français) reçoivent une formation professionnelle leur
permettant d'aborder un répertoire exigeant, souvent pour la première fois. La
recherche d'un modèle d'excellence dans le domaine de l'éducation musicale,
voilà la spécificité le Verbier ! Un creuset où l'on cherche même à dépasser la
seule qualité musicale pour préparer à la carrière : repérer, former et lancer
les professionnels de demain, la boucle est bouclée!

Masterclasse de violoncelle par
Gautier Capuçon ©Nicolas Brodard
Côté spectateur, c'est chaque jour toute une journée
en musique qui lui est offerte, de 9H à 23H, rythmée au son des concerts bien
sûr, à 11H et à 14 H à l'Église, puis à 19H et 20H, respectivement à la grande
salle des Combins et à l'Église ; mais aussi des masterclasses publiques, des rencontres avec des artistes,
des répétitions publiques et des conférences introductives. Une petite brochure
quotidienne en énumère les diverses étapes ainsi qu'un journal hebdomadaire les
évènements saillants. Car on sait, à Verbier, assurer une bonne et efficace communication.
Musique de chambre sur les cimes

Daniel Hope et Torleif Thedéen ©Nicolas Brodard
L'intimisme du concert chambriste est à
Verbier plus qu'une évidence. Dans le cadre feutré de l'église, moderne, qu'on
atteint après une petite marche, car elle est située tout en haut de la
station. Chaque matin, grâce à la formule dite à géométrie variable, l'émotion
artistique est au rendez vous. Ainsi du concert
« Rencontres inédites II » réunissant Daniel Hope, Torleif Thedéen, Marc-André
Hamelin et le Quatuor Ebène. Pour jouer Mendelssohn et Chausson. Le Trio
pour piano et cordes N°1 op. 49 date de 1839 et offre une partie de piano
très élaborée, surtout dans sa seconde rédaction, suggérée par le compositeur
Ferdinand Hiller. C'est assurément un des joyaux de cette littérature qui
faisait flores à l'époque avec les trios de Beethoven, Schubert, Hummel ou
Moscheles, sans parler de ceux de Chopin, d'Alkan, de
Clara et de Robert Schumann. Il s'ouvre par un molto allegro agitato que les
présents interprètes prennent à bras le corps, le pianiste Hamelin en
particulier dont la vision est d'une fièvre emportée après l'introduction
cantabile du cello. C'est celui-ci qui initie le
second thème. La belle mélodie de l'andante « con moto tranquillo »
contraste, chantée comme un Lied, d'abord au piano, reprise par les cordes en
de savantes arabesques. Au scherzo, marqué « leggiero
vivace », s'exprime la féérie si typique de Mendelssohn, les cordes
prenant le dessus alors que l'un des thèmes n'est pas sans évoquer la fameuse
pièce de piano titrée « La fileuse ». C'est légèrement fantasque et
bien sûr nocturne. Le piano reprend ses droits au finale
« allegro assai appassionnato » qui mêlera
trois thèmes. Hamelin dont la main n'est pas toujours des plus légères, en dessine
les contours brillants, les cordes assumant un fin cantabile,
jusqu'à la coda brillantissmime. Une version engagée
et d'un enthousiasme communicatif.

©Nicolas Brodard
Celui-ci sera encore plus porté à blanc par
l'interprétation du Concert pour piano, violon, et quatuor à cordes en
Ré majeur op. 21 d'Ernest Chausson. On sait que le musicien a peu composé,
fauché dans sa 44 ème année par un accident de
bicyclette. De ses 34 numéros, une seule symphonie, un seul opéra (Arthus),
et des pièces hors normes comme le Poème pour violon et orchestre, ou le
Poème de l'amour et de la mer, et surtout ce Concert op. 21.
Écrit entre 1889 et 1891, dédié à Eugène Ysaÿe, qui le créera en 1892 à
Bruxelles, fleurant bon le mélodisme de la musique
française, même si quelques relents wagnériens s'y font jour çà et là. Ce que
tempère Pierre Colombet, le 1er violon du Quatuor
Ebène, qui ne manque pas de rappeler le mot de Chausson « Il faut se déwagnériser ». Six instruments pour ce
« Concert », ce qui le distingue aussi bien du sextuor, car ceux-ci
ne sont pas placés sur un pied d'égalité, que du concerto, même si le violon
occupe une place de choix, de leader à certains endroits. Comme le souligne
Jean Gallois dans sa monographie sur le compositeur (Fayard), il faut rattacher
l'ouvrage « à la tradition de la ''conversation en musique'', du
''concert'' tel que pratiqué au XVIII ème
siècle ». Voilà une œuvre à la fois généreuse et ascétique : généreuse par
le flot mélodique continu qui submerge l'auditeur au fil des quatre mouvements,
ascétique par la science du dessin raffiné qui ne laisse place à aucune redite.
La grande liberté du propos laisse une impression de bonheur. L'interprétation
le démontre à l'envi : dès l'attaca du piano du
premier volet « Décidé », repris par les deux cordes graves, on
perçoit le sens de l'évènement qui sera tour à tour passionné et détendu. Le
violon de Hope dessine le thème qui reviendra en boucle au fur et à mesure des
trois autres mouvements. La « Sicilienne » apporte charme, fraicheur
et transparence après ces pages lourdes de sens, balancement exquis, d'une
courbe élégante. Le « Grave », centre névralgique du morceau, débuté
par un duo violon-piano extrêmement expressif, relayé par le quatuor à cordes,
déploie le tragique d'une plainte d'une rare sombritude,
que traversent des pages plus élégiaques. Colombet
soulignera combien leur interprétation veut donner au quatuor à cordes sa place
réelle, au-delà d'un pur accompagnement des deux parties plus solistes, de
violon et de piano. A juste raison. Et cela se perçoit dans l'interaction entre
les diverses composantes, dans le retenu des pages lyriques ou à travers les
vagues irrésistibles dont Chausson habite sa composition. Vision intense, où la
complicité entre les participants est palpable : le plaisir de faire de la
musique entre amis est on ne peut plus tangible, d'une belle éloquence, d'une
luminosité toute gallique, due sans doute à la patte de nos quatre jeunes
français communiquant à leurs deux collègues un élan et une limpidité essentielles
ici. Une version de référence assurément, qui leur vaudra une ovation sans fin
et leur fera bisser la Sicilienne.

Gautier Capuçon & Daniil Trifonov ©Nicoals Brodard
Le lendemain, l'Église remplie à ras bord,
accueillait une trilogie improbable puisque réunissant Leonidas Kavakos, Gautier Capuçon et Daniil Trifonov. Combien de
scènes peuvent-elles s'offrir un tel luxe de stars ! Et pourtant, le mot paraît
presque déplacé devant la simplicité dont font preuve nos trois artistes.
Encore un concert maniant le principe de géométrie variable, si délicat à
assurer en d'autres circonstances. Il débutait par les Fantasiestücke
op. 73 de Schumann, dans la version pour violoncelle et piano. Car l'œuvre,
écrite en 1849, était originellement conçue pour clarinette et piano. Ces
« morceaux de fantaisie », un terme utilisé à plusieurs reprises par
Schumann, même dans sa production pianistique, prennent ici un tour particulier
: ces trois courtes pièces, apparemment distinctes, forment un tout et offrent
un caractère d'improvisation de par leurs constants changements d'humeur. La
première « Zart und
mit Ausdruck » (tendre et avec expression) se
coule telle une rêverie, avec mélancolie ; la deuxième, « Lebhaft, leicht » (vif et léger ) se vit comme un intermezzo, petit scherzo plein
d'énergie, presque ludique ; enfin la dernière « Rasch
und mit Feuer »
(rapide et avec feu), pousse à la frénésie jusqu'à la fin marquée ''de plus en
plus vite'', conduisant les deux interprètes à se dépasser. Ce que Trifonov et Capuçon mènent haut
la main, dans un engagement certain : le premier magistral au clavier, le
second de sa chaude sonorité. Suivait la Sonate pour violoncelle et piano op.
19 de Serge
Rachmaninov. Composée en 1901, juste après le Deuxième Concerto
pour piano, et donc au sortir de la longue période dépressive qui suivit
l'échec de la Première Symphonie, l'œuvre appartient au corpus étroit de
musique de chambre de son auteur, hélas peu joué aujourd'hui. Elle est pourtant
profondément originale, magistralement écrite pour les deux partenaires, même
si le piano se voit souvent réserver la part du lion : Rachmaninov était en
effet un fameux pianiste. Mais au fil de ses quatre mouvements, c'est tout
l'univers émotionnel du musicien qui est révélé avec ses contradictions et ses
luttes. Ainsi du premier qui débuté lento, construit un allegro moderato en
arche ; un parcours somptueux qui révèle un violoncelle tendu et un piano
tourmenté mais aussi des pages plus calmes, comme des éclaircies obtenues au
prix d'un dialogue serré entre les deux voix. Capuçon
et Trifonov rivalisent de virtuosité transcendée d'un
chant profond. L'allegro scherzando est un scherzo agité, lutte acharnée entre
tragique et lyrique, d'une force de vie inouïe sous les doigts de deux
interprètes qui réservent au trio médian des traits fantasques à couper le
souffle. Ils vont nous faire atteindre le Nirvana dans le long andante :
rarement a-t-on rencontré une telle douceur dans l'expression chez le
compositeur, une telle tristesse sublimée par le chant du cello
et la partie pianistique qui se fait non pas discrète mais complémentaire. Le finale sera on ne peut plus énergique, voire trépidant,
mais la lutte entre les deux protagonistes laisse au cello
le dernier mot dans une douce péroraison élégiaque ; avant que les deux voix ne
concluent avec brio. Du vrai bonheur.

Leonidas Kavakos, Daniil Trifonov, Gautier Capuçon ©Nicolas
Brodard
Le concert se terminait par le Trio pour
piano et cordes op.15 de Bedřich Smetana. Là
encore une pièce rare (1855), que Kavakos, Capuçon et Trifonov vont porter à
l'incandescence. Relatant un épisode autobiographique tragique - la disparition
de sa fille aînée Bedriska – la pièce est sombre
quoique traversée d'une opposition obscurité-lumière intéressante. Le moderato
assai initial est intense, d'une tension presque insoutenable, miroir de
désespoir, telle la phrase du cello qui l'ouvre. On
note d'étonnants solos de piano puis de violon, un développement serré et une
coda tragique. L'interprétation des trois mousquetaires vise plus un
classicisme intemporel qu'une slavité marquée.
L'allegro ''ma non agitato'' trace un scherzo déclamatoire presque schumannien
par endroits, entrecoupé de deux trios, l'un sombre, l'autre lumineux. Quant au finale presto, il sera bouillonnant d'énergie, sorte de
danse effrénée, tel un furiant, cette fois
bien slave. Gautier Capuçon nimbe la grande montée
lyrique de sa sonorité royale. La rythmique se fera implacable. Mais on perçoit
combien Smetana s'est souvenu du Lied Erlkönig
(Le roi de aulnes) de Schubert et de ses terribles paroles du père envers
son enfant. De la belle ouvrage, saluée par une standing ovation.

Daniel Lozakovich ©Nicolas Brodard
Autre matinée, celle donnée par le jeune
prodige Daniel Lozakovich. Ce violoniste de 15 ans
tout juste, qui fut présenté à Paris lors de la conférence de presse de
lancement du Verbier Festival 2016 à l'Ambassade de Suisse, en juin dernier
(cf. NL de 6/2016), est assurément un cas. Natif de Stockholm, il est lauréat à
11 ans de plusieurs concours, dont le Solna de Stockholm, et reçoit les trois
prix « Classiques Viennois » en 2014. Il s'était produit à l'âge de 9
ans avec les Virtuoses de Moscou sous la direction de Vladimir Spivakov et a déjà à son actif des prestations concertantes
avec les orchestres de La Scala, de Lyon ou de la Suisse Romande. Après être
passé comme beaucoup de ses confrères par L'Academy,
les deux années précédentes, il donnait son premier récital solo et avec piano.
Pour ouvrir le bal, la Partita pour violon seul N° 2 en ré mineur BWV
1004 de JS. Bach ; autrement dit un chalenge. Au fil des quatre premières
danses, le garçon fait montre d'une autorité étonnante quant au dosage de la
sonorité, au phrasé et à la tenue de la ligne mélodique. L'Allemande et la
Sarabande montrent une profondeur remarquable, tandis que la Courante et la
Gigue, loin d'être mécaniques, déploient une réelle fluidité. Partout le clarté du trait est mise en valeur par une approche sans
fard, naturelle et hautement pensée. Quant à la Chaconne elle sera tout aussi
magistrale, livrant dans son ampleur une maturité incroyable chez un si jeune
interprète. Avec le pianiste Franck Dupree (*1991),
également boursier de la Verbier Academy, il jouera
la Sonate K. 301 de Mozart puis la troisième sonate de Brahms. La sonate
K. 301 en sol majeur, de 1778, que comme ses trois œuvres sœurs, les sonates K.
302, 303 et 305, Mozart appelle « duetto pour piano et violon », est
en deux mouvements. On admire chez Lozakovich et Dupree le beau classicisme du dessin associant à l'allegro
con spirito la mélodie du violon et la rythmique du
piano, légers comme l'air, et à l'allegro qui suit, un rondeau dansant et
joyeux, le jeu racé dont émerge au violon une sicilienne. La Sonate N° 3
pour violon et piano op. 108 de Brahms (1888) les trouve tout autant
magistraux. L'inspiration mélodique de cette ultime sonate pour la formation, Lozakovich la fait sienne avec une autorité qui défie là
encore les préjugés. Qui s'empare de la liberté de propos brahmsien avec aplomb
: un allegro breve expressif mené dans ses divers
sujets avec une rare maestria ; un adagio rendant compte de la généreuse
inspiration du vieux musicien, au violon en particulier si chantant ; un
scherzo « un poco presto e con sentimento »,
capricieux et fantasque ; un finale « presto agitato » passionné à
partir du premier thème exposé par le violon. La musicalité et le souffle du
jeune violoniste font merveille, magistralement soutenus par le pianiste. En
bis, ils donneront deux pièces d'Edward Elgar, tour à tour lyrique et virtuose.
Un nom à retenir. Qui vient au demeurant de rejoindre l'écurie Deutsche Grammophon, en faisant la plus jeune signature de la firme
(Anne Sophie Mutter avait déjà seize ans lors de son
premier contrat!).
L'expérience fascinante d'un récital de Grigory
Sokolov

Grigory Sokolov ©Nicolas Brodard
« Verbier n'agirait-il pas
comme un irrésistible aimant auprès des plus grands musiciens
internationaux » s'interroge le chroniqueur du journal ''Le Festival au
quotidien'' ? De fait - et le carnet d'adresse de son directeur général Martin T:son Engstroem n'y est pas pour
rien – on peut s'enorgueillir ici de faire venir les big
stars. Grigory Sokolov, une icône du piano
aujourd'hui, est de cette eau-là. Alors que se produisant dans les plus vastes
auditorium, dont on s'arrache les places en un tournemain, il joue à Verbier
dans la modeste Église, devant quelques 600 auditeurs dont plusieurs collègues. Avantage en termes
de proximité, d'intimisme, léger inconvénient côté acoustique car la vaste
palette - pour dire le moins – du russe se trouve parfois à l'étroit dans
pareil vaisseau. Schumann et Chopin se partageaient le récital. De Schumman, l'Ararbesque
op.18 et la Phantasie op.17, donnés sans
interruption. L'Arabesque en do majeur (1838) est un rondo en deux parties ouvert par un
refrain, l'une légère et tendre, l'autre plus calme dans un rythme de marche,
qui se conclut dans une péroraison d'une belle poétique. Sokolov en restitue le
fantasque. Autrement plus spectaculaire, la Fantaisie sonate op. 17, qui
d'abord conçue en un seul mouvement - l'actuel premier volet - en 1836, se voit
adjoindre deux autres (1838) pour connaître la forme définitive que nous lui
connaissons. Œuvre titanesque, dédiée à Liszt qui impressionné, répondra plus
tard par sa propre Sonate en si mineur, conçue pour Clara Wieck, la bien-aimée, et imaginée comme un tribut pour
l'érection à Bonn du futur monument à Beethoven. Pareilles intentions ne
pouvaient conduire qu'à un travail hors norme. Dont toute exécution doit se
ressentir. Il y a quelque chose de prométhéen dans l'interprétation de Grigory Sokolov qui selon son habitude scrute le tréfonds,
décortique chaque phrase, interroge chaque intention, voire met à plat la
pensée du maitre pour en représenter une vison renouvelée.
La manière transcende toute virtuosité pour atteindre quelque stade supérieur
de l'idée : des contrastes dynamiques extrêmes, allant de forte
assourdissants, mais jamais bruyants, révélant toute la résonance harmonique de
l'instrument dans le grave comme dans l'aigu percussif, aux pianissimos non
pas évanescents, mais translucides. Ainsi du premier mouvement « Durchhaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen » (A jouer d'un bout à l'autre d'une
manière fantastique et passionnée) : Sokolov l'attaque par un vibrionnant
accord. Les tourbillons de la main gauche vous empoignent et une extrême
tension s'installe, les phrases sonnant comme des cris de passion. L'entrelacs
des thèmes principaux et secondaires, si décalés par Schumann, hors des canons
classiques, comme les transitions si éphémères sont analysées pas à pas. La
remarque de Brigitte François-Sappey
(« Schumann », Fayard) parlant de « déconstruction d'allegro de
sonate et de reconstruction de fantaisie » prend ici tout son sens.
Et puis, éclair de bonheur dans un océan de véhémence, survient le passage
médian « Im Legendenton » (Dans le ton
d'une légende) apportant un bienfaisant répit, d'une musique sans âge, grâce à
des traits d'une infinie douceur et un toucher qui effleure, caresse le clavier. Le volet suivant « Mässig, durchhaus energisch » (Modéré, avec une constante énergie),
prolonge guère ce répit. Car ce qui s'apparente à un intermezzo, sonne de
nouveau quasi orchestral dans son rythme de marche où l'on perçoit une allusion
au Fidelio de Beethoven, traversé d'un trio plus élégiaque aux allures
fantastiques, et terminé par une triomphale coda d'une virtuosité proprement
inouïe. Le dernier mouvement « Langsam getragen, durchweg leise zu halten »
(Lent et soutenu, dans une sonorité constamment douce) apporte ce bonheur si
longtemps entrevu : musique nocturne d'une fluidité digne de Schubert
s'épanchant tel un Lied que le toucher ineffable de Sokolov ennoblit. On reste
subjugué devant pareil pianisme, alliant
dépouillement et total investissement de l'instrument.

DR
Chopin, en seconde partie,
réserve d'autres félicités. Là encore deux courtes pièces, les Nocturnes op.
32, préludent sans interruption la Sonate N° 2. Les Deux
Nocturnes op. 32, qui ne passent pas pour les plus adulés de la série,
réservent pourtant un intéressant binôme : calme romance pour le premier, mode
plus dramatique dans le second. Sokolov leur accorde justement leur caractère
d'improvisation et de suggestion du chant. L'ondulation de la basse laisse à la
mélodie sa vertu introspective. Avec la Sonate N°2 en si bémol mineur
op.35 (Nohant, 1839), changement de braquet : Sokolov en empoigne à bras le
corps la trame dramatique et va scruter, disséquer, construire un cheminement
très personnel de ce que Schumann se refusait à considérer comme un tout ;
pourtant un récit émotionnel cohérent en trois volets suivi d'un bref épilogue.
Le premier mouvement, passé sa séquence initiale « Grave », s'avance
fiévreux, lutte tragique, vraiment « agitato », tel un halètement
sonore dont l'interprète souligne tel accord ou détache tel trait de
contrepoint. La virtuosité du scherzo est là aussi transcendée en une vision
d'une puissante vitalité, mais le trio se défend de toute affectation, de
volonté de ''phraser'', pour au contraire faire sourdre une clarté nocturne par
un jeu presque secret que n'empêchent pas certaines stridences d'accords. La
« Marche funèbre » est prise très lentement, lamento endeuillé, glas
irrémédiable, auquel fait suite un passage médian consolateur. La force de cet
épisode est prodigieuse. Quant au finale presto,
incroyable unisson des deux mains, Sokolov en déroule le ruban apparemment
imperturbable frôlant l'atonalisme, halluciné, à une folle allure
formidablement maitrisée jusqu'à l'accord final asséné comme un coup de poing.
On ne sort pas indemne d'une telle interprétation, là encore si hautement
pensée, parfois inconfortable, où l'on se prend à découvrir des traits
insoupçonnés. Suit un cortège de bis comme aime à en distiller le maitre russe
: cinq des six Moments musicaux D 780 de Schubert, alliant poésie
diaphane et beauté sonore à couper le souffle, et une Mazurka de Chopin
d'une délicate mélancolie. Du très grand piano ! Assurément la patte d'un génie
de l'instrument !
Yuja Wang,
hyper virtuose

Yuja Wang ©Nicolas Brodard
Autre pianiste très en vue, autre
manière : le récital de Yuja Wang, cette fois à la
salle des Combins, avait attiré une foule nombreuse.
Son programme reprenait quasi à l'identique celui donné à la Philharmonie de
Paris en juin dernier, Schumann et Beethoven ; un morceau de Ravel substituant
les Ballades de Brahms. Si le concert parisien avait convaincu,
l'impression est différente ici. Bien sûr, la virtuosité époustouflante est là,
la formidable maitrise digitale, le toucher de force comme de douceur. Mais le
cœur pour autant ? Problème de concentration ou plus prosaïquement d'acoustique
d'un auditorium très vaste dont la disposition fait que les spectateurs sont
éloignés du podium, ce qui ne favorise pas l'intimité propice au partage, la
complicité indispensable à une exécution soliste, si exigeante en termes de
communion entre celui-ci et le public. On avait le sentiment que le son se
perdait quelque peu et surtout que le déclic de l'échange ne se produisait pas
toujours. La réaction publique peu enthousiaste à l'issue de la première œuvre
le montrait. C'étaient donc les Kreisleriana op.
16 de Schumann, autre grande fantaisie conçue en 1838 par le jeune maitre ; une
série de huit pièces que caractérise une alternance vif-lent, sauf les deux
dernières, sur le mode rapide. Cet emboitement, Yuja
Wang le maitrise bien sûr de sa technique rutilante que porte un ambitus
extrêmement large - quoique bien différent de celui d'un Sokolov la veille. Les
sections vives nous immergent dans un univers effrayant, les passages lents
dans un fantastique pareillement étonnant. Reste qu'à certains moments,
l'impact se fait mesuré en termes de choc émotionnel. Ainsi le « Sehr innig und
nicht zu rasch » (n°2 : Très intime et pas trop vite) est-il
presque désincarné, et le quatrième morceau, « Sehr
langsam » (très lent) plutôt distancié. Froideur
soudaine de l'émotion artistique - ce qui parait peu vraisemblable chez une
artiste engagée, qui au surplus n'en est pas à sa première apparition à Verbier
- ou, encore une fois, difficile appréhension des caractéristiques de la salle
de concert ? Il n'en demeure pas moins que la manière souveraine force
l'admiration, l'art de creuser le fossé dynamique, de bâtir des crescendos
d'une force incoercible, de créer et maintenir la pression. Elle donne ensuite,
après une courte pause, « Scarbo »,
troisième volet de Gaspard de la nuit, une pièce hantée de fantastique.
Car Ravel s'inscrit ici dans l'univers démoniaque des poèmes d'Aloysius Bertrand, pas si éloigné finalement de celui des
poèmes de ETA. Hoffmann, à l'origine de l'œuvre précédente de Schumann - les
« Fantaisies dans la manière de Callot », dont se sont inspirés les
deux écrivains. Le choix est fort judicieux. Là encore, on est séduit pas la
virtuosité de la pianiste chinoise qui entraine l'auditeur dans une frénésie
rythmique qui aurait ravi l'auteur.

DR
La Sonate op. 106 « Hammerklavier » de Beethoven apporte pareille
sensation d'impérieux dynamisme. Une sonate qui en fait éclater les cadres, les
dépassent, nantie d'une « abondance symphonique », dira Romain
Rolland. Là encore un challenge, qu'on dit réservé aux interprètes chevronnés.
Mais ''la valeur n'attend pas …'', semble répondre Yuja
Wang qui s'empare de cette composition avec une vigueur peu ordinaire,
contrastant avec sa frêle apparence. L'allegro initial est phénoménal par
l'explosion fortissimo qui l'ouvre et l'élan qu'imprime l'interprète au sein de
son morcellement thématique dans le colossal développement. Sans parler du
travail sur l'harmonie. Le scherzo impose une nervosité rythmique se déjouant
de l'instabilité de l'écriture, qui sait aussi se métamorphoser en atmosphère
spectrale. Le trio sera étrange, fantomatique, et la coda libèrera un presto
plus déterminé encore, tel un cauchemar. Vient alors l'adagio sostenuto,
« puissante méditation passionnée » (ibid.) que Wang distille
entièrement mezza voce, mains collées au clavier ; ce qui peut, là encore dans
pareil environnement, révéler moins de poids que dans l'exécution parisienne, d'une
plus grande gravité habitée. Du finale, la pianiste maitrise les climats
antagoniques successifs : une section largo mystérieuse jouée comme improvisée
; un allegro risoluto hallucinant dans son labyrinthe
rythmique débouchant sur une fugue proprement irrésistible dans ses forte
impérieux. Là où Beethoven conduit l'auditeur à la limite du dissonant. Deux
bis, en complète rupture stylistique, concluent le récital : la paraphrase de
la Marche turque de Mozart, truffée d'insertions jazzy, et celle de Carmen
dans l'arrangement de Vladimir Horowitz, majoritairement inspirée des thèmes du
début du 2 ème acte, d'une ébouriffante digitalité, qui ne fait pas démentir le surnom de « Flying fingers » (Les doigts
volants) que donnent à Yuja Wang la presse et le public
anglo saxon. Mais le temps semble pressé car un autre
événement doit s'enchainer : l'anniversaire des 10 ans de la plateforme de
streaming Medici.tv. Dommage car on eût aimé savourer, comme à Paris, d'autres
propositions de la pianiste.
On la retrouvera, entre autres
invités surprise du concert anniversaire, un peu plus tard, jouant, aux côtés
de Gautier Capuçon, la courte Sonate pour cello et piano, de son collègue Evgueni Kissin, compositeur à ses heures. Passés des discours de
remerciements obligés, mais un peu empruntés, ledit concert pot
pourri permettait d'entendre divers morceaux intéressants : une
improvisation sur une musique Klezmer par le
clarinettiste suédois Martin Fröst et des membres du
VFCO, le finale endiablé du Trio de Smetana par
Kavakos, Trifonov et Capuçon, deux airs gallois par Bryn
Terfel, accompagnés à la harpe, et enfin deux libres
adaptations de leur cru par les Ebène de musique sud
américaine et d'un air des Beatles...
Le Falstaff hors norme de Bryn Terfel
Giuseppe VERDI : Falstaff.
Comédie lyrique en trois actes. Livret : Arrigo Boito d'après The merry Wives of Windsor et Henri
IV de William Shakespeare. Bryn Terfel, Lucas Salsi, Erika
Grimaldi, Yvonne Naef, Roxana
Constantinescu, Ying Fang, Atalia
Ayan, David Shipley, Carlo Bosi, Luca Casalin. Oberwalliser Vokalensemble. Verbier Festival Orchestra, dir. Jesús López
Cobos. Mise en espace:
Claudio Desderi. Salle des Combins.

Bryn Terfel
©Nicolas Brodard
Chaque saison, un ou deux opéras sont donnés
en version de concert à Verbier. Cette année, après Carmen, voici donc Falstaff,
l'ultime chef d'œuvre de Verdi. Une œuvre pas facile à monter, surtout lors que privée de représentation scénique. Les grincheux
s'en satisferont peut-être, pour n'avoir pas à en supporter une vision
énervante ou décalée. En tout cas la mise en espace imaginée par Claudio Desderi, un fameux Falstaff naguère, apportait une touche
de vie indispensable : une direction d'acteurs minimaliste, sur le versant
conventionnel, certes, mais bien vue, assurant à l'exécution musicale un
agréable complément visuel. Au centre de l'affaire, Bryn
Terfel, un Falstaff d'envergure. Le gallois mène une
carrière sagement maitrisée, même si confrontée à des rôles exigeants (Sir
John, chez Verdi, Le Hollandais, Hans Sachs ou Wotan dans Wagner, sans omettre Scarpia de Puccini, voir Méphisto de Berlioz ; mais plus
guère de Strauss qui vit pourtant ses premiers succès, comme Jochanaan de Salomé en 1992 à Salzbourg). C'est que
le chanteur aime aussi le crossover et ses chères mélodies
du Pays de Galles dont il cultive le secret. Le personnage de Falstaff, il le
connait bien, depuis sa prise de rôle en 1999 et ses interprétations à la scène
et au disque (DG) avec Claudio Abbado, deux ans plus tard. Il lui insuffle une
verve intarissable mais aussi une fine refléxion. Car
le bonhomme bourru et fat est loin d'être d'un seul tenant : moins bouffon
qu'il en a l'air, moins dupe qu'il n'y paraît. Sa capacité à rebondir fait de
lui, chez Verdi et Boito, sans doute la figure la plus intéressante d'une
comédie lyrique finalement douce-amère. Il est le héros de la farce, dans un
premier degré de lecture, mais aussi et peut-être surtout celui qui la dénoue
habilement : « Ma subtilité crée la subtilité des autres », car « c'est moi qui vous rends rusés »,
proclame-t-il. Et la morale « Tout dans le monde est farce », il la
porte haut. Berné, il est vrai, par la manigance des femmes, elles qui
maitrisent si bien l'illusion que les hommes vivent naïvement, mais habile,
lui, à flouer ces hommes si bêtas dans leur réaction d'honneur virile froissé.
Ford au premier chef. Cette exécution le fait ressentir, bâtie autour d'une
star de l'opéra qui pourtant ne cherche pas à tirer la couverture à lui. Le
personnage sera grandiose, même physiquement, et la truculence certaine mais
pas appuyée, transcendé plutôt par une fine compréhension des tenants et
aboutissements, et surtout animé du vrai plaisir de jouer, de camper cette
figure que leurs auteurs, après Shakespeare, ont élevé au rang d'archétype de
comédie. La stamina du gallois est un régal, sa
diction un plaisir gourmand, au fil de trois monologues dont celui tragi comique du dernier acte « Mondo
ladro, mondo rubaldo, reo mondo
» (monde ladre, monde scélérat, méchant monde), lors que rescapé des eaux froides
de la Tamise. Aucune affectation ni sollicitation, excepté quelques œillades
affriolantes. Du grand art !

Atalla Ayan (Fenton) &
Ying Fang (Nannetta ) ©Nicolas Brodard
Si le gentilhomme séducteur est
le phare de l'intrigue, aucun des neuf autres personnages n'est un faire valoir. La distribution réunie, de belle facture, le
démontre. Qui révèle de belles individualités. Au premier rang desquelles la Nannetta de Ying Fang : joli minois et chant extatique
culminant dans l'air de la reine des fées, « Erriam
sotto la luna » (nous
errons sous la lune), un des rares morceaux répondant au schéma classique, que
Verdi détourne vite de son cheminement habituel. Les autres commères sont bien
achalandées, Erika Grimaldi, en Alice, Roxana Constantinescu, Meg, et la parodique et avantageuse Mrs Quickly d'Yvonne Naef. Côté
masculin, on remarque le cantabile généreux de Atalla
Ayan, Fenton, et le vindicatif Ford de Luca Salsi, un
peu monochrome cependant. Tous favorisent un chant fort coulant, presque proche
du parlé. C'est que Jesús López Cobos veille au grain d'une
exécution idiomatique rendant justice au raffinement de l'orchestration et à la
formidable concision du dernier Verdi. L'opéra, il le connait comme sa poche.
C'est peu dire que ses nombreux musiciens sont galvanisés. Leur sonorité est
d'une réelle italianitá. Pour avoir assisté à une
répétition de travail, on mesure la minutie avec laquelle le maestro demande à
ses jeunes pousses tel détail, telle intonation particulière qui soit en accord
avec la ligne de chant. Et les ensembles si complexes sont sûrement
ménagés.
András Schiff et le Verbier Festival Chamber
Orchestra : le miracle !

András Schiff, chef... ©Nicolas
Brodard
On ne mesure pas assez en France
combien András Schiff est
une personnalité au-dessus du lot, une sorte de sage de la musique. Sa venue à
Verbier est donc dans l'ordre des choses. Il donnait cette année, entre autres,
un concert d'orchestre à la tête du Verbier Festival Chamber
Orchestra, se produisant en tant que pianiste et chef, comme il le fait
souvent, à la Mozarwoche de Salzburg par exemple.
Trois compositeurs de la première école de Vienne au programme : Bach, Haydn et
Beethoven. Le Concerto pour clavier et orchestre en ré mineur BWV 1052
de JS. Bach, premier d'une série de six, est un arrangement par Bach lui-même
d'un concerto de violon semble-t-il perdu. La forme concertante occupe chez
Bach une place prépondérante. Tout comme Bach est pour Schiff
la boussole : une musique qui « tombe naturellement sous les
doigts », souligne-t-il, « une musique très spirituelle ». Cela
transparait dans son interprétation, à la fois d'une transparence et d'une
force d'élévation étonnantes. Il règne une allégresse, une joie de vivre dans
l'allegro initial et le finale paré en outre d'une
vigueur non pesante ; tandis que l'adagio offre une plénitude qui respire le
bonheur de jouer. L'écriture si fluide du Cantor devient dentelle et les
cadences absolument naturelles chez le pianiste hongrois. L'accompagnement des
seules cordes, six Ier, six seconds violons, deux altos, deux cellos et une contrebasse, est discret mais pas neutre et
c'est plaisir de voir comme le pianiste-chef stimule ses jeunes musiciens. La Symphonie
N° 88 de Joseph Haydn en sol majeur (1787), qui vient juste après la série
des « Parisiennes » (82-87) et peu avant celle des
« Londoniennes » (93-104), mérite une attention particulière :
maniant le monothématisme au fil de ses quatre
mouvements, elle est emplie d'une inventivité et d'un humour que Schiff se plait à souligner : « n'hésitez pas à
sourire, voire à rire si vous le pouvez », dira-t-il dans un mot
d'introduction. Un seul thème pare le 1er allegro, mais traité avec une
inventivité de tous les instants qui dépasse les notions formelles
d'exposition, développement et récapitulation. Le rôle des bois (flûte,
hautbois et basson par deux) est rien moins qu'éblouissant, que Schiff nurse de sa souple battue. Le Largo, entamé sur une
cantilène du hautbois doublé par le cello, d'une
beauté spectrale, la module à satiété dans diverses combinaisons, alternant piano
et forte. L'extrême douceur de la vision du chef magnifie le vrai classicisme de cette
musique. Dire que le Menuetto est un moment de grâce
est faible devant pareil sentiment de fluidité. Le trio, sur une base de musette,
fait diversion d'une délicate ironie. Le finale ''allegro con spirito'' est vif au fil du son refrain et de ses amusantes
ritournelles puis d'un canon fortissimo, où là encore affleure l'humour chez
les deux bassons et les deux cors. Une interprétation à mi-chemin entre une
vision baroqueuse et une manière plus moderne, que l'effectif instrumental
utilisé (6,6,4,2,2) rend parfaitement transparent.

...et
pianiste ©Nicolas Brodard
La seconde partie était consacrée
au Concerto pour piano et orchestre N° 5 op. 73 de Beethoven, dit
« Empereur ». Un monument s'il en est. Une œuvre
mythique que Schiff s'attache à sortir de clichés
aussi tenaces qu'usurpés. Fustigeant le sentiment de complaisance et la notion
d'emphase, à ses yeux hors de propos. La composition de la formation des cordes
d'abord : 8, 6, 4, 4, 2, assurant une assise d'une clarté exemplaire, évitant
tout effet de masse, même dans les tutti les plus chargés ; l'équilibre piano-orchestre ensuite :
rarement le mot de ''symphonie avec piano'' n'a paru aussi en situation, fuyant
la manière virtuose du grand concerto dont Beethoven rejetait l'apparat ; même
si cet ultime opus marque un progrès en brio par rapport aux quatre précédents.
Le sous-titre d'« Empereur » est apocryphe.
Certes, la composition l'a été dans un moment de difficultés politiques, de
luttes - la préparation de la guerre d'Autriche contre Napoléon en 1808/1809 -
mais Beethoven vise sans doute plus haut et plus large. C'est nul doute la
leçon qu'en retient András Schiff
et qui fonde sa lecture. Qui évite l'éclat martial, du moins le limite à
l'essentiel, comme il infuse un naturel au discours et l'habite de l'univers de
la danse au dernier mouvement. Le gigantesque allegro progresse avec naturel
après l'entrée en scène du piano et les divers séquences
sont contrastées tel le passage en pizzicatos au soutien du soliste. Le chant
souverain de l'adagio « un pocco messo » s'épanche comme une méditation de l'âme sur un
orchestre assagi : un moment d'absolue beauté de par la simplicité du geste. La
transition vers le dernier mouvement est proprement magique, un pianissimo
d'une infinie quiétude avec le solo de deux cors. L'attaca
n'en est que plus formidable, quoique sans inutile brio pour créer l'effet de
surprise ; une des autres caractéristiques de la manière de Schiff
: jouer comme à la première fois. Le fougueux allegro final bondit et la
remarque de l'interprète d'« apothéose de la
danse », prend tout son sens. On est plus dans l'élan spirituel que sur la
chevauchée martiale. Et le combat épique cède le pas à un dialogue
soliste-orchestre serré. Le triomphe final ne sonnera pas ''militaire'' mais
jubilatoire. Une exécution pétrie d'humanité, qui transcende la qualité
pianistique et orchestrale car Schiff dont le jeu est
souvent immatériel, tire là encore des musiciens VFCO des couleurs
envoûtantes.

Devant
la salle des Combins ©Nicolas Brodard
Deux remarques finales. D'une
part, quant à la concentration du public : rarement a-t-on constaté une telle
qualité d'écoute, un tel calme durant les exécutions, quel que soit le lieu ou le type de concert. La convivialité d'autre part, de
rigueur partout, qui vous permet de rencontrer les artistes dans la rue ou au
concert, les uns assistant à ceux des autres - lors du récital de Grigory Sokolov, le nombre de collègues pianistes, Schiff, Hamelin, Trifonov, sans
parler du celliste Maisky et du chef López Cobos, était
impressionnant. C'est là encore une marque de fabrique de l'esprit Verbier !
Jean-Pierre
Robert.
***
LE FESTIVAL DE BAYREUTH

DR
Il y eut le temps où l'on se plaisait à
écraser le chapeau des vieux conservateurs : Wieland Wagner dans les années 60,
Patrice Chéreau une bonne décade plus tard. Est désormais venu celui de
l'interrogation en règle des volontés du maitre de céans. On fait appel aux
iconoclastes de la scène allemande : Christoph Schlingensief,
Jan Philipp Gloger, Frank Castorf... Quelques fois cela fait mouche (Hans Neuenfels pour Lohengrin, Stefan Herheim
dans Parsifal). Dans d'autres, cela tombe à
plat ou franchement à côté (Tannhäuser revu et corrigé par Sebastian Baumgarten). Signe des temps, c'est sans doute à
Bayreuth qu'on peut voir ce qui se fait de plus avant gardiste,
moderniste ou osé en matière de dramaturgie wagnérienne. Son statut de
laboratoire reste plus vrai que jamais. Au point qu'on en vient à se demander :
jusqu'où peut aller la volonté d'innover, de relecture au scalpel en détricotage, de relecture radicale en sévère
déconstruction. Et c'est peut-être hors de la cité de Franconie élue par Wagner
qu'il faut désormais chercher fortune, à Berlin par exemple, autre ville
wagnérienne s'il en est. C'est qu'aussi sur la Verte colline les grandes voix
s'en sont allées : les calibres dits wagnériens – synonymes non de force mais d'endurance
et d'intelligence textuelle – et les autres. Temps de répétitions conséquents, moindre cachets qu'ailleurs ? Quelques
unes, comme le ténor Klaus Florian Vogt, résistent à la surenchère du bling bling qui ont conduit leurs
collègues à préférer se produire ailleurs. D'autres émergent heureusement;
telle la basse Georg Zeppenfeld, et Bayreuth ne
dément pas alors son label de découvreur et de lanceur de carrières. On se
souvient du jeune René Kollo dans le rôle du pilote
du Fliegende Holländer.
Reste que l'ambiance est bien là et perdure avec ses traditions fort
sympathiques (les fanfares de cuivres avant chaque acte, le cérémonial de la
préparation de la salle avant la représentation, etc.. )
à laquelle souscrit un public enthousiaste, très mélangé question langues (même
si en majorité allemand) et âges (quoique avec un bon quarteron de jeunes). Un
engouement frisant l'exaltation, qui semble se satisfaire de toutes
propositions, scéniques, voire même musicales, ce qui est plus curieux, excepté
quelques huées. L'expérience particulière ressentie dans la fameuse salle en
éventail du Festspielhaus de Bayreuth, inspirée de
l'amphithéâtre d'Epidaure, à l'acoustique d'une clarté unique du fait de sa
fosse d'orchestre recouverte, « l'abyme
mystique », n'y est pas pour rien. Bayreuth a de beaux jours devant lui
pour remettre en permanence sur le métier les dix grands drames de son mentor.
Ce seront Die Meistersinger von Nürnberg, l'an
prochain, dirigés par Philippe Jordan.
Trsistan et Isolde
déconstruit
Richard WAGNER : Tristan
und Isolde.
Action musicale en trois actes. Livret du compositeur. Stephen Gould,
Petra Lang, Georg Zeppenfeld, Ian Peterson, Claudia Mahnke, Raimund Nolte, Tansel Akzeybek,
Kay Siefermann. Der Festspielchor.
Das Festspielorchester, dir. Christian Thielemann. Mise
en scène : Katharina Wagner.

Acte I : Brangäne, Tristan, Isolde ©Enrico Nawrath
Que dire de cette production (initiée en
2015) si ce n'est qu'elle irrite et soulève bien des interrogations. Comme déjà
dans Les Maitres Chanteurs de Nuremberg, Katharina
Wagner relit à sa façon le théâtre de son bi aïeul. Et surtout ne veut rien
faire comme les autres. Ses idées forces : anticiper l'événement, le
démythifier et plus prosaïquement faire perdre le sens de l'importance à tout
passage essentiel, surcharger enfin ce qui est parfaitement lisible par la mise
en exergue d'un contrepoint dramaturgique aussi gênant qu'inutile. Pour elle,
l'histoire est celle d'un banal triangle amoureux : Marke,
Isolde, Tristan ; le premier auquel la seconde doit être mariée contre son gré,
et le troisième vécu comme un substitut plus que souhaité. C'est peu dire
qu'ici le personnage du roi Marke prend une
importance singulière : un homme jeune, et non pas dans la force de l'âge, qui
bien que n'apparaissant pas à la fin du premier acte, va s'ingénier à faire
épier les deux amants au deuxième, rabrouer vertement son épousée à l'issue du
flagrant délit et, au dernier acte, l'emmener par la main sans ménagement une
fois les ultimes mots de la Liebestod prononcés.
On n'est certes pas très éloigné du substrat textuel, mais le parti pris est
franchement asséné, au point d'opposer deux clans, façon bons et méchants ;
dans le dernier cas les sbires agissants du roi autoritaire : Melot et quelques vils suppôts, vêtus jaune moutarde. Tous
les traits sont appuyés : ainsi de ce voile de mariée qu'on tord et déchire
rageusement avant même la scène du philtre. A propos, qu'en est-il de ce
passage ? Isolde agite plusieurs fioles tandis que Brangäne
reste tapie dans un coin, de dos : point de substitution du breuvage d'amour à
celui de mort. Les jeux sont faits d'avance : la dame n'a nul besoin d'adjuvant
chimique pour clamer sa passion. La fiole choisie passe de main en main
pourtant, et on en laissera couler le liquide abondamment - qu'on ne boit pas
-, avant une nouvelle embrassade. Car Isolde avait étreint son Tristan bien
avant malgré les efforts vains de Kurwenal et de Brangäne pour les séparer et partant, de les laisser
commettre l'irréparable. C'est peu dire que l'émotion est évacuée lors de ce
passage crucial. Comme il en va de tout le premier acte qui voit les
protagonistes se déplacer tels des pions au milieu d'un dédale d'escaliers et
de passerelles, pour nous signifier sans doute l'inanité de ce voyage chaotique
mêlé de haine et de passion exacerbées. On est empêtré dans ce capharnaüm dont
les issues se bloquent les unes après les autres. Cette idée d'enfermement, on
la retrouve à l'acte suivant, pour atteindre un étonnant paroxysme : l'attente
fiévreuse d'Isolde, qui a été trainée là de force, et le duo d'amour prennent
place dans un lieu clos, façon salle de torture plongée dans l'ombre, tandis
que sur une galerie en hauteur, Marke et ses hommes
observent, espionnent les tourtereaux. Le duo se déroulera d'abord de dos dans
un parfait immobilisme avant que l'un et l'autre ne cherchent à se lover dans
un carcan de métal, piège de leur éphémère - et sans doute indue - destinée,
pour ne pas se toucher. Surpris, Tristan se voit bander les yeux et Isolde
jeter à terre sans égards. Ravalé au rang de fait divers trivial, tout cela
n'est au surplus pas d'un esthétisme renversant. Comme le troisième acte :
plongé dans les ténèbres, sur un plateau désormais dépouillé, le délire de
Tristan lui fait évoquer le spectre de la bien aimée
incrusté dans des triangles surgissant çà et là. Kurwenal
et ses compagnons, blottis sur la droite, resteront interdits, comme navrés des
élucubrations du maitre. L'arrivée d'Isolde ne procure que bien peu de frisson
émotionnel. La fin de l'acte : Marke avec sa horde
peu amène débarque, non pour pardonner, mais bien décidé à faire rentrer les
choses dans l'ordre, savoir la fin annoncée d'un amant usurpateur. Loin de
quelque transfiguration, la mort d'amour est vécue comme un cliché de lubie
(durant laquelle Brangäne s'impatiente devant le
catafalque du héros). On est bien loin du hiératisme, de la proximité textuelle
et de la vraie concision visuelle d'un Wieland Wagner, pour risquer une
comparaison familiale. Alors que la direction d'acteurs reste souvent
simpliste, en tout cas moins
travaillée que les idées qu'elle est censée transmettre.

Acte II : Marke, Tristan ©Enrico Nawrath
Côté voix, le bât blesse aussi. Malgré un
timbre a priori intéressant, Petra Lang n'est aucunement une Isolde : sa couleur
grave - celle d'une Ortrude plutôt - la contraint à
délivrer le texte le plus souvent en voix de poitrine, n'atteignant l'aigu que
grâce à l'artifice. Ce chant qui se complait naturellement dans le medium pour
ne pas dire le grave, laisse une curieuse impression de monotonie, ce qui est
frustrant à la longue, privé que l'on est de la brillance du rôle. Les
intonations ne sont pas non plus toujours idoines. Le Tristan de Stephen Gould
est héroïque à souhait, presque trop car la voix est souvent projetée d'un
bloc, en force. La diction est cependant impeccable comme le soin pour le
texte. Quant à l'endurance, elle ne fait pas défaut qui autorise un troisième
acte sans faute. Le bonheur vient des autres rôles dont on sait qu'ils
connaissent eux aussi leur propre drame, Brangäne au
Ier, Marke au II ème, et Kurwenal au dernier. Ian Peterson est un compagnon de route
attentif et dévoué ; mais est-ce bien utile d'en surligner la réalité par les
contorsions que lui impose la régie ? La voix de baryton, sans être
exceptionnelle, est bien en place. La Brangäne de
Claudia Mahnke est une découverte : mezzo-soprano
claire, magistralement projetée et atteignant sans mal les hautes contrées
réservées à cette partie, au point qu'elle y semble plus à l'aise que sa maitresse
Isolde. Belle caractérisation aussi, malgré une mise en scène qui ne la
favorise pas toujours. Enfin Le Marke de Georg Zeppenfeld apporte le vrai ''echt''
wagnérien de la soirée, en particulier lors du monologue du II, un morceau
d'anthologie, et une aura que pourtant la régie cherche à lui disputer en en
faisant un personnage peu sympathique. La direction de Christian Thielemann assez prudente au début, s'améliore au fil des
actes pour atteindre une transparence remarquable au II ème,
chambriste lors du duo d'amour, et un vrai impact émotionnel au troisième. Les
tempos plutôt lents savent laisser passer un feu tragique que la mise en scène
nous refuse bien souvent, en particulier au dernier acte. Et l'orchestre qu'on
sent fourni comme toujours à Bayreuth, mais non chargé, répond avec brio au
directeur musical du festival.
L'absolue magie musicale de Parsifal
Richard WAGNER : Parsifal. Festival scénique sacré en trois
actes. Livret du compositeur. Andrea Schager, Ryan McKinny, Georg Zeppenfezld, Gerd Grochowski, Karl-Heinz Lehner, Elena Pankratova, Tansel Akzeybek, Timo Riihonen, Alexandra Steiner, Mareike
Morr, Charles Kim, Stefan Heibach,
Anna Siminska, Katharina Persicke, Bele Kumberger, Ingeborg Gillebo, Wiebke Lehmkuhl. Das Festspielchor. Das Festspielorchester, dir. Harmut Haenchen.
Mise en scène : Uwe Eric Laufenberg.

Acte I ©Enrico Nawrath
Le nouvelle production de Parsifal aura été celle de tous les changements : de
metteur en scène (Uwe Eric Laufenberg ayant substitué le
régisseur annoncé de longue date, le très controversé Jonathan Meese), de chef (Harmut Haenchen, en lieu et place d'Andris
Nelsons qui, suite à une friction avec le directeur
musical, avait renoncé), et enfin de titulaire
du rôle titre (Klaus Florian Vogt, pour
cette troisième représentation, ayant cédé la place à Andreas Schager ; cette fois en
toute amitié, car
celui-ci doit le remplacer dès l'année prochaine dans cette production).
Cette dixième mise en scène (depuis la création du Festival en 1882) est
finalement assez sage malgré ses quelques audaces, nettement moins fouillée que
la précédente céans, due à Stefan Herheim, et surtout
que celle de Dmitri Tcherniakov
récemment au Staatsoper de Berlin. Une lecture qui se
veut proche du texte, quoique non sans quelques interprétations personnelles
pour le moins discutables. Elle s'inscrit dans un contexte religieux : une
communauté monacale quelque part dans un monastère au Moyen Orient, qui
accueille des pèlerins du dehors et même des frères d'autres religions, comme
on le verra à la fin de l'œuvre où bouddhistes, musulmans, juifs et chrétiens
cohabitent dans un unanimisme qu'on souhaiterait être évident dans la réalité.
La croix latine est là bien présente et Amfortas
prend la figure du Christ à couronne d'épines. De beaux traits dans le
personnage de Gurnemanz émeuvent : lors par exemple
qu'étreignant la croix à la fin de son monologue, tandis qu'un tout jeune
enfant surgit annonçant l'arrivée du fol Parsifal. Ce
début de premier découvre une large vasque où l'on baignera Amfortas,
et qui lors du second tableau, se transforme en un autel où sera représentée la
cérémonie du Graal, telle une réplique de la Cène, après qu'on eut recueilli le
sang coulant abondamment du flanc d'Amfortas dont on
a ravivé la blessure. Si un certain ''classicisme'' règne donc dans le Ier
acte, les choses évoluent sérieusement au suivant qui découvre l'antre de
Klingsor affairé à collectionner les croix latines arrachées à ses adversaires
de Montsalvat, tandis que le premier d'entre eux, Amfortas, est présent muselé et que se pressent un essaim
de femmes voilées. A part ce dernier trait, un peu gratuit, la scène tombe dans
un convenu assumé mais peu convaincant. Les filles fleurs évolueront comme dans
un harem coloré, kitsch, flanqué d'une piscine où l'on immergera Parsifal. Réapparition d'Amfortas
lors de la proclamation plus enflammée que douloureuse du héros, « Amfortas, die Wunde ».
Récupérant plus tard la lance des mains de Klingsor, il la brisera net pour
confectionner de ses deux morceaux une croix latine. Le troisième acte
réinvestit la chapelle du Ier, désormais envahie de verdures, signe d'abandon,
tandis que Gurnemanz et Kundry
vieillis en sont réduits à la chaise roulante, cliché bien usé. L'épisode de
l'Enchantement du Vendredi Saint laisse place à une vision de paradis terrestre
perdu : rideau de pluie en fond de scène découvrant des naïades nues... Et la fin de l'œuvre, qui évacue totalement
le personnage de Kundry, donne à voir la communauté,
enrichie de ses confrères étrangers, se disperser pour laisser un plateau
complètement vide éclairé de manière de plus en plus insistante, luminosité qui
s'étend à la salle même du Festspielhaus. Dernier mot
laissé à la musique ? On reste sur l'impression d'une succession d'idées dont
certaines fort originales, mais sans réelle cohérence, et au final d'une
approche non aboutie. Les explications alambiquées du metteur en scène, dans le
programme de salle, laissent d'ailleurs perplexes sur ses intentions, qui se
pose plus de questions qu'il n'en résout. Reste que la conception des
personnages ne laisse pas place à la transposition hasardeuse.

Acte I : Amfortas et les Chevaliers ©Enrico Nawrath
L'interprétation musicale réserve d'autres
sujets de satisfaction. Par une distribution de qualité. Au premier rang de
laquelle le Gurnemanz de Georg Zeppenfeld.
Que de chemin parcouru depuis son interprétation, déjà remarquable, du rôle à
l'Opéra de Lyon (cf. NL 4/2012) : noblesse du chant, rondeur de l'émission,
beauté de l'intonation en font une pointure du chant wagnérien. La simplicité
de l'approche qu'exige la régie n'est pas sans conséquence sur une déclamation
dont on apprécie le naturel : comme lors de ce merveilleux passage au Ier acte
: « Der reiner Tor », délivré pianissimo.
Le dernier acte est vécu avec une émotion contenue. L'américain Ryan McKinny, lauréat du concours Operalia,
prête à Amfortas de accents de sincérité et un chant
assuré qui lui permet de triompher des périls accumulés dans les monologues
exposés du Ier et surtout du dernier acte. Si le Klingsor de Gerd Grochowski déçoit par une émission pas assez projetée, le Titutel de Karl-Heinz Lehner, présent sur scène comme chez Tcherniakov,
offre un beau métal grave et aucunement dur. Le personnage de Kundry est un de plus délicats à distribuer et ne l'a pas
toujours été à la hauteur à Bayreuth, là où plane le souvenir inoubliable de
Waltraud Meier. La russe Elena Pankratova en défend
le territoire avec brio : présence scénique hors du commun dans ses
interventions proches de l'interjection au Ier acte, vocalité accomplie au
second, dans la grande tirade « Ich sah dass Kind »,
bien amenée dans le registre grave, et assumée dans les quintes aiguës
redoutables de la fin de l'acte. Andreas Schager, qui
débutait donc ce soir-là dans le rôle titre à Bayreuth,
a visiblement convaincu les auditeurs qui lui ont réservé un triomphe aux
rideaux finaux. On admire, comme déjà observé à Berlin, une assomption de
stature : des forte bien négociés, une clarté d'émission et une
projection aisée. Comme une intéressante progression dans la psyché du
personnage dont le destin bascule à partir du baiser de Kundry.
On tient là un grand interprète allemand du rôle avec lequel il faudra compter.
Bel ensemble de filles fleurs. Et surtout fabuleux chœurs sous la houlette de
Eberhard Friedrich, maintenant un niveau d'excellence qui distingue le Festival
de Bayreuth depuis des lustres : cette belle clameur mâle qui pare la fin du
Ier et du III ème acte, cela ne s'oublie pas en
termes d'absolue beauté sonore. Tout aussi admirable la transformation des
registres que procure les fameux trois niveaux de couleurs vocales. Harmut Haenchen est le type même
du Kappelmeister sûr qui connait son Wagner du dedans : il l'a déjà
démontré à l'Opéra Bastille. Le sens de l'architecture d'ensemble comme le soin
apporté au soutien du chant, dépourvu d'emphase, confèrent à cette partition
des miracles de sonorités fusionnelles. Sa direction, sur le versant lent, mais
non trainante ni appuyée, aux Ier et III ème actes,
est justement plus nerveuse et dramatique au II ème.
Partout la coulée sonore et la finesse du trait emplissent d'une vraie émotion.
Quels que soient les aléas visuels du spectacle, entendre ici cette œuvre,
conçue pour ce théâtre, est décidément une expérience unique.
Jean-Pierre Robert.
***
Concert de gala au
Théâtre des Champs-Elysées

Jonas Kaufmann ©Julian Hargreaves
Il existait au moins trois
excellentes raisons d'assister à ce concert de gala clôturant la saison au
Théâtre des Champs-Elysées, un concert très attendu expliquant l'affluence du
public parisien avenue Montaigne. La première de ces raisons étant le passage à
Paris de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, d'ailleurs habitué du lieu
puisqu'il s'y produit deux fois l'an depuis de nombreuses années, la deuxième,
la présence sur scène de la star des ténors du moment, Jonas Kaufmann, et enfin
la troisième, un superbe programme viennois associant Beethoven, Richard
Strauss et Gustav Mahler, taillé sur mesure pour la prestigieuse phalange. A la
baguette le chef britannique Jonathan Nott, ancien
directeur de l'Orchestre de Bamberg, prochainement attendu à la tête de
l'Orchestre de la Suisse Romande, remplaçant Daniele
Gatti initialement prévu, mais indisponible du fait d'une blessure récidivante
à l'épaule. L'Ouverture symphonique de
Coriolan de Beethoven débutait la soirée, une pièce composée en 1807 qui
dresse la figure du héros face à la foule, à l'histoire et au destin, tout un
monde et une lutte emblématiques chers à Beethoven. Une composition concise,
reconnue comme un des premiers poèmes symphoniques, qui ouvrira la voie à
nombre de compositeurs ultérieurs comme Liszt ou Richard Strauss notamment qui
préfèreront cette forme de musique à programme, refusant de se mesurer avec le
maître de Bonn dans le domaine purement symphonique…Une partition qui démarre
fortissimo sur des accords de trompette, laissant une large place aux vents et
aux cordes graves saisissant l'auditeur à bras le corps pour ne plus le lâcher
jusqu'au renoncement du héros. Une tragédie courte mais intense dont Jonathan Nott donna une vision très contrastée à la fois lyrique et
épique, héroïque et dynamique, de très belle tenue. Suivaient deux œuvres du
répertoire post romantique, Mort et
Transfiguration (Tod und Verklärung)
de Richard Strauss et Le Chant de la
Terre (Das Lied von der Erde) de Gustav Mahler. L'œuvre de Strauss, composée en
1888, narre les
souvenirs d'un homme alité se souvenant de sa jeunesse. Réconforté par
l'espérance d'un au-delà radieux, le héros retrouve enfin la sérénité avant de
s'éteindre. Sujet morbide, avouons-le, dans lequel certains ont voulu voir une
sorte de rédemption et d'accès à l'éternité par l'idéal artistique…Une occasion
plutôt pour le compositeur viennois de coucher sur le papier une partition très
contrastée, pleine d'énergie, magnifiquement orchestrée dont, là encore, le
chef britannique donna une lecture toute empreinte d'urgence et de dramatisme
conduisant à une sérénité sonnant un peu faux car entachée d'une certaine
grandiloquence. Une interprétation très narrative, engagée, parfaitement en
place.
Pour conclure : Le Chant de la Terre de Mahler
interprété par Jonas Kaufmann dont l'étendue de la tessiture permet au ténor
allemand de chanter les deux rôles, le plus souvent dévolus à un ténor et une alto. Une partition très originale, datant de 1907, où
Mahler parvient à accomplir ce qui restera pour lui une obsession constante
pendant toute sa vie de compositeur dans le désir de réaliser la fusion entre
le Lied et la symphonie. Avec le Chant de
la Terre et la Neuvième Symphonie, nous retournons au Moi profond de
Mahler. Composé dans une période de créativité difficile, après la crise de
1907 qui verra son départ de l'Opéra de Vienne, la mort de sa fille aînée Putzi et la
découverte de sa cardiopathie, Mahler a conscience de la nécessité de
poursuivre son œuvre malgré la solitude,
la menace de mort, quasiment acceptée. Le travail semble son seul dérivatif,
conçu comme un réconfort. Par le Chant de
la Terre, Mahler retrouve le chemin de lui-même en reprenant son inlassable
quête de construction, réalisant l'apogée de l'esprit romantique en reliant
subjectivité de l'expression et raffinement de la technique. Conçu pour
échapper à la malédiction des Neuvièmes symphonies (Beethoven, Schubert,
Bruckner), construit à partir de sept poèmes chinois du VII ème
au IX ème siècle de notre ère,
découverts dans le recueil La Flûte
Chinoise de Hans Bethge, il s'agit d'une
véritable symphonie de Lieder pour ténor, alto (ou baryton) et orchestre.
Mahler y évoque la condition humaine : l'ivresse et le désespoir, la
solitude et la nature, la jeunesse, la beauté, le printemps et enfin l'adieu à
l'ami se terminant dans un murmure sur le mot « ewig » (éternellement) répété
sept fois comme un rite sacré qui laisse entrevoir le passage de l'intime à
l'universel, transition qui se confirmera dans la Neuvième Symphonie. On
regrettera peut-être une trop pesante lenteur dans l'interprétation de cette
superbe partition avec parfois un problème d'équilibre entre chanteur et
orchestre. Par ailleurs, le fait de chanter les deux parties, s'il constitue
assurément un exploit vocal technique, retire à l'œuvre beaucoup d'émotion et
de couleurs, ne serait-ce que par une certaine monotonie de timbre. Si cette
façon d'envisager cette œuvre ne nous séduisit qu'à moitié, on ne saurait
toutefois mettre en doute la qualité vocale superlative du ténor allemand
Kaufmann ni la qualité musicale de la phalange viennoise qui sembla pour
l'occasion retrouver un lustre quelque peu terni lors de ses dernières prestations,
notamment au niveau des cuivres. Un beau concert et un triomphe bien
mérité !
Patrice Imbaud.
Chopin côté Jardin

François
Dumont ©Jean-Baptiste
Millot
Au festival Chopin de
l'Orangerie de Bagatelle, François Dumont a donc joué Chopin. On sait que
Chopin excella dans les pièces brèves, François Dumont a donc concocté un
programme de pièces brèves. Pas d'intégrales ni de longs morceaux. Et c'est une
gageure de jouer devant un public averti un répertoire entendu et réentendu
mille fois. Le pianiste a d'abord précisé qu'il enchaînerait les œuvres sans
interruption ni évidemment applaudissements qui viendraient rompre le cours de
ce concert qu'il considère comme une longue invitation à la rêverie. François
Dumont est français et on peut affirmer qu'il joue Chopin à la française, en
privilégiant le côté raffiné et élégant de cette musique tout en préservant ses
solides racines slaves. Dans ce récital, les Nocturnes ont une place de choix.
Le Nocturne en ut dièse mineur est le plus sombre de tous et le pianiste
dont une des très grandes qualités est de faire sonner clairement des basses
puissantes, en use judicieusement pour rythmer ce morceau qui exalte la passion
et gronde avant de se laisser mourir dans une caresse. Les autres Nocturnes
sont faits de désolation et de poésie mais François Dumont, grâce à la fluidité
de son jeu et à l'économie de ses gestes, échappe au sentimentalisme et fait
mentir Field, lui qui regrettait que les Nocturnes ne soient rien de plus que
de « la musique de chambre de malade ».
La Première Ballade,
ce chant d'un amour brisé entre Chopin et Marie Wodzinska,
tout en nuances entre la fougue et le désespoir, entre arpèges et petites
notes, François Dumont l'interprète en épurant le romantisme et, comme le
voulait Chopin, il ne joue ni les forte ni les piano
avec la pédale mais avec les doigts. Dans la Deuxième Ballade, véritable
flot d'harmonies dissonantes et d'appogiatures, François Dumont charge chaque
note d'émotion et respecte la règle du compositeur qui voulait que « la
main gauche soit le maître de chapelle » et que la main droite joue sa
partie en la suivant ad libitum. Un des plus beaux morceaux du concert. Dans la
Valse en ut dièse mineur, on retrouve la manière délicate et feutrée d'un Dinu Lipatti, dont
on écoutait jadis le microsillon dans
les salons des notaires et des médecins de province. Musique intemporelle,
interprétation intemporelle. Avec les deux impromptus (n° 1 et n°3), musique de
salon par excellence, on se croirait invité chez Chopin, place Vendôme. Ici le rubato cher au compositeur est roi et
François Dumont le maîtrise parfaitement, ce rubato si subtil qui étire la mesure comme si le morceau était une
improvisation sans cesse recommencée, de ces improvisations dont raffolait
Chopin. Avec son
toucher délicat, François Dumont, termine par La Berceuse, à la basse obstinée, en
jetant un voile "d'ingénuité pur comme le souffle d'un enfant". Puis il revient
combler un public enthousiaste avec trois
bis : une Étude et deux Valses Brillantes. Ah ! J'oubliais, à
la fin d'une des Ballades, le cri strident d'un des fameux paons du parc de
Bagatelle était exactement dans le ton.
Jean-François
Robin.
Coup de génie / coup de cœur
La huitième édition du
Concours International de Piano de Lyon s'est déroulée du 2 au 5 juillet
dernier. L'événement musical dépasse le simple cadre de la compétition.
Svetlana Eganian, sa fondatrice, déborde
d'enthousiasme. En quelques années, cette véritable fête du piano a pris une
envergure comparable à celles des concours Reine Élisabeth de Belgique ou
Frédéric Chopin de Varsovie.

Dmitri Bashkirov
entouré des lauréats de la session 2016 / DR
Coup
de génie
La capitale des Gaules est
dotée d'un concours de piano à sa mesure ! Présidé par des personnalités
musicales telles que Jacques Rouvier, Christian Ivaldi,
Marie-Catherine Girod, Michel Dalberto, Alexandre Paley ou Dmitri Bashkirov, cette manifestation vise à : « Révéler
des artistes et enrichir la société ». La double devise traduit une
volonté de promouvoir de jeunes talents et de créer un carrefour musical, un
lieu d'échange privilégié où artistes et public communient dans un même amour
de l'Art.
Depuis la création du
concours en 2009 ce sont des centaines de spectateurs qui sont venus écouter la
cinquantaine de jeunes candidats sélectionnés chaque année. Le service de
communication de la ville de Lyon donne une splendeur particulière à
l'événement. Le Conservatoire à Rayonnement Régional ainsi que le Conservatoire
Supérieur de Musique de Lyon ouvrent les portes de leurs salles de répétitions
et de concerts. Des sponsors privés et des entreprises partenaires
apportent leur soutien. Enfin, les nombreux bénévoles et les familles d'accueil
contribuent à optimiser ce cadre d'exception.
Coup
de cœur
Le concert de gala clôt le
concours. Yolande Kouznetsov, co-directrice
artistique, évoque ces moments musicaux :
« Ce sont toujours des
concerts exceptionnels et je suis souvent émue lorsque j'entends des pièces
sublimes du répertoire jouées à la perfection ».
Au terme de la session 2016,
cinq prix ont été remis
Le premier prix, d'un
montant de 5000 euros offert par la société BDO, revient à Leonel
Morales-Herrero. Le jeune virtuose
espagnol a également suscité le coup de cœur des Festivals Les Pianissimes
et Les Virtuoses du piano de
l'association Fréderic Chopin de Lyon. Il est, de plus, invité par le Festival Gwadloupgroove et
par celui de Barbizon.
Le second prix, d'un montant
de 2500 euros, offert par la société Eiffage, est attribué à l'allemande
Caterina Grewe. La pianiste germano-japonaise est
aussi coup de cœur du Festival Musica Formosa "Voyage
d'Hiver". Elle est invitée par le festival de Pompignan.
Bruno Vlahek,
originaire de Croatie, emporte le 3ème Prix de 1500 euros offert par la
Fondation Berdjouhi et Kevork
Karagueuzian, ainsi que le Prix du Public de 1000
euros offert par la société Leximpact.
L'arménien Artavazd Hambaryan est récompensé
par le Prix spécial pour l'interprétation de l'œuvre d'Alexandre Scriabine
offert par un mécène privé, Monsieur Jean-Marie Monnier, et d'un montant de 300
euros.
Enfin, les finalistes Aysylu Salyakhova de Russie-Bashkortostan et Youngsun Choi de
Corée ont obtenu le Diplôme de Mérite et des partitions en cadeau.

Yolande
Kouznetsov et Svetlana Eganian
en concert /DR
La ville de Lyon peut donc
s'enorgueillir de la généreuse initiative de Svetlana Eganian.
Rappelons que le concours est ouvert aux candidats âgés de seize à trente-trois
ans. La sélection est effectuée par DVD, CD ou Youtube. Nous souhaitons bonne
chance aux futurs candidats et croyons savoir que la session 2017 devrait
proposer une finale avec orchestre.
Pour en savoir
plus : www.gpipl.fr
Par ailleurs,
voici le lien pour écouter l'interview de Svetlana Eganian
(sa fondatrice), diffusée sur RCF Lyon : https://rcf.fr/culture/les-jeunes-virtuoses-du-piano-sinvitent-lyon
Laurent Hurpeau*.
*Laurent Hurpeau est PRAG Université de
Bourgogne, Docteur en musicologie, Diplômé du CNSM de Lyon.
***
L'ÉDITION MUSICALE
FORMATION
MUSICALE
Marie-Hélène
SICILIANO/Florent SICILIANO : Faisons
de la musique en F.M. vol.3 1vol. 1
CD. Lemoine : HC51
Nous avons rendu compte en juillet 2014 et
novembre 2015 des deux premiers volumes de cette méthode. Nous nous permettons
de renvoyer à ces deux articles pour de plus amples détails. Disons que ce
troisième volume est tout à fait fidèle à son titre et présente effectivement
une manière nouvelle d'enseigner la FM même si, bien sûr, les données
« traditionnelles » sont données avec le plus grand soin. Il y a
toujours trois parties : lecture, rythme et écoute, mais ces trois parties
sont en interconnexion constante, et toujours axées sur la musique à écouter ou
à jouer ensemble. La variété des styles présents se fait toujours dans un souci
de culture musicale. Bref, cette méthode mérite d'être découverte. Nous ne
reviendrons pas sur la qualité du CD, inséparable de la méthode.

Claude
PIPON : Les chansons de Charlotte. 5
chants pour chorale d'enfants et premier cycle de Formation Musicale.
Delatour : DLT2649.
Ces cinq charmantes chansons feront le
bonheur des chefs de chœurs et professeurs de FM. Si elles ne présentent aucune
difficulté, ce n'est pas au détriment de la qualité de la musique. Les mélodies
sont variées, les accompagnements de piano très bien écrits. Une partie de
percussion (facultative) est également indiquée, destinée à être jouée par les
chanteurs en battant des mains ou sur de petites percussions. Les deux
premières chansons possèdent même deux versions, l'une avec un accompagnement
qui double le chant, l'autre avec un accompagnement qui a sa vie propre… On
peut dire également qu'il y a une progression de chanson en chanson. Il s'agit
donc d'un recueil de qualité, tant au point de vue musical que pédagogique.

ORGUE
Théodore
DUBOIS : L'œuvre d'Orgue. Vol.
III. Bärenreiter : BA 8470.
Poursuivant la publication des œuvres
complètes pour l'orgue de Théodore Dubois, les éditions Bärenreiter nous
offrent les Trois pièces pour Grand
Orgue de 1890 et la Messe de Mariage, cinq
pièces pour orgue de 1891. Rappelons que Théodore Dubois (1837-1924), Prix de
Rome, directeur du Conservatoire de Paris et éminent organiste, est redécouvert
aujourd'hui dans le cadre du regain d'intérêt porté à la musique romantique de
la fin du XIX° siècle. C'est pendant qu'il était organiste à la Madeleine qu'il
composa un grand nombre de pièces d'orgue dont font partie celles qui se
trouvent dans ce volume qui contient beaucoup de pages en fac-similé, un
commentaire critique en français, un catalogue des sources et une préface
détaillée retraçant les grandes lignes de la vie du compositeur, ainsi que des
indications d'interprétation et un examen critique très intéressant des
éditions précédentes.

PIANO
Sébastien
TROENDLÉ : Méthode de
Boogie-Woogie. Lemoine : 29 240 H.L.
L'auteur
s'adresse au pianiste autodidacte débutant qui souhaite s'initier au
Boogie-Woogie. Bien sûr, les notions de bases en solfège sont quand même
requises, mais la méthode est d'une grande clarté et procède acquis par acquis
avec un grand sens pédagogique. Chaque étape est expliquée en détail et la
progression est remarquablement graduée. Très prochainement des vidéos de
travail seront présentées sur le site de l'auteur :
http://www.sebastientroendle.com/methode/

Natalia
FLAMENT : Les exercices à la barre
sur ½ pointes. Collection « L'accompagnement de danse au piano ».
Lemoine : 29 227 H.L.
La postface de Yannick Stéphant, Première
danseuse de l'Opéra de Paris, Danseuse Étoile aux Ballets de Monte Carlo., est
un gage de la qualité de ce travail. La présentation qu'en fait l'auteur
explicite le propos de cet ouvrage qui aidera les nombreux pianistes
accompagnateurs de cours de danse à enrichir leur répertoire. Ceux qui ont
pratiqué ce métier savent bien qu'il leur faut improviser sans répit et qu'il
est bon parfois, de pouvoir se nourrir de l'invention des autres… Ces trente et
une pièces sont de qualité et le sommaire en donne à la fois l'esprit, par des
titres suggestifs, et l'utilisation technique par des indications précises.
C'est un excellent travail qui devrait rendre service à beaucoup !

VIOLON
Gioacchino
ROSSINI : Le Barbier de Séville vol.1
pour piano et violon. Arrangement : Régis Boulier. 3ème cycle.
Sempre più : SP0196.
Il s'agit en fait d'une de ces
« paraphrases » sur des airs d'opéra comme on les aimait au XIX°
siècle. Mais la mode revient, et qui s'en plaindrait ? C'est une manière
bien agréable de pénétrer dans le monde de l'auteur. Pourquoi volume 1 ?
C'est que Régis Boulier traite son arrangement par personnage. Et dans ce
premier volume figurent seulement Rosine, Bartolo et Figaro. L'ensemble, bien
réjouissant, respecte tout à la fois la lettre et l'esprit de l'original en
même temps qu'il est tout à fait adapté au duo piano violon. On peut attendre
le deuxième volume avec confiance !

Jean-Paul
HOLSTEIN : Rêve d'étoiles pour
violon solo ou violon et piano. Moyen. Delatour : DLT2620.
Le fait qu'on puisse se passer de la partie
de piano pourrait laisser croire que celle-ci n'est qu'un faire-valoir plus ou
moins facultatif. Il n'en est rien. Si l'œuvre possède sa plénitude avec le
violon seul, le piano n'est pas un rajout mais concourt à donner à l'œuvre un
autre visage tout aussi intéressant. Le langage est libre, mais le système
tonal n'est jamais loin. L'interprétation demande à la fois beaucoup de lyrisme
et beaucoup de retenue… Il faut faire preuve de bon goût, tout
simplement !

ALTO
Paul
COLLIN : Six esquisses pour alto
seul. 3ème cycle. Sempre più : SP0233.
Ces six courtes pièces possèdent chacune leur
caractère propre. On peut parler de six petits tableaux très variés, pleins de
vigueur autant rythmique que mélodique. Elles sont faites pour être enchainées.

Jacques
BORSQARELLO – Laurent VERNEY : Le
spiccato dans les traits d'orchestre pour alto. Troisième cycle. Sempre
più : SP0193.
Dans leur préface, les auteurs expliquent
comment cette technique spécifique de coup d'archet s'est perfectionnée à
partir du célèbre altiste et pédagogue français Maurice Vieux en se
transmettant notamment par Serge Collot. Ce volume regroupe donc dix-neuf
traits d'orchestre, de Mozart à Prokofiev, qui permettent aux altistes de
travailler et d'améliorer ce coup d'archet indispensable pour l'interprétation
des œuvres du répertoire.

VIOLONCELLE
Josiane
DIEFFERDING : Carrousel pour
violoncelle et piano. Fin de 1er cycle. Sempre più : SP0232.
Le titre correspond parfaitement au caractère
de la pièce : vrais chevaux ou chevaux de bois, tout tourne avec grâce.
Mais ce n'est pas pour autant que l'œuvre manque de variété, et le piano n'y a
pas un simple rôle d'accompagnateur. Il y a dans cette pièce beaucoup de charme
mais aussi de fantaisie.

Pascal
PROUST : Sirènes pour violoncelle
et piano. Premier cycle. Sempre più : SP0245.
Voici de bien attirantes sirènes !
Pascal Proust nous déroule un discours à la fois simple et ondoyant tandis que
le piano le soutient en délicates harmonies. Si la technique est évidemment
sollicitée, c'est d'abord de sens musical que devront faire preuve les jeunes
interprètes.

CONTREBASSE
Daniel
MASSARD : La contrebasse dans
l'orchestre. Cycles 2/3 et concours. Combre : CO 6795.
Nous écrivions en juillet 2014 :
« Contrebassiste au sein de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse
ainsi que professeur au CRD de Montauban, l'auteur fait profiter les jeunes
contrebassistes à la fois de son expérience de musicien d'orchestre et de
pédagogue. Bien loin des exercices arides, cette méthode ne contient, même pour
les études techniques préparatoires, que des textes tirés des meilleurs
auteurs. Chacun est présenté et mis en situation. Il ne reste plus à l'élève
qu'à aller écouter l'œuvre mais c'est si facile à l'heure actuelle ! Bref, on
ne saurait trop recommander cette approche profondément musicale de
l'instrument. » Nous n'avons rien à changer à cette recension, sinon à
dire que l'on retrouve dans ce volume qui s'adresse aux plus hauts niveaux
toutes les qualités de pédagogie et de souci à la fois technique et de culture
musicale qui présidaient au premier recueil. De l'époque baroque au XX° siècle,
tous les styles sont présents, expliqués et commentés avec beaucoup de soin et
de pertinence.

FLÛTE
Pascal
PROUST : Passatempo pour 3
flûtes et piano. 2ème-3ème cycle. Sempre più :
SP0210.
Construite sur un rythme obstiné, cette pièce
haletante devrait connaître un franc succès auprès des flûtistes un peu
avancés. Le pianiste n'est pas en reste : bien loin d'être seulement un
accompagnateur, il prend une part active au concert. L'ensemble est varié,
coloré, même si s'en dégage un brin de nostalgie. C'est de la très bonne
musique !

Ivan
BOUMANS : Két Tánc pour flûte et piano.
Fin 2ème cycle. Sempre più : SP0207.
Il s'agit d'une commande de l'Union Grand-Duc
Adolphe, fédération nationale de musique du Luxembourg pour le Concours
Luxembourgeois et Européen pour Jeunes Solistes 2008. Une première pièce, Elégie, se déroule dans des mesures
diverses qui donnent une impression de liberté du rythme et du discours. La
deuxième pièce, intitulée Néptáne, est un Allegro molto endiablé et très rythmé dans un
dialogue constant avec le piano.

Marc
LYS : Anecdotes pour hautbois et
piano. 2ème cycle. Sempre più : SP0212.
Ces charmantes anecdotes sont au nombre de
deux : la première possède une nonchalance un peu mélancolique avec, au
centre, un passage plus impétueux. La deuxième est une valse d'abord assez sage
puis de plus en plus tourmentée. L'ensemble est fort agréable et dans un
discours harmonique plein de délicatesse.

Michel
CHEBROU : Chanson pour Suzon pour
flûte et piano. Débutant. Lafitan : P.L.3053.
Cette jolie petite chanson se déroule selon
le schéma refrain – couplet – refrain, le couplet étant au ton de la dominante.
Si la partie de piano n'est pas écrite pour un débutant, elle n'est cependant
pas très difficile. Il faudra que le jeune pianiste maîtrise à la main droite
les arpèges continus de l'accompagnement. Le tout est fort agréable à entendre.

HAUTBOIS
Jean-François
PAULÉAT : Jaïza pour
hautbois et piano. Facile. Delatour : DLT2629.
Cette très agréable pièce dans le style
« jazz » demande un pianiste aguerri mais est destinée à un
hautboïste sinon débutant, en tout cas de petit niveau… du moins en instrument,
car il vaudra mieux qu'il ait le sens du rythme ! On peut écouter
l'intégralité de la pièce sur le site de l'éditeur.

CLARINETTE
Bruno
CAMPORELLI : Clarinette concertino pour
clarinette et piano. 1er cycle.
Sempre più : SP0227.
Ecrit, comme il se doit, en trois mouvements,
ce concerto miniature s'ouvre par un Allegro
moderato en forme de marche triomphale. Il se poursuit par un Andante – Cantabile qui a une allure de
barcarolle très poétique. Le Maestoso
martiale qui clôt le tout correspond évidemment à son titre. C'est une musique
plaisante qui doit permettre au jeune clarinettiste de découvrir les joies de
la musique d'ensemble.

Alain
FLAMME : En quelques mots pour
clarinette et piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.3064.
Cette pièce aux harmonies délicates déroule
un discours lyrique et pudique à la fois. Piano et clarinette dialoguent de
façon fluide et un peu mélancolique. L'ensemble est très intéressant et peu
constituer sans déparer une courte pièce de concert.

SAXOPHONE
Benjamin
ATTAHIR : Etudes obstinées pour
saxophone. Difficile. Lemoine : 29 249 H.L.
Chacune de ces cinq études constitue
l'exploration d'une difficulté, d'une exploration musicale, d'une tessiture et
d'une couleur sonore particulière. L'ensemble vise à la virtuosité la plus
grande possible.

Olivier
DEVIENNE : Sur le sable pour
saxophone alto et piano. Débutant. Lafitan : P.L.2966.
Lorsqu'on lit le titre, on pense d'abord à la
plage… Mais le rythme obstiné et la tonalité de do mineur, avec de temps en
temps la fameuse seconde augmentée entre cinquième et sixième degré fait plutôt
penser à la caravane dans le désert. Qu'importe ? Le tout, c'est de se
faire une image mentale qui permette d'interpréter cette pièce fort
intéressante. Le pianiste est ici un partenaire à part entière : c'est de
la vraie musique de chambre. Bref, les jeunes interprètes devraient trouver à
jouer cette œuvre beaucoup de plaisir et de profit.

TROMPETTE
Marc
LYS : Anecdotes pour trompette
et piano. 2ème cycle. Sempre più : SP0213.
Il s'agit d'une version pour trompette de la
pièce pour hautbois et piano recensée plus haut.
André
GUIGOU : Juan pour trompette ou
cornet ou bugle et piano. Débutant. P.L.2985.
Voici une œuvre pleine d'optimisme et de vie,
ce qui n'empêche pas la mélodie de se dérouler paisiblement. Piano et trompette
dialoguent à égalité et l'ensemble se termine dans une joyeuse fanfare.

TROMBONE
Rose-Marie
JOUGLA : L'elfe de cristal pour trombone et
piano. Assez facile. Delatour : DLT2626.
Il est bien joli cet elfe qui nous parle par
des phrases très expressives soutenues par un accompagnement délicat dans des
harmonies qu'on pourrait qualifier de debussystes. Si cette pièce possède une
visée pédagogique, c'est au service de la musique. Et c'est là où on pourra
juger du sens musical des jeunes interprètes.

Rose-Marie
JOUGLA : Chat flâneur. Assez
facile. Delatour : DLT2625.
Ce bon gros chat se promène tranquillement. A
peine a-t-il l'idée de se lancer après une proie qu'il renonce aussi vite…
L'ensemble est facile et ne fait pas appel à la clé d'ut 4°. La partie de piano
accompagne non moins placidement le félin dans sa marche un peu nonchalante.

Rose-Marie
JOUGLA : Prince Nénuphar pour
trombone et piano. Moyen. DLT2627.
Bien que le mouvement métronomique soit donné
à la croche, il faut évidemment « penser » cette pièce à la noire
pointée. Notre nénuphar princier ondule avec grâce dans un 6/8 à la fois
lyrique et épanoui. Les modulations délicates ne font jamais oublier le ré
majeur finalement triomphant. L'ensemble est très joli et devrait plaire tant
aux interprètes qu'au public.

EUPHONIUM
Marc
LYS : Anecdotes pour euphonium
et piano. 2ème cycle. Sempre più : SP0214.
Il s'agit d'une version pour euphonium de la
pièce pour hautbois et piano recensée plus haut.
PERCUSSIONS
Dimitri
GLADKOV : Timb – All pour
timbales et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.3070.
Trois timbales sont nécessaires pour
interpréter cette pièce au titre évocateur…D'un bout à l'autre de la pièce, un
ostinato rythmique d'accords de la main gauche du piano crée une atmosphère
obsédante accentuée encore par la tonalité de ré mineur. Le tout se termine par
trois accords paroxystiques. Il s'agit donc d'une œuvre qui ne manque pas de
caractère !

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Alireza
MASHAYEKHI : Points. Opus 173. 3
trios avec contrebasse. Assez facile. Delatour : DLT2638.
Ecrites la première pour alto, contrebasse et
piano, les deux autres pour violon, contrebasse et piano, ces trois courtes
pièces pédagogiques sont destinées à initier les jeunes musiciens à la musique
de chambre tout en leur permettant de jouer en public. Ces pièces comportent
également une initiation méthodique à l'écriture contemporaine.

Johannes
BRAHMS : Les sonates pour clarinette
de Johannes Brahms pour Violon et Alto. Bärenreiter : BA 10907 et
10911.
La publication de ces œuvres tardives de
Brahms est tout à fait intéressante. En effet, on connait le perfectionnisme de
Brahms et ces œuvres sont autant des transcriptions que des réécritures en
fonction du nouvel instrument auxquelles elles sont destinées. Il faut lire
absolument les très longues introductions rédigées par les éditeurs, Clive
Brown et Neal Peres Da Costa, qui font le tour de ces œuvres, décrivant leur
origine, leur élaboration, l'histoire complexe de leur publication. Et bien
sûr, on appréciera à sa juste valeur la clarté de cette édition. Le premier
volume contient les versions pour alto et piano, le second, les versions pour
violon et piano qui constituent l'opus 120.


ORCHESTRE
Sophie
LACAZE : Immobilité sérieuse I pour
piano et orchestre à cordes. Delatour : DLT2654.
« Immobilité sérieuse I », écrite en
2013, est la première d'une série de pièces pour instrument solo et orchestre à
cordes de Sophie Lacaze. Hommage à Erik Satie, « Immobilité sérieuse I » est
basée sur un motif tiré des « Vexations » que Satie avait composées pour le
piano, et qui avaient été créées à New York par John Cage et plusieurs de ses
amis pianistes le jour de la naissance de la compositrice.
« Pour se jouer 840
fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le
plus grand silence, par des immobilités sérieuses », Erik Satie. »
Que dire de plus que
cette présentation, sinon que la pièce est d'une écriture résolument
contemporaine. En exergue de cette première « immobilité », Sophie
Lacaze nous livre cette constatation de Satie : « Ici il fait très
chaud. Je comprends maintenant pourquoi Diogène avait un tonneau. Il le
remplissait d'eau & se mettait froidement dedans. »

Gérard
HILPIPRE : Résonances nocturnes. Trois
esquisses pour orchestre à cordes. Difficile. Delatour : DLT2548.
Ecrites dans un langage atonal, ces esquisses
s'opposent par leur caractère. Un « Vivacissimo impalpabile » est
encadré par un « Lento, misterioso » et un « Molto
tranquillo ». Tout se trouve dans la recherche des couleurs et une
atmosphère mystérieuse traversée de fulgurances. Très courtes, elles ont aussi
un objet pédagogique puis qu'elles ont été composées pour un orchestre d'élèves
de Conservatoire. Elles peuvent ainsi constituer une excellente initiation à la
musique contemporaine.

ORATORIO
G.F.
HAENDEL : Te Deum for the
Victory of the Battle of Dettingen. HWV 283. Urtext. Bärenreiter : BA
10706. Chant et piano : BA 10706-90.
Le 27 Juin 1743 l'armée britannique et ses
alliés, sous le commandement du roi George II et de Lord Stair, ont vaincu
l'armée française à la bataille de Dettingen. Au retour du roi, un jour
d'action de grâces est proclamé et Haendel, à cette époque "Compositeur de
Musique de la chapelle royale," a été chargé d'écrire un Te Deum et un
hymne (« Le roi se réjouira ») pour cette occasion. Composé entre les 17
et 29 Juillet 1743, le Te Deum est exécuté pour la première fois le 27 Novembre
de la même année à la chapelle royale du palais de Saint-James, à Londres, en
présence de George II. Cette œuvre tout à fait intéressante pour chœur,
solistes et orchestre, et qui dure environ quarante minutes est remarquablement
éditée tant pour la partition d'orchestre que pour la version voix et piano. On
lira avec profit la copieuse préface d'Amanda Babington.

Georg
Philipp TELEMANN : Der Tod Jesu. TVWV
5:6. Urtext. Bärenreiter : Piano et chant : BA5853-90.
Bien que cette œuvre soit très imprégnée de
la liturgie luthérienne, nous sommes loin des passions de Bach. C'est plus à
une méditation sur la mort de Jésus que nous sommes invités dans cette œuvre
monumentale qui ne dure pas moins d'une heure et quart. Chœurs, orchestre et
solistes font succéder chorals, chœurs, récitatifs et arias da capo.

Daniel
Blackstone.
ORGUE
& INSTRUMENT AD LIBITUM
Carsten
KLOMP : Organ
plus one. Loben und Danken. Taufe und Trauung, Kassel, Baerenreiter
(www.baerenreiter.com ), 2016, Réf. BA 8505. VI - 64 p. (+ 4
cahiers séparés pour les instruments (16
p. chacun) - 18, 50 €.
La mention « plus one » se réfère aux 4 cahiers
joints destinés à des instruments divers (en ut) et transpositeurs (en si b,
mi b et fa), par exemple violon, flûte, hautbois ; cor,
trompette… dont la ligne mélodique plane au-dessus de l'orgue : ce qui
représente « un plus »
exploitable pour des concerts ou pour rehausser un service dominical avec
des objectifs liturgiques précis: louange et reconnaissance ;
baptêmes et mariages.
Le premier volet
propose des œuvres non liées à un cantus firmus de choral, notamment : le Prélude et Fugue en Fa majeur jadis
attribué à J. S. Bach (d'après BWV 556), le Concerto
en La majeur de Max Philipp Zeyhold, la Fugue
en Do majeur de John Alcock, le Prélude
en Fa majeur de Christlieb Siegmund Binder et la Fanfare en Ré majeur de Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881), entre
autres. Le second volet présente des pièces associées à des chorals luthériens
(cf. Index, p. 64), reposant sur des
mélodies bien connues : Allein Gott in
der Höh' sei Ehr' (Gloria ; Nikolaus Decius, 1523) ; Ich bin getauft in deinem Namen (baptême ;
sur la mélodie de O dass ich tausend
Zungen hätte) ; Was Gott tut das
ist wohlgetan (sur la mélodie de Severus Gastorius, 1675)...
Les organistes
découvriront des chorals exploités par Georg Friedrich Kaufmann (1679-1735),
arrangés par C. Klomp et — plus proches de nous — Carl Piutti (1846-1903), Karl
Hoyer (1891-1936) et les accompagnements fonctionnels (Begleitsatz) de l'éditeur, également auteur du Prélude à la française sur le Choral Lobet den Herren alle die ihn ehren (sur le texte de Paul Gerhardt,
1653, et la mélodie de Johann Crüger, de la même année). Dans une perspective
comparative, les interprètes seront intéressés par certains chorals traités par
deux compositeurs différents ou en deux versions émanant du même auteur.
Les fidèles
retrouveront avec plaisir ces 27 mélodies familières chantées au culte
dominical. Les organistes seront ravis d'interpréter — le dimanche ou lors de
concerts — ces chorals, encore rehaussés par les sonorités d'un instrument ad
libitum. D'ores et déjà, cette précieuse publication organistique, thématique
et fonctionnelle sera hautement appréciée.

Édith Weber.
CHOEUR
MIXTE A CAPPELLA
Philippe MAZÉ : Livre de Prières. Fleurier
(Suisse), Éditions Musicales de la Schola Cantorum (www.schola-editions.com ), SC 8754, 2014, 21 p.
Philippe
Mazé, chef de chœur très remarqué, ayant entre autres été maître de chapelle à
l'Église de la Madeleine (Paris), est un prolifique compositeur de musique
religieuse : Messes — dont
celles pour le Centenaire de la Cathédrale de Monaco et pour le Jubilé de l'An
2000…—, Hymnes, Requiem, Psaumes, Prières et, d'une manière générale, pour
les divers temps liturgiques. Il ne se réclame d'aucune école et sa vaste
expérience est à l'origine de ses œuvres destinées à des chœurs mixtes (voix de
femmes et d'enfants) accompagnés à l'orgue ou au piano : ce qui multiplie
les possibilités d'interprétation. Elles restent accessibles aux jeunes
chanteurs, aux fidèles et aux mélomanes lors d'offices ou de concerts, et
s'imposent par leur intériorité.
Son Livre de Prières pour chœur mixte à
quatre voix a cappella en comportent sept sur des textes latins bien connus,
dont certains d'origine biblique (Psaume
102, 10 ; Cantique de Siméon…). Il s'agit de
prières d'intercession, d'invocation mariale, de supplication, d'action de
grâce, d'allégresse et de louange comportant la Doxologie trinitaire. Ces
brèves Prières sont vraiment traitées
pour les voix avec un remarquable sens de l'adéquation entre prosodie verbale
et prosodie musicale, d'une belle facture mélodique et une harmonisation assez
classique, comprenant quelques dissonances à finalité expressive et de très
précises oppositions de nuances.
À noter,
entre autres : l'Alleluia à 5
voix, avec Soprano soliste dialoguant avec les 4 voix du chœur, tout en
souplesse, puis une seconde voix d'Alto pour aboutir à l'Amen à 6 voix posant un point d'orgue ppp sur l'Alleluia
vocalisé, suivi de la Doxologie à 4 voix mp,
puis piu lento pp pour l'Amen.

Édith Weber.
CHOEUR A TROIS VOIX EGALES (FEMMES OU ENFANTS) ET PIANO OU ORGUE
Philippe MAZÉ : Deux Hymnes Ambrosiennes. 1.
Hymne du matin 2. Hymne
du soir. Fleurier (Suisse), Éditions Musicales de la Schola Cantorum
(www.schola-editions.com), SC 8767, 2016, 13 p.
Philippe
Mazé possède le sens de la musique religieuse liturgique respectueuse de la
tradition et de son exploitation fonctionnelle au service des célébrations.
Fidèle à la tradition multiséculaire, il traite des textes latins bien connus,
par exemple de Saint Ambroise (né vers 340, mort en 397), Évêque de Milan,
considéré comme l'un des quatre Pères de l'Église.
L'Hymne
du matin (pour l'Office de Prime) : Jam lucis orto sidere pour 3 voix égales de femmes ou d'enfants
accompagnées à l'orgue ou au piano est parfaitement réalisable pour cette
formation sur le plan pratique. Après une introduction (Poco Andante) bercée par des triolets de croches omniprésents, les
voix procèdent par entrées successives sur une basse (pédale) avec des passages
en style note contre note homorythmique et homosyllabique pour une meilleure
compréhension des paroles conclusives.
L'Hymne
du soir (pour l'Office des Complies) : Te
lucis ante terminum, moins développée, nécessite, pour son accompagnement,
une bonne coordination entre les deux mains. L'ensemble de cette prière
s'élance vers l'aigu et aboutit à l'Amen
en valeurs longues.

Philippe MAZÉ : Deux Hymnes pour tous les jours. 1. Hymne de Grégoire
de Naziance 2. Lucis Creator optime. Fleurier
(Suisse), Éditions Musicales de la Schola Cantorum (www.schola-editions.com ), SC 8768, 2016, 20 p.
Soucieux
des tendances actuelles relatives à la langue vernaculaire, Philippe Mazé
traite aussi des textes en français accessibles à tous, sans pour autant renier
la tradition avec une adaptation française du texte attribué à Grégoire de
Naziance, Père de l'Église mort en 390.
La
proclamation : O toi, l'au-delà de
tout, hymne très développée, se présente comme une prière d'intercession.
L'accompagnement au piano ou à l'orgue (« On laissera l'interprète libre
pour le pédalier et la registration ») contient des octaves parallèles
syncopées ; la facture vocale mélodique est dotée de nombreuses
altérations. La dernière partie Andante
— avec traits de doubles croches au clavier et allègement des voix d'abord à
découvert, puis en style note contre note — aboutit à une longue pédale aux
voix et au rappel des octaves syncopées dans l'accompagnement. L'ensemble se
déroule dans un mouvement lent et méditatif.
La
partition comprend encore l'Hymne bien connue Lucis Creator optime commençant dans la douceur, sous-tendue par
des traits de croches (par 3) avec entrées successives des voix, changements de
mesures, accords parallèles pour terminer en force cette page qui s'inscrit
dans la liturgie catholique de Pentecôte, sur un texte traditionnel traité avec
une dynamique très subtile et dans l'idiome musical de notre temps.

Édith Weber.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Hervé
LACOMBE et Nicolas SOUTHON (dir.) : Fortune de Francis
POULENC. Diffusion, interprétation, réception. Rennes, Presses
Universitaires de Rennes (www.pur-editions.fr ), 2016, 301 p. – 22 €.
Grâce aux efforts
inlassables de Simon Basinger, rédacteur-en-chef des Cahiers Francis Poulenc et aux recherches musicologiques
spécialisées, l'œuvre de Francis Poulenc (1899-1963) et plus particulièrement
ses sources, son esthétique et son langage sont mieux connus des mélomanes et
de ses admirateurs. En revanche, comme le soulignent Hervé Lacombe et Nicolas Southon, il manquait encore une réflexion sur le succès de
son œuvre très appréciée au XXe siècle et « son devenir » actuel.
La première partie
concerne la réception ; la
deuxième, les problèmes d'interprétation ;
la troisième, plus ciblée, son chef-d'œuvre : Le dialogue des Carmélites ; la quatrième
dégage ses affinités
littéraires et musicales ; la cinquième replace Poulenc dans l'histoire de la musique, à partir des
Années Vingt. La conclusion situe son œuvre par rapport à la musique savante,
mais aussi au jazz et à la chanson entre 1922 et 2012 et, finalement, évoque
son influence sur les compositeurs de tous horizons et leur réappropriation de
son langage.
Les 17 auteurs
cosmopolites (Angleterre, Japon, Italie, France) qui sont des universitaires de
formation (musicologie, histoire, littérature, philosophie, mise en scène,
bibliothéconomie…) ont réussi à cerner le succès de Francis Poulenc : de
l'Espagne au Japon, d'Outre-Rhin à Strasbourg et même au Met… ou encore sous
l'Occupation. Ils ont ainsi signé une large contribution à l'histoire de la réception et au destin jusqu'au XXIe siècle de l'œuvre
de cet éminent compositeur français.

Édith Weber.
Pascal
GRESSET (éd.) : Tempo
Flûte. Paris, Revue de l'Association d'Histoire de la Flûte
française (www.tempoflute.com ; tempo@live.fr ; 7, rue Louis Pasteur 95777 Saint-Clair-sur-Epte),
numéro 14, second semestre
2016 (parution juin 2016), 68 p.
11, 80
€ (+ frais de port).
Fidèle à ses
rubriques habituelles, cette revue axée sur la flûte privilégie l'aspect
technique, les expériences pédagogiques actuelles, les œuvres conçues pour cet
instrument, mais aussi sa facture à propos des « Flûtes Parmenon », et des témoignages par le biais d'un
entretien réalisé par Pascal Gresset, directeur de cette publication.
Au fil des pages de
ce numéro très bien présenté et judicieusement illustré, les lecteurs
découvriront l'activité (depuis 2014) de Philippe Bernold
au poste de professeur de flûte au CNSMDP, ses partis pris dans la mouvance de
John Eliot Gardiner, son approche personnelle de la musique baroque, ses choix
discographiques mais aussi didactiques et même administratifs (organisation des
Conservatoires). Les lecteurs auront l'impression d'assister à « une
classe de maître » au Conservatoire de Genève, de mieux comprendre les
thèmes abordés (son, legato, coup de langue, intervalles, qualités et palette
sonore, problème d'accord…).
L'attention est aussi
attirée sur l'apport pédagogique et artistique de Marie Corselis
dont l'ouvrage : Enseigner la
musique comme un art (Lyon, Symétrie, 2012) est particulièrement
instructif, et l'auteur, très appréciée au Conservatoire de Genève. L'article
plus technique est dévolu aux « Flûtes Parmenon »,
instruments haut de gamme, par le biais d'un très ponctuel entretien avec les
facteurs, à l'initiative de Pascal Gresset (fabrication, modèles différents,
sertissage, entretien des instruments, y compris les étuis, et même « la
flûte à gauche »), assorti de nombreuses illustrations et de témoignages
de flûtistes connus et du restaurateur Guy Colin, ainsi que de souvenirs
concernant Aurèle Nicolet, Marcel Moyse,
Michel Debost, René Le Roy, entre autres…
Cette Revue
spécialisée est complétée par de précieuses informations relatives aux disques
et partitions récentes qui seront très utiles aux enseignants, interprètes,
mélomanes et discophiles. Ils apprécieront à plus d'un titre cette publication
tout à l'honneur de l'Association d'histoire de la flûte française.

Édith Weber.
Pierre GERVASONI : Henri Dutilleux. Actes Sud/Philharmonie de Paris. 1 vol. 2016, 1768 p. 49€.
Disons-le d'emblée, au delà
de toute critique, il
faut d'abord s'incliner devant ce qui constitue une somme impressionnante.
Aucun détail relatif à Henri Dutilleux n'a échappé à l'auteur, Pierre Gervasoni, et ce sous le regard bienveillant du compositeur
et après sa disparition grâce à l'accès de ses archives autorisé par la
famille. Mais à trop détailler, on perd peut-être l'essentiel : avoir des
clés pour appréhender la musique du maître dans toutes ses dimensions. Sans
doute l'entreprise de Gervasoni permet-elle d'entrer
dans l'intimité du compositeur ; parfois on a l'impression de feuilleter
l'agenda du maître dans lequel auraient été consignés tous les faits et gestes
de la vie quotidienne. Il s'ensuit certains détails n'apportant guère
d'éclairage particulier sur sa personnalité, tel cet exemple loin
d'être isolé: « Le lendemain la Fiat 124 récemment vidangée, graissée et
lavée prend la direction de la Suisse ; à 13 heures 30, elle fait une
halte à Dole, dans le Jura, pour que son conducteur assoiffé, affamé et fatigué
recharge ses batteries » (p.1069). Ce qui alourdit l'ouvrage aussi, c'est
l'abondance de citations dans le corps même du texte. Certes, ce sont souvent
des extraits importants de courriers ou de critiques des auditions des œuvres
de Dutilleux, mais on les aurait plutôt lues en note soit de bas de pages soit
de fin de volume. Un autre regret que l'on peut avoir c'est l'absence totale
d'iconographie avec à la place - ce qui est frustrant - de longues descriptions
de photographies! On aurait par ailleurs apprécié avoir
une liste des compositions du maître, non par ordre alphabétique mais par ordre
chronologique de présentation au public en première audition. En revanche, au
cours des longs développements on a une vision très intéressante de la vie
musicale en France, mais aussi dans un certain nombre de pays comme les
États-Unis, l'URSS. Bien évidemment de nombreux passages de ce livre aident à
mieux cerner la personnalité d'Henri Dutilleux et à corriger quelques
appréciations erronées ; il en est ainsi d'une prétendue attitude
critiquable de sa part
pendant l'Occupation, ainsi que d'une prétendue grande lenteur
dans l'écriture de ses compositions.
A propos de l'attitude de Dutilleux pendant
la guerre, on se souvient qu'après son décès il a été question de placer une
plaque sur la façade de l'immeuble de l'Ile Saint Louis où il vécut avec son
épouse Geneviève Joy. Durant des semaines la ville de Paris a reculé l'échéance
de la cérémonie sous prétexte d'un supposé « fait de collaboration »
pointé par le Comité d'Histoire de la Ville de Paris. Il s'agissait de la
composition d'une musique accompagnant un film dit de propagande ; en fait un
documentaire à la gloire du sport, « Forces sur le Stade » (p 284).
C'était oublier son attitude exemplaire pendant la guerre comme en témoigne le
mot « LA HONTE » écrit de sa main sur la déclaration sur l'honneur
dont le modèle fourni par la Sacem attestait de son
aryanité et qu'il avait été contraint de signer (p.249). Et Gervasoni
de rappeler que le jeune compositeur était inscrit au Front National depuis le
1er novembre 1943 (p.349). Front National qui, faut-il le redire, était un
mouvement de résistance fondé par le Parti Communiste dans un esprit
d'ouverture.
Quant à la « lenteur » d'écriture
elle serait illustrée par un catalogue assez mince. En fait il faut en rendre
responsable les charges extrêmement nombreuses que le musicien a
assumées : depuis le poste très prenant de chef du service des
illustrations musicales à la radio nationale en passant par des commissions chargées
de redéfinir la politique musicale en France ainsi que de nombreux jurys de
concours, preuve de son engagement citoyen, de son ouverture d'esprit
exceptionnelle. Gervasoni expose très bien cette
caractéristique de la personnalité de Dutilleux. Ainsi souligne-t-il l'extrême
curiosité du maître aussi bien en matière littéraire - le choix des poètes mis
en musique le prouve -, en peinture et bien sûr en musique ; ainsi est-il
de ces compositeurs soucieux d'assister aux concerts de ses confrères même éloignés
de son esthétique : ne fait-il pas une incursion d'une journée à Rouen au
printemps 1971 pour assister à une représentation du rare Ulysse de
Luigi Dallapicolla (p.920)!
On le voit aussi au Palais des Congrès de la Porte Maillot assister en 1974 à
l'audition de Inori de Karlheinz
Stockhausen (p.1004). Ainsi grâce à ce que nous en rapporte Gervasoni,
a-t-on une description très complète de la richesse de la vie musicale en
France sur plusieurs décennies.

DR
Ce livre est aussi l'occasion de portraits
émouvants comme celui du directeur de l'école de musique de Douai, Victor
Gallois, de Henri Büsser, des chefs d'orchestre Roger
Désormière, Charles Münch..... Sont évoquées les
profondes amitiés avec Irène Joachim, André Jolivet, Edison Denisov
lequel vouait à Dutilleux une admiration totale. Les relations étroites avec Mtislav Rostropovitch sont aussi longuement décrites. Très
étonnante est la description du cheminement sur près de 10 ans des Métaboles,
avec l'infinie patience de Georg Szell. Ce livre est
aussi l'occasion de s'arrêter sur des noms que l'histoire de la musique ne
devrait pas oublier comme celui du chef hongrois Ferencs
Fricsay, de la pianiste Monique de la Bruchollerie, des compositeurs - disciples de
Dutilleux- Francis Bayer et Jean Louis Florentz. Bien évidemment Geneviève Joy est omniprésente
dans cette biographie : sa carrière est abondamment évoquée, ce qui n'est
que justice. Deux découvertes pour le signataire de ces lignes. Tout d'abord le
nom et par voie de conséquence l'œuvre puissante d'un compositeur soviétique,
Andreï Eshpaï, évoqué par Dutilleux dans une
correspondance adressée à Denisov (p.1204). Ensuite
la relation avec Pierre Boulez très loin d'être fondée sur l'ignorance
réciproque. Voici ce que celui-ci lui écrit en 1999 « Je voulais vous
redire ce que nous avons évoqué dans notre conversation : si vous désirez
écrire pour l'Ensemble Intercontemporain, vous serez
le bienvenu. La formation que vous désirez sera votre décision.... »
(p.1475).
Malgré ses défauts, cette biographie trop
foisonnante permet d'avoir l'image d'une vie culturelle servie par un grand
humaniste, compositeur essentiel du siècle passé et du début de l'actuel,
admiré par les plus grands interprètes que la disparition du maître a pu
profondément bouleverser comme ce fut le cas pour Barbara Hannigan :
lisons ce qu'écrit Gervasoni en évoquant - avec
grande pudeur - les derniers jours du compositeur : « Barbara Hannigan se rend à l'hopital
Broca... Elle est accompagnée d'Anssi Kartunen et de Simon Rattle.
Henri Dutilleux n'aura pas entendu la voix de ses Correspondances
enflammer le public mais c'est tout comme... Ce que lui dit Barbara suffit à
lui réchauffer le cœur. » (p.1590). Voici un ouvrage utile qui mérite
d'être consulté tant les informations de première main sont abondantes.

Gilles Ribardière.
Jérôme ROSSI (dir.
scientifique) : LA MUSIQUE DE FILM EN FRANCE Courants, spécificités,
évolutions. 1 vol. 17x24 cm. Édition Symétrie, collection Recherche, Série
20-21, 2016, 470 pages, 45€.
Voilà un ouvrage « somme », écrit à
plusieurs voix, et lisible ! Quel plaisir de voir que de nombreux mémoires
ou thèses paraissent aujourd'hui sur la musique à l'image. Découpé en trois
gros chapitres : « Les Pionniers » (1930-1960), « Nouvelles
Vagues » (1960-1970), « Tendances Contemporaines » (1970 à
aujourd'hui) et agrémenté de quelques entretiens avec des compositeurs, une
vingtaine de chercheurs se sont penchés sur cet art mal aimé qu'est la
composition pour le cinéma. Après une préface de Gilles Mouëllic
- interviewé pour le site sur Jazz et musique de film – et une introduction
fort bien documentée de Jérôme Rossi, les textes traitent soit de courants soit
de compositeurs. Bien rédigés, précis, ils remettent à l'honneur les musiques
des pionniers si souvent décriées - Honegger, Ibert, Auric, Manuel, Milhaud, et
un bel entretien d'Henri Dutilleux de Stéphane Chanudeau
-, analysent la
musique des cinéastes de la nouvelle vague (pas plus innovante que leurs
prédécesseurs) ainsi que les musiques d'aujourd'hui avec les difficultés qui
existent à composer dans ce genre spécifique. Quelques films sont étudiés plus
concrètement musicalement – ces mémoires sont plus difficiles à suivre sans la
présence de la musique, des scènes citées ou si l'on n'a pas une culture musicale
plus poussée – : Kosma et la « Grande
Illusion », Delerue et « Vivement
Dimanche », Rombi et « Swimming Pool », Rivette et
l'emploi de la musique contemporaine. Les nombreux entretiens sont passionnants
à lire (Duhamel, Demarsan, Colombier, Cosma). Il faudrait citer tous les talentueux chercheurs
qui ont participé à cet ouvrage. Un index des personnes et un index des œuvres
le complètent. C'est un livre que l'on peut feuilleter selon ses humeurs et
selon ce qu'on veut découvrir. Depuis ceux de François Porcile
et d'Alain Lacombe on
n'avait pas eu entre les mains un ouvrage aussi intéressant. Tous
les amateurs de musique de film, ou de musique tout court, devraient se le
procurer.

Stéphane Loison.
***
LE BAC DU DISQUAIRE
Heinrich ISAAC : Missa Virgo prudentissima. Ensemble Gilles Binchois, dir.
Dominique Vellard.
1CD ÉVIDENCE (www.evidenceclassics.com): EVD023 : TT : 64' 50.
Heinrich
Isaac, vraisemblablement originaire des Flandres, est né vers 1450 et mort en
1517 à Florence. Sa production se situe entre le XVe et le XVIe siècle ;
elle comprend des Messes, dont certaines reposent sur des cantus firmus de mélodies grégoriennes ou profanes. Ses œuvres se
rattachent en principe à l'esthétique franco-flamande. Il est l'auteur du
recueil Choralis Constantinus
destinée à la Cathédrale de Constance, terminé en 1529, regroupant des pièces
pour l'Office et les grandes Fêtes. Il préconise l'écriture de 4 à 6 voix et un
contrepoint élaboré. Il est aussi célèbre par ses Chansons (Tenorlied), par exemple : Innsbruck, ich muss dich lassen
(Innsbruck, je dois te quitter).
Il a été chanteur, compositeur, maître de chapelle, et — selon l'usage de
l'époque — a séjourné en Italie. Au cours de son voyage, il s'est arrêté à
Innsbruck et, en 1497, est nommé Compositeur de la Cour de l'Empereur
Maximilien Ier. Ensuite, il sera au service de Laurent le Magnifique et, avec
le retour des Médicis au pouvoir, devient Presidente della Cappella et séjourne alors en
Italie, avec l'accord de Maximilien Ier. Il meurt à Florence, le 26 mars 1517.
Le disque s'ouvre sur le Motet à 6
voix : Gaudeamus omnes
in Domino (dédié précisément à l'Empereur), associé au plain-chant Virgo Prudentissima (antienne
de l'Assomption) qui, dans la Messe
éponyme, servira d'ailleurs de fondement au Kyrie
et au Gloria. L'Ensemble Gilles
Binchois est dirigé depuis 1979 avec autorité par Dominique Vellard,
remarquable chef, compositeur, musicologue et professeur. Ils ont à leur actif
une quarantaine de disques qui s'imposent par leur somptueux paysage vocal,
leur justesse extrême et la profondeur de l'expression très intériorisée.

Édith
Weber.
Johannes BRAHMS : Symphonies
3 & 4. Orchestre d'État de Francfort, dir.
Howard Griffiths. 1CD KLANGLOGO (RONDEAU PRODUCTION www.rondeau.de): KL 1514 . TT : 71'47.
Un chef anglais, Howard Griffiths, formé au
Royal College of Music, à la tête d'un Orchestre allemand, le Bradenburgisches
Staatsorchester (à Francfort et enregistré dans cette
ville en 2015) et une farouche volonté
de faire re-découvrir deux Symphonies de Johannes Brahms (1833-1897) selon les critères de la pratique musicale historique :
telle pourrait être la carte d'identité de cette réalisation discographique et
actuelle, et résumer les particularités de cet enregistrement. Ces deux Symphonies sont dirigées et restituées
par ce chef de réputation internationale.
Le compositeur a
élaboré ses 4 Symphonies entre 1876
et 1885. Il a souhaité émanciper le concept de symphonie après Beethoven, mais
pas au sens de Franz Liszt, elles se situent dans le sillage de la forme sonate
et nécessitent un orchestre puissant. Il a placé les instruments comme à
l'époque de Brahms, tenu compte des préoccupations du chef d'alors, Fritz Steinbach et de la dernière édition de l'Urtext.
La Symphonie n°3 (op. 90), en fa Majeur, créée en décembre 1883, a
immédiatement connu un grand succès aussi bien en Europe qu'aux États-Unis.
Elle est structurée en 4 mouvements : 1. Allegro con brio de caractère héroïque et majestueux, faisant appel
à des modulations inattendues ; 2. Andante
plus serein, avec discrets rappels du premier thème de l'Allegro ; 3. Poco Allegretto plus langoureux et douloureux, avec reprise du
thème principal, et un grand souci de diversification des coloris et timbres de
l'orchestre ; 4. Allegro,
d'abord inquiet, aboutissant à un fortissimo
mais, vers la fin, l'indication poco
sostenuto débouche sur une conclusion pianissimo,
calme, majestueuse et méditative.
La Symphonie n°4 (op. 98), en mi mineur, composée en 1884 et 1885, a
été créée par le compositeur en 1885. Le premier mouvement : Allegro non troppo
avec un thème aux violons et un signal d'appel réitéré caractéristique, de
construction symétrique, se termine par une coda assez sombre contrastant avec
l'Andante moderato avec un thème
confié aux cors aboutissant à une coda avec quelques roulements de timbales et
le rappel du premier thème. L'Allegro
giocoso s'apparente à un scherzo avec un thème énergique, un rythme
caractéristique de fanfare contrastant avec le second thème plus lyrique aux
accents populaires, puis enrichi des sonorités complémentaires des contrebasson, triangle et piccolo. L'Allegro energico e
passionato se rattache à l'esthétique
préclassique avec chaconne et variations. Cette Symphonie est certainement la
plus appréciée des quatre.
L'Orchestre d'État de
Francfort et son chef, Howard Griffiths, se distinguent par leurs efforts
d'authenticité, de fidélité aux critères d'époque, par leur expressivité
—sentimentale mais non ampoulée — dans les mouvements lents, par les nuances
minutieusement étudiées. Tout en s'appuyant sur la tradition symphonique,
Brahms fait preuve d'un souci d'innovation. Les interprètes proposent un
« Brahms autrement », conformément à une recherche de la pratique
musicale historique.

Édith
Weber.
Louis VIERNE (1870-1937) : Cycle
Spleens et Détresses op. 38 - Piano Quintet op. 42. Anaïk Morel, mezzo-soprano, Muza Rubackyté, piano. Terpsycordes Quartet.
1CD FAZIOLI : CD 95367. TT : 66'56.
Le nom de Louis
Vierne évoque immédiatement l'organiste de Notre-Dame, son esthétique et
l'orgue symphonique ou, par exemple, sa célèbre Toccata (1912). Ses goûts littéraires semblent moins connus du
grand public, pourtant, il a mis en musique en 1917 le Cycle Spleens et Détresses (op. 38) sur des
poèmes de Paul Verlaine (1844-1896). Le compositeur a sélectionné des titres
évocateurs (Ennui, Sommeil, Spleen) ou descriptifs et des atmosphères particulières (Le son du cor, si cher aux romantiques).
Les mélodies sont interprétées par Anaïk Morel
(Mezzo-Soprano) — née à Lyon, diplômée du Conservatoire National Supérieur de
Musique de cette ville et titulaire de nombreuses distinctions, soliste
internationale —, elle est accompagnée au piano (Fazioli)
par la pianiste lituano-française Muza
Rubackyté. Dès les premières mesures, la voix
lyrique, bénéficiant d'une large tessiture, traduit le vague à l'âme et l'ennui
(1), évoque le Grand sommeil noir (2)
ou encore le spleen (3) conformément
au titre du disque. D'autres brefs poèmes cèdent la place au sentiment amoureux
(4), puis aux effusions lyriques (5), animées (6), quelque peu énigmatiques (9)
et, enfin, le poème Marine (10), plus
mouvementé et plein d'élan, fait appel à la virtuosité des deux interprètes.
Quant à la pianiste, elle soutient la voix, assure des transitions, crée le
climat requis par chaque poème ; avec Anaïk
Morel, elles forment un duo équilibré qui s'impose par sa musicalité.
Composé
également en 1917, le Piano Quintet (op.
42) est structuré en trois mouvements contrastés : Poco lento-Moderato ; Larghetto
sostenuto ; Maestoso-Allegro
molto risoluto. Ils sont interprétés par le Terpsycordes Quartet, fondé en 1997, résidant à Genève.
Composé de Girolamo Bottiglieri (premier violon),
Raya Raytcheva (second violon), Caroline Cohen-Adad (alto), François Grin
(violoncelle), il se produit lors de Festivals dans le monde entier et est ici
associé à la pianiste Muza Rubackyté.
L'enregistrement effectué au Fazioli Concert Hall à Sacile (Italie) restitue avec finesse une riche palette
émotionnelle admirablement renforcée par les protagonistes.
Sortant
des sentiers battus, cette production discographique projette un éclairage peu
connu sur la production de Louis Vierne certes sensible à la musique liturgique
pour orgue, mais aussi à des chefs d'œuvre de la poésie française et à la
musique de chambre. Incontestablement : une découverte.

Édith
Weber.
Léonce de SAINT-MARTIN : Œuvres
pour orgue, Vol. 1. Anthony Hammond, orgue. 1CD IFO Classics (www.ifo-classics.com) : ORG 7258.2. TT : 74' 35.
Le Label IFO Classics inaugure une Série d'enregistrements consacrée aux
œuvres pour orgue de Léonce de Saint-Martin (1888-1954), organiste talentueux
et compositeur prolifique de musique religieuse, dont les récitals à Notre-Dame
de Paris ont, chaque dimanche en fin d'après-midi, attiré tant d'auditeurs
fidèles. Toutefois, pour ce premier volume, Anthony Hammond a retenu, non pas
l'Orgue Aristide Cavaillé-Coll pour lequel Léonce de Saint-Martin a pensé ses
œuvres, mais l'instrument du même facteur (1845-1846) à l'Église de La
Madeleine, revu successivement par Mutin (1927), Roethinger-Boisseau
(1956), Danion-Gonzalès (1971) et Bernard Dargassies (2001). Il possède 4 claviers : Grand
Orgue, Positif, Bombarde, Récit expressif et Pédale et, en outre, des pédales
de combinaison. L'excellent organiste, élève de Roger Fisher, David Briggs et
Naji Hakim, est aussi l'auteur d'une Thèse de Doctorat consacrée à Pierre
Cochereau dont il a d'ailleurs reconstitué des Improvisations. Spécialiste de l'Orgue symphonique (fin XIXe-début
XXe siècle), il a élaboré un programme typique mettant en valeur les différents
aspects de l'inspiration de Léonce de Saint-Martin, également sensible aux
faits d'actualité. C'est le cas de sa majestueuse et triomphante Toccata de la Libération (op. 37), œuvre
de circonstance réalisée à Paris en août 1944. Ce disque comprend aussi la Pastorale (op. 35), écrite pendant la
Seconde Guerre mondiale ; la Suite
cyclique en quatre parties : Prélude,
Fugue, Cantilène, Carillon et
son intéressante Paraphrase du Psaume 136, « Super flumina Babylonis »
(op. 15), datant de 1932, en quatre parties avec des titres conformes au
contenu du Psaume, quelque peu à la manière d'une « musique à
programme » : Tristesse des Hébreux
captifs de Babylone (1) traduisant leur situation dramatique ; Lamentation au souvenir de Jérusalem (2)
exprimant leurs regrets et contrastant avec Babylone
la Superbe (3) et, enfin, leur
ressentiment : Les Hébreux
maudissent leurs vainqueurs (4). L'enregistrement s'achève par sa Symphonie Dominicale (op. 39) : Prélude, Aria, Fantaisie-Choral, Prière et Postlude, composée après la Guerre entre 1946 et 1948 et avant la
réforme liturgique de Vatican II, car Léonce de Saint-Martin souhaitait
compléter la messe basse (missa lecta) par un concert : d'où cette symphonie dont
le Prélude correspond au Kyrie ; la Fantaisie-Choral, au Benedictus et le Postlude, à la Sortie animée.
Ce premier Volume, à
l'heureuse initiative de l'Association Les Amis de Léonce de Saint-Martin, est
très prometteur. Il illustre les différentes facettes de son esthétique se
situant, en fait, dans la mouvance du Postromantisme et de César Franck très
admiré par Léonce de Saint-Martin. Dans l'attente du second Volume…

Édith Weber.
Erik FELLER : Gregorian Orchestra.
Chœur grégorien de Paris, dir. Xavier Chancerelle. 1CD DOM (www.disquesdom.com) : DOM 1254. TT : 52'48.
Erik Feller, pianiste, organiste et compositeur, ayant effectué
ses études notamment auprès de Francis Chapelet, André Isoir,
Pierre Cochereau…, collabore avec de nombreuses chaînes de télévision en France
et à l'étranger. Depuis 1994, il a composé environ une centaine d'œuvres :
musiques symphoniques, musiques symphoniques avec chœur, musiques de ballet et
électroacoustiques. Il est aussi orchestrateur et, d'une manière générale,
spécialisé dans la musique de film et la musique contemporaine.
Le titre si original
de son nouvel album : Gregorian Orchestra
pourrait surprendre. En fait, Erik Feller précise
qu'il a « utilisé le chant grégorien comme une source sonore
d'esthétique forte, qui vient dialoguer et se fondre avec l'orchestre, ce
dernier portant à lui seul cette cargaison visuelle, cinématographique. Chacun
peut y voir ce qu'il veut, c'est
le but, la musique est ici volonté d'un voyage fantastique, seul a prédominé un
souci d'esthétique et d'imaginaire ».
Le compositeur fait
appel à un orchestre symphonique, à 5 membres du Chœur Grégorien (de Paris) et
à un support informatique. Les différentes parties sont dotées de titres
familiers : Kyrie (IV, XVII), Pange lingua, Ave Maris Stella, Ubi caritas, entre autres.
Suivent le répons pour la Semaine Sainte : Potum Meum et la Messe de Requiem selon la structure habituelle : Requiem, Kyrie, Dies Irae, Sanctus, Agnus. Les mélomanes retrouveront donc des références liturgiques
et constateront la préoccupation de grandeur, mais aussi l'effet de surprise.
Certains puristes
s'étonneront peut-être de cette juxtaposition d'un orchestre puissant et coloré
estompant quelque peu des voix d'hommes. Selon le regretté Marc Honegger,
Erik Feller privilégie « le sens des vastes
espaces, des architectures monumentales ». Ces pièces brèves font preuve
d'une grande curiosité artistique et de l'exploitation du langage de notre
temps, pourtant associé au chant grégorien multiséculaire mais décontextualisé.
La Messe de Requiem (plages 10-14)
est plus recueillie, intériorisée ; elle contraste ainsi avec le tumulte
des œuvres précédentes. Véritable prouesse : Erik Feller
non seulement dirige le chœur et l'orchestre, mais encore assure la partie
informatique.
À écouter certes avec
une indispensable curiosité, à réécouter pour mieux cerner les multiples
objectifs esthétiques et émotionnels du compositeur et apprécier sa musique
délibérément du XXIe siècle, pour, finalement, constater que c'est bien le
« chant grégorien dans un univers cinématographique ». Pari soutenu
par un compositeur et chef d'une incontestable profusion et générosité.

Édith
Weber.
Frédéric CHOPIN : Polonia. Polonaises
op. 26, 40, 44, 53. Polonaise-Fantaisie op.
61. Pascal Amoyel, piano. 1CD LA DOLCE VOLTA (www.ladolcevolta.com): LDV 25. TT : 63'32.
Pascal Amoyel rappelle : « Lorsque j'étais enfant, vers
6, 7 ans, j'essayais de reproduire d'oreille les musiques que j'entendais et
Chopin y figurait en bonne place… lorsque j'ai commencé mes vraies études de
piano à 10 ans, c'est naturellement vers Chopin, mais aussi vers Liszt que je
me suis tourné ». Après son Baccalauréat scientifique, il étudie à l'École
Normale de Musique de Paris, puis au CNSM où il obtient en 1992 les Premiers
Prix de Piano et de Musique de chambre ; il est aussi Lauréat des
Fondations Menuhin et Cziffra, titulaire du Premier Prix du Concours
international des Jeunes Pianistes de Paris et remporte une « Victoire de
la Musique » dans la catégorie « Révélation soliste instrumental
de l'année ». Il se perfectionne également auprès d'Aldo Ciccolini,
Pierre Sankan. Son rayonnement national et
international est considérable.
La Polonaise est une danse lente et
solennelle à trois temps très populaire depuis le XVIIe siècle, employée lors
de processions et de festivités, parfois chantée et provenant de la
musique populaire polonaise rurale, forme empruntée par Jean Sébastien Bach
dans sa Suite française n°6 (BWV
817), puis par son fils Carl Philipp Emanuel dans la
musique de clavecin, également traitée par Telemann, Haydn et Beethoven (Rondo alla Pollaca).
Les nombreuses Polonaises de Frédéric
Chopin (1810-1849) marquent l'apogée du genre et le renouvellement de la forme.
La présentation particulièrement somptueuse, bien illustrée, comporte des
introductions multilingues… Après son inoubliable enregistrement des Nocturnes en 2014, Pascal Amoyel s'attaque aux redoutables Polonaises (op. 26, 40, 44, 53) ainsi qu'à la Polonaise-Fantaisie (op. 61). L'éminent pianiste résume ainsi sa
démarche : « Dans mon imaginaire, les Polonaises de Chopin avec leur ton si affirmatif, leur dimension
narrative, et surtout cet élan qui se marie naturellement à celui qu'on éprouve
en découvrant puis en maîtrisant le piano, devinrent très tôt des buts à
atteindre ». Pour ce disque — réalisé en août 2015 à l'Église luthérienne du
Bon Secours (Paris) —, Pascal Amoyel a judicieusement
sélectionné un Piano Steinway (D 357) qui s'impose par sa palette sonore
exceptionnelle que le musicien exploite, tour à tour, avec élan, brio, envolées
lyriques bien enlevées, énergie ou encore émotion, rêverie… grâce à sa
technique hors pair, son jeu perlé, son toucher délicat, son sens du phrasé et
du rythme, et son intellection de ces pages de Chopin. Pour conclure, la Polonaise-Fantaisie (op. 61), en La b, composée en 1845-1846, œuvre plus
libre en 3 parties : vif-lent-vif,
avec une grande variété mélodique, représente en
quelque sorte la synthèse des autres Polonaises.
Le compositeur fait appel au lyrisme et au caractère exubérant, contrastant
avec la mélodie plus tendre dans le mouvement central Lento, puis à un grand déploiement de force en conclusion.
Incontestablement, les mélomanes se laisseront entraîner et envoûter par ces Polonaises.

Édith Weber.
Antonin DVOŘÁK : Trios pour piano op. 65 & op. 90,
« Dumky ». Busch Trio. 1CD
Alpha : Alpha 238. TT. : 76'.
Le jeune Trio Busch,
formé en 2012, s'est vu rapidement proposer une résidence à la Chapelle
Musicale Reine Élisabeth, un haut lieu de la musique de chambre en Belgique.
Ses trois membres anglais ont travaillé avec l'altiste Miguel Da Silva et le
pianiste András Schiff.
C'est déjà une formation recherchée. Ils projettent d'enregistrer l'intégrale
des trios de Dvořák. Le premier disque propose
les trios N° 3 & 4. L'allegro ma non troppo du
Trio N°3 op. 65 (1883) offre un ton puissant et tragique évoquant quelque
solidité brahmsienne même dans la deuxième section plus fougueuse. Un sentiment
d'urgence parcourt tout le mouvement qui cache à peine une riche mélodie chez
un compositeur ayant déjà à son actif des Danses moraves et des Danses
slaves. L'allegretto grazioso est plus un intermezzo qu'un scherzo,
doucement balancé, un brin mélancolique, mais aussi affirmé dans son obsédante
énergie. Le trio
apporte quelque lyrisme voilé. Le pocco
adagio, qui s'ouvre par une mélodie inspirée du violoncelle, déploie un climat
apaisé. Le discours se fait plus éloquent sans perdre son lyrisme choisi dans
la partie de violon sinueuse. C'est là une réflexion poétique sans épanchement
inutile que les Busch traduisent avec bonheur. Comme
naguère leurs ainés, les Beaux Arts Trio. Au finale
con brio, on pense à quelque danse tchèque, un furiant
par exemple. Mais est-ce bien cela ? Une formulation plus abstraite plutôt, qui
si elle puise dans la veine populaire, le fait par allusion. L'agencement du
mouvement retrouve l'urgence du premier mouvement avec la belle scansion du
piano et des plages de lyrisme comme peu avant la fin rapide.
Le Trio N° 4 op 90 dit '' Dumky trio'' (1890-91) est tout à fait
original dans la production de Dvořák. Ses six
mouvements sont une suite de dumka, une danse
d'origine ukrainienne qui se serait slavisée : une sorte de spleen traversée
d'accès de fièvre, alternance de chants méditatifs et de danses joyeuses, de
brillance et d'intimité. Chaque mouvement alterne ainsi lent et vif. Le lento
maestoso de la première impose un climat déclamatoire avant que la dumka rompe soudainement le discours. La deuxième débute
par une jolie mélopée du cello sur de doux accords du
piano. Le mystère s'installe qui débouche sur une section vivace. Les Busch sont d'une remarquable profondeur jouant à fond les
contrastes. La troisième se signale par son début poétique presque vocal et la
section vivace permet de dénicher quelque inspiration populaire. A la quatrième
s'installe une manière de marche. C'est la plus typique du style syncopé de la Dumka - et un bis favori du Beaux Arts Trio naguère! -, tour à tour retenu et enjoué.
Quelque éloquence distingue la cinquième dont la phase méditative est encore
plus raréfiée qu'ailleurs et la partie rapide plus engagée. La dernière est
dramatique dans son lento initial, extrêmement expressif, tranchant sur un
vivace presque boulé. Les jeunes artistes du Trio Busch
signent là un bien beau disque, au surplus magnifiquement enregistré. Leur
vision, justement, ne cherche pas à solliciter quelque lyrisme facile. On est
frappé au contraire par une retenue de bon aloi et un sens du rythme slave
idoine.

Jean-Pierre Robert.
« France
Espagne ». Emmanuel CHABRIER : España. Jules MASSENET : Suite de Ballet du Cid. Maurice RAVEL : Alborada del gracioso. Claude
DEBUSSY : Iberia. Les Siècles, dir. François-Xavier Roth. 1 CD Musicales Actes Sud : ASM
17.TT.: 51'04.
L'attrait exercé par L'Espagne sur les
musiciens français au tournant des XIX ème et XX ème siècle est fascinant. François-Xavier Roth a voulu en
porter témoignage dans ce disque réunissant Chabrier, Massenet, Ravel et
Debussy. Comment mieux commencer que par la rhapsodie pour orchestre España que Chabrier compose en 1883 :
brillante orchestration, effets d rythmes assurés, enfiévrés dans l'exécution
de Roth et de ses musiciens des Siècles. On connait moins la Suite de ballet
tiré de l'opéra Le Cid. Massenet et l'Espagne, voilà une longue histoire
d'amour, depuis l'opéra Don César de Bazan (1872 ) jusqu'à Don Quichotte (1910), en passant par La
Navarraise (1894) et Le Cid (1884). Il s'inspire ici du folklore
espagnol pour former les sept sections du ballet inscrit au cœur de son opéra,
comme exigé alors par les pratiques de l'Opéra parisien. Des
divers provinces de la péninsule : la Castille avec une
« Castillane » endiablée au son de ses castagnettes, l'Andalousie et
une « Andalouse » dotée d'un rythme de habanera, l'Aragon et une
« Aragonaise » bâtie sur une danse de Jota à trois temps avec tambour
de basque. Après une séquence « Aubade », intermède signalant un joli
morceau de petite flûte, les danses reprennent avec la « Catalane »,
sorte de sardane plus grave, obsédante, la « Madrilène », autre
morceau lent au parfum gitan dont se détachent les arabesques de la flûte et du
cor anglais, et enfin la « Navarraise » qui s'embrase en une
ébouriffante farandole. Ce que Roth transmet là aussi avec passion et moult
couleurs. Conçu d'abord pour piano, en 1906, Alborada
del garcioso sera orchestré
par Ravel en 1918. C'est un bref conte fantastique, le ''gracioso'' étant un
bouffon, le polichinelle de la littérature espagnole des comédies de Calderón et de Lope de Vega. L'exécution offre ici mystère
et retenue (coda), et les vents des instruments dits d'époque apportent une
coloration particulière. Le florilège se conclut par Iberia, volet
central des Images pour orchestre (1905-1908), pièce elle-même
tripartite. Debussy y peint une Espagne rêvée, « imaginée avec une
exactitude incroyable » dira Isaac Albéniz. « Par les rues, par les
chemins » évoque une journée ensoleillée, voilée d'une certaine mélancolie
chez Roth. « Les parfums de la nuit » libèrent les effluves d'une
nuit étouffante, quelque
chose de trouble, de presque inquiétant, que la présente interprétation traduit
à la perfection en retenant le tempo et à travers le soliloque de la flûte. Laissant entrevoir un
lever du jour souhaité mais qui ne vient pas. « Le matin d'un jour de
fête » n'offre cette félicité d'abord que par à coups,
avant que l'atmosphère s'embrase après un amusant crin crin
de violoneux. On admire l'extrême lisibilité du discours et la coloration là
encore singulière qu'apportent les instruments d'époque des Siècles.

Jean-Pierre Robert.
Piotr Ilyich
TCHAIKOVSKI : Quatuor à cordes N° 2 op. 22. Dimitri CHOSTAKOVITCH : Quatuor à
cordes N° 8 op. 110. Deux mouvements de Quatuors. Quatuor David Oistrakh. 1CD Muso : MU-011. TT.: 65'21.
Il est réconfortant et symptomatique que de
jeunes interprètes chambristes s'approprient le nom de leurs grands maîtres :
le Trio Busch... le Quatuor Oistrakh.
Ces quatre russes fort talentueux associent ici Tchaikovski
et Chostakovitch. Le Deuxième Quatuor op. 22 de Tchaikovski
est écrit en 1874, par un musicien de 34 ans très confiant. L'œuvre possède une
grande charge de tension à l'aune de l'adagio initial puissant, libérant vite
un moderato quasi andantino où perce quelque thématique populaire. Les quatre
voix sont très fondues ou développent un savant contrepoint entre violons I
& II et cordes graves. Toute la tension accumulée se relâche à l'extrême
fin. Le scherzo introduit un climat mélodieux qu'on rencontrera si souvent chez
le compositeur, notamment dans ses opéras. La valse du trio, d'une belle
clarté, offre une agréable diversion. Le mouvement lent est un andante d'un
chant profond. La délicatesse d'accent lyrique ne verse pas dans le
démonstratif cependant. Une deuxième section libère quelque tension
sous-jacente comme on le trouvera dans les symphonies, la Quatrième bientôt.
Pour complexe qu'elle soit, la construction est d'une cohérence remarquable. Le
mouvement s'achève dans une fusion des deux tendances. Le finale est engagé,
par un procédé de répétition cher à l'auteur d'Eugène Onéguine. L'exubérance gagne peu à peu jusqu'à une
fugue savante et une péroraison en apothéose. Les Oistrakh
offrent une interprétation extrêmement équilibrée et techniquement accomplie.
Il en va de même de leur vision du Huitième Quatuor de Chostakovitch. De
cette confession unique, ils proposent une exécution puissante, sans
concession, mue par une force intérieure et un extrême ton tragique, outre une
plastique instrumentale remarquable. Le largo est plus sombre que sombre,
effrayant, sorte de requiem intime. L'allegro est anguleux (peut-être plus
encore que chez les Danel - cf. NL de 7/2016), le
motif DSCH comme lacéré. Cela ne connait pas de rémission dans un tempo proche
du presto jusqu'à des cris éperdus dans la partie ultime. Le contraste avec
l'allegretto est intéressant, la valse déconstruite sardonique à l'envi. Le jeu
est acéré sur le motif signature et ne le cède en rien à une manière ironique.
Un travail exceptionnel des Oistrakh sur la sonorité
et la rythmique. Le premier largo libère une énergie effrayante, celle d'une
tragédie effroyable (accords répétés, assénés lourdement). La méditation est
poignante. Le second largo ouvre quelque perspective optimiste peut-être. Le
disque se conclut par Deux Pièces pour quatuor à cordes – qui ne
figurent pas dans l'intégrale des Danel. Datant de
1931, mais publiées en 1983, elles associent une ''Elegy'',
d'après l'opéra Lady Macbeth de Mzensk, alors
en cours de composition (un adagio lyrique traversé de convulsions) et une
''Polka'' tirée du ballet L'Âge d'Or de 1928 (en forme de pizzicattos et à l'humour grinçant... déjà!).
Une formation à suivre de près.

Jean-Pierre Robert.
Isaac ALBÉNIZ : Concerto
pour piano N° 1, op. 78. Rapsodia espaňola, op. 70. Suite extraite de « L'Opale magique ». Suite Espanola. Martin Rescoe,
piano. BBC Philharmonic, dir.
Juanjo Mena. 1CD Chandos : CHAN 10987. TT.: 79'42.
Certes moins connue que ses œuvres pour
piano, la musique d'orchestre d'Isaac Albéniz (1860-1909) n'en mérite pas moins
le détour. Le présent disque en propose une intéressante anthologie. A
commencer par deux pièces concertantes. La Rapsodia
espaňola op. 70 date de 1887 et comme son
nom l'indique célèbre l'Espagne! Elle est proposée ici
dans l'orchestration réalisée par Georges Enesco. Elle est conçue sur le modèle
que Liszt utilise pour ses rapsodies hongroises, avec une introduction lente
suivie de divers épisodes rapides en forme de danses : de la petenera (flamenco), de la jota ou de la malaguena (encore flamenca mais plus langoureuse). La pièce
déploie de séduisants climats, brillamment mis en valeur dans l'instrumentation
inventive d'Enesco.
L'interprétation de Martin Rescoe et de Juanjo Mena est on ne peut plus idiomatique. Le Concerto
pour piano N°1 (mais il restera le seul!) op.78 date
de la même année 1887. Il est sous-titré ''Concierto fantástico''... Ses trois mouvements flirtent avec le
schéma classique, largement revisité par Albéniz qui semble lui refuser tout
côté ibérique. Le premier mouvement allegro vire très vite sur un andante
rêveur, en particulier dans le soliloque du piano. Le discours est aisé, plus chopinien qu'espagnol (malgré une répétition de notes qui
tend à le faire croire). Un tempo plus prestissimo s'installe ensuite.
« Rêverie et Scherzo » fait se succéder deux épisodes, calme, puis
agité, ce dernier introduisant une mélodie enjouée. Le finale
apporte de multiples changements de rythmes dont un mouvement de valse. Cela
module toujours aussi agréablement, sans prétention autre que décorative.
Magistrale exécution des deux partenaires.
Orchestre pur avec la Suite tirée de
l'''Opale magique'', un opéra comique créé en
1883 à Londres ; ladite pierre magique sertie dans un anneau étant supposée
rendre amoureuse toute personne qui s'aventure avec le porteur. L'action se
passe en Grèce, mais cela sonne plus espagnol que grec. Au fil d'une Ouverture
un peu grandiloquente et d'un prélude du II ème acte
encore plus typé, introduit par la harpe qui elle-même installe une danse énergique.
Quant au ballet de ce même II ème acte, il est
entrainant avec son léger déhanchement. Le morceau le plus espagnol est nul
doute la Suite espanola. Elle connut pourtant
des vicissitudes et réorchestrations diverses dont celle, donnée ici, due au
chef Rafael Frühbeck de Burgos. On y trouve à bien
des égards la préfiguration du fameux livre de piano Iberia. C'est une
succession de danses typiques. « Castilla » est une séguedille avec
castagnettes, au rythme vigoureux et coloré. « Granada » une sérénade
andalouse dont se détache la mélodie de la flûte relayée par un orchestre gorgé
de senteurs. Le rythme de « Sevilla » est difficilement résistible,
chaloupé et ostinato de tout un orchestre ensoleillé, et une sorte
d'improvisation flamenca au milieu. « Asturias »
doit beaucoup à la guitare et la rythmique insistante a quelque chose de vocal,
en particulier dans l'improvisation médiane. Enfin avec « Aragon »,
c'est la joie aragonaise de sa fameuse Jota si animée et pleine de couleurs,
une danse de copla plus méditative faisant contraste. Cela brille de mille feux
dans l'interprétation de Juanjo Mena. Le BBC Philharmonic s'identifie à ces tunes grâce à l'empathie
éprouvée par leur chef espagnol. Magnifique prise de son d'un bel impact.

Jean-Pierre Robert.
Alexandre SCRIABINE : Symphonies N°1 op. 26 et N°2 op. 29.
Ekaterina Sergeeva, Alexander Timchenko.
London Symphony Chorus. London Symphony
Orchestra, dir. Valery Gergiev.
2CDs : LSO0770. TT. : 50'08+41'01.
Aux antipodes des œuvres de la dernière
manière comme le Poème de l'Extase, les deux premières symphonies
présentent d'Alexandre Scriabine une veine bien différente. La Première
symphonie op. 26, de 1899-1900, est en six mouvements dont le dernier est
vocal. Elle débute en forme d'ouverture par un lento très lyrique dominé par
les cordes créant un climat bucolique. L'allegro dramatico
introduit quelques remous avec des vagues successives et des interventions des
cuivres où pointe déjà la dernière manière du musicien. Une section médiane
encore plus animée bouscule un ordonnancement qui reste profondément lyrique
avec de jolis traits des bois. Gergiev qui répartit
ses violons de part et d'autre, achève une fine balance. Un curieux point
d'orgue conclut le mouvement. Un nouveau lento poursuit une trajectoire
cherchant à illustrer une forme de beauté apollinienne à travers, par exemple,
un court solo de clarinette. Le discours se fait plus prégnant mais le lyrisme
reprend aussitôt ses droits. Un court vivace fait office de scherzo
agréablement articulé aux premiers violons, avec de curieuses associations
(petite flûte et xylophone). L'allegro qui suit reprend le mode du deuxième
mouvement, quoique hésitant entre lyrisme et drame jusqu'à un accord final
abrupt. Le finale andante est donc vocal (mezzo, ténor
et chœurs) introduit par un climat de nouveau bucolique aux bois. Le texte
célèbre la merveilleuse image divine, l'exaltation de la vie et la louange de
l'art, par chacune des deux voix ou les deux réunies. Enfin le chœur entonne un
hymne de gloire à l'art et la symphonie s'achève dans une vision idéalisée, un
peu grandiloquente. La Deuxième symphonie op. 29 (1901) offre cinq mouvements alternant
deux paires (lent-vif et vif-lent) s'articulant autour d'un noyau central
andante. Scriabine y affirme un style plus personnel. Dans la première partie,
l'andante sombre, marqué par la clarinette dans le registre grave, se développe
en vagues agitées. C'est une lutte entre deux types de principes, les thèmes ''
actifs'', dramatiques, et les thèmes ''passifs'', plus fluides et souvent
sensuels. Dont l'allegro vigoureux impose la dialectique. Un dramatisme
insistant annonce les convulsions des dernières œuvres, ce que Gergiev ne se prive pas de souligner. La partie médiane est
un andante d'un lyrisme proche de la féerie, décrivant quelque jardin des
délices (flûte imitant les chants d'oiseaux, grandes vagues des cordes mezza
voce ou s'enflant démesurément ). Y a-t-il là déjà la manifestation musicale de ces idées
occultes surréalistes qui fleuriront dans les dernières œuvres ? La deuxième
partie s'ouvre par un ''allegro tempetuoso'',
grondant, régi par des thèmes ''actifs'' véhéments avec cuivres et percussions,
annonçant le maestoso final qui développe une marche boursoufflée que Scriabine
reniera par la suite comme « trop militaire », là où il voulait
« un triomphe radieux ». Valery Gergiev et
ses forces du LSO donnent de ces deux symphonies des exécutions de haute tenue.
La captation live est un peu compacte, dans la première pièce en
particulier.

Jean-Pierre Robert.
Richard STRAUSS : Der
Rosenkavalier. Comédie pour musique en trois
actes. Livret de Hugo von Hofmannsthal. Krassimira Stoyanova, Sophie
Koch, Günther Groissböck, Mojca
Erdmann, Adrian Eröd,
Silvana Dussmann, Rudolf Schasching,
Wiebke Lehmkuhl, Tobias Kehrer, Franz Supper, Martin Piskorski, Dirk Aleschus, Roman Sadnik, Stefan Pop, Andreja Zidaric, Phoebe Haines, Idunnu Münch, Alexandra Flood, Rupert Grössinger.
Salzburger Festspiele und Theaterchor. Konzertvereinigung Wiener Staatsoper.
Members of the Angelika-Prokopp-Sommerakademie
der Wiener Philharmoniker. Wiener Philharmoniker,
dir. Franz Welser-Möst.
Mise en cène : Harry Kupfer.
Salzburger Festspiele 2014.
Voici la restitution filmique de la
représentation du Chevalier à la rose du
Festival de Salzbourg 2014, qui faisait dire à sa Présidente qu'elle était
« l'une des plus réussies des nombreuses productions données au festival
de cet opéra de Richard Strauss » (in ''Propos partagés'', NL de 3/2016). De
fait, sans en éclipser d'autres, celle-ci, due à Harry Kupfer,
possède de sérieux atouts. Elle surprend agréablement par sa fidélité au texte
tout en offrant une vision renouvelée de ce grand classique straussien. Elle
situe l'action au début du XX ème siècle, à l'époque
même de la création de l'opéra, dans cette ville de Vienne que le musicien et
son poète, Hugo von Hofmannsthal rêvaient de célébrer
à travers le propos d'une histoire amoureuse à quatre personnages. Quelques
éléments topiques signent cette datation : un phonographe à pavillon, des
meubles début de siècle, des costumes pareillement achalandés ; ces objets et personnages
qui imperceptiblement changent de place au sein de différentes pièces dans la
riche demeure de la Maréchale au Ier acte. Où l'on passe de l'intimité de la
chambre d'amours au tableau du grand Lever et de ses invités bigarrés, quoique
fort élégamment vêtus. Le ''Stadt Palais'' plus que
cossu au IIème sera le signe de la réussite sociale de la famille von Faninal. Et le Heuriger ou guinguette viennoise au III ème
est le lieu idéal pour jouer une mascarade à dessein de berner un baron Ochs,
bien digne alors de son cousin Pourceaugnac chez
Molière. Tout cela est serti dans un ensemble plus vaste, générique en fait, de
la cité viennoise, apparaissant en fond obligatoire, nécessaire : les alentours
de la Hoffburg, l'enfilade d'une rue bien connue, la
façade du Musée d'État, la grande roue du Prater, et surtout ces allées de
parcs embrumées. Une impression de grandeur nullement compassée s'impose à
l'œil et les images sont d'une beauté à couper le souffle : un
camaïeux de gris rehaussé de quelques touches de couleur pour éviter
toute monotonie. La régie est pareillement léchée, qui respecte les didascalies
à la lettre tout en leur donnant du poids (telle réplique amusante « Es ist ein Besuch »
- Voilà une visite -, lancée par la Maréchale à son jeune hôte, en claquant des
mains de joie amusée) ; et leur restituant leur sel : ainsi de l'entrée
fracassante de Ochs chez la Maréchale au I, qui défonce littéralement la porte
monumentale de la chambre, ou de la vraie-fausse comédie de l'homme blessé - au
sens propre et nul doute figuré - par l'intrépide Octavian,
qui conclut l'acte II sur une note moins appuyée que d'ordinaire ; ou encore de
la gaudriole du III, si souvent traitée grotesque, alors que l'échange entre le
baron et Mariandl/Ovtavian
se vit et se solde par un échec cuisant des manœuvres du bonhomme.
La captation filmique restitue à l'envi ces
moments essentiels et des plans rapprochés soignés en magnifient la beauté
spectrale. Comme pour ce qui est des longues conversations émaillant la pièce
(entre Ochs et la Maréchale au I par exemple) ou des scènes d'ensemble (toute
une maisonnée attendant fébrilement la venue du Chevalier et de la rose). La
caméra saisit des figures fort habilement portraiturées : un Baron Ochs jeune,
pas rustaud, carnassier plutôt pour satisfaire un appétit sexuel fort
développé, qui reconnait quelque chose d'effrayant dans l'inéluctabilité de la
situation finale, comme la gorge sèche ; un Faninal
dépassé par sa déconvenue devant un si gros scandale dans sa propre demeure ;
une Maréchale nullement ''femme sur le retour'', très féminine, qui sait passer
la main à plus jeune encore, sans affectation ni mélancolie outrancière lors
des premiers ''adieux'' au Ier acte ; un Octavian
conquérant, toujours racé, hésitant à l'heure du choix offert, et joliment
comique lors du travestissement au deuxième degré en femme de chambre et en
égérie de cabaret.
On a dit ici (Cf. NL de 10/14 et de 9/15) combien le volet
musical de cette représentation était mémorable. De par une direction en réelle
empathie avec l'idiome straussien : Franz Welser-Möst
et les Wiener Philharmoniker à leur meilleur, et même
plus, ce qui n'est pas peu dire ! De la beauté du flux ininterrompu d'une
musique déjà extrêmement séduisante, qui ne souffre aucune sollicitation ici.
Et grâce à une distribution de haut vol, dominée par un Ochs d'une rare
pointure, Günther Groissböck, voix d'airain d'une
fluidité remarquable, pourvue de notes graves impressionnantes, et prestation
décomplexée, jamais caricaturale, même si la caméra scrute avec facétie un
visage parfois presque déformé par une inextinguible soif de jupons. La
Maréchale de Krassimira Stoyanova
est pareillement de la plus pure eau : diction souveraine, art consommé de
l'inflexion straussienne, pour un portrait sans affèterie, que ce soit dans le
monologue sur le passage du temps au Ier acte ou à l'heure des choix décisifs
au dernier. Un Octavian, Sophie Koch, d'une force de
conviction et d'une spontanéité peu communes, se jouant des prouesses vocales
du rôle, qu'elle traite comme une seconde nature. Une multitude d'autres rôles
parfaitement assurés enfin, où seule la Sophie de Mojca
Erdmann parait à l'étroit, quoique cela soit moins
sensible qu'à la représentation. Un version DVD à chérir.

Jean-Pierre Robert.
Igor STRAVINSKI : Threni. Requiem Canticles. The Dove Descending Breaks the Air. Da
pacem Domine. Collegium
Vocale Gent. Royal Flemish Philharmonic,
dir. Philippe Herreweghe. 1CD Phi : LPH 020. TT. :
47'22.
Ce disque focalise sur la musique religieuse
écrite par Stravinski dans sa dernière période créatrice, et plus précisément
de veine liturgique. Impressionné par l'Ars Nova des XIV et XV ème
siècle, tout comme par les théories du musicologue Robert Craft
qui passait pour le chantre de la musique sérielle de Schönberg et de Webern,
il s'attèlera dans les années 50 à plusieurs pièces mêlant les deux influences.
Threni, achevé et créé à Venise en 1958, est
une mise en musique des Lamentations de Jérémie. Son écriture est
totalement sérielle. Fragmentée, elle annonce la dernière manière du maitre
russe. Stravinski a retenu des extraits des Lamentations, intitulées
''Élégies'', choisies parmi les première, troisième et cinquième. L'effectif
instrumental est conséquent quoique les instruments soient traités par petits
groupes, ce qui confère à l'ensemble un sentiment de transparence au fil d'une
belle psalmodie chorale et de l'intervention des solistes dans un plain-chant
polyphonique. On remarque en particulier le dialogue basse-ténor ou celui des
deux ténors. L'œuvre fut donnée en première française au Domaine Musical en
1959 et provoqua l'ire de l'auteur du fait d'une mauvaise exécution, mais les
éloges de l'écrivain Michel Butor. Son interprétation par Philippe Herreweghe
est ici grandiose, au premier chef de par la qualité des chœurs de Gand. Les Requiem
Canticles, dernière œuvre de Stravinski, a été
créée en 1966 par Craft. Elle est constituée de six
parties vocales précédées d'un prélude instrumental et suivie d'un postlude, un
interlude en occupant la partie centrale. Est utilisée une sélection de
fragments de l'Ordinaire de la Messe de Requiem, dont quelques versets du
« Dies Irae », le couplet final « Pie Jesu »
et la totalité du « Libera me ». Cela créé une succession de courtes
séquences autonomes. Le langage est sériel, mais cela sonne typiquement stravinskien ! Comme le Praeludium sur un rythme de marche avec violons âprement
dissonants. L'Interludium propose une stance
chambriste dotée d'un original concertino des bois. Le Postludium
évoque une volée de cloches, rappelant Noces, et offre des accords
cérémonieux. Des interventions vocales, on notera le « Tuba mirum » pour basse, introduit par une fanfare qui
éclate littéralement, le « Rex tremendae »
pour chœurs, ou le « Lacrimosa » pour alto,
un peu opératique ici, forcé comme s'il s'agissait des imprécations d'Oedipus Rex. Au « Libera me »,
quatre solistes du chœur se détachent de la masse de celui-ci, cette
superposition créant une impression de mi parlé mi chanté dans un climat
effrayant. L'évocation d'œuvres précédentes confère aux Requiem Canticles un statut de remémoration : on pense aussi au
Sacre (Prélude), à la Symphonie de psaumes (Exaudi),
à Renard (Dies Irae)... Herreweghe et ses
forces en donnent une exécution techniquement accomplie et en bien des points
incandescente. On a ajouté deux autres courtes pièces dont le Da pacem Domine de 1957 pour chœur a capella, sur l'un des
trois motets de Gesualdo, reconstruit par Stravinski pour ce qui est de ses
parties manquantes. Le Collegium Vocale Gent y est
éblouissant comme dans l'anthème The Dove Descending Breaks the Air, de 1962, sur un texte de
T.S. Eliot.

Jean-Pierre Robert.
Serge PROKOFIEV : Concertos
pour piano No 4, op. 53 & N° 5, op. 55. Symphonies N° 4, op. 112, N° 6,
op. 111 & N° 7, op. 131. Alexei
Volodin, Sergei Babayan,
piano. Mariinsky Orchestra, dir.
Valery Gergiev. 2CDs Mariinsky
: MAR0577. TT.: 81'02+77'22.
Valery Gergiev
revient à Prokofiev pour lequel il avait déjà laissé quelques disques
mémorables avec le LSO (Philips) puis son orchestre du Mariinsky.
Cette anthologie, captée au fil de concerts à Saint-Pétersbourg et à Moscou,
présente trois des sept symphonies et deux des cinq concertos du maitre russe.
Le Concerto n° 4 op. 53 pour la main gauche (1930) est le fruit d'une commande
du pianiste Paul Wittgenstein amputé du bras droit, tout comme il en avait
passé à Ravel, Hindemith et Richard Strauss. Dans le sillage de la nouvelle
esthétique moderniste qu'il avait inauguré avec Le Fils prodigue,
Prokofiev écrit une partition dont l'orchestration est volontairement allégée,
apte à ne jamais couvrir le soliste. Il n'empêche, elle est extrêmement
virtuose et pas seulement pour ce dernier. Comme chez Ravel, l'impression est
celle d'un jeu des deux mains. Ainsi en est-il du ''vivace'' qui, après une
attaque tranchée du piano, se vit comme un grand éclat de rire avec force
ostinatos. D'abord retenu, l'andante déploie une grande expressivité et de
belles couleurs. Suit un moderato, sorte d'intermezzo alerte secoué de thèmes
aussi variés que pétillants. Le mouvement est traversé dans sa seconde partie
d'une courte cadence acrobatique du soliste dans le registre grave. L'œuvre se
termine par un très bref ''vivace'' reprenant la légèreté du premier mouvement
et ses principaux thèmes. Alexei Volodin
y est proprement magistral. Le Concerto N° 5 op. 55, de 1932, en cinq
mouvements, est d'une extrême complexité. C'est sans doute celui requérant la
plus redoutable technique pianistique de l'ensemble des concertos. Comme le
montre l'allegro con brio frappé de pugnacité, de vigueur dans le traitement
martelé de la partie soliste favorisant des accords plaqués et percussifs. Avec
le « moderato ben accentuato », Prokofiev
installe le style de marche qui fera flores dans le ballet Roméo et Juliette
quelques années plus tard, et un jeu chaloupé du piano. La partie de celui-ci
est diablement virtuose : glissandos rageurs, changement de rythmes fréquent.
Le bref ''allegro
con fuoco'', renchérit en éclat et dynamisme avec
cascades d'accords frappés. Le répit viendra du larghetto, d'un calme tout
pastoral quoique la virtuosité reprenne vite ses droits dans une section plus
animée. L'œuvre se conclut par un ''vivo'' agité où perce un thème souriant qui
revient en boucle : l'allure s'emballe, traversée de plages de réflexion
jusqu'à une coda démonstrative. L'arménien Sergei Babayan
offre un jeu athlétique que Gergiev relaie par un
accompagnement tout aussi engagé.
La Symphonie N° 4, écrite en 1929/1930 à partir des thèmes du ballet Le
Fils prodigue, avait été commandée à Prokofiev par Serge Koussevitzki pour le 50 ème
anniversaire du Boston Symphonie Orchestra. Elle sera remaniée plusieurs années
plus trad, en 1947. On est frappé par son abondance
thématique, installée dès
l''allegro eroico'' motorique
quoique traversé de traits élégiaques dans une manière typique de son auteur.
C'est tout un orchestre chauffé à blanc, cuivré, surligné de percussions que
lance ici Gergiev. Après ce déluge sonore, le
contraste est grand avec l' ''andante tranquillo'', vaste pastorale bâtie sur un thème de flûte
qui se développe agréablement, ponctué d'un tic-tac rythmique, très habituel
chez Prokofiev. Le ''moderato quasi allegretto'' offre un divertissement
dansant, typique des grands ballets de son auteur, au fil de diverses variations
pleines d'esprit et magistralement orchestrées. Le finale ''risoluto''
revient au schéma volubile du début de la symphonie avec de belles parties
solistes (trompette, hautbois) jusqu'à une apothéose incandescente. L'Orchestre
du Mariinsky est fastueux sous l'énergique conduite
du maestro Gergiev. La Sixième Symphonie op.
111 est l'une des plus élaborées. Après une introduction lente, le discours se
fait agité, énergique en scansions marquées dont émerge une mélodie intensément
lyrique. Le développement porte son lot de motorisme
avec effets cuivrés. Mais la coda sera assagie. Un sentiment de sérénité émane
du largo par son geste ample, que Gergiev conçoit
expansif, soutenu par des vents ronflants. Le développement cède le pas à une manière plus animée,
comme s'il s'agissait d'un scherzo, et la coda respire de nouveau la quiétude.
Le vivace final offre l'effervescence d'une fête brillante dans un thème enjoué
et preste que ponctuent quelques coups assénés de grosse caisse et des aplats
de cuivres. Celle belle harmonie semble peu à peu se distordre dans une course
haletante alternant fortissimos et pianissimos, avant de grands climax finaux
abrupts.
La Septième Symphonie op. 131
(1951/52) est dédiée à la jeunesse. Le vent avait tourné pour le musicien en
1948, lorsque dénoncé par la Nomenklatura soviétique. Pour faire amende
honorable, il décide de revenir à un style plus ''idiomatique''. L'œuvre, en
quatre mouvements, est lumineuse, dans l'esprit des souvenirs heureux, mais
aussi empreinte de nostalgie. L'allegro moderato, qu'ouvre un ample thème
lyrique, est bercé par le rythme de tic-tac au glockenspiel. S'en dégage un
sentiment de plénitude. L'allegretto apporte quelque divertissement valsé au
charme peu résistible décuplé par l'animation qui s'empare de tout l'orchestre,
aux bois en particulier. Le tempo s'envole, marque le pas, puis reprend son
essor véhément. L'andante espressivo renoue avec le lyrisme du Ier mouvement,
tout en légèreté. Et le ''vivace'' final éclate de sa rythmique tourbillonnante
et sur un thème populaire. Une course poursuite s'installe, brillante, mais
aussi ironique ; allusion à Rimski-Korsakov et à son Coq d'Or dont le
personnage de L'Astrologue tire son épingle du jeu à la cour du roi Dodon. Joli pied de nez ! Gergiev
restitue toute la limpidité de cette partition chatoyante qui fit l'admiration
de Chostakovitch. Celui-ci, au lendemain de la création, le 11 octobre 1952,
souligne dans une lettre à son confrère : « Écouter des œuvres comme votre
Septième Symphonie rend la vie plus facile à vivre et plus joyeuse ».

Jean-Pierre Robert.
Dimitri CHOSTAKOVITCH : Symphonies No 5, op. 47 , N° 8 , op. 65 & N° 9,
op, 70. Musique de scène pour Hamlet, op. 32a
(extraits). Boston Symphony Orchestra, dir. Andris Nelsons.
2CDs DG : 479 5201.TT. : 76'44+80'54.
Voici le deuxième volet d'une trilogie
consacrée à la musique orchestrale de Chostakovitch conçue « Dans l'ombre
de Staline », savoir les symphonies 5 à 10. Sont ici jouées les symphonies
Nos 5, 8 & 9. La Cinquième Symphonie, op. 47, créée en 1937 par Evgeny Mavrinsky, faisait suite
au fameux article paru en 1936 dans la Pravda, sur la nécessité de se conformer
aux ukases officiels quant à la manière de composer pour le peuple soviétique.
Elle est tragique et pathétique. A l'exemple du moderato initial qui propose une sombre exorde débouchant sur un rythme curieusement
allant et très consonant, lourd de sens pourtant. Ce que souligne Andris Nelsons qui lorsque le
tempo soudain s'accélère, ménage plusieurs strates jusqu'au grand climax sur un
rythme martelé avec feu roulant des tambours. Lors de la reprise du premier
thème, le solo de flûte est magistralement délivré et la coda pacifiée. Le
scherzo allegretto est empli de sarcasme : Nelsons
pense ici à Mahler, triturant les traits des bois et adoptant des rallentendos propres à installer le suspense. Les bois du
Boston Symphony sont superlatifs, comme les
percussions. Le refrain de marche triomphale est juste retenu, créant une vive
tension. Avec le largo, centre expressif de la symphonie, la méditation
s'installe, l'interrogation plutôt. L'interprétation de Nelsons
en trace toute la fabuleuse intensité dans un crescendo magistralement monté.
L'atmosphère se fait raréfiée au développement, lors du thème énoncé par le
hautbois, presque étouffant. Comme la progression exacerbée qui suit. Le finale
attaca est très articulé, introduisant une dose
d'optimisme forcé. Nelsons pousse peu à peu
l'ensemble dans un magma incandescent jusqu'aux ultimes pages, d'un impact
grandiose. On mesure les qualités du chef qui montre une vraie empathie avec
cet idiome, favorise de larges contrastes dynamiques, avec un sens avisé des
transitions comme une absence de théâtralité, même dans les moments les plus
démonstratifs ; enfin s'attache à la recherche de la couleur, ici prodiguée par
un orchestre fastueux, en particulier dans la petite harmonie.
La Huitième Symphonie op. 65, de 1943, est elle aussi sombre, troublante, monumentale. C'est l'une
des plus complexes. On a dit que ses cinq mouvements faisaient penser à un
opéra imaginaire. Peut-être celui que Chostakovitch caressait alors le projet
d'écrire d'après Le Joueur de Gogol ? Le vaste adagio qui l'ouvre est
introspectif et Nelsons le joue douloureux (chant des
violons) lors du thème répétant à l'unisson une même note. Est exploité le
registre le plus pathétique ppp dans une sorte d'abyssale résignation.
Un climax est vite atteint après une montée en puissance que Nelsons amène sans concession : cordes désespérées et bois
stridents, avec des effets d'écrasements gigantesques, les uns roulant sur les
autres. Le contraste du solo de cor anglais sur une pédale de l'orchestre est
angoissant. Suivent deux courts mouvements : un allegretto d'un humour grinçant
sur une marche grotesque, sarcastique ; un allegro non troppo,
scherzo en forme de chevauchée des cordes ponctuée de crins crins
éperdus des bois puis de cuivres rageurs. La tension conduit à un déferlement
sonore comme il en est peu dans la littérature symphonique. En forme de
Passacaille, le largo installe une marche funèbre au-delà d'un climat
d'affliction, dans une fausse douceur tragique. Le finale
allegretto amène plus de sérénité par le thème introduit par les bois, repris
par les cordes. Plus tard, celles-ci et la flûte solo se partagent le discours.
Les divers épisodes, Nelsons les ménage avec un rare flair pour cette
marqueterie d'impressions. Et on atteint aux dernières pages quelque Nirvana,
apaisement après tant de désespérante monumentalité. Une grande interprétation
!
La Symphonie N° 9, op. 70 ( 1945), crée à Leningrad par Mavrinski,
se signale par son climat détendu, joueur, mais sardonique. Ce qui se manifeste
dès l'allegro : une étrange entrée en matière, d'une légèreté inattendue chez
l'auteur et en cette époque de sortie de la guerre. Nelsons
drive avec élégance les phrases claires et les interventions d'accords
grotesques au vague ton militaire. Cela parait brillant surtout avec un tel
orchestre, mais les sous-entendus sont bien là. Le moderato est aussi
introverti que le précédent mouvement était extériorisé, bâti sur le chant des
bois, dont la flûte, débouchant sur une large phrase des cordes progressant
comme laborieuse. Le presto, le chef le prend soutenu et sarcastique. Le largo
se distingue par ses accords assénés des cuivres et le solo de basson qui
emplit l'atmosphère d'angoisse. Nouvelle transition avec l'allegretto faisant
encore la part belle au basson tandis que les cordes entament un nouveau thème
allant, pas si optimiste que cela toutefois. La parodie de marche militaire en
dit long sur ce qui est derrière les notes. Mavrinski
voyait là une musique conçue « contre les Philistins, avec leur
complaisance et leur enflure, leur souci de se reposer sur leurs
lauriers ». Staline réagira d'ailleurs. Le disque est complété par une
rareté : la Suite tirée de la musique de scène pour ''Hamlet'', op 32a.
Sont joués ici 7 des 15 mouvements écrits par Chostakovitch en 1932 (remaniés
par la suite) : une partition au feeling cinématographique avec une belle dose
d'humour pour contrebalancer les sombres pages qui peuplent la pièce de
Shakespeare. Aussi les transitions sont-elles des plus inattendues, passant du
cocasse au grotesque. Ainsi de « Fanfare et musique à danser », ou de « La
chasse » dégageant une énergie toute excessive. La « Chanson
d'Ophélie » est si parodique qu'elle semble en perdre son sujet, comme la
« Berceuse », un chef d'œuvre de sarcasme. « Requiem », sur
le thème grégorien du Dies Irae, joué par les vents, conclut ici en apothéose.
Au fil de ces pièces et symphonies on aura aussi remarqué une qualité
d'enregistrement live très « atmosphérique », capté dans le Boston Symphony Hall à l'acoustique claire et ouverte. Le spectre
sonore est large et l'équilibre cordes-vents frôle l'idéal.

Jean-Pierre Robert.
« Patchwork ».
George ENESCU: Cantabile &
Presto. Erwin SCHULHOFF : Sonate pour flûte et
piano. Serge PROKOFIEV : Sonate pour flûte et
piano, op. 94. Robert MUCZYNSKI : sonate pour
flûte et piano, op. 14. Raquele Magalhães, flûte. Sanja Bizjak, piano. 1CD Evidence : EVCD025. TT. : 52'.
Voici une invitation à la découverte d'œuvres
pour flûte et piano de compositeurs qu'unissaient deux mêmes idées : l'hommage
à la culture slave (ou peu s'en faut) et à un instrument emblématique et si
consubstantiel d'un pays alors phare, la France. Georges Enesco a vécu
longtemps à Paris, y fréquentant l'élite intellectuelle. La pièce intitulée Cantabile
et Presto, morceau de concours pour le conservatoire, de 1904, sonne
étonnamment gallique, d'un grand raffinement mélodique. La Sonate pour flûte
et piano d'Erwin Schulhoff (1894-1942) a été
créée en 1927 par le flûtiste français René le Roy. Elle s'ouvre par un allegro
moderato d'une écriture aisée pour l'instrument, sautillante, et s'éteint dans
un souffle. Suit un scherzo humoristique et une Aria au ton rêveur dans la
mélopée de la flûte sur l'accompagnement gambadant du piano. Le rondo final
déborde de joie, avec dans la partie centrale, un échange entre les deux
partenaires aussi savant qu'original ; et cela se finit par une pirouette comme
tous les mouvements de cette délicieuse pièce. La Sonate pour flûte et piano
de Serge Prokofiev, op. 94, a été créée en 1943 à Moscou ; puis à Paris en
1949, à la salle Gaveau, par le jeune Jean-Pierre Rampal. C'est un sommet
d'expressivité, magiquement conçu pour la flûte. Le moderato installe un thème
lyrique mémorable, moult fois repris. Raquel Magalhães
le joue délicat et pas virtuose, ce qui lui confère
tout son poids distinctif. Ce sont en fait des variations finalement fort
différentes les unes des autres, avec cette pointe d'ostinato que l'on retrouve
souvent sous la plume du compositeur. Le scherzo est volatile, pris par les
présents interprètes dans un ton enjoué. La manière dansante fait penser à Roméo
et Juliette. Le trio apporte une note de tendresse et une pointe d'humour
passager qui permet d'enchaîner la reprise, d'un babil encore plus marqué.
L'andante trace une délicate borderie de la flûte dans son balancement et ses
répétitions de notes identiques. Le finale, allegro
con brio, décidé, conduit à une apothéose après divers mini épisodes très
contrastés et techniquement ardus. Mais Raquel Magalhães
et Sanja Bizjak en font
leur délice. L'américain Robert Muczynski (1929-2010)
a écrit sa Sonate pour flûte op.14 en 1961. Cette courte pièce offre un
langage fragmenté, voire haché, qui n'en montre pas moins une légèreté et une
fluidité dignes de Prokofiev : sur un accompagnement un peu motorique
du piano (allegro deciso), un sens du rythme jazzy
(scherzo), un beau cantabile expressif (andante) et une manière spirituelle
(allegro con moto). Une découverte que la perspicace exécution des deux dames
rend encore plus agréable.
*

Jean-Pierre Robert.
« Europe
1920. Sonates pour violon &
piano ». Ottorino
RESPIGHI. Eos JANACEK. Boris LYATOSHYNSKY. Maurice RAVEL. Dania Tchalik,
piano, Gabriel Tchalik, violon. 1 CD Evidence classics : EVCD024. TT : 82'09.
Belle réussite musicale et programme original
pour ce dernier enregistrement des frères Tchalik.
Quatre sonates bien connues, en dehors de celle de Boris Lyatoshynsky
(1895-1968) en même temps qu'un instantané de la révolution esthétique qui
caractérisa les années 1920. Panorama représentatif des avant-gardes de
l'Europe musicale avec quatre compositeurs bien différents, quatre esthétiques
parfois opposées oscillant entre Romantisme finissant, musique populaire et avant garde assumée. Un dialogue des styles porté au plus
haut niveau et des réponses très personnelles apportées à la modernité. La
Sonate d'Ottorino Respighi (1879-1936) post romantique
et virtuose, témoigne du cosmopolitisme et du désir de synthèse de son
compositeur soumis aux influences italiennes, germaniques, russes et
françaises. A l'inverse, moins savante d'aspect, celle de Leos
Janacek (1854-1922), par une certaine aridité se tourne plutôt vers un
expressionnisme concis, un vérisme se nourrissant des chants populaires
tchèques. La Sonate de Lyatoshynsky constituera sans
doute pour beaucoup une découverte. Tenant de l'avant-garde russe, Boris Lyatoshynsky appartient à cette génération
sacrifiée au nom du réalisme soviétique. Totalement ignorée en Occident, sa
sonate porte en elle les influences de Scriabine, de Bartók et de la Seconde École de Vienne, résolues
dans un syncrétisme d'une surprenante modernité rythmique et harmonique.
Tortueuse, grimaçante et ambiguë, Chostakovitch saura s'en souvenir quelques années plus tard.
Enfin la célèbre Sonate de Ravel frappante par sa modernité, ses accents jazzy
bien connus, tente de se libérer du médium instrumental pour atteindre à une
abstraction décuplant sa force expressive. Une très belle interprétation des
frères Tchalik où la sonorité envoûtante du violon
combinée au jeu complice du piano réussit à nous passionner de bout en bout. Un
disque qui vient poursuivre avec talent et pertinence un parcours comptant déjà
deux enregistrements
remarqués (Locatelli et Tishchenko)
pour le même label. Un disque à ne pas manquer.

Patrice Imbaud.
Ludwig van BEETHOVEN : Symphonies nos 2, 3, 4, 5, 7, 8. Concerto pour violon et orchestre. Wolfgang Amadé MOZART : Serenade « Gran Partita » K.
361. Concerto pour hautbois K. 314. Franz
SCHUBERT : Symphonie N°8 « Inachevée ». LD 007. David Grimal, violon. Les Dissonances. 5CDs : Dissonances records : LD 007. TT.: 345'63.
Béla BARTÓK : Divertimento
pour cordes. Leonard BERNSTEIN : Sérénade
d'après Le Banquet de Platon. Dimitri CHOSTAKOVITCH : Symphonie de chambre op. 110a . Alfred SCHNITTKE : Concerto grosso N°1 Moz-Art à la
Haydn. Arnold SCHOENBERG : Kammersinfonies N°1, op. 9 & N°2 op. 38. Les Dissonances. 3CDs :
Dissonances records : LD 008 (www.les-dissonances.eu). TT.: 166'.
Alors que depuis le milieu du XIXème siècle
la musique symphonique est donnée à entendre par le truchement de chefs qui marquent
l'histoire de l'interprétation, il peut paraître audacieux aujourd'hui de la
proposer au public sans chef. Quelques ensembles pourtant fondent leur
notoriété sur des interprétations qui ne doivent rien à un chef et sont
cependant marquantes. Citons l'ensemble nord américain
Orpheus et les deux ensembles européens Spira Mirabilis et Les Dissonances. C'est ce dernier qui
nous occupe ici. Il vient de célébrer ses 10 ans sous forme d'un bilan gravé
sur 8 CD répartis sur 2 coffrets, le premier réunissant Beethoven, Mozart et
Schubert et le second Bartók, Bernstein, Chostakovich,
Schnittke et Schoenberg. Les enregistrements
s'échelonnent de 2010 à 2014 et sont exclusivement des prises effectuées lors
de concerts publics à Dijon où Les Dissonances sont en résidence depuis 2008,
et à Paris à la Cité de la Musique ; sachant qu'on imagine mal des
enregistrements en studio pour ce type de formation. En effet malgré une mise
au point préalable très exigeante entre les musiciens pour éviter tout incident
majeur lors des interprétations, il y a une fragilité naturelle qu'il convient
de prendre sur le vif, et qui est soumise à de multiples facteurs :
intensité de la concentration des musiciens qui se doivent de communiquer entre
eux par une écoute réciproque de chaque instant, communication qui se nourrit
de la présence du public dont il faut s'assurer l'attention. Ce phénomène se
vérifie pleinement dans les interprétations données par les formations sans
chef.

©Gilles Abbeg
La réussite des enregistrements des Dissonances
repose donc bien pour une part essentielle sur la spontanéité captée sur le
vif, même si parfois
il a pu y avoir une tendance de la part des ingénieurs du son à
effacer tout indice de présence humaine. L'autre facteur de réussite de ces
deux coffrets réside dans l'incontestable qualité instrumentale de l'orchestre.
Elle se vérifie pour toutes les œuvres gravées pour les vents, avec une mention
particulière pour la Serenade Gran Partita K. 361 de Mozart et, s'agissant des
cordes, le Concerto Grosso n°1 d'Alfred Schnittke.
Un regret cependant s'agissant des textes accompagnant les CD : si la
présentation des œuvres est bien faite –
informations essentielles avec un vocabulaire qui sait éviter le jargon
– on a peu de précisions sur la façon de travailler de l'orchestre, et il
aurait été intéressant de connaître le point de vue des musiciens sur
l'expérience qu'ils vivent avec Les Dissonances, alors qu'ils appartiennent
souvent à des phalanges symphoniques avec des chefs qui entendent leur
transmettre leur conception. Cela aurait pu être éclairant et rappeler que même
si la qualité de l'ensemble doit beaucoup à David Grimal,
ils sont aussi les acteurs de sa réussite. Critique toutefois marginale au
regard de ce que l'on peut entendre. Avec les Dissonances on a des moments de
musique collective qui viennent toucher au cœur, même s'il peut y en avoir de
moindre intensité.
Les lectures des grands classiques -
Beethoven, Mozart, Schubert - se caractérisent par une approche au plus près
des textes, ce qui se traduit par un vibrato discret des cordes, par exemple
dans le premier mouvement de la Deuxième Symphonie de Beethoven (CD1).
On note, de façon générale, la netteté dans les attaques et souvent une énergie
contagieuse facilitée par la virtuosité des musiciens. La Huitième Symphonie bénéficie de ce
traitement ce qui a pour effet une très grande finesse dans le second
mouvement. Le second CD est une réussite
totale. Grâce à leur style d'interprétation, Les Dissonances confirment que la Quatrième
Symphonie peut certes sonner comme une œuvre de Haydn, mais qu'elle ouvre
aussi des perspectives d'une extrême audace à l'instar de l'Héroïque.
L'urgence du dernier mouvement en est à cet égard la preuve. Les
instrumentistes virtuoses de l'ensemble sont à la hauteur du défi que propose
Beethoven à ses interprètes. La seconde œuvre de ce CD n'est rien moins que le Concerto
pour violon de Beethoven. On retiendra la pureté du son du violon de David Grimal dans le second mouvement ainsi que le scherzo final
à la fois homogène et flamboyant.
On sera peut-être plus interrogatif quant au
troisième CD. Mais rappelons la loi de prises de concerts : l'alchimie
entre public et musiciens peut ne pas prendre totalement et influer sur
l'engagement de ces derniers. C'est peut-être ce qui a pu se passer le 9
décembre 2010 à Dijon pour une Cinquième Symphonie manquant semble-t-il
de cohérence : un premier mouvement parfois trop précipité - se rapprocher
des indications métronomiques de Beethoven peut avoir pour effet une certaine
sécheresse ! Un second mouvement, par contraste, semblant manquer de ligne
directrice. En revanche le dernier mouvement est à juste titre déterminé,
surtout à son début. La Septième Symphonie apporte plus de satisfaction.
Dans le premier mouvement les musiciens mettent en valeur leur instrument au
service d'une énergie sans lourdeur, avec des contrebasses d'une superbe
profondeur. L'allegretto est sans doute languissant dans ses premières mesures
pour évoluer vers une marche que Jérémy Pérez, auteur des notices de
présentation, n'hésite pas à caractériser comme étant « lente aux accents
funèbres ». Le quatrième mouvement est irrésistible, justifiant le surnom
donné par Richard Wagner d'« Apothéose de la
danse », avec une finesse exceptionnelle des violons et une intervention
magnifique de la flûte de Julia Gallego Ronda.
Le quatrième CD réunit deux chefs d'œuvres
incontournables : l'Héroïque de Beethoven et l'Inachevée de
Franz Schubert, « augmentée de l'esquisse du scherzo » (1 minutes de musique!). Même si dans les deux cas on ne peut que
s'incliner devant la qualité instrumentale et l'homogénéité du groupe, il faut
admettre que la profondeur du propos des deux compositeurs n'est que
partiellement atteinte. Certes la modernité du premier mouvement de l'Héroïque
est totalement assumée, avec de superbes sonorités, mais la « Marcia Funebre » évolue trop prosaïquement. En revanche dans
le Scherzo, Les Dissonances sont à leur affaire ; de même que pour le dernier
mouvement malgré une entrée en matière un peu légère. Il n'en reste pas moins
que l'ensemble est convainquant. Ce qui est moins le cas avec la Huitième
Symphonie de Schubert : ainsi peut-on être surpris par le parti pris par
les musiciens de conduire un discours un peu haché, ce qui nuit à l'unité du
premier mouvement. Quant au second engagé, quasi allegro moderato, il perd par
voie de conséquence en émotion. Dommage, car nous ne le dirons jamais assez :
le travail instrumental uni dans un ensemble homogène est impressionnant.

David Grimal ©Jean-Louis Atlan
Le cinquième et dernier CD
« classique » est consacré à Mozart. Le hautbois d'Alexandre Gattet, soliste du concerto K. 314, est virtuose à souhait
et donne de l'œuvre son caractère galant à bon escient. La Sérénade « Gran Partita » K. 361 est une belle réussite. Est mise
en évidence l'excellence des vents des Dissonances ainsi que celle de la
contrebasse de Yann Dubost. Rappelons que cet
instrument est parfois remplacé par un basson dans d'autres interprétations.
L'absence de chef pour cette sérénade dont l'effectif n'est que de 13
instrumentistes est plus facilement envisageable que pour une œuvre
symphonique. Ce serait même la façon la plus naturelle de l'interpréter.
Toutefois il existe des enregistrements marquants laissés par de grands chefs,
de Wilhelm Furtwängler à Pierre Boulez en passant par Otto Klemperer ou Franz Brüggen. Mais avec les Dissonances nous avons une
fraîcheur, un enthousiasme communicatif auquel l'auditeur ne peut qu'adhérer.
Ce premier coffret, au-delà de quelques
réserves de détail, confirme qu'un travail sur les partitions de maîtres du
passé même en absence d'un chef, quoique ici avec un
rôle à coup sûr non négligeable du premier violon David Grimal,
offre des interprétations de toute façon intéressantes et parfois même
marquantes. Le coffret est donc à marquer d'une pierre blanche. Comme il en est
de celui consacré à des œuvres du XXème siècle. Le programme est d'une grande
richesse : Chostakovich et sa Symphonie de
Chambre op.110a, Bartók et son Divertimento pour cordes, les deux Symphonies
de Chambre de Schoenberg, la Sérénade pour violon, orchestre à cordes,
harpe et percussion de Leonard Bernstein et enfin d'Alfred Schnittke le Concerto Grosso n°1 et Moz-Art à la Haydn.

Le premier CD offre un Chostakovich
de qualité supérieure. Si l'introduction de l'op. 110a– largo - semble manquer
d'âpreté, le très court (2'47) Allegro molto se caractérise par une urgence à
couper le souffle que les musiciens rendent parfaitement grâce à leur
virtuosité, et le largo qui conclut cette symphonie de chambre - en fait
transcription par Rudolph Barchaï du quatuor op. 110
- répand un flot tragique qui bouleverse. Le Divertimento de Bartók ne trouve
pas en revanche chez les Dissonances le mordant qu'on souhaite trouver dans une
musique qui a sa source dans la culture traditonnelle
hongroise. Cela aurait dû être le cas pour le dernier mouvement en particulier.
Bref, interprétation plutôt sage. Ce ne sera pas le cas pour la Symphonie de
Chambre n°1 de Schoenberg, qui ouvre le CD suivant. Celui-ci est du reste sans
doute le plus passionnant de tout l'ensemble car il montre le chemin parcouru
par le compositeur entre l'opus 9 qui date de 1905/1906 et l'opus 38 qui date
de 1938, bien qu'esquissé dans la foulée de l'opus 9. Pour la Première
Symphonie de Chambre, la révolution que va conduire Schoenberg s'amorce, et
les interprètes le savent qui, grâce à la maîtrise de leur instrument,
projettent des éclats sonores parfois stridents d'une grande violence ainsi que
des timbres d'une très grande diversité. Il s'ensuit qu'avec la Seconde
Symphonie le contraste est saisissant. Cet opus 38 s'écoule presque avec
sagesse, ce qui ne doit en aucun cas être compris comme un reniement des
audaces inventées pas Schoenberg. Celles-ci sont toujours présentes avec
l'utilisation rigoureuse des règles qu'il a élaborées quelques années
auparavant. L'homogénéité de l'ensemble, la qualité des instrumentistes rendent
pleinement justice aux deux symphonies si justement placées en regard.
Le dernier CD offre à écouter trois œuvres plutôt
rares. D'abord de Leonard Bernstein, la Sérénade pour violon solo, orchestre
à cordes, harpe et percussions. Elle est une occasion d'admirer le violon
expressif de David Grimal, même si on peut regretter
une trop grande réverbération dans l'enregistrement. L'œuvre est vraiment
représentative du « style » de Bernstein, plutôt hétérogène mais qui
témoigne d'un savoir faire évident aussi bien pour
proposer des rythmes entraînants que des mélodies que l'on retient. Il sait
aussi, aidé en cela par ses interprètes, susciter l'émotion comme dans le
superbe adagio « Agaton ». Il y aussi
hétérogénéité chez Schnittke, mais elle est d'un
autre ordre et en fait cache une cohérence. Cette apparente hétérogénéité est
liée aux emprunts que le compositeur russe fait aux maîtres du passé. Ce qui
unifie l'ensemble, c'est le détournement qu'il en fait en altérant les mélodies
et les rythmes, apportant une couleur qui précisément donne du liant au tout.
Les Dissonances réussissent cette gageure, sachant mettre de l'humour dans la
première citation pour ensuite s'engager progressivement dans un discours
rageur, avec un superbe travail sur les sonorités. On remarquera, dans le
« Recitativo », des pizzicatos qui ont du
corps, preuve s'il en était besoin de l'excellence des cordes des
Dissonances ! Le Rondo Agitato est l'occasion d'un étonnant rythme de
tango et se conclut par une agitation faussement anarchique. Quant au Postlude,
qui fait écho au « Preludo », les
Dissonances savent le rendre particulièrement mystérieux. Le dernier morceau – Moz-art – est brillant et peu
paraître assez vain... Est-ce du fait que David Grimal
et ses complices ne permettent pas de débusquer le côté étrange de
l'œuvre ; au contraire d'un Gidon Kremer
avec les musiciens du Chamber Orchestra of Europe,
dans un enregistrement publié chez Deutsche Grammophon
en 1990 ? Réserve qui n'enlève rien à la qualité réelle du coffret dont on
ne soulignera jamais assez l'originalité. Deux coffrets marquants qui
s'inscrivent dans l'histoire naissante de l'interprétation du XXIème siècle!

Gilles Ribardière.
Olivier PENARD : Chroniques.
Dana Ciocarlie,
piano, Philippe Bourlois, accordéon, Jean-Marc Fessard, clarinette, Jonas Vitaud,
piano. Quatuor Debussy. 1 CD DUX (www.dux.pl) : DUX 1112. TT.: 75'29.
Le catalogue du label DUX est extrêmement
varié. Il permet d'entendre des œuvres du grand répertoire mais aussi des
œuvres de compositeurs peu enregistrés, notamment français du XXème siècle
comme Henri Busser, Jacques Ibert, Jean Français, Philippe Gaubert, Reynaldo Hahn, Henri Tomasi ou
les grands maîtres de l'orgue tel que Charles Tournemire, Louis Vierne ou
Charles Marie Widor. Deux compositeurs qui s'expriment aujourd'hui ont même
droit à un CD qui leur est intégralement consacré : Renaud Gabriel Pion et
Olivier Penard. Ce dernier, né en 1974, est
autodidacte tout en ayant reçu les conseils de Philippe Capdenat
et de Guy Reibel. Le présent enregistrement offre un
panorama de sa production entre 2001 et 2012. Si les quatre œuvres enregistrées
peuvent s'écouter séparément, une audition en continu se justifie tout à fait,
car le CD est conçu comme une seule œuvre : les pièces à quatre ou deux
instrumentistes sont encadrées par l'opus 30 – Chroniques – pour piano,
à entendre comme des interludes. Leur interprète, Dana Ciocarlie,
est remarquable : jeu franc, dense et varié. On remarquera l'atmosphère
très debussyste du début de « stupeur » qui débute l'œuvre et le
romantisme discret de la dernière partie de ce cycle, « Romances »
qui clôt l'enregistrement. Le quatuor à cordes Opus 28 Polyptique dit
« du diamant » est très subtilement introduit par les Debussy qui
ensuite se jouent de la variété des rythmes comme cette valse en seconde
partie de l'œuvre. Dans le quatrième mouvement, « Fruit des
étoiles », on peut entendre des accents proches de ceux qu'avait créés
Janacek ; dans le cinquième et dernier, on évoquerait plutôt Stravinsky,
soit autant de références subjectives qui peuvent être contredites par d'autres
auditeurs. Ainsi dans sa présentation du CD, Dominique Hayer
évoque pour le quatrième mouvement de cet opus 28 successivement Mahler et les
minimalistes ! Artefact, composition la plus ancienne (2001),
associe piano, violon, violoncelle et la clarinette virtuose de Jean-Marc Fessard. Avec lui et ses partenaires, la parenté, en
particulier du dernier mouvement – « Rhapsodie jazz »- avec les Contrastes de Béla Bartók
est évidente.
Mais la composition la plus intéressante est
sans doute Charade sur un thème d'Henri Dutilleux (en l'occurrence la
première symphonie). Il n'y a pas de tendance au pastiche mais au contraire une
réelle originalité, à commencer par l'alliage sonore entre un violoncelle et un
accordéon, parfaitement réussi. Voilà bien une œuvre certes de dimension
modeste mais vers laquelle on a plaisir à revenir. Cette « Charade »
échappe au reproche que l'on peut émettre à propos des autres œuvres ; que
ce soit Chroniques, Polyptique ou Artefact, l'auditeur est
trop sollicité à identifier les influences ce qui est un obstacle pour
débusquer l'originalité des compositions d'Olivier Penard
qui, cela étant, ont l'avantage de se laisser écouter. Tous les interprètes
sont dignes d'éloge et la qualité de l'enregistrement excellente, mis à part
une perspective sonore trop large pour Artefact. Le livret, en français,
anglais et polonais, donne des œuvres un éclairage précis et dans un langage
évitant le jargon. Disque intéressant consacré à un compositeur sans doute trop
prisonnier de ses influences mais dont les œuvres restent séduisantes à
l'écoute.

Gilles Ribardière.
***
MUSIQUE ET CINEMA
ENTRETIEN
Philippe
Le Guay :
« un film secrète un imaginaire musical »

DR
Réalisateur éclectique d'une dizaine de films
– Les Deux Fragonard, Le Coût de la Vie,
Les Femmes du Sixième étage, Alceste à Bicyclette, Floride..
-, il nous a reçu à la Maison des Auteurs SACD, pour que l'on parle de ses
rapports à la musique de film.
Comment
avez-vous trouvé, pour votre premier film, Jorge Arriagada
avec qui vous avez fait quatre films par la suite ?
C'était le compositeur attitré de Raoul Ruiz.
J'avais un rapport assez proche avec son cinéma, et surtout j'avais remarqué
qu'il y avait une forme qui frisait l'abstraction avec des motifs quasi
algébriques de narration, des jeux de renversements, de miroir, des choses très
sophistiquées, et en même temps il y avait un lyrisme ; toutes les
dimensions émotionnelles étaient amenées par la musique. C'est probablement
cette tension qui existe entre la musique, d'un côté, et cette écriture
tellement distanciée, de l'autre, qui est une grande composante du style de
Raoul Ruiz. J'en serais resté là si ce n'est que j'ai rencontré Jorge Arriagada au cours de la projection d'un film d'un ami
réalisateur, Laurent Perrin, aujourd'hui décédé. et je
lui ai proposé d'écrire la musique de mon premier film « Les deux Fragonard ».
(Jean-Honoré
Fragonard, peintre très célèbre du XVIIIe siècle, prend un jour pour modèle une
jeune lavandière dont il tombe amoureux, Marianne. Mais le sinistre Comte
Salmon D'anglas projette d'assassiner la jeune femme et de la livrer à Cyprien
Fragonard, anatomiste, afin que ce dernier dissèque le modèle... )
Ce n'était pas mon premier choix. J'avais
voulu Stanley Myers que j'avais rencontré à Londres, mais j'ai pris confiance
en Jorge et je pense que c'est une des plus belles partitions qu'il a écrites.
Vous avez commencé
avec un film assez gonflé !
Oui, un film à costumes avec un thème qui est
la rencontre du modèle et de la momie. Je viens de récupérer les droits et j'ai
un DCP flambant neuf aujourd'hui !
On
aurait pu penser que vous auriez cherché des musiques Dix-huitième. Avec Arriagada vous êtes parti dans une autre direction...
Je savais qu'il fallait une musique de film
étant donné qu'il y avait l'univers Dix-huitième traditionnel de Fragonard, et
que l'autre aspect du film était un conte gothique. Il fallait une musique
quasiment à la Bernard Herrmann, une musique à
suspens, avec un romantisme noir, quelque chose qui n'était pas Dix-huitième.
L'idée de faire des emprunts, à la « Barry
Lyndon », d'aller chercher du Vivaldi, je l'ai écartée d'emblée. Il y
a quarante minutes de musique dans le film et cela a été un vrai bonheur de
travailler avec Jorge. « Sur Les
Années Juliette », je lui avais évidemment proposé de composer la
musique ; mais là il y a eu un hiatus entre la musique et le film. C'était
assez violent. Il avait composé une musique qu'il avait même enregistrée, et
finalement on y a renoncé.
Il l'a écrite d'après
scénario ?
Non, c'est d'après le montage. Jorge, il lui
faut les images. Je sais qu'il y a des compositeurs qui travaillent sur
scénario. C'est le cas de Morricone : il préfère ne rien voir et aime que les
images soient montées sur sa musique.
Vous
parlez de Morricone. On dit souvent que les réalisateurs n'ont pas de culture
musicale : est-ce votre cas ?
J'avais une culture de musique de film et
c'est par cette musique que je suis venu à la musique tout court. Disons que
mes deux divinités sont Delerue et Herrmann : ce sont
deux grands inspirateurs.
Vous avez fait
l'IHDEC : on ne vous parlait pas de musique à l'époque ?
A l'IHDEC on ne vous parlait que de très peu
de choses. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un type merveilleux qui a écrit
un livre consacré à la musique de film. C'est Henri Colpi
- Défense et illustration de la
musique dans le film -. Colpi avait travaillé avec Delerue,
notamment sur son film « Une Aussi Longue Absence », avec la
fameuse chanson « Trois Petites Notes de Musique » qui l'a fait vivre
pendant 20 ans ! C'était un grand monteur – « Hiroshima Mon
Amour », « L'Année Dernière à Marienbad
», et d'autres films. Je l'ai vu caler de la musique sur l'image, il avait
une intuition qui était extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'on a écrit de la
musique pour une image que ça va marcher. Alors pourquoi une musique marche ou
pas ? Là on entre dans quelque chose d'absolument mystérieux. Souvent les
musiques qui ont été écrites pour une séquence, on découvre, en fait, qu'elles
fonctionnent mieux ailleurs et vice versa. Je pense qu'un film sécrète un
imaginaire musical mais qu'après, les correspondances entre les images et les
sons sont de l'ordre de l'accident, du mystère. Mais en tout cas jamais de la
raison.
Lorsque vous montez, mettez-vous
des musiques temporaires ?
J'essaye d'en mettre le moins possible, même si
j'en ai la tentation parce que je risque de m'y habituer et ne pas accepter la
musique d'un compositeur. Mais lorsqu'il y a des projections de travail avec la
production, on est obligé d'en mettre.
Qu'écoutiez-vous lorsque vous
étiez jeune ?
J'ai découvert la musique classique par le
cinéma. Je me souviens d'un film avec Charlton Heston,
je devais avoir dix ou onze ans. Je crois que le film s'appelait « La Symphonie des Héros ». Je suis
bien incapable de me souvenir du metteur en scène, [Ralph Nelson] - ça se passait pendant la guerre de 40, il était le
chef d'un orchestre qui se faisait prisonnier des nazis et il y avait Le Lac
des Cygnes de Tchaïkovski. C'était une grande découverte musicale
originelle. Après j'ai acheté le disque et pendant très longtemps j'ai adoré
Tchaïkovski. Tous les mélomanes hurlent quand on dit qu'on aime ce
compositeur ! Je pense que ce compositeur est le précurseur de la musique
de film ; le deuxième étant Ravel !
Après
le fiasco musical de « L'Année Juliette » vous avez changé de
compositeur !
Le personnage du film est flûtiste, donc il
reste des thèmes de musique classique : Mozart, Debussy, Khatchaturian.
Mais pas ceux composés par Jorge. Il y a eu un conflit avec le producteur.
Après j'ai fait un film, « Trois
Huit », avec Yann Tiersen, à peine connu,
qui habitait dans un petit deux pièces. Il n'avait pas encore fait « Amélie Poulain » ; il avait écrit
une chanson que j'aimais bien. Le premier qui avait utilisé Tiersen
c'était Zonca dans « La Vie Rêvée des Anges » : c'est « Rue des Cascades »,
une chanson pour le générique de fin. Pour « Trois Huit » (Pierre est ouvrier dans une usine de verre. Tout va basculer
lorsqu'il décide de travailler en nocturne. Là, il rencontre l'équipe de nuit,
dont Fred qui va faire de lui son souffre-douleur),
je voulais quelque chose d'assez sec. Il y a la chanson « L'Homme aux bras
ballants », très mélancolique, que j'ai mise et puis j'ai eu besoin d'une
dizaine de minutes de musique dans le film et il les a composées d'une manière
très instinctive en regardant à peine l'image.
www.youtube.com/watch?v=YXvznEXRTB8&index=1&list=RDYXvznEXRTB8
Pour « Le Coût de la Vie » (Une héritière qui n'arrive pas à
hériter, un radin qui ne peut rien dépenser, un petit garçon qui trouve un
billet dans la rue, un restaurateur prodigue qui ne fait que donner... Tels
sont, entre autres, les personnages de ce film "choral".), je
voulais retravailler avec lui. Mais entretemps il y a eu « Amélie Poulain » et là ça était un désastre. Il avait
un manager, il ne m'a rien donné, il est arrivé un beau jour avec une heure et
demie de musique et il n'y avait pas un morceau qui collait ! Le sauveur,
ce fût Philippe Rombi. J'étais à Cannes : je vois
« Swiming Pool » de François Ozon, j'entends
la musique et je me suis dit : pourquoi je n'ai pas cette musique dans mon
film ! On l'a appelé, et en un mois il a écrit la musique.
www.youtube.com/watch?v=WWi4nsfupqU
J'ai continué avec lui sur « Du Jour au Lendemain » (La vie est bien
ingrate pour François Berthier : un chien hurle toute la nuit et l'empêche de
dormir, la machine à café lui explose au visage, il pleut, le chef de bureau à
la banque l'humilie et le menace de renvoi. Et puis, du jour au lendemain, tout
ce qui était violent ou pénible pour François se transforme comme par miracle.
Que se passe-t-il ? Pourquoi le monde devient-il si brusquement doux et
enchanteur ? C'est l'énigme que va essayer de résoudre François.)
C'est formidable ce qu'il a fait : il y avait
une sorte de petit morceau de comédie musicale. Puisque c'est l'histoire d'un
type qui est angoissé par le bonheur, je voulais qu'il soit prisonnier d'une
comédie musicale. Benoît Poelvoorde est extraordinaire.
J'ai retrouvé Jorge pour « Les Femmes du Sixième Étage » (Paris, années
60 : Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « coincé
», découvre qu'une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit,
lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l'opposé des manières
et de l'austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se
laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois.
Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?). La raison pour
laquelle j'ai retravaillé avec lui, c'est que je voulais que les femmes
chantent des chansons espagnoles : il y a de la guitare, des coplas. Et puis il
m'a beaucoup rassuré, il y avait de la musique sur le plateau, il a réadapté un
tube espagnol. Il a surtout la dimension émotionnelle. Une émotion se dégage de
sa musique qui est tendre, proche des personnages, qui allait parfaitement avec
le film.
www.youtube.com/watch?v=6cynRV3a67A
C'est toujours
difficile d'écrire pour des comédies ?
Il ne faut pas attendre de la musique qu'elle
soit drôle, qui même souligne les effets comiques.
Cela devient du Tex
Avery, du Mickey Mousing !
Voilà. La musique en réalité est d'abord un
élément de rythme, et pour une comédie ça aide. Ensuite, l'usage qu'on en a
fait est un usage émotionnel : elle souligne l'émotion des personnages, et
notamment le trouble, car pour ce qui est des femmes, il s'agit de l'histoire
d'un grand bourgeois qui est troublé par la présence de ces espagnoles. On m'a
même proposé d'en faire une comédie musicale. C'est un producteur de Broadway
qui en avait l'idée. J'ai dit oui tout de suite, mais ça s'est perdu dans les
sables… Je pense que les chansons espagnoles et la variété des années soixante
peuvent servir de base pour une confrontation avec un côté « West Side
Story » avec la chanson America - « Life is all right in America/If you're all white in America » - Il y avait la confrontation de deux
univers musicaux. Je m'aperçois que l'usage de la musique pour moi est question
de personnages : quel est le personnage et quel est le parcours émotionnel
du personnage ? La musique est là, bien sûr, pour être en accord avec les
images mais fondamentalement la musique est le prolongement des personnages ;
c'est cela l'accord souterrain…
Surtout par rapport à l'usage que
vous en faites dans vos films, cela doit être très complexe d'écrire des
musiques pour vous ?
Ce
n'est pas facile, d'autant qu'en réalité il n'y en a pas tant que cela. J'adore
les grandes plages musicales : la fin de « L'Impasse » de Brian de Palma avec la musique de Patrick
Doyle, ou la grande scène, toujours chez De Palma, de filature dans le musée de
« Dress To Kill ». Brusquement la musique
de Pino Donaggio devient un support narratif : plus
qu'un support, elle devient le récit. J'adorerais faire ça un jour. C'est dans
la conception de l'écriture : on sait qu'on va avoir quinze minutes en silence
et c'est la musique qui va créer la construction dramatique. Ce n'est pas
innocent que De Palma ou même Hitchcock soient les champions toute catégorie
de ce genre de séquence avec ce mélange de saccades et de lyrisme…
Ensuite vous avez continué avec Jorge Arriagada...
Dans
« Alceste à Bicyclette » (Au sommet de sa carrière d'acteur, Serge
Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. Trop de colère,
trop de lassitude. La fatigue d'un métier où tout le monde trahit tout le
monde. Désormais, Serge vit en ermite dans une maison délabrée sur l'Île de Ré…
Trois ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision adulé des
foules, abonné aux rôles de héros au grand cœur, débarque sur l'île. Il vient
retrouver Serge pour lui proposer de jouer «Le
Misanthrope» de Molière), Il y a quinze minutes de musique, générique
compris.
www.youtube.com/watch?v=sPOAGC4BkiE
Là aussi ce n'était pas évident
d'écrire de la musique, il aurait pu ne pas y en avoir...
On
a beaucoup cherché sur le thème du générique début. Soit c'était trop joyeux et
c'était une fausse note, soit c'était trop sombre et on croyait que cela allait
être un film noir. Le film commençait avec huit minutes dans un théâtre. Je
l'ai enlevée ! Maintenant le film débute avec Lambert Wilson dans un train
et le générique est sur les images, entre le départ du train et l'arrivée dans
la maison de Fabrice Lucchini. Il y a un thème tout du long, avec des reprises,
des arrêts mais très souterrains, même sous les dialogues. Jorge a dû s'y
reprendre à plusieurs fois pour trouver une tonalité à la fois sombre et
lumineuse. Sombre dans le sens où il y a un mystère avec des basses qui créent
une interrogation : Qui est ce personnage ? Où va-t-il ? Avant il y
avait les explications, j'ai tout enlevé ; donc la musique est là un élément de
la narration. Si on a un personnage dont on ne sait qui il est et où il va, la
musique peut s'accorder à son sentiment. Par contre, si on ne sait pas, la
musique doit entretenir ce mystère.
Comment travaillez-vous avec lui ?
Comme
c'est un gros travailleur, il vient avec sa musique. On essaye, ça marche ou
pas. On s'est trompé, il recommence, on réessaye, on écoute. Mes indications sont
très concrètes. Il compose à l'image près et s'il demande six images de plus,
on lui met six images de plus…
Et pour « Floride »?
Il
y avait une volonté d'éclaircir un sujet grave, c'était la première commande de
la musique, la deuxième commande était l'intériorité du personnage, on entre
dans sa tête. Il y a des choses qui s'insinuent, qui sont à mi-chemin entre la
musique et le montage son, des bruits qui deviennent musicaux, des musiques
avec des étirements, un travail qui s'est fait beaucoup au mixage. Il y a quand
même une émotion à la fin lorsque la fille met son père dans la maison de santé
: on doit sentir que la vie continue. La commande était très précise. Il y a
toujours un mystère pour moi entre la commande et l'inspiration du musicien : d'où
vient que telle musique appartient à ce film et pas à un autre ? C'est la
question qu'on peut se poser sur tous les films. Lorsqu'on écoute les grandes
collaborations de Delerue - Truffaut, on se dit toujours : mais il aurait pu
composer la musique de « Les Deux
anglaises et le Continent » pour « La Peau Douce » ou vice versa. Et bien non ! La musique
de « La Femme d'à Côté »
c'est la musique de « La Femme d'à
Côté » !
www.youtube.com/watch?v=745p0KnFcBY
Et on reconnaît que c'est du Delerue
Et
on reconnaît que c'est du Delerue. Dans « La Femme d'à Côté », au début, il y a cette tension de
l'hélicoptère, il y a quelque chose de tendu, presque de messe funèbre, et puis
il y a une note suspendue, et là il y a du pur Delerue, une sorte de
relâchement de cette tension, un mouvement de cordes très langoureux, paisible,
qui fait que la musique de ce compositeur réussit ce paradoxe d'être joyeuse et
mélancolique. C'est cela le mystère Delerue. J'avais vu un entretien avec lui
où il s'amusait à son piano, et il était comme un enfant très joyeux. Il disait
: on me propose toujours des musiques tristes, mais je suis quelqu'un de
joyeux. Récemment j'ai vu « Diamant
Noir » de Harari. J'ai trouvé la musique d'Olivier Marguerit
superbe.
Et le prochain film ?
J'ai
un sujet sur lequel je travaille depuis deux ans et demi ; c'est beaucoup mais
pas tant que cela. Il y a des films qui s'écrivent et se montent très
facilement et avec d'autres on galère. Mon prochain se passe en Normandie, avec
des agriculteurs : ce sont des taiseux un peu déprimés. C'est un univers à la
Depardon, mais il y a quand même une forme d'humour.
Avez-vous pensé à la musique ?
Je
ne vois pas quel univers musical peut correspondre à mes personnages, de ce qui
leur arrive, de leurs excès, de la connivence que j'ai avec eux. J'aimerais
mettre des tubes, des chansons, mais je n'ai pas du tout cette culture-là ; la
variété n'est pas ma culture. Je suis toujours épaté par les metteurs en scène
qui arrivent à mettre des musiques rock, des chansons dans leurs films. Dans
« Pretty Woman »
par exemple, Marshall met le tube Pretty Woman et c'est parti, et il y en a 15 comme ça dans le
film. C'est ce que j'aimerais faire, mettre des chansons connues. Regardez ce
qu'a fait Jonathan Demme avec « Something Wild », c'est
formidable ! Il y a des tubes qu'il a puisés dans sa discothèque et des
chansons qui ont été composées pour le film ! C'est ce que j'aimerais
faire : un tube avec des tracteurs !
Vous avez des jeunes compositeurs
qui sont capables de vous proposer ce genre de composition… Bon courage pour
votre tournage de « Normandie
Nue » en mars !


Propos recueillis par
Stéphane Loison.
BO en CDs
CUTTHROAT ISLAND (L'île aux Pirates 1995). Réalisateur:
Renny Harlin. Compositeur: John Debney. 1CD
La-La Land - LLLCD1387
Le plus cuisant
échec commercial, ce film de pirates est pourtant plein d'actions, d'abordages
et Geena Davis est formidable dans ce rôle à la
Yvonne de Carlo des années 50. La musique de John Debney
(The jungle Book, Iron Mann 2, The
Passion of The Christ) est très énergique à la manière d'antan, à l'opposé
de celle de Zimmer pour les films de pirates. Un vrai régal pour les yeux et
les oreilles !

www.youtube.com/watch?v=1Nni777i0HU
ADIEU
BONAPARTE – THE FIRST CIRCLE. Réalisateur : Youssef Chahine - Sheldon Larry. Compositeur : Gabriel Yared. 1CD Music Box
Records - MBR-095
« Adieu Bonaparte » est une fresque romanesque réalisée par Youssef Chahine
avec Michel Piccoli et Patrice Chéreau. En 1798, Bonaparte envahit l'Égypte et
se pose en libérateur face à l'oppression turque. Il est accompagné du général Caffarelli, scientifique et humaniste, qui se lie d'un
attachement profond pour deux jeunes frères Égyptiens. Gabriel Yared a composé un très beau thème mystérieux, écrit pour
orchestre symphonique et des chœurs ténébreux. Le reste de sa partition navigue
entre ambiances orientales et climats mystérieux.
« The First Circle » est un film adapté du roman de l'écrivain soviétique
Alexandre Soljenitsyne, réalisé par Sheldon Larry, avec F. Murray Abraham,
Robert Powell et Christopher Plummer. D'anciens scientifiques, prisonniers
politiques en URSS, sont envoyés dans une prison spéciale, située près de
Moscou, où ils se retrouvent forcés de travailler pour le gouvernement. Gabriel
Yared a signé une partition intimiste mettant en
valeur les ambiances feutrées aux rythmiques électroniques, avec l'utilisation
de voix bulgares.

www.youtube.com/watch?v=3fwQkLBtkWQ
UNE FEMME FIDELE. Réalisateur : Roger Vadim. Compositeur : Mort Shuman, Pierre Porte. 1CD Music Box Records - MBR-094
Librement
inspiré du roman épistolaire Les
Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos
de Laclos, « Une femme fidèle » met en scène le Comte Charles de Lapalmmes
(Jon Finch) et Mathilde Leroy (Sylvia Kristel), deux
« doubles » du Vicomte de Valmont et de La Présidente de Tourvel. Roger Vadim s'était déjà penché sur « Les
Liaisons dangereuses », en signant en 1959 une adaptation contemporaine du
roman de Laclos, sur une musique du jazzman Thelonious
Monk. Pour « Une femme fidèle », Roger Vadim (Et
Dieu… créa la femme, Barbarella)
fait un nouveau choix atypique, en demandant au chanteur/songwriter
Mort Shuman de composer la musique du film, en
collaboration avec son complice Pierre Porte. Pour le thème principal, les deux
compères composent un concertino pour piano, au lyrisme exacerbé, et destiné à
traduire l'aspect pur et sincère de la liaison entre Charles et Mathilde. Il
sera décliné sous différentes formes tout le long du film. Ainsi, dans La déclaration d'amour,
c'est le violon alto qui interprète cette délicieuse mélodie, conférant ainsi
une certaine gravité non seulement au thème, mais aussi à la scène du film.
D'autres plages font davantage preuve de délicatesse au niveau de
l'orchestration. C'est le cas de La
Mort de Mathilde, où la harpe traduit littéralement
le dernier souffle de la femme abandonnée.

QUI ÊTES-VOUS
POLLY MAGGOO ? / MISTER FREEDOM / LE COUPLE TÉMOIN. Réalisateur : William Klein. Compositeurs : Michel Legrand, Serge Gainsbourg,
Michel Colombier; 1CD Rambling Records -
JAP-RBCP-2994 (Import Japon)
L'intrigue
de « Polly Maggoo »
se partage entre le monde de la publicité, de la mode et de l'ORTF, et un
royaume d'opérette, dont le prince héritier Sami Frey s'éprend du mannequin
Polly Maggoo alors que la jeune femme fait l'objet
d'un reportage télévisé. Celle de « Mister Freedom » est une satire sur
l'impérialisme des E.U. Mister Freedom,
un superhéros américain, vient sauver la France de Red
China Man et de Moujik Man ! « Le
Couple témoin » est une expérience organisée par le Ministère de l'Avenir.
Expérience filmée dans l'appartement de demain, censée déterminer les mœurs et
les attentes du couple pour l'an 2000. Sur ce CD on retrouve des compositions
écrites pour les trois fictions réalisé par William
Klein, plus connu par ses photos et ses documentaires. La chanson de Polly Magoo est écrite dans le pur style Michel Legrand avec un
humour assez réjouissant. Pour « Mister Freedom », musique de Michel Colombier et Serge
Gainsbourg, on retrouve rock, funk et l'humour corrosif qui colle parfaitement
à ce film déjanté avec une Delphine Seyrig
hallucinante. Le Funk est aussi présent pour « La Couple Témoin »
composé par Michel Colombier. Une belle compilation pour des films qui sont
devenu rares !

www.youtube.com/watch?v=Is5IuN2Yoxo
www.youtube.com/watch?v=q42QHrJKYFM
www.youtube.com/watch?v=myJfal01OeM
INDEPENDANCE DAY. Réalisateur : Roland Emerich. Compositeurs : Harald Kloser et Thomas Wander. 1CD Sony Classical 8898529312
Au
secours ils reviennent, ils détruisent tout mais le fils de Will Smith (au
cinéma) va sauver le monde, et les américains bien sûr ! Et puis il faut,
l'indépendance n'étant plus à l'ordre du jour, l'aide des chinois !
Rassurez-vous, les jeunes pilotes vont la supprimer la vilaine bébête. Tout
n'est que trucages impressionnants mais avec une musique en décalage et c'est
peut-être là la surprise. Écouter chez soi cette musique de ces deux
compositeurs d'origine australienne est quand même agréable ; mais dommage que
cette résurgence après vingt ans d'oubli ! Oublions le film et écoutons la
musique. On a droit sur le CD à la énième version de Bang Bang
: celle-ci par Annie Trousseau. Après celle de Cher et surtout celle de Lady
Gaga, on peut oublier. C'était David Arnold qui avait composé en 1996 la BO du
premier ! Le compositeur des James Bond après Barry avait quand même une
sacrée patte !

HIBOU. Réalisateur : Ramzy
Bedia. Compositeur : Arthur Simonini,
Ulysse Cottin, Louis Sommer. 1CD Milan 399 847-2
Rocky
est un homme discret. Il est heureux mais n'existe dans le regard de personne.
Un soir, en rentrant chez lui, il découvre un hibou "Grand Duc"
sur son canapé qui le fixe intensément. Il comprend qu'il doit agir. Le
lendemain, arrivé à son bureau, il revêt un déguisement de hibou sans que
personne n'y prête la moindre attention. Jusqu'au jour où il rencontre une panda... Premier film de Ramzy
Bedia, voilà une fable pleine de poésie et d'humour
absurde sur ce personnage qui est invisible aux yeux des autres. Un film plein
de maladresses mais touchant. La musique est extrêmement sympathique, joyeuse,
avec un thème joué par des instruments à vent, ou en rockabilly
qui ajoute à la candeur et à la naïveté des personnages. Arthur Simonini est violoniste, compositeur surtout connu pour ses
arrangements, Louis Sommer est acteur et clarinettiste (joli
valse de Father's Theme),
Ulysse Cottin joue du piano et de la guitare. Ils ont participé tous les trois
à la création de cette musique a-typique qui colle
bien au film. C'est une musique avec de jolis moments de tendresse. Un film et
une musique à apprécier sans chercher un quelconque second degré.

GENIUS. Réalisateur : Michael Grandage
.Compositeur : Adam Cork 1CD Milanmusic 399
839-2
Écrit
par John Logan (Spectre, Skyfall, Hugo Cabret…),
« Génius » est l'histoire de Thomas Wolfe,
écrivain à la personnalité hors du commun, et révélé par le grand éditeur
Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway.
Thomas Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques
grâce à son talent littéraire fulgurant. Malgré leurs différences, l'auteur et
son éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre, qui marquera leur
vie à jamais. Ce film magnifique est accompagné par des musiques discrètes, de
mélodies des années 20! Dans un club de jazz à Harlem
où Thomas Wolfe fait le parallèle entre jazz et littérature, un grand moment de
Jude Law, le swing du trompettiste Chris Storr et de son orchestre est
exemplaire, on y est ! Comme la lumière, le décor, la musique est tout à
fait juste pour recréer cette ambiance new yorkaise du début du XXème siècle.
On sent qu'Adam Cork
connaît bien son sujet et surtout qu'il a une vraie relation avec
le réalisateur avec qui il travaille de longue date. « Genius » est
un film fascinant et la BO sur CD est tout à fait agréable à écouter.

GHOSTBUSTERS. Réalisateur : Paul Feig. Compositeur : Theodore Shapiro
S.O.S.
FANTÔMES est de retour, revisité et dynamisé avec ce coup-ci un casting féminin
et de tous nouveaux personnages plus hilarants les uns que les autres. Paul Feig offre sa vision super vitaminée de la comédie
surnaturelle, et les fantômes n'ont qu'à bien se tenir ! La musique de Shapiro
reprend le célèbre thème du précédent Ghosbusters qui
est arrangé assez astucieusement. C'est de la musique « énergisante »
bien ficelée. Théodore Shapiro a composé de nombreuses BO, efficaces, solides,
mais qui n'ont pas laissé de grand souvenir. Il avait fait celle de « La
Vie Rêvée de Walter Mitty » et « Tonnerre
sous les Tropiques », deux films de Ben Stiller (il vient de faire le
dernier de ce réalisateur, « Zoolander 2 ») . Son heure de gloire fut avec « Le Diable s'Habille
en Prada » en 2005. Ce disque est agréable à écouter, c'est du travail de
pro, peut-être la meilleure composition de Shapiro !

https://www.youtube.com/watch?v=dIeA6TRI4I8&list=PLDSdIQfEoZflARFTkpRkJxDZASKntvDYB&index=3
JUILLET AOUT. Réalisateur : Diastème.
Compositeur : Frédéric Lo. BOriginal Cristal
Records 80029
Diastème est à la mode (il écrit pour
Christophe Honoré…). La presse va trouver de nombreuses qualités à ce film qui
est à cent coudées en dessous des films sur le même sujet de Pascal Thomas ou
même de « L'Hôtel de la Plage » ou d'autres films de la petite bourgeoisie
en vacances. Cette comédie cucu, niaise, avec tous les poncifs du film
« charmant », « de l'été », a trouvé son chantre avec Frédéric
Lo et Alex Beaupain, et chanté ( ?)
par Jérémie Kisling ! « Juillet Août » va vous faire aimer
« Camping 3 », le vrai film de l'été ! A lire les textes
inénarrables de Diastème et
Lo ! Les chansons dans le film sont « comme un chœur
grec qui traverse le film » ! Et Platon a dû écrire le
scénario !

STAR TREK (Beyond) (sans limite). Réalisateur: Justin Lin. Compositeur:
Michael Giacchino. 1CD Varèse
Sarabande VSD-067397
Star
Trek est de retour! C'est le 13ème long métrage de
cette franchise !
Il est produit par J.J.Abram - réalisateur des deux derniers et excellents
Star Trek et qui a commis le dernier Star Wars ! –
« Beyond » est réalisé par le réalisateur de « Fast and Furious » ! Il
y a donc de l'énergie et dans le scénario et dans la mise en scène. Il y a
aussi de l'émotion ; les rapports aux pères qui sont morts sont présents
dans l'histoire, mais aussi face à la réalité car en 2015 Léonard Nimoy alias Mr.Spock
s'est éteint et c'est un élément du scénario – la fiction rejoint la réalité –
Anton Yelchin qui interprète Pavel Chekov vient de se tuer en voiture au mois de juin, il
avait 27 ans ! Depuis le 11 septembre 2001, dans tous les films
catastrophe il y a destruction du symbole de la liberté, ici l'Enterprise,
avant la riposte victorieuse ! On retrouve bien sûr toujours la
marque de fabrique de Star Trek avec les symboles de fraternité, de paix, de
tolérance entre les peuples de l'univers. Les trucages sont impressionnants –
il faut voir le film en Imax, il donne le vertige !–
et la planète Yortown n'a jamais était aussi
surprenante ! La musique est signée par Michael Giacchino.
Il avait écrit pour les deux précédents. Ce compositeur a toujours autant de
talent et il sait reprendre le fameux thème et l'arranger de brillantes façons
- Il avait fait ce même travail avec « Mission Impossible » - Les vents, les cordes et aussi les chœurs sont
utilisés à bon escient. Il a écrit un véritable space
opéra de 1h30 avec des moments de lyrisme, de tendresse (Night On The Yorktown)
et aussi d'action. Il est le digne héritier de Goldsmith. L'humour dans le
scénario est présent, avec une chanson des Beastie
Boys (allez voir le film pour comprendre). C'est Rihana
qui chante le générique de fin, une bien belle chanson. Voilà un blockbuster
enthousiasmant par la mise en scène et par la musique, qui fait oublier une
autre franchise - une grande déception, même musicale - Star Wars VII !

https://www.youtube.com/watch?v=OE0PtJLe8IQ
RIO de JANEIRO (Ville Merveilleuse ?).
Réalisateur : Pascal Cuissot,.Compositeur
: Renaud Barbier. 1CD BOriginal, Crystal Record
Arte a proposé au mois de juillet en
commentaire des jeux olympiques un documentaire passionnant sur 450 ans de Rio
de Janeiro, son peuplement, son extension et ses différents quartiers, sur
l'évolution architecturale de cette ville et sa diversité culturelle. Renaud
Barbier a déjà composé pour des documentaires de Pascal Cuissot (Le Colisée,
Vauban.) des musiques subtiles. Pour Rio, il n'est pas tombé dans le cliché de
la musique brésilienne. Il a cherché de nombreuses textures musicales avec un
mélange de chants indiens, religieux, des sons électroniques, du jazz et même
du rock. L'ensemble est une nouvelle fois original et colle parfaitement aux
discours de ce documentaire captivant. Le CD prouve une nouvelle fois le talent
de ce compositeur que le cinéma n'emploie pas assez souvent. Dommage !

Stéphane Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Le site de l’Education Musicale
La librairie de L’éducation
musicale
| 1.STOCKHAUSEN JE SUIS LES SONS | ||
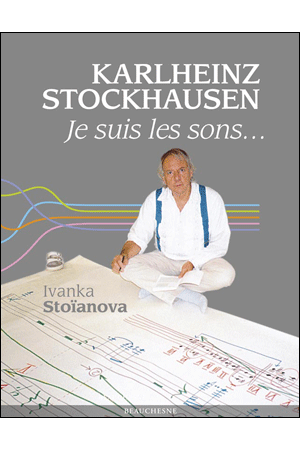 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite)
|
|
| 2. ANALYSES MUSICALES VIIIè SIECLE - Tome 1 | ||
 |
BACH Cantate BWV 104 Actus tragicus : Gérard Denizeau Toccata ré mineur : Jean Maillard Cantate BWV 4: Isabelle Rouard Passacaille et fugue : Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu : Janine Delahaye Phœbus et Pan : Marianne Massin Concerto 4 clavecins : Jean-Marie Thil La Grand Messe : Philippe A. Autexier Les Magnificat : Jean Sichler Variations Goldberg : Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale : Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses : Gérard Denizeau Apothéose Corelli : Francine Maillard Apothéose de Lully : Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus : Sabine Bérard Israël
en Egypte : Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile : Jacques Michon L’alleluia du Messie : René Kopff
Musique feu d’artifice : Jean-Marie Thill |
|
| 3. LE NOUVEL OPERA | ||
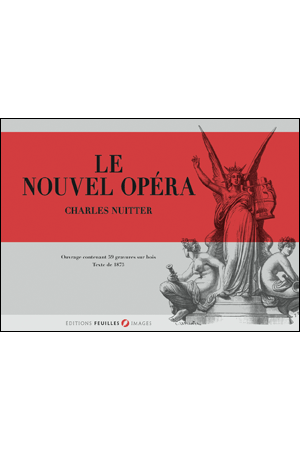 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
|
| 4. LEOS JANACEK, JEAN SIBELIUS, RALPH VAUGHN WILLIAMS - UN CHEMINEMENT COMMUN VERS LES SOURCES | ||
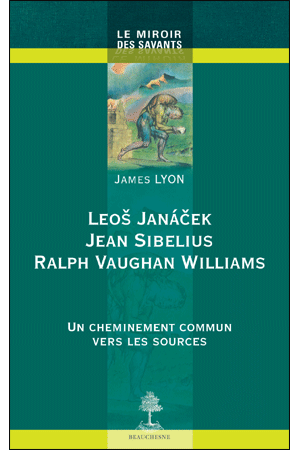 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque.
|
|
| 5. LA RECHERCHE HYMNOLOGIQUE | ||
 |
En plein essor à l'étranger, particulièrement en Allemagne, l'hymnologie n'a pourtant pas encore acquis ses titres de noblesse en France. |
|
| 6. JOHANN SEBASTIAN BACH - CHORALS | ||
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. |
|
| 7. LES 43 CHANTS DE MARTIN LUTHER | ||
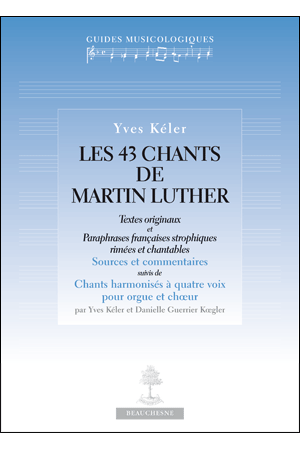 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. |
|
| 8. LES AVATARS DU PIANO | ||
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ?
Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ?
Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui.
Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ?
Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique. |
|
| 9. CHARLES DICKENS, LA MUSIQUE ET LA VIE ARTISTIQUE A LONDRES A L'EPOQUE VICTORIENNE | ||
|
|
Au travers du récit que James Lyon nous fait de l’existence de Dickens, il apparaît bien vite que l’écrivain se doublait d’un précieux défenseur des arts et de la musique. Rares sont pourtant ses écrits musicographiques ; c’est au travers des références musicales qui entrent dans ses livres que l’on constate la grande culture musicale de l’écrivain. Il se profilera d’ailleurs de plus en plus comme le défenseur d’une musique authentiquement anglaise, forte de cette tradition évoquée plus haut. Et s’il ne fallait qu’un seul témoignage enthousiaste pour décrire la grandeur musicale de l’Angleterre, il suffit de lire le témoignage de Berlioz (suite). | |
Les analyses musicales de L'Education Musicale