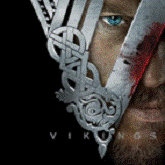LE FESTIVAL D'AIX EN PROVENCE : UN GRAND MILLESIME
PRESTIGIEUX FESTIVAL DE SALZBURG
ECLECTISME AU FESTIVAL DE MONTPELLIER
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
À RESERVER SUR L'AGENDA
20 / 09
Création de La Fureur d'Aimer d'Édith Canat de Chizy

© DR
La nouvelle œuvre d'Édith Canat de Chizy, inspirée par les
fulgurances de la poésie mystique d’Hadewijch d’Anvers, sera donnée en création mondiale au collège des Bernardins. Une
femme, compositrice du XXIe siècle se fait exégète musicale d’une
mystique du XIIIe siècle, la poétesse flamande Hadewijch d’Anvers, dont la vie reste très mystérieuse. Celle-ci fut en effet l’une de
ces béguines vivant dans une communauté féminine, vouée à la prière et la
contemplation, volontairement en marge d’une Église trop souvent oublieuse de
ses valeurs premières. Son parcours spirituel est singulier, dont rendent
compte ses écrits où Dieu, cet Autre âprement désiré, est partout présent en
une foi ardente, hors de toute rhétorique théologique. L’univers contemplatif
d’Hadewijch ressemble plus à une mer déchaînée qu’à
un long fleuve tranquille. N’écrivait-elle pas : « Vous avez trop peu souci de I'Amour qui me possède, dont j’éprouve si terriblement l’étreinte et la violence. Mon
cœur, mon âme, mes sens ne reposent ni jour ni nuit, pas une heure : cette
flamme ne cesse de brûler dans la moelle de mon être ». Les textes,
issus des « Poèmes spirituels » d’Hadewijch d’Anvers,
seront chantés ou dits par sept solistes, pouvant être également distribués en
soli, duo, trio, quatuor. Édith Canat de Chizy tisse son propos musical en le confrontant à celui
d’autres compositeurs. Cette musique d’aujourd’hui fait ainsi écho aux
compositions d’Hildegard von Bingen, l’incontournable abbesse visionnaire et compositrice du XIIe siècle, de Klaus Huber, musicien suisse contemporain dont l’œuvre fait souvent
référence aux traditions d'écriture de la Renaissance et du Moyen Âge, de Cristóbal de Morales, compositeur espagnol de musique
sacrée de la Renaissance, et enfin de Claudio Monteverdi. Pour cette création,
on a fait appel à l’Ensemble Solistes XXI : une formation constituée de
chanteurs aux sensibilités stylistiques multiples que son créateur et animateur
Rachid Safir a voulu virtuose du répertoire de la
polyphonie vocale de la Renaissance à nos jours.
Collège
des Bernardins/Festival d'Ile de France, 18-20, rue de Poissy, 75005 Paris, le
20 septembre 2013, à 20H30.
Location
: par tel : 01 53 10 74 44 ; en ligne : www.festival-idf.fr/2013/concert/la-fureur-d-aimer
29 / 09 et 3, 6, 10, 13, 15 /10
Manon au Capitole

© DR
La mise en scène de Manon, conçue par Laurent Pelly, atteint enfin l'hexagone,
et logiquement Toulouse, où celui-ci illustre d'ordinaire plus volontiers ses
talents au Théâtre National. On attend beaucoup de cette lecture de l'opéra de
Massenet, du parcours de cette femme mythique, qui au-delà de son charme
insaisissable, offre un caractère autre qu'insouciant, séductrice presque à son
corps défendant. Ne souffre-t-elle pas d'une attraction quasi irrépressible
pour les contraires : joie presqu'enfantine et gravité abyssale, hyper activité
et peur effrayante de l'ennui, attrait pour la facilité de l'argent et désir
sincère d'aimer ? Assurément, une mine d'idées pour un régisseur. Si on est
assuré d'une lecture sans complaisance, on l'espère révélatrice. L'affiche
musicale, en tout cas, ne se refuse pas : Natalie Dessay et Charles Castronovo, pour incarner les amants
malheureux, et au pupitre, Jesus Lopez Cobos, un fin connaisseur du répertoire français.
Théâtre du Capitole, les 29 septembre, 6, 13 octobre, à 15H ; et
les 3, 10, 15 octobre, à 20H.
Location : Théâtre du Capitole, Place du Capitole, BP 41408
Toulouse Cedex 6 ; par tel : 05 61 63 13 13 ;service.location@capitole.toulouse.fr ou wwww.theatreducapitole.fr
16 au 20 / 10
Pianoscope à
Beauvais

Pour la 8ème édition du festival Pianoscope, Boris Berezovsky reprend le flambeau artistique de Brigitte Engerer,
sa fondatrice et inspiratrice : un festival rêvé « comme une rencontre
entre amis musiciens soucieux d'associer le public à leur joie de jouer
ensemble et heureux de partager leurs découvertes » souligne le pianiste
russe. Plusieurs lignes de force commandent la programmation : la découverte de
jeunes pianistes, le français Rémi Geniet, les russes
Yuri Favorin, Alexei Petrov
et Mikhaïl Turpanov ; puis le folklore d'Europe
centrale, avec les chanteurs de l'Église de Saint Panteleimon de Tbilissi (chants anciens orthodoxes et populaires géorgiens) et l'ensemble
traditionnel tzigane de Leonard Lordache (musiques
traditionnelles roumaines) ; les rendez-vous avec les étoiles encore : Michel
Portal (pour un concert Jazz, avec Bojan Z au piano), Roger Muraro,
mais aussi le trompettiste Serguei Nakariakov ; les
piliers de la « troupe de Pianoscope »
aussi : Henri Demarquette, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, la violoniste Deborah Nemtanu,
l'altiste Ellina Pak, la
flûtiste Juliette Hurel ; enfin, la présentation de
trésors méconnus, comme les pièces pour piano de Nikolai Medtner ou de Alkan, la
Sonate N° 7 de Scriabine, les Métopes de Szymanovski,
ou la Sonatine pour trompette et piano de Jeanine Rueff. C'est qu'on joue ici,
soit en récital, soit en formation de musique de chambre.
Du 16 au 20 octobre 2013, horaires
variables (et matinée scolaire, le vendredi 18/10 à 9H45) : Théâtre du
Beauvaisis ; la Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais ; Centre hospitalier de
Beauvais.
Renseignements et Location : Théâtre de
Beauvais, place Georges Brassens, 60000 Beauvais ; par tel : 03 44 45 49 72 ;
pianoscope.beauvais.fr ou
www.beauvais.fr
15, 18, 20, 23, 25, 28 / 10
La Vestale au Théâtre des Champs-Elysées

© DR
La Vestale est à n'en pas
douter, l'œuvre la plus connue de de Gasparo Spontini. Unissant la tragédie lyrique issue de
Gluck et la grande tradition vocale italienne, cet opéra, créé en 1807, et
dédié à l'impératrice Joséphine, est un exemple parfait du néoclassicisme dans
l'opéra français, déployant cette grandeur de ton inhérente aux pièces de cette
époque, par ailleurs illustrée par Cherubini ou Mehul.
Il devait être réhabilité par Maria Callas, lors de la fameuse production de
décembre 1954 à La Scala. L'amour passion d'une jeune vestale pour un général
romain inscrit le drame au sein d'une communauté vouée à la contemplation.
Celle-ci sera soudain bouleversée par le forfait de sa prêtresse qui au mépris
de ses devoirs, laisse s'éteindre la flamme sacrée. L'intensité des airs et des
duos ne le cède en rien aux grandes fresques scéniques. La clarté de la ligne
devrait trouver sa mesure dans la direction de Jérémie Rhorer.
Une rare occasion d'apprécier l'œuvre dans sa version d'origine, en
français.
Théâtre des Champs-Elysées, le 15, 18, 23,
25, 28 octobre 2013, à 19H30, et le 20 à 17H.
Renseignements et Location : 15 avenue
Montaigne, 75008 Paris ; par tél. : 01 49 52 50 50 ;
en ligne : theatrechampselysees.fr
Pour sa saison 2013/2014, la Péniche Opéra vogue en folie

© DR
Pour sa prochaine saison, la
Péniche Opéra entend illustrer le thème de la folie, si porteur en contrées
lyriques. Et en un festival, une idée longtemps caressée par sa fondatrice et
animatrice Mireille Larroche. Il verra le jour de
mars à mai 2014. Et se déclinera, d'abord, par « Les dits de la
folie », spectacle réunissant, d'une part, « 8 Songs for a mad king » de
Peter Maxwell Davies, et d'autre part, une création d'Alexandros Markeas, « Folie quotidienne », commande de
la Péniche Opéra. Le propos entend se nourrir de l'oscillation entre deux pôles
de perception de la présence du fou (du 14 au 21 mars 2014). L'ensemble Clément Jannequin, sous la houlette de l'inusable Dominique
Visse, proposera des conférences musicales, « folie en musique »,
dissertation musicale entre ancien et moderne, convenu et inattendu, autrement
dit l'éclectisme assumé. Mireille Larroche a concocté
une mise en espace (21 et 23 mars). La comédie L'île de fous de Egidio Romualdo Duny, sur un livret de Anscaume, parodie de Goldoni, créée en 1760, reprendra du
service grâce à la compagnie les Paladins de Jérôme Corréas et à la mise en scène de Mireille Larroche : une
fantaisie déraisonnable, qui se promet déjantée (28, 29 et 30 mars).
En avril, un spectacle intitulé
« Chambre », autour de la Kammermusik de Hans Werner Henze, sur des textes de Hölderlin, en première française, sera
l'occasion de pénétrer dans l'intimité de l'univers du poète, entre démence et
génie (9, 10 et 11 avril). Une autre création, « Carmen intime »,
partagée avec l'Opéra de Rouen, s'appliquera à décrypter l'amour fou qui mène à
la folie meurtrière. Ici, l'opéra de Bizet est adapté pour quatre chanteurs et
un violoncelle, une gageure (4,5 et 6 avril).

© DR
Enfin, le joli mois de mai
verra la concrétisation d'un projet qu'on veut à la pointe de l'avant-garde.
Après l'opéra Wozzeck, donné la saison dernière, « Chantier Woyzeck », du compositeur Aurélien Dumont, sur un
livret et une dramaturgie de Dorian Astor, ambitionne de puiser aux
sources même de l'œuvre littéraire,
savoir les fragments visionnaires du Woyzeck de Georg Büchner. Autrement dit, et au-delà de l'opéra de Berg, « revenir
à un état du texte où les personnages ne sont pas encore constitués en
caractères psychologiques, mais flottent dans une forme intermédiaire, en
marge », dit Mireille Larroche. Et l'occasion de
se confronter à un théâtre visuel et sonore, « jeu de construction de
nos désirs d'amour et de mort dans des lieux lieux invisibles suppurés par nos sociétés », selon Dorian Astor. Ou comment
revisiter une œuvre mythique pour en faire « un opéra de notre
temps » (du 16 au 20 mai).
Renseignements et Location :
Péniche Opéra, 46, Quai de la Loire, 75019, Paris ; tel.: 01 53 35 07 77
; www.penicheopera.com ;
penicheopera@hotmail.com
Jean-Pierre
Robert.
***
L’ARTICLE DU MOIS
Pour le compositeur lyrique Alvaro Legido (né
en 1952), l’épisode dit de L’enchantement
du Vendredi Saint(Karfreitagszauber en allemand), au cœur du troisième acte de Parsifal, ne
constitue rien de moins que « l’absolu musical ». Et il reste vrai
que même les détracteurs de Richard Wagner ne contestent pas la nature
envoûtante de cette page étrange, dont l’analyse scrupuleuse ne fait pourtant
surgir aucun effet qui la situerait en marge du grand œuvre wagnérien. Pour
tenter de saisir (à défaut de le comprendre) ce qui fait de l’Enchantement une réussite si
singulière, tout à la fois unique et exemplaire, démonstrative et inimitable,
le plus efficient est peut-être d’en revenir aux conditions particulières
d’écriture de l’ultime chef-d’œuvre du maître de Bayreuth (précision incidente,
le Porazzi-Thema de 1882, présenté
dans certains catalogues comme la toute dernière page du compositeur, n’est
jamais que la reprise d’un thème écrit en 1858 pour Tristan et finalement non utilisé).
Au temps donc de la composition de Parsifal, Wagner mène une
existence véritablement royale, au sein de sa villa Wahnfried,
palais où, maître absolu des lieux, il reçoit fastueusement des admirateurs
venus du monde entier, de préférence dans le salon de la musique et dans la
bibliothèque, deux espaces rehaussés de grands portraits peints et d’ornements
héraldiques. Pourtant, en dépit de la somptuosité du cadre et de la vénération
dont jouit son propriétaire, l’atmosphère est désormais plus à la mélancolie
qu’à l’euphorie ; le compositeur n’a-t-il pas fait construire au fond du
jardin le tombeau qui doit abriter son dernier sommeil et celui de
Cosima ? Par ailleurs, les écrits produits au crépuscule ne sont-ils pas
tous placés sous le signe de l’interrogation anxieuse, directe pour Was ist deutsch ? (Qu’est-ce qui est
allemand ? 1878), Wollen wir hoffen ? (Voulons-nous espérer ? 1879) ou Was nützt diese Erkenntnis ? (À quoi sert cette connaissance ? 1880), indirecte, mais tout aussi
angoissée, avec Religion und Kunst (Religion et art,
1880) ? Car à l’instar de tous les hommes, Wagner est prisonnier de son
enveloppe charnelle, une enveloppe désormais affaiblie et souffrante. Pour le grand musicien, hyperactif depuis sa plus tendre
enfance, ce n’est certes pas le moindre motif d’exaspération que cette
défaillance chronique de son corps, plus particulièrement de son cœur,
défaillance que la médecine du temps est impuissante à combattre.
Au crépuscule, la reconsidération religieuse
En
dépit, cependant, de l’âge et de la maladie, Richard Wagner ne récuse rien de
ses plus hautes ambitions pour la composition de Parsifal, entamée dès 1877. C’est
en janvier 1882, dans le cadre enchanteur de Palerme la sicilienne, qu’il met
la dernière main à cette ultime partition, dans le même temps qu’il reconsidère
totalement sa position intellectuelle et morale relativement au christianisme
et, de façon plus générale, à la religion. L’approfondissement continu de sa
connaissance du bouddhisme, une relecture attentive de Schopenhauer, il n’en a
pas fallu plus pour que la figure du Christ lui soit apparue sous un jour aussi
troublant qu’inattendu. Par quelle terrible confusion, s’interroge le musicien
vieillissant, le Christ aryen, miroir et symbole de la race la plus pure,
a-t-il été rapatrié sur les rives du Jourdain pour devenir une simple divinité
tribale des terres d’Israël ? N’est-il pas évident que son origine est
bien plus lointaine, que l’Inde est le véritable berceau de son aventure mystique,
que c’est aux rives du Brahmapoutre ou du Gange, et non sur celles du Jourdain,
qu’il faut en chercher les premières traces pour retrouver son authentique
visage ? De ces nouvelles méditations, affermissant la position morale
mais aussi les choix artistiques et esthétiques du compositeur, la composition
de Parsifal subit l’influence, aussi directe que pénétrante. Car, chez lui, il ne saurait
être question de césure entre l’homme et l’artiste. Loin de tenir à distance sa
nouvelle fascination pour la compassion et pour l’abnégation chrétiennes, il en
fait le nouveau moteur de son inspiration. Quelle meilleure occasion,
d’ailleurs, aurait pu lui être offerte de traiter en profondeur de la
compassion, caractère le plus distinctif du christianisme à ses yeux ?
Une conversion déconcertante
Isolée du
reste de l’opéra, la scène de l’Enchantement
du Vendredi Saint perd une grande partie de sa signification, presque tout
ce qui l’a précédé s’étant déroulé dans un climat de morne désespérance ou de
perplexité angoissée. Les souffrances du souverain de Montsalvat, Amfortas, frappé par le félon Klingsor, ne lui
accordent aucun répit ; ni baume, ni onguent, ni bain ne parviennent à
réduire sa souffrance. Le seul viatique ne peut être que la Lance Sacrée, celle
qui frappa le Christ et qui ne lui sera restituée que par le jeune Parsifal, dont la pureté et l’innocence n’ont pas souffert
la moindre altération. De ce chaste héros cependant, de ce jeune chevalier sans
tache, Klingsor croit pouvoir corrompre le cœur, au second acte, en chargeant
la sulfureuse et séduisante Kundry de l’échange d’un
long baiser passionné. Or, c’est précisément avec ce baiser que se joue
l’essentiel du drame. Car, loin de céder à la tentation de l’amour charnel, Parsifal saisit soudain ce qu’il avait déjà vu, au premier
acte, sans rien y comprendre, la blessure d’Amfortas,
la forfaiture de Kundry, le rachat dont il est seul à
posséder le secret. Le troisième acte est donc celui de la rédemption.
Longtemps après les événements précédents, Parsifal se présente une nouvelle fois au château de Montsalvat,
Sainte Lance à la main et ceint d’une armure noire. Le vénérable Gurnemanz lui offre le meilleur accueil, ainsi qu’une Kundry vieillie et épuisée, mais désormais fidèle au culte
du Graal. Une fois son heaume soulevé et son identité révélée, Parsifal s’agenouille devant la Sainte Lance pour prier,
avant d’être baptisé roi des chevaliers du Graal par Gurnemanz.
C’est ici que s’élèvent, séraphiques, les accents de l’Enchantement du Vendredi Saint qui suit le baptême de Kundry par le héros au cœur pur, sacrement qui fait
lui-même office de prélude à l’épilogue de l’opéra, marqué par la guérison d’Amfortas, dont Parsifal cicatrise
la plaie au prix d’un simple attouchement de la Sainte Lance et par la mort d’une Kundry apaisée. L’Enchantement
du Vendredi Saint se présente de la sorte comme l’apothéose d’un long
voyage initiatique au terme duquel le Bien aura triomphé du Mal, l’ascétisme de
la luxure, le rachat de la malédiction, l’idéal chevaleresque de la médiocrité
matérialiste ! Tout cela à la grande fureur ultérieure de Friedrich Nietzsche ! Avec le recul de l’Histoire, il faut bien admettre que
ce retour de l’iconoclaste Richard Wagner au sein de la confrérie chrétienne ne
pouvait manquer de déconcerter ses plus ardents admirateurs, voire de les
choquer, ne fût-ce que par son caractère délibéré de rituel commémoratif.

© DR
Du pessimisme à la rédemption, des ténèbres à la lumière
C’est
en 1854 que Wagner avait découvert Le
Monde comme volonté et représentation d’Arthur Schopenhauer
(1788-1860), ouvrage dans lequel il
avait salué avec enthousiasme l’expression de sa propre pensée. Pessimiste dans
la forme, cette théorie du renoncement en tant que seuil de la félicité ne pouvait,
certes, que séduire un homme, un compositeur, si avide de reconnaissance
artistique et de fortune matérielle. Il ne s’agit alors de rien de moins que de
se convertir à une nouvelle volonté, aux antipodes de tout mépris et de toute
volonté de pouvoir. Les conséquences de cette conversion sont assez
surprenantes chez notre musicien, allant de l’abstinence alcoolique à
l’exercice d’une judéophobie virulente ! Pour le
compositeur, en effet, rien de plus périlleux que le métissage et rien de plus
important que la grandeur d’un peuple allemand corrompu par un esprit de lucre
et de profit dont il ne voit d’autres prophètes que les fils d’Israël ! Au
passage, il est aussi à observer qu’il renie nombre de ses idées de jeunesse
relatives aux doctrines matérialistes, évolutionnistes et scientifiques dont il
s’était voulu l’ardent prosélyte. Désormais, il n’est point d’autre voie de
salut que l’intuition et point d’autre mission à l’art, plus spécifiquement à
la musique et au théâtre, que la représentation des vérités morales et
spirituelles à l’aide de symboles transcendants. C’est à ce seul miroir qu’il
faut ainsi observer les figures de Parsifal et de Kundry, protagonistes de l’Enchantement. Pour le compositeur, il s’agit bien plus, en
l’occurrence, de révéler le mystère de la Foi par la splendeur de sa vêture
sonore que de simplement transposer sur scène l’épisode, somme toute banal,
d’une occurrence sacrée. Occasion pour chacun de se remettre en mémoire que Parsifal renvoie
équitablement au vieux fonds des légendes germaniques et à l’imaginaire du
premier millénaire chrétien. Loin d’être évacuée, cette ambiguïté est soulignée
avec force dans l’opéra : Parsifal ne
s’étonne-t-il pas de ce que la Nature en larmes
dégage de si puissantes effluves, si parfumées ? Et n’est-il pas détrompé
par Gurnemanz lui révélant que la douce rosée n’est
rien d’autre que le total des larmes des pécheurs touchés par la grâce et par
le repentir ? Wagner lui-même n’a-t-il pas pris soin d’indiquer, dans ses
didascalies, que le regard levé par Kundry sur Parsifal est mouillé par les larmes de la
transfiguration ?
Une stratégie
complexe
On ne le soulignera probablement jamais
assez, c’est à plusieurs scènes rituelles (lavement des pieds de Parsifal par Kundry, onction
royale du preux chevalier par Gurnemanz, baptême par
le héros de la pécheresse repentie), d’une intelligence purement biblique –
voire évangélique – universelle, que succède, sans transition, l’épisode de l’Enchantement du Vendredi Saint. Il est
remarquable qu’au long de ces mêmes scènes, Richard Wagner mette en œuvre une
stratégie compositionnelle dont il a peut-être découvert les effets dans la VIIe symphonie de Beethoven (œuvre à
l’endroit de laquelle il pratiqua toute sa vie une dévotion particulière),
stratégie fondée sur un savant processus d’épuisement du matériau sonore par
retraitement de motifs en quelque sorte épurés, au besoin désincarnés. Il est à
noter que, quelques décennies plus tard, ce mécanisme sera repris et encore
approfondi par Alban Berg, notamment dans Lulu et dans le Concerto à la mémoire d’un
ange. Car le plus frappant, dans le traitement des motifs de l’Enchantement est beaucoup moins leur
retour (qui offre à l’auditeur ces repères sans lesquels tout langage perd son
intelligibilité) que leur transfiguration, soumise à la règle stricte des
didascalies ; rien de plus révélateur, de ce point de vue, que la mutation
des anciennes plaintes contingentes des Filles-Fleurs en doléance métaphysique
de Kundry, lorsque celle-ci reçoit le sacrement du
baptême sous le sceau sonore et triomphant de la Foi.

Or, c’est précisément au sortir de cet
enchaînement aux connexions obscures que s’élève le motif éthéré de l’Enchantement. De ce fragment mélodique
dont on ne relèvera jamais assez le pathos inédit, y compris chez Richard Wagner, les commentateurs se plaisent
ordinairement à souligner le caractère enveloppant, ensorcelant, voire
hallucinatoire. Nul ne songera d’ailleurs à leur donner tort sur ce point, et
nombre de grands compositeurs germaniques du romantisme tardif sauront en
retenir la leçon, à commencer par le Richard Strauss du Chevalier à la rose. Mais le plus étonnant reste probablement le
soin avec lequel le compositeur a discrètement préparé son approche. Partition
en main, il est aisé de repérer les dessins qui, dénaturés par le rythme mais
d’une parfaite cohérence mélodique, annoncent directement ce merveilleux thème
du Vendredi Saint. Ainsi l’auditeur
éprouve-t-il le curieux sentiment d’une logique sonore dont sa perspicacité
sensible ne lui aurait pas rendu compte, mais à laquelle son pur instinct
sensoriel l’aurait préparé. Au sujet de ce fragment de mélodie, enfin, les
hésitations de la musicologie universitaire quant à son classement catégoriel
sont tout aussi révélatrices : leitmotiv ? thème ? motif secondaire ? simple cellule ? Il est assez
tentant de paraphraser ici Arnold Schoenberg pour postuler que le thème de l’Enchantement Vendredi Saint est tout à
la fois moins et plus qu’un leitmotiv.
Moins car il ne sera quasiment pas repris par la suite (à une seule exception
qui échappe souvent à l’attention de mélomanes saisis par la progression et par
l’intensité du drame), plus car il gouverne toute l’intelligence théâtrale de
la scène, avec bien plus de force et de trouble que les simples intitulés
sonores du « bottin musical » plaisamment dénoncé par Claude Debussy
dans la Tétralogie. Tout au long de
cet épisode sacré, mystique et par instants surnaturel, les leitmotive de Parsifal se signalent à
l’auditeur par leur insistance autant que par leur abondance : Expiation, Cène, Lance, Appel au
Sauveur, Graal, Plainte des Filles-Fleurs… jusqu’à
l’apothéose sonore de La Promesse et à la rupture de l’envoûtement par
l’appel des cloches du Montsalvat. Sans que le motif proprement
dit de l’Enchantement ne perde plus
de son importance à accepter leur voisinage que, pour reprendre l’exemple cher
à Plotin, le soleil ne perdrait de sa lumière à en inonder l’univers ! En
regard – et en retour – ces leitmotive,
momentanément secondaires, ne sont en rien amoindris par l’écho amplifié qu’ils
confèrent, le temps d’une pause sacrée, à la réalité transcendante du thème
principal.
La vérité, en amont
de l’œuvre
C’est
ici que l’auditeur, affronté à une réalité trop mouvante pour être domestiquée
par la raison, peut solliciter la grande leçon de Marcel Proust. Pour le génial
auteur de la Recherche du temps perdu,
l’incompatibilité de toute fusion ne vient-elle pas du fait même de la
différence des natures entre les propositions de nature différente ? Et ne
découvrait-il pas, chez Wagner, tout un panel de préoccupations parentes ?
« Dans
la même soirée, un peu plus loin, je ne serais pas surpris qu’en parlant de la
petite phrase, j’eusse pensé à l’Enchantement
du Vendredi Saint [dans Parsifal, de Richard Wagner] ».
(Lettre
de Marcel Proust à Monsieur Jacques de Lacretelle,
Paris, 20 avril 1918)
Pour
caractériser, entre autres exemples, l’émotion éprouvée par Swann à l’audition
de la “petite phrase musicale”, le narrateur-écrivain la compare à celle que
dispensent « certaines odeurs de roses circulant dans l’air humide du
soir ». Et il note que Swann, ne connaissant pas la musique, a pourtant
éprouvé une impression purement musicale, irréductible à tout autre ordre
d’impressions, une impression « pour ainsi dire sine materia ». Plus généralement,
tout au long de l’épopée proustienne, la conscience s’affirme que l’audition de
la musique induit la perception intuitive, au-delà ou en deçà des notes, d’un
univers illimité sur lequel la forme sensible jette de fulgurantes lueurs
faisant apparaître « çà et là, séparées par d’épaisses ténèbres inexplorées »
quelques-unes de ces millions de touches par quoi les artistes nous révèlent
tout ce que « cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et du néant ».
C’est au thème de l’Enchantement que
le grand écrivain, par ailleurs si peu disert sur l’esthétique wagnérienne,
aurait pu encore plus précisément se référer pour noter qu’il appartient
« à un ordre de créatures surnaturelles et que nous n’avons jamais vues,
mais que malgré cela nous reconnaissons avec ravissement quand quelque
explorateur de l’invisible arrive à en capter une, à l’amener, du monde divin
où il a accès, briller quelques instants au-dessus du nôtre ».
Dans
le même ordre d’idées, et pour passer de la littérature à la philosophie,
l’audition répétée de l’Enchantement du
Vendredi Saint semble donner raison à Gaston Bachelard pour qui la
continuité se fait à la faveur du groupement, conception d’un temps
dialectique, donc discontinu, qui, favorisant l’illusion du devenir contre la
réalité de l’état, semble inconciliable avec la proposition bergsonienne d’un
temps unique, ramassé, point de convergence de tous les temps vécus et
intégrés. La dialectique de l’utile et de l’inutile, chère à Bachelard, et la
négation d’une réelle discontinuité, défendue par Bergson – pour qui les
apparences objectives de cette discontinuité ne sont que de surface – opèrent
en effet équitablement dans la perception auditive de toute la musique de
Richard Wagner, mais avec une force inégalée dans l’épisode sacré de l’Enchantement du Vendredi Saint. Et
l’intuition reste forte, alors, que cette merveilleuse musique est porteuse
d’autres réalités que les signes et motifs qui la composent et qui peuvent être
nommés, comme si elle renvoyait à l’hypothèse d’un langage germinal,
virtuellement signifiant mais à jamais indéchiffrable.
Gérard Denizeau.
AU FESTIVAL DE GLYNDEBOURNE

©
David Illman
Pour sa 79ème édition, le
célèbre festival anglais se lançait dans un certain nombre d'événements : l'entrée au répertoire d'un opéra de
Rameau, Hippolyte et Aricie, et la
commémoration des anniversaires de Verdi et de Britten, avec des reprises de Falstaff et de Billy Budd. On n'a, par
contre, pas célébré celui de Wagner, la reprise de la merveilleuse production
des Maîtres Chanteurs s'avérant, sans doute, trop coûteuse ; la seule
manifestation d'hommage devant être la diffusion sur grand écran du DVD de la
production de 2011. Dommage, car la présentation simultanée du chef d'œuvre
« comique » des deux géants de l'opéra du XIX ème eût été un formidable coup ! En revanche, une nouvelle production d'Ariadne auf Naxos anticipait l'année Richard Strauss, de 2014. Ce festival marquait la dernière
année de la direction musicale de Vladimir Jurowski,
qui 13 étés durant, aura fait bénéficier Glyndebourne de son immense talent. Il peut se flatter, à juste titre, d'avoir pu
« créer de l'opéra dans l'environnement unique que propose Glyndebourne ».
Un autre aspect mérite d'être
souligné : l'accent porté sur la diffusion sur CD et DVD des spectacles du
festival. Bien des maisons d'opéra le font désormais, mais à Glyndebourne la question est abordée de manière
compréhensive, qui publie ses productions anciennes et récentes. On a relaté
récemment celle, légendaire, de Falstaff, captée en 1962.
Rameau fait une entrée remarquée
au répertoire
Jean-Philippe RAMEAU : Hippolyte
et Aricie. Tragédie en cinq actes
et un prologue. Paroles de l'Abbé Simon-Joseph Pellegrin. Sarah Connolly,
Christiane Karg Ed Lyon, Stéphane Degout,
Katherine Watson, Ana Quintans, François Lis,
Emmanuelle de Negri, Aimery Lefèvre, Julie Pasturaud, Loïc Félix, Mathias Vidal, Charlotte Beament, Callum Thorpe, Samuel
Boden, Timothy Dickinson. Orchestra of the Age of Enlightenment, dir William
Christie. Mise en scène : Jonathan Kent.

© Bill Cooper
Glyndebourne a, de
longue date, réservé une place de choix à l'opéra baroque. Haendel, et plus
récemment Purcell, y ont été gratifiés de productions mémorables. Le temps
serait-il venu de l'opéra français, singulièrement de Rameau ? William Christie
a choisi Hippolyte et Aricie, « la plus
dramatique et la plus parfaite de ses tragédies lyriques ». Ce premier
opus de l'auteur (1733) trouve certainement dans le théâtre du Sussex écrin à
sa mesure. Et on a fait appel à Jonathas Kent qui,
avec le même chef, avait donné de The Fairy Queen de Purcell une version extrêmement achevée. La
réussite dramaturgique est-elle de nouveau au rendez-vous ? La réponse est
nuancée. Kent professe vouloir réinventer le baroque pour le public du XXI ème siècle, et ainsi chercher à étonner et enchanter, et
finalement, retrouver le sens du « merveilleux », inhérent à ce genre
musical français. S'il y parvient, car le public semble adhérer à ses vues,
c'est à travers le prisme de l'humour anglais, cette exagération calculée qui
tire le rire plus que l'empathie. Nul doute qu'on a voulu ménager le manque
d'accoutumance de l'auditoire pour un genre foncièrement gallique, en
appliquant une approche baroque, au sens étymologique du terme, avec son lot de
contrastes accentués, de miroir grossissant, d'entertainment souvent. Le cadre en est défini au Prologue, qui voit s'opposer Diane et
Cupidon, mais comme si les jeux étaient déjà faits, au bénéfice de la première
: sa froide austérité, son aversion pour tout ce qui dévie d'une rigide
trajectoire, contre le goût prononcé de son rival pour une folle anarchie et
une passion incontrôlable. Aussi sommes-nous transportés... à l'intérieur d'un
réfrigérateur, univers figé, où Diane règne sur des rayonnages bardés de
victuailles dont la vie a été artificiellement stoppée, paquet de saucisses et
autres branches de brocolis, tandis que l'Amour éclot d'une rangée d'œufs
enchâssés dans la porte d'en face... De même, à la scène finale, la réunion des
deux héros aura-t-elle pour lieu une improbable chambre mortuaire garnie de ses
tables métalliques présentant les défunts. C'est que le dénouement heureux
qu'impose la tragédie française, paraissant un peu court, on a cru bon de le
corser. Entre temps, on sera passé d'une scène de sacrifice rituel d'animaux
égorgés, dont on recueille le sang, à un no man's land situé à l'arrière du
frigo, parmi les résistances et autres réceptacles de refroidissement, en guise
de scène des enfers, ou encore dans un intérieur bourgeois, chez Phèdre et
Thésée, un couple décidément bien mal assorti, qui vole en éclats du fait de la
passion incestueuse de la mère vis à vis de son beau fils Hippolyte. Certes,
une mise en scène n'est pas censée se mesurer au seul aspect visuel, mais Jonathas Kent lui-même s'en réclame pour asseoir son propos
: une lutte entre l'apollinien et le dionysiaque, un monde éclectique, où des
dieux plus vrais que nature côtoient des humains quelque peu manipulés.
L'imagerie est saisissante, à défaut d'être esthétique, et tout mise sur
l'emphase, non sur la suggestion ; à la différence de la régie d'Ivan
Alexandre, au Capitole et à l'Opéra Garnier (cf. NL de 9/2012). Concession, ou
rappel révérencieux, à la machinerie baroque, des apparitions du dessus
semblent vouloir nimber le spectacle d'une aura de poésie. Le coup de théâtre
n'est pas rare, tel le divertissement marin qui clôt le III ème acte, où l'ambiance vire soudain au rose bonbon, un globe aux facettes d'argent
projetant mille paillettes dans la salle. Le ballet des marins, culotte courte,
béret à pompon, est déjanté, dans un excès tout britannique. Ailleurs, les
intermèdes dansés, qui mêlent pantomime et figure chorégraphique pure, seront
plus prosaïques. C'est peu dire, au final, qu'on est loin de Racine, rangé au
rang des accessoires, plus que considéré comme référence obligée.

© Bill Cooper
Le volet musical est une toute
autre affaire. William Christie, dans une forme éblouissante, démontre son
empathie pour l'idiome de Rameau et ce qu'il qualifie, chez celui-ci, de
« très linguistique », savoir l'importance de la déclamation eu égard
à la part déterminante du récitatif ; ce qui distingue le musicien de ses
collègues français, tel un Lully, aussi bien que de Haendel et des italiens. Le
soin apporté à la fluidité du chant se conjugue à celle de la symphonie :
l'intonation des chanteurs rencontre celle des instrumentistes. L'immersion est
totale et la battue s'avère vibrante, presque fébrile, cherchant loin ce qui
dans cette musique peut se révéler descriptif ; et pas seulement dans le
déchaînement marin qui clôt le III ème acte. Le fini
instrumental prodigué par l'Orchestra of the Age of Enlightenment est prodigieux : la douceur impalpable des deux flûtes enlaçant le chant
élégiaque, la sonorité glaçante des quatre bassons lors de la scène des enfers,
les cordes frémissantes, frottées pour un effet de tremblement, ne sont que des
exemples d'une interprétation fouillée. Le merveilleux, c'est assurément là
qu'on le mesure. Christie peut aussi s'enorgueillir d'un cast quasi idéal. Comme lors de sa prestation à Paris, Sarah Connoly incarne une Phèdre immense qui crie la tragédie à chaque intervention, qu'il
s'agisse de la jalousie ou du remords. Sa première entrée, robe rouge fendue
sur la jambe, talons hauts, a grande allure. Stéphane Degout dresse de Thésée une figure imposante, à vrai dire une des créations les plus
originales de Rameau : parangon de belle intonation française, dignité et
assurance, déclamation vigoureuse qui trouve son apogée dans l'invocation à
Neptune « Puissant maître des flots ». Les deux héros, Ed Lyon,
Hippolyte, ténor ductile et expressif, et Christiane Karg,
pathétique Aricie, soprano corsée, assument la
finesse d'un chant savamment dosé. Le registre des voix graves est bien servi
par le Pluton de François Lis. Un grand moment de tension restera l'échange
musclé, eux enfers, entre ce dernier et Thésée, les deux voix graves se livrant
à une joute sans merci et rivalisant d'embonpoint vocal. Comme il en est, par
ailleurs, du trio des Parques. Le Chœur de Glyndebourne est lui aussi en phase. L'harmonieux mélange entre musique théâtre et danse
tourne définitivement à l'avantage de la première.
Un Falstaff onirique
Giuseppe VERDI : Falstaff.
Comédie lyrique en trois actes. Livret d'Arrigo Boito, d'après la comédie de
Shakespeare, The Merry Wives of Winsdor.
Laurent Naouri, Roman Burdenko, Graham Clark, Ailyn Perez, Lucia Cirillo,
Susanne Resmark, Elena Tsallagova,
Antonio Poli, Colin Judson, Paolo Battaglia. Orchestra of the Age of Enlightenment,
dir. James Caffigan. Mise en scène : Richard Jones.

©
Tristam Kenton
Le Festival de Glyndebourne n'a pas attendu l'année 2013 pour célébrer
Verdi, et pour s'en tenir à Falstaff, on en est, ici, à la quatrième
production, la première remontant à 1938. La présente, reprise de celle créée
en 2009, offre cette particularité de jouer la comédie lyrique de Verdi avec un
orchestre d'instruments anciens. John Eliot Gardiner avait déjà tenté
l'expérience, avec succès, naguère aux Prom's de
Londres et au disque. Sir Mark Elder, ici responsable de la préparation
musicale, souligne combien un tel traitement rend justice au raffinement
extrême de la partition, à la subtilité des coloris imaginés par l'auteur, à
son sens de la forme aussi, d'un souverain équilibre. De fait, et sous la
baguette du jeune James Caffigan, qui reprenait le
flambeau de son aîné et profitait du travail intense des répétitions, consolidé
au fil des précédentes représentations, la sonorité émanant de la fosse est
envoûtante : clarté des plans, subtilité du trait, fabuleux jeu d'ombre et de lumière,
qui donne sa sveltesse à la magistrale orchestration de Verdi. Certes, la
brillance et l'impact sont là. Mais avec un nombre d'instrumentistes pas
moindre que dans le cas d'un orchestre conventionnel, le galbe apparait bien
différent. La prodigalité mélodique n'en ressort que mieux : ces phrases si
concises qu'on a à peine le temps d'en appréhender la substance que déjà elles
sont recouvertes par d'autres, plus habiles encore, ces combinaisons
instrumentales géniales que Verdi s'empressait de coucher sur le papier au fur
et à mesure de la composition, orchestrant d'emblée, de peur d'en laisser
perdre la nouveauté. Car tout ici est fugacité, les ensembles en particulier.
Dans un tel contexte « dégraissé », les bois, tout particulièrement,
livrent leur potentiel d'esprit et de limpidité : la flûte accompagnant les
« Reverenza » de Mrs Quickly,
le caquetage du hautbois lors de la déclaration d'amour de Falstaff, sans
parler du cor naturel préludant la dernière scène.

©
Tristam Kenton
L'étonnante modernité du
théâtre musical de Verdi, qui tourne le dos au long développement, la mise en
scène de Richard Jones la saisit également avec acuité. Celle-ci sort des
sentiers battus, quoique restant scrupuleusement en phase avec la trame, et ne
s'embarquant pas dans la transposition farfelue. On a seulement cherché à
rafraichir l'intrigue, située immédiatement au sortir de la Seconde Guerre
mondiale, dans ces années 40 finissantes qui ont vu la femme conquérir une
certaine indépendance. Falstaff, fidèle à lui-même, entend bien qu'on lui
prodigue tous les égards et satisfasse son immense appétit, en particulier
sexuel. Le Dr Cajus, que Ford s'est mis en tête de
donner pour époux à sa fille Nanetta, est un senior
diplômé d'Eton, et le jeune Fenton un soldat US stationné à Windsor.
Sympathique auberge, « La Jarretière » est fréquentée par les gens de
la petite cité léchée, style Tudor, à l'image des maisons et des rues du bourg.
Rien ne manque, pas même le chat se prélassant sur le comptoir, tandis que
l'habitué Falstaff s'affaire à taper à la machine ses fameuses missives. Il n'y
a là pourtant rien qui choque, et le comique provoque plus le sourire que le
rire. Le buffa restera discret tout au long, voire
même tendre, pour se nicher dans le détail, souvent amusant : ce jardin potager
à l'arrière de la maison des Ford, où tout un chacun déambule parmi les rangées
de salades, et même une escouade d'athlètes en short blanc convoyant canot et
avirons en direction de la river Thames. Ou encore cette rue pittoresque, à la
première scène du III ème acte, une des réussites du spectacle, qui
enchâsse la devanture de l'auberge entre celles de boutiques de « farces
et attrapes » (Jokes) et de lingerie féminine,
tandis qu'au premier étage, le spectateur perce le secret de la chambre de
l'hôte illustre. Lui qui, un peu plus tôt, avait été repêché des eaux du fleuve
par des passants intrigués de leur déconcertante découverte. Jones joue sur
l'effet simple, mais terriblement efficace : ses dialogues sont percutants
parce que non exagérés, ses confrontations gourmandes des sous entendus qui
font le sel de la pièce. Le trait est suggéré avec malice et nulle épaisseur.
La scène chez Ford, qui conduira à la tempête des esprits et au délestage du
héros par la fenêtre, dans une gerbe d'écume, occupe une surface curieusement
réduite, où la tradition des objets est respectée, avec paravent et panier en
osier, quoique agrémentée d'une touche de modernité : c'est sur un meuble phono
et son crachotant 78 tours que la sérénade de Falstaff sera égrainée. La
dernière scène nocturne, dans la parc séculaire,
retrouve l'ambiance shakespearienne : seul, un immense arbre peuple le plateau,
où se déroulera cette vraie fausse parade dont Falsaftf prendra la direction pour tirer la morale de l'affaire. Dans un tel contexte,
la distribution se fraie le meilleur des chemins. L'ensemble est jeune et vif.
Les quatre commères sont fort bien achalandées, Alice et Meg, Ailyn Perez et Lucia Cirillo,
deux jeunes femmes sans façon, Nanetta, Elena Tsallagova, pas si ignorante qu'on le croit des chose de la
vie, la Quicky, Susanne Resmark,
avantageuse et impayable, tout en contenant un naturel bagou. Celui de Ford est
lui aussi mesuré et le baryton Roman Burdenko fait de
sa tirade chez Falstaff un fier morceau. Bien que n'étant pas un choix naturel
pour incarner le « fat Knight », n'en possédant ni la rondeur
physique ni la faconde italienne, Laurent Naouri domine, mais sans écraser. Sa
vision est plus réfléchie que foncièrement truculente, et le comique est passé
au prisme de l'intelligence. Encore qu'il soit difficile de démêler à qui
revient la responsabilité de cette approche : à l'interprète lui-même, dont la
réserve toute française, le conduit à mitiger l'excès buffa du personnage, ou au régisseur qui cherche à en gommer le côté grotesque et à
bannir toute surcharge. L'irrésistible n'en est pas pour autant écorné. C'est, finalement, un extraordinaire
sentiment de précision qui distingue ce spectacle, justement mis en exergue par
l'agilité orchestrale.
Jean-Pierre
Robert.
***
LE FESTIVAL D'AIX EN PROVENCE : UN GRAND MILLESIME

© DR
Nonobstant l'idée d'inclure le
festival d'Aix-en-Provence dans l'orbite de Marseille, capitale européenne de
la culture, l'immense succès de la cuvée 2013 revient à son directeur, Bernard Foccroulle, qui aura su marquer cette 65 ème édition du sceau de l'excellence. L'aura des orchestres
invités, le LSO, l'Orchestre de Paris et la Cappella Mediterranea,
et des chefs, a largement contribué à la réussite musicale, tandis que côté
mises en scène, l'imagination était à l'œuvre : les quatre spectacles vus,
confiés aux tenants incontestés de la mise en scène lyrique et à un jeune
talent plus que prometteur, confortent l'idée que la scène d'opéra est
résolument vivante. Et, bonne nouvelle, l'amélioration notable de l'acoustique
de la fosse de la cour de l'Archevêché contribue, enfin, à sortir ce lieu de
son inconfort à cet égard, avec l'aide, cette année, de nuits paisibles et d'un
ciel étoilé, sans nul air de mistral.
Où l'on découvre un opéra baroque passionnant : Elena de Francesco
Cavalli
Francesco CAVALLI : Elena. Dramma per musica en un prologue
et trois actes. Livret de Nicolo Minato sur un argument de Giovanni Faustini. Emöke Barath, Valer Barna-Sabadus, Fernando Guimarães, Solenn' Lavanant Linke, Rodrigo Ferreira,
Anna Reinhold, Scott Flores, Madjouline Zerari, Brendan Tuohy,
Christopher Lowrey, Job Tomé. Cappella Mediterranea, dir. Leonardo
García Alarcón. Mise en scène : Jean- Yves Ruf.

© Pascal
Victor / ArtcomArt
Le chef d'orchestre Leonardo
García Alarcón, infatigable dénicheur de musiques
oubliées, avait prévenu : il nous préparait une découverte majeure. Les faits
ne l'auront pas démenti. Francesco Cavalli (1602-1676) est surtout connu par
son opéra La Calisto, exhumé naguère
par René Jacobs. Ce qu'on sait moins, est que le compositeur vénitien, élève de
Monteverdi, a écrit bien d'autres œuvres pour la scène. Grâce à la
collaboration avec un librettiste impresario de talent Giovanni Faustini. Même par delà la disparition de celui-ci, en
1651, la créativité perdurera, à travers plusieurs pièces, dont cette Elena.
Une autre main se chargera de mettre au point le livret et le dramma per musica sera créé dans
un des théâtres de la Sérénissime, fin 1659. Elle sombrera dans l'oubli peu
après, jusqu'à nos jours. Aussi cette présentation aixoise fait-elle figure de
« re création ». L'intrigue donne à voir
les aventures d'Hélène, en un vaudeville mythologique, « une sorte de Belle
Hélène baroque », selon Leonardo García Alarcón.
Là où Offenbach, bien plus tard, se moquera tant et bien de l'inconstance des
mœurs de ce mythique personnage, Cavalli se l'approprie déjà de divertissante
manière : la toute puissance du désir amoureux, hommes et femmes ne sauraient
bien longtemps y résister, car ils sont faits pour y succomber. Celle qu'on
n'hésitait pas à décrire, à l'époque, comme la plus belle femme du monde,
Hélène, a vocation à être convoitée par tout mâle alentour : le beau Thésée
qui, ne s'embarrassant pas de vains scrupules, va l'enlever, ou ce Ménélas
diablement possédé, qui pour l'approcher, emprunte le stratagème cocasse du
déguisement en Amazone, sachant qu'elle est sportive et aime la lutte avec ses
consœurs. Comment dévoiler sa flamme en pareille occurrence ? Le quiproquo
inter sexe sera le moteur d'une intrigue aux mille rebondissements et
nombreuses facéties, au point qu'il serait vain de vouloir en dessiner ne
serait-ce que les grandes lignes. La musique est d'une créativité qui semble
inépuisable, pleine d'esprit, justement attrayante par son intimisme, passant
en un rien de temps de la veine comique à la tonalité tragique, faisant sienne
le mélange des genres inhérent au livret.

©
Pascal Victor / ArtcomArt
Dans l'écrin du Théâtre du jeu
de Paume, la production aixoise découvre bien des sortilèges de sensualité à ce
marivaudage avant l'heure, à ces jeux amoureux travestis, qui, en ces temps de
mariage pour tous, prennent une piquante saveur. Les courtes scènes mettant aux
prises pas moins d'une douzaine de personnages s'enchainent sans solution de
continuité dans un décor habile d'arène tauromachique ; belle métaphore pour
figurer les joutes ardentes, relevées de costumes chatoyants. Jean-Yves Ruf évite l'écueil de la monotonie dans un spectacle
pourtant long, par un sens du mouvement remarquable, conférant vie aux
ensembles, et tout leur sel aux vifs dialogues. La jeune distribution fait
merveille, de par sa spontanéité et sa fureur de jouer, communicative. On en
détachera l'Hélène de Emöke Barath,
belle à ravir, justement malicieuse, et le Ménelas de Valer Barna-Sabadus, voix de contre ténor sûre, même si la prestance
eût mérité plus d'assurance. Leurs duos, dont certains approchent le lustre de
ceux du Couronnement de Poppée de Monteverdi, atteignent une singulière
force. Leonardo García Alarcón est dans son élément
et avec sa poignée de musiciens de la Cappella Mediterranea,
se délecte de ce texte musical enchanteur. On est bercé par les sonorités
envoûtantes des flûtes baroques, théorbes et autres percussions.
Rigoletto : aux
sources de Victor Hugo
Giuseppe VERDI : Rigoletto. Melodramma en trois actes. Livret de Francesco Maria Piave, d'après Le Roi s'amuse de Victor Hugo. George Gagnidze, Irina Lungu, Arturo Chacón-Cruz, Gabor Bretz, Josè Maria Lo Monaco,
Michèle Lagrange, Wojtek Smilek, Julien Dran, Jean-Luc Ballestra,
Maurizio Lo Piccolo, Valeria Tornatore, Rasmus Kulli. Estonian Philharmonic Chamber Choir. London Symphony
Orchestra, dir. Gianandrea Noseda. Mise en scène : Robert Carsen.

© Patrick Berger / ArtcomArt
Premier volet de l'illustre
trilogie de maturité, avant Il Trovatore et La traviata, Rigoletto figure au panthéon des pièces les plus populaires de Verdi. En cette année
anniversaire, sa présentation à Aix relève de l'inédit. Pour sa première
rencontre avec l'œuvre, Robert Carsen se tourne
résolument vers Victor Hugo. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que le melodramma de Verdi suit de près Le Roi s'amuse,
dont l'éloquence est endossée, via le livret de Piave, dans sa trivialité comme
son pathétique. Seuls, les personnages et les lieux ont été modifiés pour
sacrifier à la censure vénitienne. Le personnage du bouffon occupe la place
centrale, comme il en est du Triboulet hugolien. Il sera, ici, la figure
maîtresse de l'action, dans son ambivalence : amuseur officiel par métier et un
brin de cruauté, préservant jalousement son jardin secret, l'amour presque
maladif pour sa fille Gilda. Il sera l'artisan de sa propre chute, de cette
« maledizione », attachée à ses faits et gestes.
L'action est placée dans un décor unique, en l'occurrence sous le chapiteau
d'un cirque, univers clos où le clown Rigoletto étale
sa faconde triste. Un tel lieu ne messied pas pour symboliser la cour du Duc de
Mantoue, où tout n'est que fard et faux amusement. Les courtisans entourant le
souverain débauché portent smoking et évoluent sur les gradins rouges grenat.
Par contraste, la maison où Rigoletto maintient
secrètement recluse sa fille Gilda, est une petite roulotte de saltimbanque,
sorte de bulle où tout semble rapetissé, jusqu'aux personnages qui y font
figure de géants. Lors du rapt de la jeune fille, la caravane sera emportée par
les assaillants. Il y a du funambule chez Carsen, à
l'image de Gilda perchée sur un trapèze volant lors de son grand air
« Caro nome », comme évoluant sous la voûte étoilée du ciel d'Aix ;
une image peu conformiste, mais combien saisissante de poésie. Carsen ira jusqu'à réimaginer la
fameuse scène du drame de Victor Hugo, dite de la clef, délaissée par Verdi
pour heurt à la bienséance : au II ème acte, le duc,
dépouillé de ses vêtements, gravira une échelle dans le plus simple appareil,
pour rejoindre Gilda... Les scènes de transition, telle la première rencontre
entre Rigoletto et Sprarafucile,
mais aussi l'entrée du héros durant l'Ouverture, et la scène finale, sont
ménagées devant le rideau de scène, sorte de no man's land, pour signifier
combien ces moments clés doivent être mis en exergue. On reste moins convaincu
par la scène de l'orage du dernier acte, peu favorable au frisson, et le
quatuor qui suit, privé de vrai ressort par un dispositif décoratif abscons. De
même, la défroque du héros, en grand Pierrot noir, plus près de Paillasse que
du bouffon de cour, même ravalé au rang de clown, n'est pas toujours porteuse
d'émotion. Assurément, Carsen cherche à accentuer la
marginalité du personnage par rapport au milieu qui l'entoure : un pauvre hère
d'une tristesse insondable, complice malgré lui des frasque de celui qu'il sert, héros à la fois grotesque et sublime.

©
Patrick Berger / ArtcomArt
La prestation du London Symphony Orchestra apporte à la production une vraie aura
de grandeur, et le chef Gianandrea Noseda démontre sa parfaite connaissance des arcanes
verdiennes : une lecture d'une absolue clarté, où la compacité musicale est au
service d'une vision presque chambriste par instant, dégagée de toute enflure.
Dotée surtout d'une efficacité dramatique confondante, là où Verdi privilégie
la scène comme cellule dramatique essentielle, plus que l'aria, aussi grandiose
soit-il ; la « scena » consistant à
replacer l'air dans un contexte plus global du point de vue dramaturgique. La
couleur des bois de l'orchestre londonien apporte un supplément de plasticité,
telle l'alliance de la clarinette et du basson, sur un accompagnement des
cordes graves, lors de l'échange entre Sparafucile et Rigoletto, vraiment sinistre et glaçant. La
distribution est dominée par la Gilda de Irina Lungu dont le beau soprano spinto apporte une vraie
consistance à cette partie délicate, trop souvent distribuée à une voix légère.
Et dont on a tendance à faire une égérie timide. Tout le contraire ici : Gilda
est femme et assume ses choix. Le baryton géorgien George Gagnidze campe un Rigoletto solide et intense, même si le
timbre, un peu mat, n'a pas la fulgurance italienne et l'aisance nécessaire aux
longues phrases que Verdi associe au personnage. Retenant l'idée force de la
régie, de ne jamais sombrer dans la facilité d'une malédiction annoncée, la
caractérisation est mesurée dans l'emportement comme la tendresse. A cet égard,
le duo vengeur qui réunit le père et la fille, à la fin du II ème acte, ne dévoile qu'à peine son immense charge
explosive, heureusement déployée avec évidence à l'orchestre. Le Duc d'Arturo Chacón-Cruz est d'une sympathique jeunesse et d'une belle
sincérité, charmeur mais nullement cabot. Si la quinte aiguë est plaisante,
notamment à l'heure de « La Donna e mobile », la prestation manque
d'aura vocale sur le long cours. Les autres rôles sont bien tenus, dont un mordant Sparafucile, un sonore Monterone et une attrayante Maddalena. A noter la prestation de la grande Michèle
Lagrange dans le rôle, trop souvent sacrifié, de Giovanna, la duègne au double
jeu.
Don Giovanni : l'éternel recommencement
Wolfgang Amadée MOZART : Don Giovanni. Dramma giocoso
en deux actes K 527. Livret de Lorenzo Da Ponte. Rod Gilfry,
Kyle Ketelsen, Kostas Smorigenas, Paul Groves, Maria Bengtsson, Alex Panda, Joelle Harvey, Anatoli Kotscherga. Estonian Philharmonic Chamber Choir. London Symphony Orchestra,
dir. Marc Minkowski.Mise en
scène : Dmitri Tcherniakov.

© Patrick Berger / ArtcomArt
On ne compte pas les manières
d'accommoder Don Giovanni. Celle du russe Dmitri Tcherniakov va résolument à contre courant, même
d'une lecture transposée. Il fonde la sienne sur deux présupposés : un
fractionnement du temps, l'action étant répartie sur plusieurs semaines, au
lieu d'une seule journée, exigée par la règle de l'unité de temps, et une
contraction de l'espace en un lieu unique et clos, l'immense salon de la
demeure du Commandeur, faisant fi des divers lieux imaginés dans le livret. Il
en résulte un spectacle séquencé en scènes bien distinctes, qu'un brusque
baisser de rideau clôt de manière abrupte, et la nécessité d'une pause plus ou
moins longue entre celles-ci. Ce découpage n'est pas sans inconvénient en terme de longueur globale d'exécution, surtout au second
acte. La trame est celle d'un drame familial, annoncé durant l'Ouverture
réunissant tous les protagonistes autour d'une table, présidée par le maître de
céans, le Commandeur. Les divers
personnages s'y côtoient, étant précisé que Zerline est la fille de Donna Anna d'un premier lit, qu'Elvira est la cousine de cette
dernière, et que Leporello est un jeune parent, plus
ou moins parasite, du Commandeur. Ils vont évoluer auprès d'un homme fatigué,
« qui contient en lui-même tous les Don Juan du passé ». Un Don Juan,
en fait, qui a déjà toute une expérience derrière lui, et dont la rencontre
avec Zerlina est peut-être le seul moment de joie de
son existence actuelle, celui où tout peut encore basculer. Cette scène est
d'une formidable intensité : lui, assis, cherchant à conter à la petite mille
choses banales, elle, debout, à quelques mètres, puis s'avançant lentement
comme aimantée, pour tomber à genoux et lui saisir la main. Comme Don Giovanni,
tous les personnages ont déjà joué mille fois leur rôle. Ils espèrent ne pas le
rejouer. Mais, en fait, ils le reprennent encore une fois, car nul n'échappe à
son destin. Ce Don Juan est un homme
banal, vieilli, pas spécialement beau, usé plutôt, sympathique même. Il n'est
pas quelqu'un de nouveau, mais un phénomène mythique qu'on ne saurait malgré
tout esquiver. La personnification du mythe ne présuppose pas nécessairement la
beauté. Pour lui, les présentes aventures offrent une saveur particulière, sans
doute le jeu du quitte ou double. Tcherniakov substitue, certes, ses propres clichés à bien d'autres, vus et revus, habituels
ou non. Mais il s'en dégage un pouvoir de fascination réel, emporté par une
direction d'acteurs d'une prodigieuse présence. Chaque personnage, disséqué
avec soin, acquiert un relief étonnant. Ce sont pourtant des gens de tous les
jours, si naturels dans leurs comportements et leurs réactions aux événements.
Ainsi de Don Ottavio, qui loin du bellâtre emprunté ou embarrassé, est un homme
de responsabilité, qui ira jusqu'à prendre la tête de la conspiration de la
vengeance. De Masetto aussi, qui abandonne sa
casquette de pauvre gars trompé, pour une posture autrement plus consciente de
futur marié soucieux du bonheur de son épousée. L'un d'eux, Leporello,
se détache même du lot. Mauvais garçon, à la mèche tombante, arrogant et pusillanime, fasciné par son Don Juan de patron, il est de tous les coups et
trépigne, comme lui, à l'annonce de nouvelles frasques. Cette dramaturgie
réinventée entraîne, bien sûr, la prise de libertés avec le pied de la lettre
du texte, dans le sextuor notamment, et surtout à la scène du cimetière, qui
n'est qu'imaginée dans les dires de ses protagonistes. De même, celle du souper
final voit-elle arriver le Commandeur grandeur nature, et non sa statue, pour
un ultime rappel à l'ordre : saisissant la main qu'il lui tend, Don Giovanni
est confondu par plus fort que lui. Pour osée, voire déroutante, quelle soit,
cette conception est d'une totale cohérence, et à aucun moment l'intérêt ne
faiblit tant la réalisation atteint un rare degré de perfection théâtrale.

©
Patrick Berger / ArtcomArt
Confiées à Louis Langrée, lors de la présentation du spectacle au festival
de 2010, les rênes musicales de cette reprise le sont, cette fois, à Marc
Minkowski qui dirige, non pas son propre Orchestre des Musiciens du Louvre,
mais le LSO. La palette sonore est, comme dans Rigoletto, grandiose. Le tempo d'ensemble est plus lent qu'attendu, nul
doute influencé par le séquencement dramaturgique ; ce qui se fait sentir encore plus au deuxième acte, à propos
duquel le chef n'hésite pas à parler de son caractère déjà labyrinthique. Chez
celui qui affirme placer en avant le souci des enchaînements, et favorise dans
Mozart une virile articulation, la surprise est de taille. Pour autant, rien
n'échappe à la sagacité d'une lecture d'une souveraine plénitude et d'une
magnificence d'accents certaine. La distribution est d'une belle homogénéité.
Les trois rôles féminins sont parfaitement assortis : Alex Panda (Alexandrina Pandatchanska), naguère révélée comme mozartienne accomplie
par René Jacobs, est une sûre Elvira, combien déchirante dans l'amour d'un homme qu'elle sait non payé de retour. Maria Bengtsson n'éprouve nulle gêne avec la tessiture ardue et la vocalité tendue d'Anna, et
la composition est dépourvue de cet aspect altier souvent associé au
personnage. La jeune Joelle Harvey, ex impétrante de
l'Académie européenne de musique, offre une Zerlina assurée, qui flirte avec le danger. Le
Commandeur caverneux d'Anatoli Kotscherga tranche par
son allure d'homme policé, qu'on verra, de temps à autre, se mouvoir chez lui,
n'étant mort, sans doute, que dans l'imagination des membres de cette curieuse
famille. Paul Groves a encore bien des atouts pour
tenir la partie d'Ottavio et son chant orné. Kostas Smorignas est un Masetto de
poids, un Don en devenir. Avec Rod Gilfry, le rôle
titre offre des saveurs vocales puissantes et extrêmement nuancées, et une
apparence insoupçonnée : blasé plus que cynique, promenant une silhouette lymphatique,
enveloppé dans son long manteau camel. Le plus
original reste le Leporello, Kyle Ketelsen,
dont l'allure de jeune loubard, voire de malappris, et le bagou vocal, d'une
assurance inouïe, éblouissent. Si un personnage est emblématique de la manière
de Tcherniakov, c'est bien celui-ci. Un brelan de
figurants peuplent aussi le plateau lors de certaines
scènes, telle la noce campagnarde, en fait ici une joyeuse invasion de bonnes
gens découvrant le luxe de la demeure du Commandeur, ou le premier souper
(final du Ier acte), où les six invités de marque de Don Giovanni, masqués, se
tiennent par la main pour chanter la liberté. Une supra lecture, en somme, un Don Giovanni comme vu en surplomb, qui assène cette vérité : le pouvoir des
mots est, à lui seul, suffisant pour susciter le désir, mais aussi le rejet de
celui qui, à trop en faire, finit par être éliminé.
Une Elektra d'anthologie
Richard STRAUSS : Elektra. Tragédie en un acte. Livret de Hugo von Hofmannsthal, d'après Electre de Sophocle. Evelyn Herlitzius, Waltraud Meier,
Adrianne Pieczonka, Mikhail Petrenko, Tom Randle, Franz Mazura, Florian Hoffmann, Donald Mcintyre,
Renate Behle, Bonita Hyman, Andrea Hill, Silvia Hablowetz,
Marie-Eve Munger, Roberta Alexander. Coro Gulbenkian.
Orchestre de Paris, dir. Esa-Pekka Salonen. Mise en scène : Patrice Chéreau.

©
Pascal Victor / ArtcomArt
Patrice Chéreau se fait rare
sur la scène d'opéra, choisissant avec soin les titres pour lesquels il éprouve
de l'empathie. Hier, De la maison des morts ou Tristan und Isolde, pour ne citer que les plus récents.
Aujourd'hui, Elektra de Richard
Strauss. Enfin, car un tel sujet, puisé dans la tragédie grecque, ne peut
qu'inspirer l'homme de théâtre. Hugo von Hofmannsthal
savait qu'en le proposant au musicien, il jouait gros, surtout après les
déluges de Salomé. Mais sa parfaite connaissance des textes grecs, comme
de Shakespeare, dont Hamlet sera une autre source d'inspiration, et la
finesse de sa langue, finiront par lever les doutes de Strauss. Loin d'éluder
les crudités du texte de Sophocle, et sa violence à peine contenue, le poète
l'accommode dans une langue littéraire et lisible. Chéreau s'en empare à son
tour avec son art d'habiter un texte : « un opéra de dialogues »
souligne-t-il, justement, dans « une maison rongée de l'intérieur par le
meurtre ». Celui d'Agamemnon, qu'Elektra ne peut admettre et ressasse, car elle aimait ce
père d'un amour exclusif, celui de la jeune fille confrontée pour la première
fois à l'homme et au désir. Le sacrifice de Clytemnestre, ensuite, souhaité
jusqu'à l'idée fixe. Le meurtre d'Égisthe, enfin, pour assurer à la vengeance
sa totale complétude. Se rapprochant du théâtre antique, dans le décor
dépouillé de camaïeux gris bleu de Richard Peduzzi,
Chéreau introduit la tragédie avant que la musique ne commence, par une scène
muette des servantes lavant le sol et balayant la cour où s'est réfugiée Elektra. S'en suit une succession de tableaux d'un impact
dramatique peu commun : les premières invocations d'une Elektra ravivant le souvenir du père, la saisissante apparition de Clytemnestre, comme
par surprise ; une des ces images d'une beauté sculpturale dont le metteur en
scène a le secret. Débarrassée de toute grandiloquence, femme d'une extrême
beauté, on perçoit chez elle un désir de dépasser, pour un temps, le mur de
haine qui la sépare de cette fille esseulée qu'elle a voulu bannir, et auprès
de laquelle elle vient prendre conseil. Le dialogue entre les deux femmes a la
force de l'épure. Les échanges qu'Elektra aura avec Chrysothémis, la jeune sœur, ne sont pas moins marqués du
même souci de simplicité. Les personnages sont vrais, mus par une force
intérieure et non par un réalisme de façade. La régie évite l'hystérie, au
profit des moments de tendresse. Et il y en a à foison, même dans les passages
de plus extrême cruauté. Pour Chéreau, la figure d'Oreste est l'épine dorsale
de l'opéra, son fil conducteur, car c'est par lui qu'Elekta pourra assouvir son désir de vengeance. Il apparaît, flanqué de son précepteur,
si discrètement qu'on ne le remarque pas d'emblée, et peu à peu s'impose. Les
retrouvailles, paradoxalement, ne donneront lieu qu'à une effusion retenue. Son
devoir accompli, par le meurtre de Clytemnestre - achevée sur scène, de ce
deuxième coup fatal réclamé par Elektra - puis celui
d'Aegisth, il quitte ostensiblement le palais. Au
comble de l'exaltation, Elektra peut se perdre dans
une danse frénétique et d'extase, se murant soudain dans un immobilisme
saisissant, alors que tous alentour sont figés par l'effroi.

©
Pascal Victor / ArtcomArt
La réussite théâtrale se double
d'un achèvement musical comme il en est peu. Esa-Pekka Salonen, qui rêve de longue date de se pencher sur
cette partition gigantesque, en tire une coulée lumineuse, nourrie aussi de
traits chambristes. L'Orchestre de Paris se surpasse en termes d'engagement et
de chatoiement de couleurs. Et on se prend à redécouvrir des transitions
insoupçonnées, des accélérations fulgurantes ou des contractions révélatrices.
Évitant l'écueil d'un jet uniformément massif, mu par la volonté de ne pas
déverser une énergie envahissante, Salonen mise sur
la différenciation instrumentale et la nouveauté qu'elle révèle à plus d'un
endroit, aux confins de la tonalité. A l'écouter, on réalise que
l'orchestration straussienne n'est pas si boursouflée, encore moins creuse,
qu'on le dit, et que, malgré quelques paroxysmes à la limite du martèlement,
notamment dans la scène d'hystérie finale, il y a le plus souvent matière à
tout un dégradé de nuances. A cet égard, le chef ravale le lyrisme ronflant de
la scène de la reconnaissance à de plus justes proportions, rejoignant en cela
l'économie de moyens de la mise en scène à cet instant. Et si l'on n'échappe
pas à l'impression curieuse d'anticipation du rythme de valse consubstantiel à
l'opéra suivant, Le Chevalier à la rose, dans la musique associée au
personnage de Chrysothémis notamment, le phénomène
apparait moins topique que parfois. Pareille conduite orchestrale est pur
bonheur pour les chanteurs. Quelle distribution de rêve au demeurant ! Pour ce
qui est des trois personnages féminins en particulier. On n'a pas approché
depuis longtemps d'aussi complète Elektra que celle
proposée par Evelyn Herlitzius : physique félin, voix
inextinguible, développée dans le medium du soprano dramatique, et d'un
registre grave des plus assurés, réserve de puissance, évitant toute tentation
de devoir hurler le texte. Une Clytemnestre de haut vol avec Waltraud Meier, dont
la beauté ajoute à la présence intérieure. Son grand monologue ne flirte jamais
avec l'exagération. Chéreau gomme d'ailleurs le rire sardonique qui conclut la
scène mère-fille, lorsque la reine est subrepticement avisée de la nouvelle de
la mort d'Oreste. Adrianne Pieczonka, Chrysothémis, ne larmoie pas, comme souvent, et ses
interventions sont marquées au coin de la sincérité de la femme qui aspire à
une vie normale, parce qu'elle ne porte pas sur elle le poids du passé comme sa
sœur aînée. Mikhail Petrenko offre un Oreste quelque peu détaché, parti pris voulu par Chéreau, tout comme
Tom Randl se veut un pleutre Égisthe. Les servantes
forment un groupe cohérent, finement travaillé dans la plus pure tragédie. Et
on admire la présence de deux vétérans et habitués des productions de Chéreau,
Franz Mazura, le précepteur d'Oreste, hier de
l'aventure de la fameuse Lulu du Palais Garnier, et Donald McIntyre, un
vieux serviteur, naguère Wotan du Ring du centenaire à Bayreuth !
Jean-Pierre
Robert.
***
PRESTIGIEUX FESTIVAL DE SALZBURG

© Salzburger Festspiele Archiv
L'an II de l'ère Pereira se
voulait fastueux. Il l'aura été, notamment en misant sur les anniversaires des
deux géants Verdi et Wagner. Le premier se verra gratifier de productions de Falstaff,
de Don Carlo et d'une mémorable exécution du Requiem. Au second, on
prêtera la gloire des Maitres chanteurs de Nuremberg, dans une
production imaginative, si pas totalement convaincante, de Stefan Herheim, assortie de
la direction erratique de Daniele Gatti, mais aussi
les pompes martiales de Rienzi, donné en version de concert par un
Philippe Jordan galvanisant les jeunes du Gustav Mahler Chamber Orchestra et une distribution dominée haut la main par Sophie Koch. En tout
cas, l'intendant pourra s'enorgueillir d'avoir réussi le challenge de
rapprocher les chefs d'œuvre « comiques » de deux musiciens. Un
hommage à Benjamin Britten aura été l'occasion d'entendre son War Requiem, dirigé par Antonio Pappano, à la tête de son orchestre romain, et enluminé par
un trio de solistes dignes des créateurs, Ian Bostridge,
Thomas Hampson et Anna Netrebko ; la présence de cette dernière n'étant sans doute pas étrangère au fort taux
de remplissage du Grosses Festspielhaus ! Opéras,
concerts symphoniques et de chambre se seront succédés à un rythme d'enfer,
dont l'intégrale des Quatuors de Beethoven par les Hagen, enfin de retour chez
eux, et l'exécution des trois oratorios de Joseph Haydn par Nikolaus Harnoncourt ne sont que les gemmes d'une saison décidément de prestige.
Gawain : la
démesure
Harrison BIRTWISTLE : Gawain. Opéra en deux actes. Livret de David Harsent, d'après la romance anonyme du Moyen-Âge « Sir Gawain and the Green Knight ». Christopher Maltman,
John Tomlinson, Laura Aikin, Jennifer Johnston,
Jeffrey Llyod-Roberts, Gun-Brit Barkmin, Andew Watts, Brian Galliford,
Ivan Ludlow, Alexander Spargue. Salzburger Bachchor.
ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dir. Ingo Metzmacher. Mise en
scène : Alvis Hermanis.

© Ruth Walz
On ne change pas une équipe qui
gagne. La production de Gawain réunissait, en
effet, celle qui fit les beaux soirs du festival 2012, avec Les Soldats de Berndt Alois Zimmermann : Ingo Metzmacher à la direction d'orchestre, Alvis Hermanis à la régie. Mais l'opéra de Harrison Birtwistle,
monté en lieu et place de celui promis par György Kurtág, hélas
non achevé à temps, offre-t-il le même prestige ? On en doute. Créé en 1991, au
Royal Opera de Londres, il ne devait connaître depuis
lors aucune reprise. Un signe peut-être. L'œuvre est tirée d'une romance
anonyme du XIV ème siècle, intitulée « Sir Gawain and the Green Knight » (Sir Gawain et le Chevalier Vert), où à la cour décadente du Roi Arthur, un mystérieux
chevalier vêtu de vert se présente à cheval, une hache à la main, et demande à
la cantonade qu'on veuille bien lui trancher la tête, à la condition,
toutefois, qu'un an et un jour après, le même sort soit réservé à l'auteur de
ce geste, au Royaume de la Chapelle Verte. Personne, bien sûr, ne se risque à
relever un défi aussi absurde, si ce n'est Gawain, un
des chevaliers de la Table Ronde. Une fois l'acte rituel accompli, celui-ci
entame un parcours initiatique qui le mènera à la Cour du roi Bertilak - interprété au demeurant par le même acteur que
celui qui joue le Chevalier vert - dont la femme, Lady Hautdesert,
tente, par trois fois, de le séduire et ainsi de le détourner de sa mission.
Malgré sa résistance, elle lui fait présent d'un
ceinturon magique susceptible de le protéger de la mort. Gawain reviendra bien à l'heure dite pour se soumettre au sort prévu. Mais après trois
tentatives, Le Chevalier vert ne lui effleure que le cou. Gawain estime alors avoir tenu sa promesse. De retour à la Cour du roi Arthur, on veut
l'accueillir en héros. Ce qu'il refuse, car il est devenu un autre homme, ayant
triomphé de ses doutes et ayant trouvé son accomplissement, une victoire sur
soi-même surtout, sur la lâcheté et la peur. On a dit qu'il y avait quelque
chose de wagnérien dans cette histoire moyenâgeuse, et que la destinée de Gawain pouvait rappeler celle de Parsifal.
C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Harrison Birtwistle a écrit, pour ce qui était son troisième opéra, une musique compacte, dominée
par le registre grave, mais aussi démesurément bruyante,
insistant sur les cuivres et les percussions, dont une grosse caisse
tonitruante. De gigantesques clusters se succèdent en rafales, un bien mince
trait de flûte venant furtivement apporter quelque lyrisme dans un contexte
pesant. On est loin de la sobriété d'un Britten. Certes, Zimmermann, lui aussi,
dans Les Soldats, commet une partition frappée de gigantisme, mais
autrement plus inspirée et variée. Ici, le mode répétitif devient vite obsédant
et les tunnels se succèdent, qui ne parviennent pas à donner vie à une action
dont le débit reste lent, en seconde partie notamment.

©
Ruth Walz
Pour animer cette bien curieuse histoire, Alvis Hermanis use avec doigté de l'immense plateau de la Felsenreitschule dans une débauche d'images souvent insolites. On est saisi par l'utilisation
spectaculaire d'un lieu scénique où l'absence de cadre conventionnel offre tant
de possibilités ; quoique pas avec autant de pertinence que dans l'opéra de
Zimmermann. Il prévient : nous sommes en 2021, alors que la nature a envahi les
restes d'une civilisation à bout de souffle, soumise à la décrépitude. Des
visions de chaos s'imposent : murs délabrés, portes rouillées, empilement de
cercueils dont on extrait les squelettes, carcasses de voitures rongées par la
rouille et le chancre vert. Dans cet environnement lépreux, et aux côtés des
gens fort agités de la Cour d'Arthur, des personnages en guenilles se
trémoussent comme des diables, qui dans une fourgonnette désarticulée, qui au
sol enveloppés dans des couvertures ou des matelas de mousse. Un brelan de
chiens, non tenus en laisse, achève de communiquer un sentiment de malaise. Au
milieu de ce monde d'apocalypse, l'arrivée du Chevalier Vert sur son cheval de
bois, comme statufié, emplit d'étonnement et ne passe pas pour une image
mémorable. En seconde partie, la quête de Gawain s'illustre sur vision de tsunami, envahissante. Certes, la réalisation est
exemplaire, grâce à une direction d'acteurs soutenue et un traitement habile de
l'environnement naturel, métamorphosé par des éclairages ingénieux et des
projections virtuoses sur la roche à l'arrière plan. Hermanis ménage aussi la forte symbolique attachée à ce conte médiéval, tel le pentangle ou pentacle d'or de Gauwain.
Comme les effets de symétrie commandés par le récit, du chiffre trois notamment
- les trois coups de hache, les trois baisers. Mais l'obsession de l'idée de
retour à l'état de nature ravale par trop au rang d'anecdote la composante
symbolique. Ingo Metzmacher sauve cette partition
démesurée, où guette l'ennui, et la réalisation fait honneur à un chef
décidément en phase avec les déluges sonores. D'une distribution de haut vol,
on retiendra le Gawain de Christopher Maltman, intense et dont la voix projette haut et fort. Sir
John Tomlinson, un spécialiste de la musique de Birtswistle,
a encore de beaux atouts, même si le registre élevé de la basse, souvent
sollicité, est mis à rude épreuve. Mais celui qui incarna de mémorables Wotan
et Hans Sachs, possède toujours un sens aigu de la scène. Chez les dames, il
faut saluer la performance de Laura Aikin, elle aussi
habituée des parties périlleuses dans le soprano aigu dont les auteurs
contemporains aiment faire usage.
Don Carlo ou le poids de l'Histoire
Giuseppe VERDI : Don Carlo. Opéra
en cinq actes. Livret de Joseph Méry et Camille Du Locle, d'après la pièce « Don Karlos, Infant von Spanien » de Friedrich Schiller. Matti Salminen, Jonas Kaufmann, Anja Harteros,
Thomas Hampson, Ekaterina Semenchuk,
Eric Halfvarson, Robert Llyod,
Maria Celeng, Sen Guo, Benjamin Bernheim, Antonio Di
Matteo, Peter Kellner, Domen Krizaj, Roberto Lorenzi, Luriin Samoilov, Christoph Seidl,
Oleg Savran, Anna-Eva Köck. Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Wiener Philharmoniker, dir. Antonio Pappano. Mise en scène : Peter Stein.

©
Monika Rittershaus
La version jouée se veut
intégrale. On a en effet choisi de donner le premier acte, dit de
Fontainebleau, ce qui a pour avantage de clarifier l'action en plaçant au
centre de celle-ci l'idylle entre l'Infant d'Espagne et la jeune princesse
française Élisabeth. Leur première rencontre dans une clairière de la forêt
bellifontaine, alors que le peuple se lamente du sort que lui fait subir le
conflit avec le royaume ibérique, justifie le drame qui va suivre : le jeune
homme y déclare sa flamme et est payé de retour, perspective vite ruinée par
l'annonce faite à la jeune princesse qu'elle est choisie pour être la reine
d'Espagne. Leurs trois duos, respectivement au Ier, au
III ème, puis au V ème acte, constituent chacun un pôle de l'action. Bien sûr, le contexte politique,
tiré de la pièce de Schiller, est ben présent. En franchissant l'étape de
l'adaptation au format de l'opéra, la trame historique n'a pas perdu de son
acuité. Il n'est que de penser aux confrontations dont le roi Philippe II est à
l'origine : avec le marquis de Posa,
puis avec le Grand Inquisiteur. Certes, « Don Carlos », conçu pour
l'Opéra de Paris, et ses exigences en termes de spectacle grandiose, se veut un
hommage au genre du « grand opéra », tel que pratiqué alors sur la
scène française, avec son mélange de tableaux spectaculaires et de passages
plus intimistes. Mais le métier de Verdi y assure une vraie continuité
dramatique, même au prix de ces scènes où l'intrigue soudain semble marquer une
pause : lors de ces « moments gelés », comme les appelle le metteur
en scène, où l'action doit satisfaire à la tradition de l'opéra du XIX ème, et la musique verser dans le décoratif - mais quel
décoratif ! - comme lors de la chanson sarrasine qu'Eboli exécute devant les suivantes de la reine, ou des concertati enchâssés au milieu des longues scènes finales, les divers personnages se
livrant à quelques digressions ornementales. Cela fait partie d'un tout, et il
ne viendrait à l'esprit de personne de s'en plaindre. Ce qui constitue un
challenge pour le dramaturge, Peter Stein sait le maîtriser. Sa conception
reste d'une totale lisibilité. Pour signifier l'interaction entre ces grandes
figures, qui n'en sont pas moins, à l'exception sans doute de l'Inquisiteur et
de Charles Quint, des êtres humains, déchirés par la passion ou le doute.
Confronté au défi que constitue le vaste plateau, tout en longueur, du Grosses Festspielhaus, ne facilitant pas les choses question
intimité, Stein résout la question, rétrécissant drastiquement les dimensions
quand il le faut : lors de la première scène du IV acte, par exemple, qui voit
Philippe II méditer sur les malheurs politico sentimentaux auxquels il est
confronté. Les échanges plus que musclés avec le Grand Inquisiteur acquièrent,
dans cet endroit étriqué, quelque chose de troublant. La décoration se veut
épurée et ne cherche pas à capter l'attention : n'est-on pas dans la froideur
des murs de l'Escurial ou dans des lieux plus symboliques qu'expressément
désignés. Il revient aux costumes chamarrés de pourvoir au contexte historique.
La grande scène de l'autodafè, déployée sur toute
l'immensité du plateau, se veut plus démonstrative que spectaculaire, avec ses
défilés obligés et groupements divers (les députés flamands). Une échancrure de
ciel bleu, qui vire au nuageux, avant de signaler l'enfer des flammes pour les
hérétiques, sera ici la seule concession à la couleur. Stein ne cherche pas à
s'éloigner du texte, fut-ce au prix d'une gestuelle classique, presque
convenue. Mais l'essentiel est pourtant là : un intense morceau d'histoire se
vit, qui voit passer le vent du despotisme. Et jamais n'est-on distrait du
propos musical.

©
Monika Rittershaus
Et celui-ci, on le savoure au
centuple, car à une exception près, la distribution réunie frôle l'idéal. Anja Harteros est une Elisabetta d'un
galbe vocal insolent, possédant cette « stamina »
typiquement verdienne, qui la confirme bien haut parmi ses consœurs. La
composition, aristocrate, trouve son glorieux épilogue dans le fameux air du
dernier acte sur la vanité des choses, d'une rare puissance d'émotion, et lors
du duo qui suit avec Carlo. Ekaterina Semenchuk assure pleinement le personnage d'Eboli dont la
tessiture hybride taxe tant d'interprètes : que ce soit dans la chanson
sarrasine ou le grand air « O don fatale », sa maitrise est un sans
faute, et la vision se veut moins belliqueuse que souvent. Thomas Hampson répète sa grandiose incarnation de Posa : avec lui,
le texte vibre, au fil des échanges ardents avec Carlo ou des discussions
enflammées avec le roi. L'instant où Posa demande à l'Infant rebelle de
remettre son épée, devant la foule réunie, comme la scène d'adieu où, en ami
fidèle, il lui livre un ultime secret, bouleversent par leur engagement. De
Filippo II, Matti Salminen propose une assomption vocale à contre courant de bien de ses collègues. Car la
voix n'est pas de ce métal flambant italien auquel on est habitué (Ruggiero
Raimondi, Ferruccio Furlanetto),
ou de ce grain vibrant des basses d'Europe centrale (Boris Christoff, Nicolai Ghiaurov). Elle est
résolument plus terne et a tendance à être désormais dépassée dans l'extrême
forte. Le choix de cet artiste s'explique sans doute par une volonté de
vraisemblance : un royal vieillard enveloppé, qu'une certaine impassibilité a
endurci. Si le portrait séduit, la flamboyance sonore laisse à désirer. Rien de
tel avec le personnage de Carlo : Jonas Kaufmann ajoute un nouveau fleuron à sa
couronne, et peu après son Manrico (Il Trovatore) à Munich, démontre ses capacités à défendre
les grands héros verdiens. On sait délicat le rôle de l'Infant, dont certaines
notes haut perchées peuvent être ardues à négocier. Aussi savoure-t-on une
projection dépourvue d'effort alliée à un legato de rêve et à ces pianissimos
magiques dont le ténor munichois orne ses prestations. Le personnage offre
panache, mais aussi une belle retenue, sans sombrer dans la mélancolie. Les
duos avec Anja Harteros, une de ses partenaires
attitrées, ont cette évidence qui rend une soirée mémorable. Lorsque cette voix
d'or s'allie avec le baryton sonore de Thomas Hampson,
c'est pur morceau de choix, enluminé par une musique hautement inspirée. Côté
du registre des basses, l'Inquisiteur d'Eric Halfvarson reste un parangon de puissance terrifiante, là où le Charles V est un peu trop
pâle dans l'incarnation de Robert Llyod. Tous sont
soutenus par un orchestre incandescent. L'alchimie entre Antonio Pappano et les Wiener Philharmoniker est de celle qu'on comprend vite réussie. Le chef italien possède ce sens
naturel du discours verdien, sa fluidité, mais aussi ses chutes abruptes, son
immense lyrisme comme sa propension aux fiers accents. La prégnance du drame ne
se relâche jamais, au prix d'une tendance à presser le tempo, qui peut devenir
haletant, en accentuant encore l'impact.
Avec les Viennois, qui savent ce que ligne de chant veut dire, la coulée est
d'une superbe plasticité. Et les interventions solistes, notamment du
violoncelle au début du IV ème acte, sont d'une
couleur mémorable. Du très grand art !
Une Messe de Requiem de Verdi comme il en est peu
Giuseppe VERDI : Messa da Requiem pour
soli, chœur et orchestre. Krassimira Stoyanova, Elī na Garanča, Piotr Beczała, Dmitry Belosselskiy. Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor.
Wiener Philharmoniker, dir.
Riccardo Muti.

©
Silvia Lelli
Cette aisance verdienne, on la
retrouve, à un degré peut-être encore plus abouti, dans la vision que Riccardo Muti livre du Requiem. Il est des exécutions où tout semble
tomber sous le sens. Celle de Muti est de cette
veine. La symbiose entre le chef italien et les Viennois est légendaire. On se
souvient de leur prestation dans un Macbeth d'anthologie, lors du
festival 2011, au demeurant mis en scène par Peter Stein. Ce qui fait d'autant
plus regretter que ne soit plus céans confié d'opéra au maestro. L'élégante
gestuelle du chef respire la musique. La Messa da
Requiem, écrite en hommage au poète Manzoni, est une œuvre grandiose, dont la
théâtralité n'est pas absente. Mais pouvait-il en être autrement chez Verdi ?
Qui dépasse la catégorisation entre musique religieuse et opéra. On sait la
boutade du chef d'orchestre Hans de Bulow qui y
voyait « un opéra en habits ecclésiastiques », aussitôt contredit par
Johannes Brahms, criant au génie. Bien sûr, la vision du Jugement dernier
émanant du « Dies Irae », nantie de ses appels de cuivres et de ses forte assourdissants à l'unisson, est le signe d'une puissance divine plus
terrifiante qu'indulgente. Mais peut-on résister à pareil tumultueux
déferlement ? Riccardo Muti, qui ne lésine pas sur la
dynamique, assène abruptement les coups de grosse caisse et déchaîne ses forces
en un geste quasi cataclysmique. Mais on ne saurait mesurer une exécution à
l'aune de ce seul passage, fut-il le plus spectaculaire. Les quinze séquences
de cette magistrale fresque musicale sont ici autant de moments intenses. Qu'il
s'agisse des solos, des duos – comme le bouleversant « Recordare Jesu pie », où fusionnent les deux voix de
femmes -, ou des ensembles, tel le « Quid sum miser », réunissant soprano, ténor et mezzo, extrêmement proportionné,
tout ici signe l'inspiration la plus aboutie. Et peu importe que tel trait
« rappelle » une page d'opéra, telle la mélodie du « Lacrymosa », empruntée à son Don Carlo. Le quatuor
vocal réuni pour cette exécution, bien que ne comprenant pas une seule voix
italienne, fonctionne à merveille, emmené par celle suprême de Elīna Garanča dominant un déclamatoire « Liber scriptus ». Krassimira Stoyanova pare
le « Libera me » d'un dramatisme non forcé, et le fil de voix lors
des dernières notes est justement extatique. Piotr Beczała prête tant à l' « Ingemisco » qu'à l'
« Hostias » les prestiges d'un ténor
justement pas trop corsé, tandis que la basse Dmitry Belosselskiy sait ne pas charger d'effet inutile des
phrases telles que « Mors stupebit » ou « Confutatis maledictis », ce
qui en libère d'autant la force expressive. La contribution chorale n'est pas
moins remarquable. Les chœurs de l'Opéra de Vienne savent leur Verdi comme peu
: la séquence du « Sanctus » comme leurs diverses autres
interventions sont frappées au sceau de
la ferveur. On sort de cette exécution impressionné et rasséréné tout à la
fois. Le sens de l'événement y était on ne peut plus manifeste.
Norma fait de la résistance
Vincenzo BELLINI : Norma. Opéra
en deux actes. Livret de Felice Romani d'après
la tragédie « Norma ou l'Infanticide » d'Alexandre Soumet. Cecilia
Bartoli, Rebeca Olvera,
John Osborn, Michele Pertusi, Liliana Nikiteanu, Reinaldo Macias. Coro della radiotelevisione svizzera,
Lugano. Orchestra La Scintilla, dir. Giovanni Antonini. Mise en scène : Moshe Leiser / Patrice Caurier.

©
Hans Jörg Michel
La représentation de Norma s'écarte résolument des clichés qu'on a coutume d'associer à cette œuvre. Et
présente une toute autre vision, tant dramaturgique que musicale. Déjà, le CD récemment
paru (cf. NL de 7/2013) avait signalé un changement notable d'optique,
signifiant un retour aux sources, à travers une nouvelle édition critique. La
vision scénique donnée à Salzbourg achève la métamorphose. La trame d'une Gaule
occupée par les romains est transposée dans la France de l'Occupation allemande
des années 1940. Dès l'Ouverture, le climat s'impose : c'est en un lieu clos,
secret, que va se dérouler l'action, une salle d'école où se rassemblent les
résistants dont Norma est la prophétesse et Ovoreso le chef de file. La thématique du conflit entre sentiments personnels et
patriotisme prévaut dans la dialectique mettant aux prises amour, sacrifice et
trahison. Mais aussi confrontant le passé, les amours de Norma pour un
proconsul romain, dont elle a eu deux enfants, et l'avenir, l'aspiration à la
rébellion de tout un peuple contre l'envahisseur. C'est peu dire que la
composante religieuse, le forfait d'une druidesse ayant rompu son serment de
chasteté, est délibérément écartée, au profit d'une approche plus porteuse
théâtralement : la liaison à risque entre une jeune femme française et un
officier allemand, au mépris des engagements de non collaboration proclamés par
elle-même. Passée la surprise, de taille il est vrai, on se rend à l'évidence
qu'ainsi repensée en une réelle tragédie, l'œuvre libère une puissance
dramatique insoupçonnée. Les scènes se succèdent en rafales, avec une acuité
qui ne se dément pas. La vision, entièrement cohérente, offre cet avantage de
fondre arias, duos et ensembles en une construction dramatique qui ne laisse
place à aucune vacuité. L'opéra se fait théâtre. Dès sa première apparition,
prélude au fameux air « Casta diva », loin
du défilé prosaïque offrant au public l'occasion de saluer une chanteuse de
renom, Norma se présente comme une femme résolue à défendre son peuple, certes,
mais déjà en proie aux affres du danger de son amour pour Pollione.
Qu'elle cherche sans doute à protéger, dans ce qui est une prière en faveur de
la paix, plus en phase avec ses propres sentiments intimes. L'échange
douloureux avec la jeune novice Adalgisa dépasse la
rivalité d'opéra entre femmes aimant le même homme : il cache d'abord un aveu
de faiblesse, prélude à l'indulgence. Et la trahison que Norma reconnait
infliger à ses amis la conduit naturellement au
sacrifice, à son propre sacrifice. Cecilia Bartoli dit approcher l'œuvre à
travers le prisme de la sensualité sicilienne, plus que dans l'optique d'une
prêtresse gallique, et s'inspirer de l'interprétation exacerbée d'Anna Magnani
dans le film « Roma, città aperta »
de Rosselini. Les références à la période de
l'Occupation sont percutantes : hommes en bérets, leurs compagnes vêtues de
tenues de l'époque, culte de la suspicion et des activités nocturnes, et ce
terrible usage de tondre les cheveux de la femme ayant trahi : Norma subira ce
funeste sort avant de périr. La décoration, volontairement claustrophobe,
évoque une atmosphère oppressante, encore renforcée par ce mur noir qui réduit
le plateau lors des scènes réunissant les trois protagonistes essentiels. Au
finale, la scène se vide peu à peu des chœurs pour ne laisser en présence que
les deux amants face à leur inéluctable destin de mort, tandis que l'incendie
fait rage alentour. Si tout est ordonné autour de la figure centrale de Norma,
la mise en scène du tandem Moshe Leiser et Patrice Caurier n'en dissèque pas moins chacun des autres
personnages : Pollione, qui lui aussi transgresse les
lois de ses mandants romains, Adalgisa, une jeune
fille toute simple embarquée comme malgré elle dans une affaire d'amour où elle
rencontre la propre destinée de Norma, Ovoreso,
gardien de la ligne pure et dure de résistance à l'ennemi. La force théâtrale
apparaît à chaque situation, à chaque réplique même, au long d'un spectacle
très abouti ; et de façon autrement plus déterminante que dans la production
erratique conçue par les mêmes régisseurs pour Giulio Cesare de Haendel,
en 2012. Et on dépasse, sans s'en apercevoir, la pure écoute musicale pour s'en
imprégner.

©
Hans Jörg Michel
C'est aussi le mérite de cette
conception que d'unir indissolublement musique et texte. Giovanni Antonini joue d'une direction extrêmement contrastée,
alternant long legato soutenu et battue rapide, fort articulée, presque
cassante. Les oppositions de dynamique entre pppp étonnamment clairs et fff, vigoureux, comme
cravachés, sont rien moins que saisissantes, comme déjà révélé dans le disque.
Le recours aux instruments anciens de l'Orchestra La Scintilla ajoute encore à
l'ascétisme sonore. On se prend à redécouvrir les subtilités de l'orchestration
et son pouvoir déclamatoire. Là encore, on est à cent lieues d'une
interprétation misant sur la seule beauté de la ligne mélodique que Bellini
déploie à l'envi. Au contraire, l'écoute se veut exigeante pour en savourer les
couleurs spécifiques. C'est que le retour à l'édition originale est source de
bien des découvertes. En termes de tempos, bien sûr, mais aussi d'accents.
L'écrin est taillé pour Cecilia Bartoli dont le timbre particulier trouve
matière à s'exprimer, à l'aune des recherches de la chanteuse sur
l'interprétation d'origine, celle de la créatrice Giuditta Pasta, puis de Maria Malibran : agilité de la
colorature, ménagée au fil des pianissimos longuement tenus, sûre déclamation
dramatique dans la force de la voix. Il
y a là quelque chose du tragique de Médée, de l'invective d'une femme poussée
hors d'elle, qui finira par assumer ce qui est une mort d'amour. On reste
subjugué par la force émanant de cette voix conduite dans ses ultimes
retranchements. Et quelle habileté suprême à manier le tourmenté et le
pathétique ! Cecilia Bartoli révèle ici une capacité d'immense tragédienne. A
ses côtés, Rebeca Olvera offre une Adalgisa volontairement jeune, alors
surtout que distribuée à une voix de soprano léger. Si celle-ci peut paraître
fluette en comparaison, et même plus encore que Sumi Jo dans le CD, le personnage n'est pas moins tendu : une jeune femme sans fard,
naturelle, assurant pleinement ses choix. C'est une des caractéristiques de
cette interprétation que de confier le rôle non à une mezzo, mais à une voix
nettement plus légère. La créatrice, Giulia Grisi,
n'avait que 20 ans ! De même, Pollione trouve en John Osborn la vraie tessiture voulue par Bellini : non
pas un ténor taillé pour Verdi, mais un timbre clair, plus orienté vers les
canons bel cantistes. Là encore, la différence avec
les exécutions habituelles est on ne saurait plus flagrante. Michele Pertusi tire du
personnage d'Ovoreso une vigueur insoupçonnée.
Pareille attitude distingue la contribution du Chœur de la Radio suisse,
particulièrement étudiée dramatiquement : l'appel « Guerra, guerra », alors que tous, alignés au premier plan,
entourent fébrilement Norma, atteint une frénésie saisissante.
Un oratorio de Haydn révélé : Le retour de Tobie
Joseph HAYDN : Il ritorno di Tobia. Oratorio en deux parties.
Texte de Giovanni Gastone Boccherini, d'après le
« Livre de Tobit » de l'Ancien Testament. Valentina Farcas, Sen Guo, Ann Hallenberg,
Mauro Peter, Ruben Drole. Arnold Schoenberg Chor. Orchestra La Scintilla, dir. Nikolaus Harnoncourt.

© Wolfgang Lienbacher
C'est chose précieuse que de
pouvoir découvrir une œuvre dont on ne soupçonnait pas même l'existence, encore
moins les beautés, grâce à une interprétation superlative. Le premier oratorio
de Joseph Haydn, créé à Vienne, en 1775, reste peu connu, sûrement la moins
jouée des œuvres majeures de son auteur. Il offre une structure bien différente
des deux pièces subséquentes, La Création et Les Saisons. Il se
conforme au modèle dit napolitain, qui privilégie une manière opératique,
ponctuée d'airs développés et d'une grande bravoure, contrastant avec quelques
duos et des interventions chorales significatives. Le thème, emprunté à
l'Ancien Testament, et adapté par Giovanni Gastone Boccherini, frère du compositeur Luigi, se situe dans la tradition métastasienne et on y observe la règle de l'unité de temps,
de lieu et d'action. C'est celui du héros biblique Tobias qui guérit son vieux
père Tobit de sa cécité. Celui-ci ne peut d'abord supporter le choc de la
lumière retrouvée, et ce n'est que grâce aux conseils de sa belle-fille Sara
qu'il pourra peu à peu s'y accoutumer. Les arias, de forme da capo, offrent une
mine d'expressions musicales. Elles sont introduites par un prélude symphonique
développé, et pour la plupart forgées sur le modèle concertant, d'un ou
plusieurs instruments à vent. Ainsi de l'aria de Tobia accompagnée par le cor,
ou de telle autre par le délicat cor anglais. Chacune des deux parties se
conclut par un chœur de vastes proportions, lui-même adorné d'une fugue à
plusieurs voix. Nikolaus Harnoncourt est bien l'homme
de la situation. Sa direction, qui peut paraître sèche dans la gestuelle, offre
une précision millimétrique quant au dosage des divers climats, dont
d'exceptionnels moments contemplatifs, et possède cette élasticité interne qui
illumine une musique austère, mais jamais terne. Elle use d'un très large
spectre dynamique, de l'impalpable pianissimo au forte bien sonnant ; ce
que l'acoustique, largement améliorée, de l'immense Felsenreitschule permet d'apprécier pleinement, sans pour autant laisser perdre à la pièce son
intimité naturelle. Il faut voir le chef « nurser »
ses exécutants, avec cette autorité naturelle, cette sévérité dans le regard,
qui tire le maximum. Il dirige non pas ses Concentus Musicus, mais l'Orchestra La Scintilla, qu'il connaît bien
par leur travail à l'Opernhaus de Zürich. Au
lendemain de la Première de Norma, ces merveilleux musiciens offrent de
nouveau une fascinante palette sonore. Les cinq solistes ont fort à faire : les
deux sopranos, Sen Guo, éthérée archange Raphaël, et Valentina Farcas, dans la partie cruciale et ardue de Sara, qui
flirte avec des écarts vertigineux entre le haut et le bas du registre ; la
mezzo-soprano Ann Hallenberg qui prête toute son
autorité à une exécution mémorable d'Anna, la mère de Tobias. Mauro Peter,
jeune ténor au timbre ductile et cristallin, pare le rôle de Tobie d'une réelle
grâce. Enfin la basse Ruben Drole, Tobit, émeut par
son impeccable diction. Certes, l'écoute s'avère, comme souvent avec
Harnoncourt, des plus exigeantes, car l'auditeur est contraint à un maximum
d'attention. Mais le public suit avec quasi religiosité, assurément subjugué
par le travail d'orfèvre qui lui est présenté. Figure vénérée ici, le maître
peut être fier de cette exécution événement.
Jean-Pierre
Robert.
ECLECTISME AU FESTIVAL DE MONTPELLIER

La 29ème édition du Festival de
Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon peut s'enorgueillir d'un large
succès. Avec 189 manifestations, dont 107 dans la seule ville de Montpellier,
ce sont quelques 110.000 spectateurs, et des auditeurs par centaines de
milliers, au fil des retransmissions, le plus souvent en direct, sur les ondes
de Radio France, qui auront pu apprécier les nombreux et divers programmes
proposés, adossés à deux thèmes : « Musique et Pouvoir », et
« La Méditerranée ». La hausse de la fréquentation touche tous les
secteurs, même celui des concerts – gratuits – de musique de chambre de 12H30,
ce qui est plus qu'encourageant.
La souveraine manière de Bernard Haitink

© Luc Jennepin
Rapprochement intéressant que
celui du Concerto pour orchestre de Bartók et de la Troisième
symphonie de Beethoven. Première œuvre américaine du musicien, le Concerto
pour orchestre a acquis une réputation envieuse. Commande du chef
d'orchestre Serge Koussevitzky, elle sera achevée en 1943, et créée à Boston,
en décembre 1944. Cette « œuvre de bilan », selon Claire Delamarche (Béla Bartók, Fayard), est un témoignage de la
dernière manière du musicien hongrois, qui malade, trouve assez de forces pour
encore étonner. Sa structure en arche culmine dans le mouvement lent, « Elegia », entourant deux scherzos, eux-mêmes bordés
par des mouvements d'envergure. Bernard Haitink aborde la pièce de manière retenue et l'impression se confirmera au long des
cinq mouvements. Mélange de sévérité et de simplicité, de noirceur même, la
vision rencontre la définition donnée par l'auteur : « une graduelle
progression allant de l'austérité du premier mouvement et du lugubre chant de
mort du troisième vers l'affirmation de la vitalité du dernier ». De fait,
les différentes séquences de l'Introduzione sont
ménagées avec hiératisme, les sections fugato aux cuivres bien détachées. Le
deuxième mouvement qui, nul doute, a valu son nom à l'œuvre, juxtaposition de
cinq brefs solos d'instruments à vent, basson, hautbois, clarinette, flûte,
trompette, jouant par deux, est un modèle d'espièglerie : ce « Jeu de
couples » est interrompu par un choral de cuivres. A l'Elegia,
les réminiscences du Château de Barbe-Bleue, en particulier de l'épisode
du « Lac des larmes », sont frappantes, alors que le chef ajoute une
touche de contemplatif et de nocturne. Le mouvement suivant, Intermezzo interrrotto alterne nostalgie d'une rengaine magyare et
humour froid. Le finale fugué sera tendu jusqu'à son ultime épisode, là où
Ernest Ansermet voyait « une coda vertigineuse comme un grand coup de
vent ». L'Orchestre National dont l'association avec le chef néerlandais
n'est pas nouvelle, se donne à fond et la sonorité est magistrale, au long d'une
exécution qui acquiert une sorte de classicisme. Il en va de même de celle de
la Troisième Symphonie de Beethoven. Les vastes proportions de cette
« Héroïque » ne surprennent plus, en comparaison de celles de
Bruckner ou de Mahler. Mais il y a toujours quelque chose de fascinant à
réentendre ces quatre mouvements, à redécouvrir leur perfection formelle.
L'interprétation de Haitink est une merveille
d'équilibre, de noblesse naturelle. Loin de l'effet, la sobriété rencontre
l'économie de moyens recherchée par l'auteur. Foin d'envolées martiales. Ce
sera, plutôt, le chant des « voix intérieures », dont parle Romain
Rolland. L'élan, plus que la conquête, lumières et ombres, dominent l'allegro
con brio. La « Marcia funebre » atteint un
hiératisme envoûtant, non pas d'une triste lenteur, mais tout simplement emplie
de grandeur. Le scherzo est tourbillonnant. Quant au finale, il est emporté, en
même temps d'une vigueur maitrisée. Une exécution dont on ressort rasséréné,
d'une perfection instrumentale rare, comme on voudrait que tous les concerts du
National soient parés.
Bach, Berio, Boulez

© Luc Jennepin
La formule du concert dit à
géométrie variable a ceci de bon qu'elle permet de rapprocher des œuvres qu'on
n'associerait pas, a priori, au cours du même programme. Celui donné à l'Opéra
Comédie était osé dans son enchaînement : la Deuxième Partita de Bach, Linea pour deux pianos, vibraphone et marimba de
Berio, et sur Incises de Boulez. La deuxième Partita, BWV 826, de Jean
Sébastien Bach, tirée du recueil du Clavierübung,
peut sembler une introduction austère. Il n'en est rien sous les doigts de
Jean-Frédéric Neuburger, qui déroule avec une
délicate rigueur, presque aérienne, les danses de cette suite, Allemande,
Courante, Sarabande et Rondeau, qu'encadrent une Sinfonia et un Capriccio en guise de Gigue. La référence à la Sonate pour deux pianos et
percussions de Bartok est fortuite dans le cas de Linea, car Berio semble emprunter à la même
composition instrumentale ; avec une sérieuse différence toutefois : s'il y a
encore deux claviers, la section des percussions se limite au vibraphone et au
marimba, deux percussions-clavier. Ces deux dernières prolongent le son des
pianos, car souvent chaque pianiste joue à une main sur l'accompagnement des
percussions. L'œuvre offre cette autre originalité d'être la première que Berio
aie conçue pour le ballet. Elle sera crée en 1973, dans une chorégraphie de Felix Blaska, par le sœurs Labèque. Elle peut tout
autant être donnée en concert. Selon son auteur, la pièce se vit comme « la
constante transformation d'une très simple mélodie au gré d'articulations plus
complexes, différenciées et indépendantes ». La sonorité cristalline
prédomine, le registre aigu étant favorisé. C'est une courte pièce pour piano, Incises (1993/94), qui est à l'origine de celle intitulée sur Incises,
écrite durant les années 1996-1998, selon le procédé, cher à Pierre Boulez, de
l'œuvre en perpétuel développement, en extension, comme par un phénomène
d'amplification, puisqu'elle comporte elle-même deux versions, une version dite
partielle (Bâle,1996), et une version compète (Edimbourg, 1998). On sait
combien le paramètre de la forme est essentiel aux yeux de Boulez. Autrement
plus développée que sa source pianistique, car atteignant une quarantaine de minutes,
dans son ultime version, donnée ici, le morceau réclame, là encore, un effectif
peu ordinaire : trois pianos, trois harpes et un brelan de trois
percussionnistes. On remarquera qu'il s'agit d'instruments résonants et que
l'espace joue, ici, un rôle primordial. Ce qui autorise une expérience
acoustique inédite, la musique confinant par endroits au scintillement sonore.
Elle nécessite un chef pour coordonner l'ensemble. Pourtant, l'impression
d'improvisation domine. Le chef « dessine presque la musique »,
confie Bertrand Chamayou. Le matériau est très
chargé, on ne peut plus virtuose, dans son tempo plutôt rapide. Chamayou, Neuburger et ses
collègues, sous la houlette de Jean Deroyer, qui a
travaillé avec le maître, à Lucerne, et dont la gestuelle rappelle la manière,
en livrent une exécution sans doute conforme à la volonté de celui-ci.
Le contre-ténor Max Emanel Cencic fête Venise

© DR
Pour célébrer le thème de la
Méditerranée, Max Emanuel Cencic avait concocté un
programme original d'airs d'opéra italien, identique à celui de son récent CD,
« Venezia », paru chez Virgin Classics. À la croisée des diverses manières célébrées
alors dans la Sérénissime, dans les années 1710-1740, illustrant
l'extraordinaire prolixité du genre, tout comme la fabuleuse habileté de ceux
qui s'y produisaient, les « divi », ou
castrats, dont le public s'arrachait les apparitions. Cencic pioche dans ces innombrables pièces dont la carrière était souvent aussi
éphémère que la brillance singulière. Il privilégie la manière élégiaque plus
que le spectaculaire. L'intimité aussi, dans une ambiance feutrée, et une
approche un brin précieuse ; ce à quoi répond un timbre plus grave que celui du
français Jaroussky, par exemple, et ce pour camper
des rôles attribués autant à des castrats qu'à des contraltos. Les premiers
morceaux ne sont, volontairement, pas démonstratifs, et la virtuosité ne prend
ses marques que peu à peu. On admire le legato, qui peut confiner à
l'hypnotique, telle l'aria tirée de La Merope de Geminiano Giacomelli,
qui paradoxalement tire son effet, non pas tant des prouesses vocales que d'un
travail sur le son de ce qui est une déchirante lamentation, entrecoupée de
longs soupirs. Impressionné par la fascinante beauté de l'aria, et sans doute
de son interprète, le castrat Farinelli, Vivaldi devait s'en emparer pour
l'inclure dans son pasticcio L'Oracolo di Messenia. Pratique courante à l'époque ! La
force dramatique, Cencic la dévoile aussi dans une aria
di furore de Caldara, « Barbaro non comprendo », tirée de Adriano in Siria, aussi exigeante pour l'orchestre d'ailleurs,
constellé de traits fébriles et agrémenté d'effets d'écho. Les extraits de
Vivaldi ne sont pas moins l'occasion de révéler chez l'interprète un art du
beau phrasé, dans des pages de La Verità in cimento, de style déclamatoire pour dresser un portrait
saisissant d'un quidam se faisant passer pour un prince du sang. Ou encore au
fil d'opéras peu connus, Agrippo ou
encore L'odio vinto dalla costanza, deux pièces tardives du musicien,
confiées à l'origine à la voix d'alto. Le dernier air, sur le mode « di tempesta », est acrobatique, du registre grave à
l'aigu du soprano, seule concession à la grande virtuosité, un peu éludée par
ailleurs de ce sage récital. Le jeune ensemble Il Pomo d'oro, fondé en 2012, a déjà plusieurs fleurons
discographiques à son actif. Il procure un accompagnement de haut vol. Là où
souvent ce type de récital se complait dans le remplissage de circonstance,
pour laisser au soliste le temps de souffler, les morceaux purement instrumentaux
atteignent, ici, un réel intérêt, au point de presque ravir la vedette au
chanteur. C'est que le violoniste Riccardo Minasi est
de ceux qui peaufinent leurs exécutions pour faire de la plus banale petite
pièce un morceau de choix. Et que la poignée de musiciens, huit cordes et un
clavecin, sont autant de solistes à part entière. Le souci d'authenticité, la
recherche des accents, autrement plus souples que dans leurs exécutions de
concertos de Vivaldi, « per Pisandel »,
hier chez Naïve (cf. infra), sont une fête. Ainsi, précisément, du concerto du Prete rosso, RV 277, « Il Favorito », merveille de fluidité. Ou de la sinfonia de Giuseppe Antonio Brescianello (1690-1758), neuf minutes d'une écriture trépidante, parée de motifs emportés
et d'une énergie sans limite dans son bref presto. Le divo,
crâne rasé et tenue excentrique, se voit, au final, gratifié d'un énorme
bouquet, telle une star de la scène ! Il ne rechignera pas à chanter, en bis,
un long air tiré de Nitocride Giuseppe Sellitto.
La Vivandière ou une Fille du régiment bien française...
Benjamin GODARD : La
Vivandière. Opéra comique en trois actes. Livret d'Henri Cain.
Nora Gubisch, Omo Bello, Florian Laconi,
Étienne Dupuis, Alexandre Duhamel, Sébastien Droy,
Franck Ferrari, Yves Saelens, Ivan Thirion. Chœur de
Radio France. Orchestre national de Montpellier Languedoc- Rousillon, dir. Patrick Davin.

© Marc Ginot
Benjamin Godard (1849-1895) a à
son actif un corpus intéressant, dans à peu près tous les genres musicaux. C'est que ce
violoniste de talent, formé chez Henri Vieuxtemps, mais aussi virtuose du
piano, est chef d'orchestre et chambriste par passion. Parmi ses opéras, La
Vivandière, commande de l'Opéra Comique, y sera créé en 1895, tout juste
après la mort du compositeur. Inachevée, la partition avait été complétée par
Paul Vidal. La musique en est de style traditionnel, comme on produisait dans
les années 1830, d'un romantisme qui ne s'embarrasse pas d'envolées ravageuses,
mais au contraire favorise la mélodie attachante dans sa simplicité, pour ne
pas dire un banal assumé. Les airs, tel « Viens avec nous, petit », ont la
grâce d'une bluette, les duos sont bien pensés, et les ensembles, si pas des
plus distingués, atteignent, du moins, leur fonction de point d'orgue, voire
même affirment une force théâtrale certaine, telle la rage de la violence dans
le quatuor dit de la malédiction. Si la pièce est musicalement inégale, le
premier acte, en particulier, souffrant d'intermittence dans l'inspiration, on
admire ensuite de beaux morceaux, tels que l'entracte introduisant le 2ème
acte, ou l'intermezzo du troisième, sorte de mélodrame muet, sans parler d'un
ballet militaire aussi amusant, dans son vrai faux martial, qu'à la limite de
l'agréable caricature. L'écriture vocale est naturelle, la partie de Marion, la
Vivandière, en particulier, pensée pour un timbre de mezzo, selon les canons de
l'époque, comme le sont Carmen, Dalila et Charlotte. Henri Cain,
un des librettistes attitrés de Massenet, a conçu un texte vif, même si pas toujours
des mieux léchés du strict point de vue littéraire. L'action se passe durant
les derniers feux de l'insurrection vendéenne, qui trace un fond militaire
pittoresque pour un drame amoureux, apportant même un suspense inattendu. La
fière cantinière saura se démener pour réunir un couple dont chacun des membres
appartient aux clans rivaux. Un mélange de comique et de pathétique, qui
faisait les belles soirées de l'Opéra Comique du milieu du XIX ème, avec des relents à peine déguisés de mélodies populaires
à la mode et de chants patriotiques, sur le ton du refrain, compose des
tableaux hauts en couleurs jusqu'au coup de théâtre final : un décret portant
amnistie et effaçant le forfait militaire de la Vivandière. Une sorte de Fille du régiment à la française, en somme.

©
Marc Ginot
L'interprétation de ce qui
passe pour une « re création », fidèle à
l'esprit du festival montpelliérain, doit beaucoup à l'engagement de Patrick Davin. Un chef qui ne laisse jamais rien au hasard et ne
ménage pas ses forces pour trouver une unité à ce qui peut passer pour un
patchwork. L'Orchestre de Montpellier répond avec brillance, notamment durant
les intermèdes purement symphoniques. Nora Gubisch,
dans le rôle titre, domine une distribution bien construite. Même privée de la
scène, son sens théâtral y fait merveille. Le timbre très italianisant du ténor
Florian Laconi, qui projette haut et fort, sonne de
manière presque détonante, affichant crânement le personnage de l'amoureux,
mais avec une indéniable sincérité. Omo Bello, Jeanne, la soupirante, pâtit de
ce voisinage claironnant, alors que la composition est attachante et la
vocalité choisie. Parmi les voix graves, la palme revient à Étienne Dupuis,
Bernard, le capitaine au grand cœur, partie des plus gratifiantes : sa belle
voix de baryton, sa diction consommée, offrent des moments de grande intensité.
Le duo avec Marion, au dernier acte, par exemple, est une page valeureuse. La
contribution chorale est remarquable. Une découverte, pas aussi mémorable
qu'espérée, mais non dénuée d'intérêt.
Jean-Pierre
Robert.
***
L’EDITION MUSICALE
FORMATION
MUSICALE
Jean-Paul
DESPAX et Marguerite LABROUSSE : Formation
musicale chanteurs. Vol. 3 Lemoine :
29087 HL.
Le développement des
classes de chant a amené les pédagogues de la Formation Musicale à concevoir un
enseignement spécifique pour ces élèves qui sont le plus souvent des adultes
dont beaucoup n’ont aucune notion de solfège. Les auteurs y réussissent
pleinement. Ce troisième volume est dans la ligne des deux premiers selon
des principes fondamentaux : ne rien intellectualiser qui ne soit d’abord
ressenti, que ce soit pour le déchiffrage, la formation de l’oreille tant
mélodique qu’harmonique. Il s’agit donc d’un ouvrage qui rendra des services
inestimables aux professeurs de chant et de formation musicale.

WAGNER : 3 ouvertures : Tristan et Isolde,
Lohengrin, Tannhäuser. Edition de poche et CD. Eulenburg :
EAS180.
Qui n’a pas au moins une
fois dans sa vie utilisé les partitions de poche des éditions Eulenburg ? La nouveauté, ici, est de joindre au
fascicule contenant la partition de ces trois ouvertures une préface tout à
fait intéressante et surtout l’enregistrement intégral des œuvres dans des
interprétations remarquables : Leif Segerstam conduisant le Royal Swedish Opera Orchestra, Michael Halász à la tête du Slovak Philarmonic Orchestra et
Antal Jancsovics dirigeant le Budapest Symphony Orchestra. On peut rêver d’excellentes séances de
formation musicale à partir de cet ouvrage.

CHANT
CHORAL
Collections
« Alfred CHORAL Designs »
et « Alfred Pop Series »
.
Les éditions Alfred (http://www.alfred.com/) proposent pour les chœurs un répertoire existant en
différentes versions (SATB, SAB, 2 voix égales, voix d’hommes…). Ce répertoire
est extrêmement varié et abondant. Ces chœurs demandent un accompagnement de
piano. Tout cela est bien écrit et de bonne qualité. Il n’est pas possible dans
le cadre de notre « lettre » de les recenser tous puisque nous en
avons reçu une quarantaine... Signalons cependant un certain nombre de titres : Adeste Fideles de Sally K. Albrecht, Reaching for the Stars et Go Ye into All the World du même auteur, Viva amoreadapté
de La finta semplice K. 51 de Mozart, The Pirates of Penzance Choral Highlightsd’Arthur
Sullivan... On trouve aussi tout un répertoire pour les mêmes formations
dans la collection Alfred Pop Series dans différentes catégories. Citons
seulement Welcome Christmas ou Lydia,
the Tattooed Lady… L’ensemble se trouve sur
le site des éditions. Ce répertoire, accessible à tous les chœurs d’amateurs,
conviendra particulièrement aux chorales d’adolescents. On peut également se
procurer le catalogue.



Richard
WAGNER : Im treuen Sachsenland WWV 71 A. Chœur d’hommes a cappella.
Schott : C55508. Steuermann, lass die Wacht ! Chant des marins tiré du « Hollandais
volant ». Version originale de 1844. Chœur d’hommes a cappella. C 55509. An Webers Grabeam 15. Dezember 1844. (WWV 72). Chœur d’hommes a cappella. C 55506. Dein ist das Reich. I » Studirfuge » für 4 Singstimmen. (WWV 19 A). Chœur mixte a
cappella. C 55507.
Les éditions Schott
ouvrent aux chœurs un répertoire fort intéressant et sans grande difficulté de
Richard Wagner à travers ces pièces fort variées. L’édition en est très claire
et très soignée. Souhaitons que beaucoup de chœurs les fassent connaître à leur
public.




Michel
VERSCHAEVE : Chœurs d’opérettes et
d’opéras comiques. Lemoine : 29090 HL.
Voilà un recueil qui met
de bonne humeur dès la couverture. Les dix chœurs proposés sont extraits
d’œuvres connues ou moins connues d’Edmond Audran, Benjamin Godard, Ferdinand
Hérold, Charles Lecoq, Jacques Offenbach et Robert Planquette. L’album commence
par la leçon de chant du Petit Duc de
Charles Lecoq, à recommander chaudement pour l’apprentissage de la gamme de sol
dans les cours de solfège. Signalons aussi le bruit de bottes des carabiniers
dans Les brigands… Bref des chœurs
incontournables fort bien présentés. Il y a là beaucoup de plaisir en
perspective pour les choristes !

Daniel
TOSI : Mareta, Mareta, no’m faces plorar pour six
voix et un percussionniste. Dhalmann : FD0410.
Ecrite pour deux voix de
soprano, alto, deux voix de ténor et basse, cette grande berceuse comporte neuf
sous-parties. Le thème en est une complainte catalano-valencienne
traditionnelle. L’ensemble est plein de charme et de jolies couleurs mais
demande des chanteurs bien exercés. L’œuvre a été créée à Marseille le 12 juin
2013.

Claire
VAZART : Celtiques. 10
arrangements de mélodies bretonnes et irlandaises pour chœur mixte (SATB) et
piano. Delatour : DLT2107.
Les mélodies sont aussi
variées que les arrangements. L’ensemble bénéficie de tout l’art de son auteur.
Le tout peut être également accompagné par un ensemble jazz avec instruments
traditionnels. L’humour est au rendez-vous, comme il se doit, par exemple dans
ce Réveil du défunt lors d’une soirée
funèbre bien arrosée. Un certains nombres de thèmes sont déjà célèbres,
tous méritent de le devenir.

CHANT
Pathways of Song compiled, arranged, translated, edited by Frank LaFORGE and
Will EARHART. Volume
4. 1 vol. 1 CD. Alfred : 39933.
Voici un choix judicieux
de mélodies de tous pays et de tous auteurs, de Bach à Strauss, sans oublier
des mélodies issues du folklore. L’ensemble est très bien choisi, très bien
édité. Le CD contient l’intégrale des accompagnements par Sally K. Albrecht qui
mérite une mention particulière pour ses interprétations sensibles et
respectueuses des styles divers contenus dans ce recueil. Cette collection
compte quatre volumes disponibles en voix hautes et voix basses.

ORGUE
Théodore
DUBOIS : L’œuvre d’Orgue. Volume
V. Bärenreiter Urtext :
BA9208.
Ce cinquième volume
comprend les Dix pièces nouvelles de
1921 et la Fantasietta avec variations de 1922, jamais
rééditées depuis la première édition. La préface d’Helga Scauerte-Maubouet est tout à fait intéressante. Théodore Dubois est
plus connu pour son traité d’harmonie que pour ses œuvres, et c’est bien
dommage. Souhaitons que cette édition donne l’occasion aux organistes de
remettre en valeur ce répertoire trop oublié.
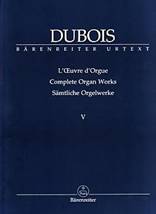
PIANO
Dan COATES : Easy Piano Selection from Once. Alfred : 4829.
Cette sélection très
simple tirée de la célèbre comédie musicale créée en 2011 réjouira évidemment
les jeunes pianistes qui connaissent l’œuvre mais peut réjouir également les
autres en leur faisant découvrir ces airs plaisants et rythmés. Ajoutons que la
présence au-dessus des portées des accords de guitare peut permettre de
savoureux duos.
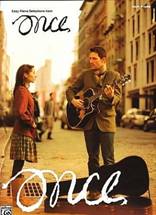
Dan FOX et Dick Weissman : Chord progressions : theory and
practice for pianists. Every thing you need to
create and use chords in every key. Alfred :
35174.
Voici un remarquable
ouvrage, certes, tout en anglais, mais cela ne devrait arrêter personne
puisqu’on apprend maintenant l’anglais dès les classes primaires… Théorie et
pratique des accords et de leurs enchainements sont minutieusement expliquées.
Les puristes regretteront sans doute que les chiffrages
« classiques » ne soient pas mentionnés. Mais l’expérience nous a
appris qu’il n’était pas difficile de les rajouter au fur et à mesure. Et il
faut bien dire que cette méthode vise plus à faire accompagner des mélodies
actuelles ou à improviser sur elles qu’à réaliser à vue des basses chiffrées.
Bref, il s’agit d’une démarche salutaire si on veut initier les élèves aux
joies de l’improvisation et de l’harmonisation, ce que tout professeur de piano
recherche, bien entendu.

Ingrid JACOBSON CLARFIELD et
Phyllis ALPERT LEHRER : Classics for the developping pianist. Core repertoire for study and performance. Alfred : 37288.
Les deux éditrices de ce
recueil ont choisi une sélection de dix-huit œuvres du répertoire pianistique
allant de Jean-Sébastien Bach à Béla Bartók, classées par périodes. Le choix
est tout à fait judicieux et on peut conseiller ce recueil non seulement comme
outil de travail pour les pianistes déjà assez avancés ou comme utile manuel de
déchiffrage qui permet de se constituer à la fois un répertoire et surtout une
culture musicale. Ajoutons que l’édition est soignée, et abondamment doigtée.

Ryo NAGAMATSU et divers auteurs : New Super Mario Bross.wii mélodies
arrangées par Shinobu AMAYAKE. Solos de piano pour
pianiste moyen ou avancé. Alfred : 38604.
On ne présente pas le
célèbre plombier qui a fait les délices de nos enfants et s’apprête à faire
celles de nos petits-enfants. Beaucoup de jeunes et moins jeunes pianistes
seront donc heureux de retrouver ici pas moins de dix-sept séquences musicales
tirées du jeu vidéo allant du « Title Theme » au « Game over »…

Modeste
MOUSSORGSKY : tableaux d’une
exposition. Souvenir de Victor Hartmann, pour piano. Bärenreiter Urtext : BA 9621.
Qu’il est agréable pour un
pianiste de trouver cette œuvre fondamentale du répertoire dans une véritable
édition critique. Christoph Flamm a réévalué les
sources et découvert de bien intéressantes variantes. On lira donc avec
beaucoup d’intérêt la longue et minutieuse préface qui précède cette édition et
en explique la genèse. Ajoutons à cela que la partition est particulièrement
claire et agréable à lire, ce qui ne gâche rien !

Wilhelm
OHMEN : L’incantation du feu. Paraphrase
de concert pour piano sur la Walkyrie de
Richard WAGNER. Schott : ED 21393.
Dans la grande tradition
des fantaisies de concert si en vogue au XIX° siècle, l’auteur nous offre une
pièce virtuose qui suit de très près la scène où Wotan condamne Brünnhilde au Sommeil éternel et lui accorde d’entourer le
rocher d’une barrière de flamme. On y retrouve dans l’ordre les principaux
thèmes dans des feux d’artifices d’accords et d’arpèges.

Pascal
PROUST : Les volets bleus pour
piano. Sempre più : SP0065.
Volets ouverts, volets
fermés : deux parties dans cette courte pièce de niveau premier cycle.
Instinctivement, la couleur des volets fait penser à la Bretagne… Quoi qu’il en
soit, il s’agit d’une jolie pièce, délicate, aux multiples facettes et faisant
appel aux différentes techniques du piano (lié, détaché, chant à droite, chant
à gauche…). Elle offre la possibilité de progrès techniques sans oublier de
faire appel à la sensibilité de l’interprète.
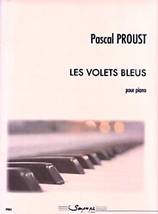
GUITARE
Jean-Maurice
MOURAT : Parfum d’automne pour
guitare. Sempre più : SP0067.
Voici une très jolie pièce
tout à fait en adéquation avec son titre. De niveau deuxième cycle, elle
permettra à l’élève de montrer tout son sens du chant et de la
polyphonie : il faudra bien faire entendre les différents plans sonores,
le tout avec des recherches de timbre passionnantes. Voilà un bel et
intéressant travail en perspective.

Johann Sebastian BACH : Le clavier bien tempéré. Transcription pour Guitare seule par
Didier Renouvin. Delatour :
DLT2147.
Voici un travail
monumental ! Cette transcription intégrale pour guitare seule du premier
livre du Clavier bien Tempéré était
une gageure. Le pari est magistralement tenu au prix de quelques transpositions
inévitables et du parti pris bien légitime que lorsque certaines tenues sont
impossibles, « tant qu’une note n’a pas été remplacée par une autre dans
sa fonction harmonique, elle garde sa fonction dans la mémoire de
l’auditeur ». Bien sûr, ce n’est pas facile… Mais ça en vaut vraiment la
peine !

ALTO
Rolande
FALCINELLI : Sine nomine pour
alto et piano. Symétrie.
Cette pièce, née en 1987
d’un cadeau de fête à un organisateur de concerts et ami de l’auteur, est tout
sauf une pièce de circonstance. Laissons la parole à sa fille, Sylviane Falcinelli : « …on découvre […] une musique
sombre, tragique même, dévoilant les versants pessimistes et introvertis d’une
personnalité en rupture face à l’ivresse matérialiste d’un monde en
décomposition ; l’écriture s’avère pleinement représentative de son style
à cette période, avec un langage harmonique tourmenté ne se posant jamais sur
des repères serein. Le chant généreux de l’alto en amples arches depuis les
tréfonds mystérieux d’où nait la pièce. Le lyrisme de l’instrument tant aimé de
la compositrice s’exprime comme pour survoler le chaos. » Comment mieux
traduire la substance de cette pièce ?

FLÛTE
Christophe
FRIONNET : Sphinx pour flûte
solo. Delatour : DLT2130.
Cette très courte pièce,
assez difficile, permet au flûtiste d’exprimer à la fois sa sensibilité et sa
virtuosité. L’auteur précise que « dans les parties libres, le flûtiste
peut varier les paramètres (nuances, vitesse, phrasés…) ». Bref une large
part est laissée à l’initiative de l’interprète.

Pierre-Richard
DESHAYS : Chauve-souris pour
flûte et piano. Premier cycle. Lafitan :
P.L.2595.
L’interprète se doit de
lire le texte de présentation écrit par l’auteur et qui constitue le
« programme » de cette pièce pleine de charme et aux harmonies
délicates. La partie de piano, assez simple, pourra facilement être tenue par
un élève. C’est une excellente manière d’initier les élèves à la musique de
chambre.

Claude-Henry
JOUBERT : Concerto « Les
lapins » pour flûte avec accompagnement de piano. Fin de premier
cycle. Lafitan : P.L.2546.
Concerto ou poème
symphonique ? Comme toujours avec Claude-Henry Joubert, on ne s’ennuie
pas. Il nous raconte une sympathique histoire pleine de rebondissements. Mais
comment s’en étonner avec des lapins ? S’il n’y a pas d’improvisation dans
cette pièce, l’interprétation est reine. Aux interprètes de s’écouter et de
trouver comment rendre cette pièce qui répond en plus aux critères du
« schéma narratif » académique puisqu’il y a une situation initiale,
un élément perturbateur en la personne du chien Miraut,
une action, un élément de résolution appelé Arlette la fermière et un retour à
l’équilibre dans une situation finale…
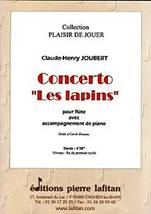
Jean-Michel
TROTOUX : Asia-Elégance pour flûte en ut et piano.
Débutant. Lafitan : P.L.2662.
Voici une charmante petite
pièce, en partie pentatonique, comme il se doit en raison du titre. La partie
de piano est sinon pour débutant, du moins pour un tout petit niveau. Elle est
donc tout à fait propice à la musique de chambre entre élèves du même âge.
L’Asie est bien là. Quant à l’élégance, elle est également au rendez-vous.
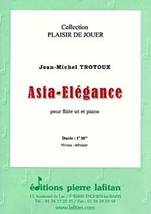
FLÛTE
A BEC
Max
MÉREAUX : Ricercare et Fughettapour flûte à bec alto et piano ou clavecin.
Elémentaire. P.L.2620.
Voici une pièce résolument
atonale et fort intéressante qui initiera les
interprètes à la pratique de la polyphonie à travers deux genres musicaux
traditionnels. L’ensemble est tout simplement beau. Souhaitons que les
interprètes ne soient pas rebutés par ce langage et ces formes indispensables à
la construction de leur « être musical ».

COR
ANGLAIS
Jean-François
PAULÉAT : En chemin. Pour cor
anglais et clavecin (ou clavier). Delatour :
DLT2174.
Il s’agit de la version
pour cor anglais et clavier de la même œuvre pour violon et clavier que nous
avons recensée dans la lettre de juin dernier. Précisons que cette version est
la version originale. Très allante, elle est écrite pour un niveau moyen
avancé.

CLARINETTE
Olivier
DARTEVELLE : D’après Andersen :
1 – La petite fille aux allumettes pour clarinette et piano. Sempre più : SP0062.
Il s’agit d’une pièce sensible
et poétique qui suit pas à pas le conte d’Andersen. On ne pourra qu’inciter
l’élève et son pianiste à le lire ou le relire avant d’interpréter cette œuvre
écrite pour un niveau de 2ème cycle. Piano et clarinette font vivre
au fur et à mesure les différents épisodes du drame dans un dialogue très
serré. Bref, de l’excellente musique.
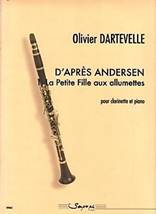
Olivier
DARTEVELLE : D’après Andersen :
2 Le Rossignol et l’Empereur pour clarinette et piano. Sempre più : SP0063.
On retrouve les mêmes
qualités et les mêmes richesses expressives dans cette autre pièce. Il n’est
certainement pas interdit de lire discrètement pendant l’exécution les rappels
de l’histoire qui figurent sur la partition. Là aussi, il s’agit d’un niveau
second cycle.
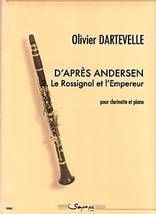
Jean-Jacques
FLAMENT : Le chant des prairies pour
clarinette et piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2580.
Ce « chant des
prairies » prend, au fil des pages des aspects fort divers et bien agréables. A un andante un peu folâtre succède un scherzando
énergique suivi d’un adagio cantabile puis d’une cadence et d’un lento avant le
retour au Tempo primo. Le jeune interprète peut dévoiler ainsi les diverses
facettes de son talent.

Jérôme
NAULAIS : Gris cendré pour
clarinette et piano. Lafitan : P.L.2562.
Ce « gris cendré » a de vraies allures de
romance. Conduite par un ostinato presque continu de croches au piano, la
clarinette égrène une mélodie heureuse et pleine de charme tout au long du
morceau. On se laisse facilement séduire. Signalons que les éditions Lafitan permettent pour un certain nombre de leurs
partitions d’en écouter un extrait mp3 sur le site. C’est le cas pour ce
morceau et le précédent. On peut aussi visualiser quelques pages de l’œuvre. On
ne peut que saluer cette initiative.

BASSON
Charles
BALAYER : Swingin’ Bassoonspour
2 bassons. Delatour : DLT2184.
De niveau assez difficile,
cette pièce constitue en effet un délicieux « swing » ou les deux
instruments alternent chant et basse. Si on veut en avoir une idée précise, il
suffit de se rendre sur le site : la référence donne accès à une
interprétation intégrale de la pièce, ce qui est bien précieux !
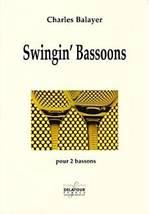
MUSIQUE
D’ENSEMBLE
Eric
FISCHER : Un cadavre de mouche
derrière la nuit. Pour saxophone soprano et accordéon. Dhalmann :
FD0388.
Publiée dans la collection
« Le bal du 21° », cette œuvre écrite essentiellement dans un tempo
de java est pleine d’allant et de charme dans un langage tout à fait
contemporain.

Jean-François
PAULÉAT : Charabanda pour bande de hautbois et percussions. Delatour : DLT2173.
Une bande de hautbois, ce
sont non seulement des hautbois mais aussi des cors anglais et des bassons. Les
percussions, au nombre de quatre, sont également variées. Cette pièce est fort
tonique et aussi entrainante que réjouissante. Après une sarabande solennelle
en guise d’introduction (solennelle mais avec un clin d’œil un peu narquois),
la pièce s’élance dans une fantaisie débridée et communicative. Bien sûr, tout
cela n’est pas pour débutants mais est accessible à un niveau moyen avancé.

ORGUE
Gerhard
DODEDER, Miguel Bernal RIPOLL (éd.) : A. de CABEZÓN : Ausgewählte Werke für Tasteninstrumente.
Selected Works for Keyboard. Urtext. Vol. I-IV, Kassel…, Baerenreiter, 2010 : BA9261, 68 p. (XXVII + 58 p.) ; –BA 9262 : 78 p. (XVII+70
p.) ; BA 9263 : 82 p. (XVII+72 p.) ; BA 9264 : 88 p.
(XXVII + 78 p.).
La
musique d’orgue de la Péninsule ibérique n’a pas encore bénéficié de toute la
diffusion qu’elle mérite : elle est pourtant elle est très digne
d’intérêt. Son répertoire cultive différentes formes associées à la liturgie et
surtout les Tientos (dans différents
tons). Grâce à l’heureuse initiative des organistes G. Doderer et M. B. Ripoll
et aux Éditions Baerenreiter (Kassel), cette lacune
est comblée à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de l’Espagnol
Antonio de Cabezón, musicien de chambre à la Cour, né vraisemblablement en
1510 à Castrillo de Matajudios (quartier de Castrojeriz)
et mort à Madrid en 1566. Il a été au service de la Maison d’Espagne, puis
musicien de la Chambre et de la Chapelle du Roi ; très estimé par Charles
Quint.
Le
remarquable apparat critique fait d’abord état de la genèse du projet de
publication, rappelle la vie, les activités et les compositions du maître,
renseigne sur les principes de la tablature, la tradition de Cabezón. Les
organistes apprécieront les judicieuses précisions concernant la technique de
jeu et l’interprétation, la métrique (mesure, proportion, tempi, notamment
l’utilisation du temps imparfait diminué),
les doigtés, les ornementations et, bien entendu, la registration, avec des
références aux sources et Traités d’époque, par exemple la Declaracion de instrumentos musicales (1557) de Juan Bermudos et l’Arte de taner fantasia de Tomas de Santa Marias qui d’ailleurs cite Cabezon en tant qu’ « éminent organiste royal ».
Les
interprètes disposent ainsi de 4 Volumes (67 œuvres) classés thématiquement
d’après les formes, représentant une sélection très révélatrice des genres en
usage : hymnes (himno) sur des
thèmes grégoriens ; tientos libres ou sur un thème grégorien ; duos ; faux-bourdons (fabordones) ;
versets (versos) de Magnificat ; nombreuses canson glosada (adaptations libres et transcriptions plus ou moins fidèles de chansons)
d’après des chansons françaises de
Thomas Créquillon, Cyprien de Rore, Josquin des Prés, Johannes Lupi,
Nicolas Gombert, Claudin de Sermisy,
entre autres… et encore des diferencias — mot
espagnol signifiant « différence » — c’est-à-dire des variations
souvent très ornées reposant sur un thème de chant grégorien ou sur des
mélodies d'origine populaires pour instruments à clavier (orgue), luth, vihuela...
Par
souci de mémoire et de fidélité à la tradition en cause, il est indispensable
de consulter, à la fin de chaque volume, la liste des abréviations, le
protocole éditorial concernant notamment les accidents ; les sources des œuvres et autres précisions ou
références aux textes, par exemple les trois parties du Kyrie trinitaire, l’indication de l’incipit mélodique du Kyrie ou du Magnificat (notamment référence à l’Arte de Canto Llano de Francisco de Montanos, Madrid, 1592). Cette excellente édition si bien
présentée comporte également d’éclairants éléments bibliographiques : un
modèle du genre qui contribuera largement à la diffusion et à la valorisation
de la musique espagnole de clavier au XVIe siècle.

Daniel MOULT : An Easy Bach Organ
Album. Kassel…, Baerenreiter, 2013,
BA11212. (XXVII + 78 p.).
En
pédagogue averti et expérimenté, dans sa remarquable Anthologie, Daniel Moult
regroupe des œuvres pour orgue de
Jean-Sébastien Bach (ou qui lui sont attribuées), avec ou sans pédalier, d’un
niveau facile ou intermédiaire, qu’il met ainsi à la disposition des jeunes
organistes. Ce répertoire varié est précédé d’excellents conseils relatifs à la
technique et à l’interprétation (doigtés, articulations, tempi, registrations
pour chaque pièce ; table manuscrite des ornements extraite du Clavier-Büchlein pour Wilhelm Friedemann Bach, avec leur
explication) et des références hymnologiques concernant les sources des
mélodies et des versions utilisées par le Cantor. Judicieusement sélectionné,
il comprend des Préludes, des Préludes de chorals luthériens (entre
autres, de l’Orgelbüchlein,
du Petit livre d’Anna Magdalena Bach,
du Recueil de Schemelli…),
une Marche de Carl Philipp Emanuel Bach et des adaptations diverses (Arias) destinées aux cultes. L’auteur
précise les différentes destinations des pièces en fonction de l’Année
liturgique et du « Temps ordinaire », y compris les circonstances
diverses de la vie du chrétien (baptême, communion, mariage, service funèbre…).
L’utilité fonctionnelle et pédagogique de ce volume et de ce choix de pièces
destinées aux services dominicaux est indéniable. Indispensable pour la
formation des jeunes organistes.

Édith Weber.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Jacques CHAILLEY : MUSURGIA. Vol. XIX 1-3, 2012 (paru juillet
2013), Paris, Éditions Eska (12, rue du Quatre
Septembre, 75002, Paris- www.eska.fr), 204 p. 22 €.
Complément
indispensable du livre : De la Musique à
la Musicologie. Mélanges J. Chailley (groupant des articles de l’auteur), ce volume de témoignages — avec la contribution de 18 auteurs — éclaire sous
divers angles : institutionnel et structurel, pédagogique et scientifique,
théorique et analytique, le rôle considérable joué par le Professeur Jacques
Chailley (1910-1999) auquel on doit l’entrée progressive de la musicologie dans
l’Enseignement Supérieur en France. Sa contribution à l’implantation de la
discipline à part entière (DEUG, Licence, Maîtrise, Doctorats d’Université, de
3e Cycle et d’État) a bien eu lieu malgré des réticences antérieures car,
selon une boutade, Gaston Paris se serait écrié en 1904 : « Si les
trombones entrent ici [à la Sorbonne], je m’en vais » (comme l’a relaté J.
Chailley en 1956). Toutefois, grâce au dynamisme du successeur d’André Pirro, la musicologie, d’abord historique et littéraire, a
été élargie à l’ethnomusicologie, puis à la philologie musicale lancée par le
maître. Il a ainsi le mérite d’avoir — de 1952 jusqu’à sa retraite en 1979 —
ouvert la voie aux spécialisations plus récentes et permis leur évolution
ultérieure. Nommée en 1958, la signataire, qui a vécu l’évolution de l’Institut
de Musicologie de la Sorbonne, en dresse un bilan significatif. D’autres auteurs
évoquent le rôle de J. Chailley dans la promotion de l’ethnomusicologie,
l’évolution du langage musical, sa théorie systématique de la sémantique
musicale, entre autres, sans oublier son enseignement de la musique grecque et
de la musique médiévale. Cet acte de fidélité et de reconnaissance de ses amis
et disciples rend hommage au Professeur qui — après Romain Rolland, André Pirro et Paul-Marie Masson — a consolidé les fondements de
la discipline musicologique et largement assuré son développement ultérieur
dans l’Université française.

Édith
Weber.
Jean-Paul AUBERT, Serge MILAN, Jean-François TRUBERT (dir.) : Avant-Gardes : Frontières,
Mouvements. Volume I : Délimitations, Historiographie. Sampzon, DELATOUR FRANCE (www.editions-delatour.com), 2013, 392 p. DLT1953. – 28 €.
Sur le plan
international, depuis plusieurs décennies, les notions et principes
esthétiques, musicologiques et sociologiques évoluent à très grande vitesse au
profit des mouvements d’avant-garde et remettent en question les
« frontières entre musique savante et musique populaire ». Toutefois,
il était temps de les conceptualiser. Ce Volume reproduit les actes d’un
Colloque sur les avant-gardes artistiques organisé en 2008 par l’Université de
Nice-Sofia-Antipolis, avec la participation de 45 intervenants. Ils ont procédé
à l’« examen critique des pratiques artistiques, des concepts politiques
et des postures éthiques » associées aux phénomènes et aux gestes
avant-gardistes. Dans une perspective pluridisciplinaire, cette nouvelle
Collection tente d’expliquer l’orientation des champs de la création tels
qu’ils sont pratiqués par les historiens de la musique et de l’art, en les
envisageant par les biais de la politique, de l’anthropologie, et de leur
réception. L’objectif consiste donc à
brosser un tableau de la production artistique à notre époque. Dans sa Première
partie, intitulée : « Délimitations, définitions », les auteurs
s’attachent à définir la notion d’« avant-gardisme », voire
d’« avant-gardité », allant jusqu’à « La mort des
avant-gardes et l’art de l’insignifiant », suscitant ainsi une solide
réflexion sur les avant-gardes et le progrès, notamment les avant-gardes
musicales et cinématographiques en France depuis les années 1920, sans perdre
de vue le progrès et, depuis les années 1968, la contre-culture. La Seconde
Partie, intitulée : « Pratiques et historiographies », propose
des réflexions sur « l’art-action et les pratiques performatives dans
les soirées futuristes », présente les points de vue de H. Strobel,
P. Boulez, F. T. Marinetti (et le cinéma par rapport à la simultanéité et à la
fusion des arts) ; elle tient compte des Festivals de Donaueschingen
(1945…), Cologne (1960). L’ensemble se termine sur la question percutante
: « la politique futuriste est-elle un art ? (1909-1920) ». Les
trois directeurs de cette publication convient donc les lecteurs à « la
découverte d’autant de lieux où des forces ont convergé, où des formes se sont
écrites (…) en posant les premiers jalons d’une étude sur les avant-gardes
menée dans le sens historiographique, esthétique et analytique ». (p.
VII).

Édith
Weber.
Hector BERLIOZ : A travers chants. Symétrie, 2013, 375 p. 13 €.
Ultime
volet de la trilogie critique d’Hector
Berlioz, amorcée avec les Soirées de
l’orchestre (1852) et poursuivie par Les
Grotesques de la musique (1859), A
travers chants (1862) s’inscrit à la fois dans la continuité et dans la
rupture par rapport aux ouvrages précédents. Études musicales, adorations,
boutades et critiques résument parfaitement le ton de cet ouvrage où Berlioz se
fait plus théoricien qu’humoriste ou polémiste. Après une introduction
consacrée à la théorie musicale, le livre comprend plusieurs études critiques
sur les œuvres de Beethoven, Gluck, Weber et Wagner. Si certaines opinions peuvent paraître, aujourd’hui, un
peu désuètes et discutables, voire contradictoires, affirmées parfois de façon
quelque peu péremptoire, ce livre, où la qualité de l’écriture n’est jamais
prise en défaut, garde indiscutablement valeur de témoignage, marqué du sceau
de la légitimité et de la sincérité. Un livre document, savoureux, à lire absolument !

Patrice Imbaud.
Myriam Chimènes et Alexandra Laederich (dir.)
: Regards sur Debussy. Éditions Fayard, 2013, 571 p.
30 €.
Cet ouvrage contient les actes
du colloque international organisé à Paris, en février 2012, à l'occasion du
150 ème anniversaire de la naissance de Claude
Debussy, et réunissant une quarantaine
de spécialistes français et étrangers. Les divers volets de la recherche
debussyste illustrés ici ouvrent de nouvelles perspectives sur des domaines
encore inexploités. Il en va ainsi de la position idéologique du compositeur, de
ses engagements et de ses attaches avec certains milieux politiques. Mais aussi
de l'étude de manuscrits peu connus, voire inédits. Certains des textes
permettent d'approfondir des sujets peu explorés tels que l'historiographie,
Debussy et le disque, et cette question enrichissante des sources précieuses
pour l'interprétation que constituent les premiers enregistrements, telles les Ariettes oubliées par Mary Garden et le compositeur au piano. Ou encore la
manière de jouer la musique pour piano au Conservatoire de Paris entre 1920 et
1960. Intéressant aussi le point de vue d'Alfed Cortot dont l'intérêt marqué pour la musique germanique ne le conduit pas
d'emblée vers celle de son illustre compatriote. Ce n'est que dans les années
1918-1919 que les pièces de celui-ci seront inscrites de manière significative
dans ses programmes. L'étude des processus de composition est privilégiée au fil de ces études : de l'art
de préluder chez le musicien au décryptage des dernières œuvres. Les liens
entre musique, littérature et danse le sont tout autant : Proust et Debussy
bien sûr, mais aussi en quoi le musicien Debussy a contribué à établir le
« sens français ». Est livrée une perspective pluridimensionnelle de Pelléas et Mélisande : une étude sur les
rapports entre texte, musique et image, et en particulier l'importance de la
dimension visuelle. Au-delà de cet opéra, la vocalité de Debussy est appréciée
dans ses mélodies. Une dernière partie s'attache à la réception de Debussy à
l'étranger, au Japon notamment, comme à son influence sur les compositeurs du
XX ème siècle, en France, chez Messiaen ou Xénakis, et hors des frontières, en Pologne par exemple. La
pluridisciplinarité est source d'enrichissement. Loin de s'additionner, ces
diverses contributions se complètent singulièrement et, constituant autant
d'angles de vue souvent inédits, élargissent la connaissance de l'univers de
Claude de France. Elles participent de ce que Pierre Boulez, dans sa préface,
appelle de ses vœux : une musicologie d'action, car « cette discipline
devrait réserver une place essentielle aux pratiques qui se forgent dans la vie
musicale d'aujourd'hui, au moins autant qu'aux perspectives ou rétrospectives
historiques ».

Jean-Pierre Robert.
***
CDs et DVDs
Songs of Iceland. 1CD KLANGLOGO (www.klanglogo.de ): KL 1406. TT : 63’ 53.
Ce disque (textes
en islandais) débute aux accents nostalgiques et rudes de la chanson : Children’s Rhymes, —
évoquant les longs mois d’hiver en Islande jusqu’à l’arrivée du printemps —,
puis de la mandoline et les chants du cygne… À noter : une description de
l’atmosphère du soir Evening arrives (n°5) ; deux
berceuses : Sleep Now, Softly Little Love (n°14), extraite d’une pièce de Johann Sigurdjonsson (mort en 1919) ; Sleep, My Gentle Little One (n°16) pour dormir tranquillement en rêvant
au ciel. Dans The Little Musician(n°10), un enfant se rapproche de sa
mère et lui raconte son rêve de devenir chef d’orchestre et de chœur (avec
elfes, humains et trolls) et sa fascination pour les instruments (tambours
joués par les trolls, flûtes par les fées, violons par les êtres humains, et
mandoline)… Dans The Raven (Le corbeau) (n°4), l’atmosphère s’anime, le piano se fait plus percussif. Le Salzburger Jazz Ensemble a réussi à redonner vie à ces
chants islandais traditionnels, à décrire ces paysages volcaniques et traduire
l’aspiration de ce peuple à la chaleur. Anthologie très révélatrice de la mentalité
et du folklore islandais.

Édith
Weber.
Collectici Intim. 1 CD TRITON (www.disques-triton.com ): TRI 331173. TT : 76’ 59.
La guitariste
française Laurine Phélut, élève d’Alberto Ponce, à
l’École Normale de Musique et au CNSM de Paris, a acquis une réputation
internationale, notamment par ses Prix et récompenses obtenus à divers
Concours, ses nombreux concerts et Masterclasses.
Avec ses Guitares (signées Dominique Delarue et, occasionnellement, Matthew Wan),
il lui tient à cœur de diffuser son répertoire et surtout des créations
contemporaines comme, par exemple, les pièces de Vincente Asencio (1908-1979), Matilde Salvador (1918-2007), Astor Piazzola (1921-1992), et, plus proches de nous, David Grimes (né en 1940) — compositeur
de 24 Préludes, à la mémoire, entre
autres, d’Alexandre Tansman, André Segovia, John
Duarte —, Anthony Girard (né en 1959). Cette mini-anthologie de 29 pièces
contient aussi un arrangement par M. Langer pour flûte (Aldo Baerten) et guitare de la Sonate BWV 1031 de J. S. Bach qui s’impose par les sonorités de la
flûte et la souplesse de l’accompagnement. Ces deux musiciens forment un duo
très attachant. Leur premier disque, enregistré dans d’excellentes conditions
acoustiques, ayant le mérite de défendre le répertoire contemporain, est déjà
prometteur. S’adaptant à tous les genres, Laurine Phélut s’impose par des sons profonds et authentiques. À plus d’un titre, cette
réalisation ravira les discophiles et guitaristes.

Édith
Weber.
Arno BABADJANIAN par Christophe Boulier et
l’AJS. 1 CD PROMUSICA ASSOCIATION
ARTISTIQUE : P1308. TT : 63’16.
Arno Haroutioun Babadjanian,
compositeur arménien, né à Erevan en 1921, est mort à Moscou en 1983. Il fait
ses études de piano dans sa ville natale, puis à Moscou, au Conservatoire Tchaikovski, et suit les cours de composition donnés par
Heinrich Litinsky à la Maison de la Culture
Arménienne de Moscou. En 1950, il est professeur de piano au Conservatoire
d’Erevan. Son Trio pour violon,
violoncelle et piano est structuré en trois parties : Largo, Allegro — dès les premières
mesures, une atmosphère tour à tour chatoyante, tourmentée, haute en couleurs,
entraîne l’auditeur dans un tourbillon d’impressions diverses, parfois étranges — ; Andante — le compositeur spécule sur l’extrême aigu du violon
planant au-dessus d’accords joués au piano qui assure aussi des interludes — ; Allegro vivace — débordant de sève et très enlevé avec virtuosité
par l’excellent trio comprenant le pianiste français Christophe Boulier (qui a
été comparé, entre autres, à Y. Menuhin…), la violoncelliste française Cécile
Guillon (formée à l’École Normale de Musique de Paris par G. Teulières) et la pianiste japonaise Hitomi Nishioka (qui a fait ses études à Kyoto, au CNR de
Paris et au CNSM de Lyon). Suit la version originale du Concerto pour violon et piano d’Arno Babadjanian,
de structure classique, en 3 mouvements : Allegro (placé sous le sceau de la grâce et de l’élégance), Andante (rêveur et plus mystérieux), Vivace (fébrile et brillant, nécessitant
une grande virtuosité). Le disque se termine avec la Rhapsodie pour violon et piano (1957) d’Edouard Bagdassarian,
pianiste et compositeur arménien, né en 1922 et mort en 1985. Il fait ses
études au Conservatoire d’Erevan, puis au Conservatoire Khatchaturian à Moscou, et enseigne la composition et l’harmonie au Conservatoire d’Erevan.
Sa Rhapsodie est interprétée avec
sensibilité et fougue par Chr. Boulier et la pianiste française Héloïse Bertrand-Oleari (élève du CRR de Tours, titulaire de nombreux Prix). Voici deux compositeurs
arméniens toniques à découvrir.

Édith
Weber.
GUIDE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Vol. II)
1800-1950. 8CDs RICERCAR (www.outhere-music.com ): RIC 103. TT. : 10 h
26’.
Ce second Volume
consacré aux instruments à partir du XIXe siècle sera autant apprécié que le
Volume I portant sur les instruments du Moyen-Âge à
l’époque classique (fin XVIIIe s.). Il est d’ores et déjà un incontournable.
Tout le mérite en revient à Jérôme Lejeune à bien des titres. Il aborde
notamment « le changement de la vie musicale et son incidence sur la
facture instrumentale », tenant compte de la pratique musicale des
amateurs un peu au détriment de l’activité musicale à l’Église après 1789, de la
naissance des écoles de musique et conservatoires et de la formation des
musiciens d’orchestre, sans oublier l’évolution de la facture instrumentale
entraînant la recherche de sonorités nouvelles dès l’époque romantique.
L’auteur va droit aux sources : témoignages provenant des premiers
enregistrements, Traités d’orchestration… Il prend le parti de « se
concentrer majoritairement sur les instruments qui participent de près ou de
loin à la formation de l’orchestre symphonique ». Le Guide (154 p.) traite donc cette vaste matière par familles
instrumentales, avec renvoi aux illustrations sonores et au contenu des 8 CDs.
Étayé de nombreux documents iconographiques et photos d’instruments d’époque
très bien présentés, il est complété par un copieux Index (alphabétique) de tous les instruments en cause allant de
l’accordéon au xylophone. Plus de 10 heures de musique font entendre des
interprètes : par exemple : la claveciniste Wanda Landowska, les
organistes Bernard Foccroulle et Freddy Eichelberger, les pianistes Paul Badura-Skoda
et Jorg Demus, l’altiste Jean-Philippe Vasseur, le
violoncelliste Nicolas Deletaille, le trompettiste
Jean-François Madeuf, le clarinettiste Philippe Uyttebrouck, le joueur de serpent Volny Hostiou, parmi tant d’autres… Cette réalisation force
l’admiration. Vademecum indispensable pour les
compositeurs, les enseignants, les discophiles et amateurs de musique
instrumentale.

Édith
Weber.
Judith.
Une histoire biblique de la Croatie renaissante. Katarina Livljanic,
Ensemble Dialogos. 1CD+1DVD
ALPHA (www.outhere-music.com ) : ALPHA
702. TT : 76’ 02 (CD).
Grâce à l’érudition
de Katarina Livljanic (restitution, voix, direction),
Maître de conférences de Musique médiévale à l’Université Paris-Sorbonne, cette
somptueuse réalisation historique comprend un livret analytique très détaillé
(français, anglais, croate) ; des précisions scénographiques ; une
introduction au poète Marko Marulic, né en 1450 à
Split et mort dans cette même ville en 1624, « remarquable représentant du
caractère universel de l’Humanisme et de la Renaissance… dont presque toute
l’œuvre se caractérise par une profonde religiosité et une propension constante
à l’enseignement moral ». L’histoire de Judith, chef-d’œuvre de Marko Marulic terminé en 1501, imprimé à Venise en 1521, retrace
la vie de cette veuve juive qui s’est infiltrée dans le palais de Holopherne
qu’elle séduit, puis décapite. Le livret avec le texte complet trilingue,
structuré en cinq parties, est étayé d’illustrations adéquates. Le film de Radislav Jovanov Gonzo (DVD) s’impose d’emblée, non seulement par la qualité
des prises de vue, des lumières et le choix des décors, mais encore par le jeu
expressif et épuré, la voix si prenante et convaincante de Katarina Livljanic à la tête de l’Ensemble Dialogos.
Les dodécasyllabes rimés et les octosyllabes en prose se prêtent tout
particulièrement à la mise en musique et, comme le signale K. Livljanic : « Dans le processus de travail, je
sentais de plus en plus que la cantillation des vers permettait au récit de
toucher l’auditeur plus facilement que la lecture du texte seul ». Bratislav Lucin « a veillé
sur ma prononciation, mon accentuation et ma déclamation. Cette préparation
faite, il m’était finalement possible d’aller vers le travail musical. »
Elle rappelle que son approche de la « musicalisation des vers a été inspirée surtout de l’art des conteurs que l’on trouve dans les
traditions musicales narratives et dont la présence est conservée notamment en
Croatie. » « Le chanteur-conteur interprète tous les rôles en se
servant d’un fond de fragments, formules et modèles qu’il possède dans sa
mémoire. » L’accompagnement instrumental (vièle, lirica croate, flûtes anciennes)
soutient le récit en exploitant nuances et couleurs. La mélodie s’inspire du
chant glagolitique en langue vernaculaire (slavon-croate) qui se rattache au
rite romain avec quelques répons grégoriens (manuscrits dalmates chantés après
les lectures nocturnes du livre de Judith)
à partir du matériau musical ancien. Si le texte de Judith a survécu sans mélodie, il est recréé musicalement avec
toute sa force émotive et dramatique. K. Livljanic a
donc l’immense mérite d’avoir recomposé et réactualisé cette dramatique
histoire jusqu’au cantique final célébrant la victoire et la libération
d’Israël, chanté par les habitants avec Judith. Exceptionnel.

Édith
Weber.
Deux
Siècles d’Orgue. Jean-Baptiste
Robin, François Espinasse, Michel Bouvard, Frédéric Désenclos,
orgue. 2CDs ALPHA (www.outhere-music.com ) : ALPHA
950. TT : 70’ 49+ 70’13.
Comme jadis à
Versailles, quatre organistes co-titulaires se
relaient (par « quartier ») à
l’Orgue de la Chapelle Royale — instrument des facteurs R. Clicquot, J. Tribuot (1710), A. Cavaillé-Coll (1875) et, plus récemment,
J.-L. Boisseau (1995). Leur programme, réparti sur deux CDs, totalise deux
siècles de musique française. Jean-Baptiste ROBIN interprète des extraits des
extraits du Premier Livre d’orgue (en
6e ton) et du Troisième (Noëls) de Nicolas Lebègue (1631-1702), mettant en valeur les registrations de cet instrument historique.
Jacques Thomelin (v. 1640-1693), rarement enregistré,
est représenté par son Hymne Ave Maris
Stella et deux Fugues nécessitant,
entre autres, les jeux de taille, trompette, clairon, puis des extraits du Deuxième Livre d’orgue de
Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714) permettent
d’entendre notamment le cromorne. François ESPINASSE propose de larges extraits
(Kyrie, Gloria, Sanctus et Agnus Dei) de la Messe pour les couvents de religieux et religieuses de François
Couperin (1668-1733) ; Michel BOUVARD (CD 2), des Pièces choisies pour l’orgue de feu le grand Marchand (Louis
Marchand, 1669-1732), faisant appel aux plein jeu, basse de trompette, tierce
en taille, fond d’orgue…, et se terminant sur le Grand dialogue très élaboré, datant de 1696. Frédéric DÉSENCLOS a
sélectionné des pages significatives de Jean-François Dandrieu (v. 1682-1738),
Claude-Bégnine Balbastre (1727-1799) et Louis-Claude Daquin (1694-1772) avec deux Noëls bien connus. La plaquette,
comportant une riche iconographie, renseigne sur la composition de l’Orgue, les
circonstances historiques et le rôle de la musique à Versailles. Les quatre
excellents organistes recréent le paysage musical de l’école versaillaise
autour de Louis XIV (1638-1715), puis de Louis XV (1710-1774). Remarquable
reconstitution historique.

Édith
Weber.
Giuseppe VERDI : Messa da Requiem. Te Deum. Chorale Robert Shaw, NBC Orchestra, dir. Arturo Toscanini (Te Deum). S. Vartenissian,
F. Cossotto, E. Fernandi,
B. Christoff, Chœurs et Orchestre de l'Opéra de Rome, dir.
Tullio Serafin (Requiem). 2CDs JADE (www.jade-music.net ): CD 699
787-2. TT : 59’+ 43’04.
Ce coffret a le
mérite de faire entendre le Te Deum (composé à partir de 1895), vaste fresque dramatique extraite des Quatre Pièces sacrées (n°4) de Giuseppe
Verdi, non seulement rarement enregistré mais encore dans une version
historique dirigée par le grand chef Arturo Toscanini (1867-1957) dont la
mémoire est proverbiale (se passant souvent de la partition), à la tête de la
Chorale Robert Shaw et du NBC Orchestra. Ce Te
Deum commence par l’intonation grégorienne a cappella énoncée par les
basses du premier chœur, puis les ténors du second chœur : Te Deum laudamus (chaque chœur ayant 8 voix), se prolonge avec le Sanctus massif et joyeux. Le compositeur spécule sur les
oppositions de nuances : sempre pp, puis tutta forza et
l’atmosphère vigoureuse, le lyrisme et la douceur, les entrées successives et
le style homorythmique homosyllabique pour insister
sur le sens des paroles. Les interprètes rendent justice à cette œuvre complexe
à découvrir. Quant au Requiem, très
connu, il bénéficie des qualités exceptionnelles de la regrettée basse bulgare
Boris Christoff (1914-1993), du concours des solistes S. Vartenissian,
F. Cossotto, E. Fernandi,
de l’Orchestre et des Chœurs de l’Opéra de Rome sous la direction dramatique du
chef italien spécialiste d’art lyrique, Tullio Serafin (1878-1968) qui a dirigé successivement le Metropolitan Opera de New York, l’Opéra de Rome, le Lyric Opera de Chicago… Document sonore historique à retenir.

Édith Weber.
Early Birds. KLANGLOGO (www.klanglogo.de). Diffusion : RONDEAU PRODUCTION
(www.rondeau.de). KL 1503. TT :
66’ 18.
Voici une
réalisation musicale originale, associée au thème des oiseaux très prisés à
l’époque baroque. L’idée générale consiste à retracer leur vie : vol en
liberté, mise en cage, amour… et à faire entendre les chants du
traditionnel rossignol, du coucou, de l’alouette, du canari, de la tourterelle,
de l’hirondelle, et même du dodo (oiseau qui ne peut pas voler, disparu vers
1690), ou encore du papillon. Ces chants d’oiseaux exprimant l’amour, la joie, mais
aussi la tristesse, la solitude, la mélancolie… sont extraits d’Opéras, de
Ballades, d’Oratorios, de Cantates, d’Airs, d’une Sonate et également du Jardin des Délices — Der Fluyten Lust-Hof (1643) de Jacob Van Eyck (v. 1590-1657). Certains morceaux sont arrangés par Simon Borutzki.
À noter : deux créations : Printemps Rossignols amoureux extrait du 9e Recueil d’Airs (1749) de Mr. Quignard (XVIIIe s.) et la Sonate à l’imitation du Rossignol et du Coucou de Theodor Schwartzkopff (1659-1732). Les œuvres sont dues à des compositeurs italiens, anglais,
allemands, hollandais, français des XVIIe et XVIIIe siècle, allant de Pietro Torri (1650-1737) (Son Rossignolo),
Thomas Linley (1733-1795) et G. Fr Haendel à François
Couperin (1668-1733) (Pièces de clavecin, 3e Livre), Louis de Caix d’Hervelois (1680-1759) (Pièces de viole), Louis-Claude Daquin (1694-1772) (Pièce
de clavecin), Johann Adolf Hasse (1699-1783) (Opéra Didone abbandonata), G. Ph.
Telemann (Trauer-Music eines Kunsterfahrenen Canarienvogels,
Suite d’orchestre La Bizarre) ;
Christoph Graupner (1683-1760) (Suite pour orchestre)…
Ce répertoire inédit est interprété par Simon Borutzki (flûte), Julia Landsberg (Soprano), Torsten Übelhör (clavecin) Heidi Gröger (Violoncelle et viole de gambe) et Thor-Harald Johnsen (théorbe, guitare Renaissance et guitare baroque) appartenant à La Chapelle de
la Cour du Château Seehaus (en Bavière) qui se
produisent sur instruments d’époque ou reconstitués. Pour ornithologues et
mélomanes curieux.

Édith
Weber.
La
Passion du Baroque brésilien. JADE (www.jade-music.net ). CD 699 792-2. TT : 55’
11.
Ce disque est
introduit par Maria Ines Junqueira Guimaraes, musicologue brésilienne vivant en France,
et Docteur de l’Université Paris-Sorbonne avec sa Thèse très documentée
soutenue en 1996 sur Lobo de Mesquita (v.1746-1805)…
Elle présente le Prêtre José Mauricio Nunes Garcia (1767-1830), maître de
chapelle, organiste et professeur à la Chapelle Royale de D. Joao VI, Roi du
Portugal installé au Brésil en 1808, et le Capitaine Manoel Dias de Oliveira (1738-1813), né dans le Minas Gerais,
compositeur d’une trentaine d’une trentaine d’œuvres de musique religieuse.
Tous deux « incarnent la première génération de musiciens
brésiliens ». Selon M. Guimaraes :
« les styles de composition différents de ces deux artistes se rejoignent
dans une universalité inscrite dans leurs individualités : il ne faut pas
y chercher une imitation du langage européen mais une création consciente,
libre et vigoureuse. » Le disque s’ouvre aux accents du Magnificat de Manoel Dias de
Oliveira : le chœur est soutenu et entrecoupé par les commentaires des
cordes ; le texte chanté avec légèreté, devient de plus en plus affirmatif
et appuyé avec les voix d’hommes, puis le chœur au complet et l’orchestre,
toujours en mouvement, interviennent, avec oppositions de nuances et de
tessitures. Cette œuvre privilégie la compréhension du texte, faisant appel au
style homophonique et homosyllabique ;
l’ensemble est bien enlevé. Plus développée, la Missa de Nossa Senhora do Carmo, un des chefs-d’œuvre de José Mauricio
Nunes Garcia, a été composée en 1818. Elle comprend les 17 parties
traditionnelles et nécessite une grande virtuosité vocale, notamment dans
l’aigu. Le compositeur spécule sur les oppositions d’intensité et de volume, la
diversité des sonorités instrumentales et vocales et l’ornementation à des fins
décoratives. Le Gloria est vigoureux,
le Cum Sancto Spiritu avec une intervention mélodique du violon, est
lent et très inspiré, il spécule sur les effets de tension et de détente, le Resurrexit est
triomphant, le Benedictus est
particulièrement intériorisé, enfin l’Agnus
Dei qui tollis peccata mundiest une
intense prière conclusive.
Les Éditions JADE
ont eu raison de faire appel à l’Associaçao de Canto Coral, dirigée par Cléofe Person
de Mattos et à la Camerata de Rio de Janeiro, sous la baguette de Henrique Morelenbaum qui interprètent ces œuvres brésiliennes tour à tour, avec musicalité et
discrétion, passion et exubérance.

Édith
Weber.
Jean CRAS : L’œuvre complète
pour violon et piano.SKARBO (www.skarbo.fr). DSK4128. TT : 61’ 15.
De son temps,
l’œuvre de Jean Cras, né en 1879 à Brest et mort en
1932 dans cette ville, officier de marine et compositeur, n’a pas eu, toute la
diffusion qu’elle mérite. Ce n’est que depuis 1996 que son disque comportant
l’œuvre pour violon et piano a été distinguée par la
critique ; en 1997, il a obtenu un Grand Prix de la Nouvelle Académie du
Disque, ce qui lui a permis d’être largement vendu. L’ancienne version reparaît remastérisée, avec le concours de l’exceptionnelle
violoniste Marie-Annick Nicolas, soliste de réputation internationale,
Professeur au Conservatoire de Genève, et de l’excellent pianiste Jean-Pierre Ferey qui interprète également les Poèmes intimes. Dès les premières mesure du Préambule de la Suite en Duo comprenant 4 mouvements,
l’auditeur est interpellé par les sonorités rares du Violon (Andrea Guarnerius,
Cremone 1673) et l’accompagnement pianistique discret et si sensible. Il
remarquera, tour à tour, le caractère chatoyant, l’attaque incisive dans la Danse à Onze Temps. Les Quatre Pièces : Air Varié, Habanera, Évocation et Églogue s’imposent par les mêmes
qualités d’expressivité et de fidélité aux intentions du compositeur, et par
l’indéniable connivence musicale des interprètes. Ce disque se termine avec
cinq Poèmes intimes joués par J.-P. Ferey au départ, ingénieur, diplômé de l’École
Polytechnique et des Mines, mais aussi Lauréat du Concours international de
piano de Saragosse en 1983, puis remarqué par la critique en 1988 avec son
enregistrement d’œuvres de G. F. Malipiero. Depuis, il se consacre entièrement
à la direction musicale de nombreux enregistrements et à une carrière de
soliste. Ce premier cycle composé par Jean Cras entre
1902 et 1911, est imprégné de distance et de réserve, de nostalgie et de
tristesse (En Islande), à mi-chemin
entre impressionnisme (Au fil de l’eau)
et romantisme (Recueillement). Cet
inégalable Duo a signé une réussite du
genre et un régal pour l’oreille.

Édith
Weber.
Lorenzo Ferrero : Tempo di Quartetto. KLANGLOGO (www.klanglogo.de ). Diffusion :
RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de ). KL
1404. TT : 58’ 22.
Spécialiste
d’acoustique au Studio Expérimental de Bourges, ensuite à Munich, Lorenzo
Ferrero (né en 1951), d’abord autodidacte, a été l’élève de Massimo Bruni et Enore Zaffiri, est aussi un
compositeur de réputation internationale, notamment d’opéra et d’opéra pour
enfants, ainsi que de pièces instrumentales, mais encore un librettiste et un
éditeur littéraire. Le Quartetto di Cremona : Cristiano Gualco (violon), Paolo Andreoli (violon), Simone Gramaglia (alto) et Giovanni Scaglione (violoncelle) interprète son œuvre Tempi di Quartetto (1996-1998) dont les Prima e Seconda Serie comportent chacune six mouvementsla totalisant
presque une heure d’écoute. Cette Série privilégie les contrastes de mouvements
lents et vifs, les timbres soignés et la facture mélodique recherchée. La 4e
pièce, ajoutée à la Première Série, intitulée : Beethovenfest, est un Allegro, incisif et énergique ; la 3e
intercalée dans la Seconde, Andante
moderato, exploitant le registre extrême-aigu du violon, est un hommage
émouvant et sensible à la mémoire de David Huntley,
ami new-yorkais et éditeur chez Boosey & Hawkes.
Enfin, la 6e et dernière œuvre de ce CD : My Piece of Africa (Allegro molto vivo) frappe par sa
verve, son élan et son dynamisme dansant. Le Quartetto di Cremona réserve
un sort royal à cette musique quelque peu intemporelle et à ces pages élégantes
spéculant sur la recherche de clarté et de simplicité.

Édith
Weber.
Marc-Antoine CHARPENTIER : David et Jonathas. Tragédie
en musique en cinq actes. Livret du Père François de Paule Bretonneau. Pascal
Charbonneau, Ana Quintans, Neal Davies, Frédéric
Caton, Krešimir Špicer,
Dominique Visse, Pierre Bessière. Les Arts
Florissants, dir. William Christie. Mise en scène :
Andreas Homoki. 1 DVD Bel Air Classics:
BAC093. TT.: 2H09.
Ce
DVD est la captation du spectacle donné au Festival d'Aix 2012, et repris
l'hiver dernier à l'Opéra Comique (cf. NL de 9/2012 et 2/2013). Est-elle
entièrement fidèle à la lettre, ou du moins à l'esprit, de la mise en scène d'Andreas Homoki ? Le découpage en courts tableaux, qui répond
presque à un montage cinématographique, passe plutôt bien le petit écran, et la dilatation de l'espace qui
caractérise l'approche du régisseur, avec ses effets en soufflet du décor,
subtil jeu sur les volumes, est restituée habilement par la caméra. Comme il en
est des mouvements de foule, une des réussites de la régie. Ramage des costumes
et lumières chaudes apportent une habile différentiation au décor de bois brut
imaginé comme écrin aux joutes opposant deux clans rêvant d'en découdre,
enfants d'Israël et Philistins. Encore qu'à favoriser le gros plan, la prise de
vue accentue l'exacerbation des sentiments jusqu'à une certaine violence :
l'indiscrétion de l'objectif détaillant les visages déformés par la passion ou
la colère, de Saül par exemple, grossit le trait. Par ailleurs, l'abus des
prises de vue plongeantes, dont certaines ménagées de biais et inconfortables,
n'ajoute que peu de chose à la théâtralité de l'approche, conçue comme un hommage
à une savante et révélatrice géométrie. Heureusement, les moments clés,
morceaux de vrai théâtre ici, sont justement préservés : les retrouvailles des
deux amis, au cours d'un original jeu de colin maillard,
leurs adieux surtout, bouleversants. La direction de William Christie est une
fête, qui prodigue cette effusion mélodique caractérisant la musique de
Charpentier. Et c'est un bonheur, à la faveur des intermèdes entre les
tableaux, de le voir en sculpter les volutes avec une élégance toute française.
On saisit combien la symphonie est l'élément unificateur du spectacle. La
distribution est un sans faute. Le David de Pascal Charbonneau respire la
sympathie et le naturel d'une voix de tête superbement conduite, Jusqu'à faire
de certaines légères imperfections d'accents une vertu dramatique. Le Jonathas d'Ana Quintans ne le
cède en rien en émotion, d'un engagement vocal éblouissant. La courbe des deux
voix forge une alliance éblouissante. Ils sont magnifiquement entourés,
notamment par Neal Davies, solide Saül, et Dominique Visse, qui n'a pas son
pareil pour camper les personnages féminins, en l'occurrence La
Pythonisse.

Jean-Pierre Robert.
Antonio VIVALDI : Concerti
per violino e archi V, ' Per Pisendel '. Concertos RV 177, en do majeur ; RV 212a, en ré majeur ; RV 246, en
ré mineur ; RV 370 en si bémol majeur ; RV 242, op. VIII N° 7, en ré mineur ;
RV 379, op. XII N° 5, en si bémol majeur ; et RV 328 en sol majeur. Il Pomo d'Oro, Dmitry Sinkovsky, violon et direction. 1 CD Naïve : OP
30538. TT.: 74'.
Cette anthologie de concertos pour violon
de Vivaldi a pour fil conducteur des pièces écrites pour Johann Georg Pisendel, illustre violoniste de l'Orchestre de Dresde.
Vivaldi le rencontra à Venise à la faveur d'un voyage organisé par son
protecteur, le prince électeur Frédéric-Auguste, futur Frédéric II de Saxe. Les
deux musiciens se lieront d'amitié et l'allemand deviendra même l'élève de
l'italien. Le Prêtre roux écrira plusieurs concertos à son intention, et
celui-ci fera office de copiste de bien des œuvres du maître vénitien. Pisendel sera aussi le dédicataire d'ouvrages de Georg Philipp Telemann ou de Tomaso Albinoni, voire même de Jean Sébastien Bach. Il sera le rouage essentiel de la
propagation de l'œuvre de Vivaldi au sein de l'Orchestre de Dresde, et donc en
Allemagne. La présente interprétation du virtuose russe Dmitry Sinkovsky est loin d'un long fleuve tranquille. La
manière est extrêmement nerveuse, recourant à une rythmique robuste dans les ritornellos, comme fourragés dans le registre grave, et
marquant les accents d'une rare véhémence ; au point qu'en comparaison, la
manière nerveuse d'un Jean-Christophe Spinosi paraît
doucement excitée. La conduite de l'orchestre est, certes, imaginative, peu
routinière, tout comme l'est l'approche soliste. L'intonation se fait
déclamatoire, vise la rudesse du trait, qui peut prétendre, au paroxysme, à une
façon « trille du diable ». A l'inverse, par un contraste saisissant, on
approche le fantasque et l'épanchement dans le registre
« affettuoso ». L'enregistrement, très présent, ajoute encore à
l'aspect percussif. L'ensemble Il Pomo d'Oro, riche d'une quinzaine de musiciens, répond plaisamment
à la pulsation énergique des mouvements rapides ou à la belle rhétorique des
largos, celui du concerto RV 246 en particulier, ou encore du RV 370, marqué
« Grave », qui progresse tel un arioso d'opéra et déploie des
contrastes extrêmes. Si Sinkovsy fait sienne
l'écriture exigeante de Vivaldi, il l'aiguise souvent de manière spectaculaire
(cadence du concerto RV 212a, comme improvisée), poussant loin la recherche
d'expressivité. Une conception de Vivaldi au comble de l'exacerbation, pas
indifférente. Mais des exécutions à consommer avec modération.

Jean-Pierre
Robert.
Georg Friedrich HAENDEL-Wolfgang Amadée MOZART : Timotheus oder Die Gewalt der Musik(Timotheus ou Le Pouvoir de la Musique). Oratorio en deux parties. Version instrumentée
par Mozart de Alexander's Feast or the Power of Musickde
Haendel. Livret de John Dryden et Newburgh Hamilton. Roberta Invernizzi, Werner Güra, Gerald Finley. Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, Concentus Musikus Wien, dir. Nikolaus Harnoncourt. 2CD
Sony Classical : 88883704812. TT.: 62'12+40'50.
Ce disque présente un intérêt historique et
musicologique. Cette captation de concert commémorait le bicentenaire de la
fondation du Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, à l'origine une « société
de musiciens dilettantes », aujourd'hui un ensemble choral universellement
célébré. Plus précisément, le concert se voulait une réplique de la séance
inaugurale du 2 décembre 1812, laquelle constituait aussi une réponse, d'ordre
musical, à la défaite de Napoléon Bonaparte sous les murs de Moscou, deux mois
auparavant, en septembre 1812. Il était constitué de l'exécution de la version
adaptée par Mozart, en 1770 (K 591), de l'oratorio Alexander's Feast de Haendel (1736). On sait l'admiration que
Mozart vouait à son aîné. Cet arrangement est le troisième qu'il ait effectué
de ses oratorios, après ceux d'Acis et Galathée, puis du Messie,
et juste avant celui de l'Ode à Sainte Cécile. Ces travaux, de nature
alimentaire, lui avaient été demandés par le baron van Swieten.
La réinstrumentation consiste en l'adjonction de
parties de vents pour être au goût du jour. La version, jouée ici par
Harnoncourt, comprend, en outre, d'autres ajouts, dont celui d'une grosse
caisse, opérés par le chef du concert de 1812, le compositeur Ignaz Franz von Mosel. Cette
fête, c'est celle qu'Alexandre, victorieux des Perses, donne en un banquet en
compagnie de sa maîtresse Thaïs, au cours duquel le barde Timothée célèbre tour
à tout Bacchus et l'amour, la fin miséreuse de Darius ou la fureur vengeresse
qui s'empare des âmes guerrières. L'oratorio s'achève, curieusement, par un
hommage à Sainte Cécile, intrusion tardive du religieux dans un sujet plutôt
païen. Le titre de « Timotheus oder die Gewalt der Musik », donné par les traducteurs allemands, et
qu'utilise Mozart, focalise sur le personnage du barde Timothée, et reprend le
sous-titre « ou le pouvoir de la musique », qui est de la main de
Haendel. On comprend pourquoi l'œuvre a été choisie pour le concert de 1812 :
ses fins à la fois musicale, pédagogique et patriotique, convenaient on ne peut
mieux à l'événement. Avec ses merveilleux musiciens du Concentus Musicus, Nikolaus Harnoncourt gratifie l'auditoire de son irrésistible talent de conteur musical,
cherchant l'idée au-delà des notes et des mots. Les tableaux courts, mais
brillants, s'enchaînent malgré le caractère brusque des transitions. Les
rythmes saisissants, quasi militaires, affectionnés par Haendel, comme l'art de
la répétition, Harnoncourt les traite avec éloquence, usant de ralentissements
marqués ou de pppp à la limite de l'audible à
des fins expressives dans les scènes plus intimes. Il s'en dégage une grandeur
certaine, en seconde partie notamment ; après que le maestro eût harangué la
salle, comme il aime le faire, pour lui faire entonner le chœur « du
réveil des héros ». La contribution soliste est de grande qualité, la
soprano Roberta Invernizzi en particulier dont la
candeur vocale apporte un rayon de soleil à cette fresque austère. Celle des
chœurs du Singverein est grandiose, bien sûr.

Jean-Pierre Robert.
Robert SCHUMANN : Symphonie N° 2, op. 61. Manfred Ouverture, op. 115. Genoveva Ouverture, op. 81. Orchestra Mozart, dir. Claudio Abbado.
1 CD Universal DG : 479 1061. TT.: 59'57.
Comme on le remarquait à propos d'une
exécution de concert (cf. NL de 5/2012), la vision que livre Claudio Abbado de
la Deuxième symphonie de Schumann est enthousiasmante. Celle qu'il n'hésite pas
considérer comme « la plus novatrice des quatre », bénéficie d'une
lecture d'une grande pudeur, comme d'un travail d'une rare finesse sur la
structure, en particulier sur les transitions, si délicates chez ce musicien.
Nulle trace de romantisme exacerbé, mais une constante fraîcheur dans le geste
: au mystère de l'introduction sostenuto fait suite un allegro vif, premier
volet d'une construction en arche qui culminera dans une fière coda. Le
scherzo, de conception hoffmannienne, mais qui n'est
pas aussi sans rappeler le nocturne de Mendelssohn, bénéficie d'un tempo
soutenu, livrant de cet intermède une belle course haletante, pas grotesque.
L'adagio espressivo, cœur de l'œuvre, loin de tout sentimentalisme, est une
interrogation de l'âme, progressant par paliers dans un mariage idéal entre
cordes et petite harmonie. Le passage fugué central va chercher loin, vers
Bach. Tandis que le finale est empli de vie et exulte de bonheur. Le nôtre est
total, en tout cas, à l'écoute de la palette de couleurs qu'Abbado obtient de
l'Orchestra Mozart, magnifiquement capté dans l'acoustique ouverte de la Salle
dorée du Musikverein de Vienne. Abbado offre en
complément deux Ouvertures du maître, pages initiales de drames atypiques,
entre opéra et mélodrame. Genoveva, l'unique
opéra de Schumann, tiré d'une légende rhénane, est introduit par une Ouverture
tourmentée, beau morceau de concert, au idées nombreuses, dont un choral et un motif syncopé, si typiquement schumannien. La
baguette experte du maestro Abbado fit ici merveille. La vaste Ouverture de Manfred,
« l'un de mes enfants les mieux venus », écrira-t-il à Liszt, en
1851, déploie les thèmes afférents au héros byronien et à son amour perdu pour
Astarté. Elle progresse en plusieurs sections contrastées, finissant sur ce
même climat apaisé qui en avait marqué le début. Abbado en fait sourdre la
mélodie profonde, et l'articulation n'est pas anguleuse dans les passages
agités et passionnés.

Jean-Pierre Robert.
Anniversaire Britten
Benjamin BRITTEN : Suites pour violoncelle
seul, N° 1, en sol majeur, op. 72, N° 2, en ré majeur, op. 80, et N °3, en ut
mineur, op. 87. Antoine Pierlot, violoncelle. 1 CD Transart Live : TR169. TT.:
71'59.
C'est Mtislav Rostropovitch, dédicataire de la Cello Sonata (1961) et de la Symphonie pour violoncelle et
orchestre (1964), qui convainquit Britten de lui écrire encore des Suites pour
le violoncelle seul. On pense immédiatement à JS.Bach,
encore que les trois pièces constituent plus un hommage qu'elles ne sont
tributaires d'un modèle servile. Le style particulier de l'auteur y est bien
présent, qui exploite les diverses possibilités techniques de l'instrument. Le
triptyque des opus 72, 80 et 87 verra le jour entre 1964 et 1971. Il est dédié
à Slava, bien sûr, qui en assurera la création, au demeurant seulement en 1974
pour ce qui est de la Troisième Suite. Il les enregistrera ensuite pour Decca.
Les versions ultérieures n'en sont pas si nombreuses. Aussi celle d'Antoine
Pierlot est-elle bienvenue. La suite N° 1 est constituée de six morceaux,
regroupés par paire, chacune précédée d'un prélude, appelé Canto. Ce découpage
offre une cohérence étonnante à l'ensemble du morceau, où les modes se
succèdent dans une dramaturgie du déchirement et évoquent par endroit
l'atmosphère de l'opéra A Midsummer-Night's Dream. La Deuxième Suite, en cinq mouvements, est
d'inspiration baroque et favorise un style plus austère. Elle culmine dans une
vaste chaconne nourrie de 12 variations, grandiose péroraison d'une œuvre
visionnaire. Britten y aura manié modes et humeurs variés, voire même l'humour,
et exploité toutes les possibilités de l'instrument : figures répétitives,
changements incessants de tempos, en une sorte de libre improvisation. Le
talent formidable du dédicataire n'est pas étranger à cette débauche de
difficultés. La Suite N° 3, qui offre neuf sections enchaînées, se veut un
hommage à la terre russe du grand violoncelliste ami, car elle emprunte à des chansons populaires, naguère
harmonisées par Tchaïkovski, et à une mélodie funèbre de la liturgie slave. Ce
long chant intérieur, alternant des tempos de marche, de barcarolle ou de
fugue, conduit à deux brefs épisodes étonnants « Recitativo : fantastico » et « Molto perpetuo », débouchant sur une Passacaille finale, là
aussi très développée ; autre révérence à la forme baroque. On peut y voir
aussi un discret salut à Chostakovitch. Antoine Pierlot appartient à cette
prolifique jeune génération des cellistes français talentueux dont les
interprétations enluminent le répertoire. Ses interprétations, intenses, sont frappés au coin de la sincérité : sens de la polyphonie
moderne de l'auteur, puissance contrôlée, richesse de la sonorité.
L'enregistrement live du Festival de Reims juillet 2010, est fidèle.

Jean-Pierre Robert.
Gustav MAHLER : The
Klemperer Legacy Edition. Symphonies N° 2,
« Résurrection », N° 4, N° 7 et N° 9. Lieder choisis. Le Chant de
la Terre. Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Hilde Rössl-Majdan, Fritz Wunderlich. Philharmonia Chorus. Philharmonia Orchestra & New Philharmonia Orchestra, dir. Otto Klemperer.Enregistrements 1961-1968. 6CDs EMI Classics : 2 48398 2. TT. :
80'15+79'19+76'22+52'52+58'19+64'11.
Ce coffret Mahler est l'un des joyaux de
l'édition discographique qu'Otto Klemperer a livrée pour EMI, récemment remastérisée à partir des bandes originales *. Et en
l'occurrence, un témoignage émouvant de ce bel été indien qui conduisit le
grand chef allemand à immortaliser sa vision de Gustav Mahler. Les quatre
symphonies enregistrées ici et Le Chant de la Terre, donnent un idée exacte de sa manière : une grandeur hiératique, où
l'architecture prime sur le détail, la ligne demeurant toujours clairement
discernable, même dans les passages les plus enchevêtrés. Et que dire de l'art
de bâtir une atmosphère ou de ménager l'effet de surprise ! Les écarts de
dynamique ne sont pas exagérés, sans excès cataclysmique dans le
« forte ». Le Philharmonia de ces années
bénies lui offrait une palette enviable, aux bois surtout, dont le modelé était
alors tout simplement sans pareil. Tout cela est restitué par des prises de son
d'un grand naturel, travaillées par des producteurs de légende tels que Walter Legge, Suvi Raj Grubb ou Peter Andry, et des
ingénieurs du son soucieux de musicalité, opérant dans un lieu mythique, célébré
pour son acoustique unique, le Kingsway Hall de
Londres, hélas aujourd'hui détruit. Le spectre sonore offre présence, impact et
immédiateté, dans l'effet de masse ou les passages chambristes. La compression
du volume, qui entachait les disques de l'époque, a été réduite, permettant
d'apprécier à sa juste valeur ce qui était alors capté.
La Symphonie « Résurrection »,
Klemperer l'a mise souvent au programme de ses concerts. La présente exécution,
captée en 1961, demeure un document fascinant. Dans le premier mouvement, au
demeurant pas spécialement lent, on est happé par la carrure, sombre et
farouche, le déferlement rythmique, les oppositions de force et de relâchement
; ce que l'image sonore restaurée restitue de manière saisissante. Le moderato
est dépourvu d'affectation afférant à ce que l'auteur marque « très
nonchalant ». Le perpetuum mobile, tiré du Lied
du « Prêche aux poissons » du Wunderhorn,
chef d'œuvre d'humour mahlérien, trouve chez Klemperer son propre esprit, basé
sur une rythmique implacable. Quant au finale, le mot grandiose est faible
devant l'immense fresque et sa course inexorable. La contribution chorale et
soliste est fastueuse. La Quatrième symphonie, saisie aussi en 1961, ne cherche
pas à charmer l'auditeur : Le monde du Wunderhorn de Klemperer est sérieux, à l'aune du « Ruhevoll »,
pris avec un bel allant, prospérant dans une joyeuse ritournelle. Klemperer
débute, pourtant, le premier mouvement de manière très retenue, et ralentit
encore le tempo lors de la récapitulation, après que le développement se soit
fait une fête d'un achalandage de climats saisissants. Certes, la voix royale
d'Elisabeth Schwarzkopf peut paraître un peu « mûre » pour épancher
l'innocente comptine du dernier mouvement. Mais la haute exigence qui fut toujours
la sienne confère à sa contribution une aura de distinction. Celle de Christa
Ludwig, dans un bouquet de Lieder tirés du Knaben Wunderhorn et des Rückert-Lieder,
qui complète le CD de la 4 ème symphonie, est un
prodige d'élégance, en accord avec la manière pénétrante dont Klemperer aborde
ces pièces.
L'interprétation de la Septième
Symphonie (1968) pourrait bien constituer l'aune à laquelle mesurer la
vision mahlérienne de Klemperer. Un premier mouvement hiératique, très mesuré,
habité de grandeur à chaque mesure, hautement significatif de ce qui est, ici,
tourmenté, et d'un dramatisme poignant aux dernières pages. Un rondo final,
dans lequel le chef voyait pourtant une « partie très problématique »
(« Souvenirs sur Gustav Mahler », 1960), aux éclats complexes,
alternant le joyeux et le triste, ressassant un même sujet, quoique de manière
toujours un peu différente, et empli malgré tout d'effets de surprise. Dans les
trois séquences médianes, formant un ensemble au sein de l'œuvre, Klemperer se révèle
magicien : la procession nocturne de la première « Nachtmusik »,
est fantastique, mais non grotesque, un peu comme un tableau de Jérôme Bosch,
le scherzo, vision du démoniaque chez Mahler, devient plus ou moins maléfique à
travers son rythme tournoyant, et s'avère être un festin de timbres. L'andante
amoroso de la seconde « Nachtmusik »,
évolue telle une sérénade nostalgique, sans perdre son côté musique populaire,
dans une orchestration transparente : l'orchestre de solistes dont on attribue
l'invention au compositeur.
La Neuvième Symphonie (enregistrée
en 1967), le chef allemand ne la joua pas souvent. Et pourtant ne lui
était-elle pas prédestinée ? De par la prédominance des mouvements lents, la
hauteur du propos, le pressentiment omniprésent de la mort dans ce bouleversant
adieu à la vie ? Les grands climax sont d'une exaltation extraordinaire. Le
cortège funèbre que conduit le premier mouvement n'est pas lugubre, pathétique
plutôt, traversé par endroit d'une folle énergie. Très retenu, le scherzo est
un peu appuyé sur l'aspect grotesque, le nonchalant le cédant à une fausse
lassitude. Les enchaînements sont révélateurs, en ce que le chef ne
s'appesantit pas sur les silences. Au rondo burlesque, le style fugato est mis
au service d'une polyphonie savante, et Klemperer ne presse pas le tempo, comme
bien d'autres, contribuant à faire de cette danse de pantins disloqués quelque
chose d'étonnamment vivant. Une poussée d'adrénaline marque la coda,
foncièrement rapide selon les canons du chef. Le finale débute sur un tempo
justement allant et les strates se décantent peu à peu, le vaste orchestre se
dépouillant vers le concertino de solistes et une atmosphère de plus en plus
raréfiée.
Le joyau parmi les joyaux est peut-être Le
Chant de la Terre que Klemperer grava en trois sessions (1964-1966), avec
deux solistes inouïs, Christa Ludwig et Fritz Wunderlich.
Le poids des mots de ces poèmes de « La Flûte chinoise », ces deux-là l'assument avec une justesse de ton et un
accomplissement qui n'ont trouvé que peu d'exemples après eux. Lui, de son
ténor solaire, illuminant le premier Lied, marqué d'un héroïsme qui n'est pas
épais, puis enveloppant d'une émouvante douceur la mélodie du « Pavillon
aux pivoines », d'un raffinement merveilleux, ou encore de douce mélancolie
la cinquième pièce, ou l'ivresse du printemps. Elle, de sa voix mordorée,
frôlant le contralto, d'une chaleur à nulle autre pareille, et de ce sens du
texte, véritable gourmandise du mot. Le chef fait siennes les différences de
texture et d'orchestration, toujours au plus près des indications méticuleuses
du compositeur, tel ce « subrepticement, avec lassitude » de la
deuxième pièce. Son orchestre est habité de ce geste à la fois grand et
naturel. Le dernier Lied, de « l'Adieu », vaste réflexion sur la
mort, ouvre ici un monde navré où la vie semble se dissoudre peu à peu. A la
partie centrale, purement orchestrale, le cortège funèbre n'avance que
péniblement, et le retour de la voix dans un climat épuré, évolue comme
s'enivrant de sa propre tristesse : un moment déchirant. La conclusion reste
d'une fascinante beauté, sorte de mort et transfiguration, alors que la soliste
égrène, par sept fois, le mot « ewig »
(éternellement), pour finalement se dissoudre dans un orchestre immatériel.

*L'édition comprend encore 11 autres
coffrets, consacrés à : Bach, Rameau, Haendel, Gluck & Haydn (8CDs), Mozart
(Symphonies, Ouvertures & Sérénades : 8CDs), Mozart Opéras (Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Die Zauberflöte : 11CDs), Mozart : Don Giovanni (4CDs), Romantic symphonies & ouvertures (10CDs),
Brahms (Symphonies & Requiem Allemand : 4CDs), Bruckner (6CDs),
Wagner et Strauss (5CDs), Concertos (6CDs), La Musique du XX ème siècle (4CDs), enfin La Musique sacrée de Bach et
Beethoven (à paraître).
Jean-Pierre Robert.
Serge PROKOFIEV : Le
Joueur. Opéra en quatre actes. Livret de l'auteur, d'après la nouvelle
de Dostoïevski. Vladimir Galuzin, Sergei Alekashkin, Tatiana Pavlovskaya,
Larisa Dyadkova, Nikolai Gassiev, Alexander Gergalov,
Andrei Popov, Nadezhda Serdyuk,
Oleg Sychev, Andrei Spekhov,
Sergei Semishkur, Vyacheslav Ignatovich. Orchestre du Théâtre Mariinsky, dir. Valery Gergiev. Mise
en scène : Temur Chkheidze.
1DVD Mariinsky : MAR0536. TT : 126'.
Il est fascinant de constater combien le
thème du jeu imprègne l'opéra russe : Tchaïkovski, dans La Dame de Pique,
trace la passion dévorante qui saisit Hermann, en quête du secret des trois
cartes gagnantes ; Prokofiev puise dans la nouvelle éponyme de Dostoïevski la
matière de son Joueur, et son héros Alexei est
saisi par la même déraison. Quoique les premières esquisses remontent à 1915,
l'opéra ne sera créé qu'en 1929, à La Monnaie de Bruxelles. Il occupe une place
à part dans la production du musicien, peut-être à cause de sa longue gestation
et de sa particularité stylistique, et a moins attiré l'attention que Guerre
et Paix ou l'Ange de feu. « J'ai voulu accorder une
attention particulière à la souplesse de l'action scénique », dira-t-il. De fait, d'un
imbroglio dramatique, il tire une trame concise et dense qui évolue sur le ton
de la conversation musicale et échappe aux procédés classiques de l'air et de
l'ensemble policé. Tout est ici dialogues vifs, incisifs souvent. Sur cette
déclamation réaliste, Prokofiev coule une musique rythmée jusqu'à la fièvre. La
présente production, filmée en juin 2010, au Théâtre Mariinsky,
rend parfaitement compte de la fluidité de l'action, du kaléidoscope de
caractères et de situations. L'authenticité, le vrai naturel se nichent jusque
dans le dernier détail, de l'habillement, de l'attitude, du geste emphatique,
froid ou précieux. L'environnement décoratif est ouvert, les personnages, fort
nombreux, se détachant de manière rapide, apparaissant dans le lointain, pour
filer comme l'éclair passée leur intervention. La régie de Temur Chkheidze offre ce côté naturaliste qui sied au
propos. Ses personnages sont fort typés, du plus épisodique au premier soliste
; même si on eût préféré plus d'imagination quant à la prise de vue. Le point
culminant qu'est le tableau de la roulette, est haletant, et habilement
illustré, à l'instar des interventions du Premier croupier, dont les saillies « faites
vos jeux » et « les jeux sont faits », en français dans le
texte, marquent des temps obligés. Quelques effets d'ombres chinoises
complètent une imagerie suggestive. Le volet musical est proche de la
perfection, grâce à la fougue qu'impose Valery Gergiev à un orchestre incandescent et à une distribution sans faiblesse. S'en
détachent l'Alexei de Vladimir Galuzin,
terriblement torturé, emporté par une passion indomptable, et Le Général,
Sergei Aleksashkin, grotesque et pitoyable. Chez les
dames, une mention particulière à Tatiana Pavlovskaya, Polina altière, et surtout à la Babulenka de Larisa Dyadkova, qui évite tout pathos dans
l'incarnation de la grand mère indigne et de son coupable penchant pour la
gagne et la dilapidation d'un improbable héritage.
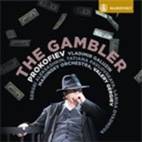
Jean-Pierre Robert.
Karol SZYMANOWSKI : Symphonies No 1, en fa
mineur, op. 15 , et N° 2, en si bémol majeur, op19. London Symphony Orchestra, dir. Valery Gergiev. LSOlive : LSO0731. TT.: 47'27.
Voici sans doute le premier volume d'une
intégrale des symphonies de Karol Szymanowski promise par le maestro Gergiev et ses forces londoniennes. Le couplage,
chronologique, n'est pas des plus attractifs, car la Première symphonie est une œuvre délicate. Composée en 1906, Szymanowski la laissera inachevée, ne
publiant que ses deux mouvements extrêmes. Cet op. 15, son auteur le qualifiera
lui-même de « monstre contrapuntico-harmonique
pour orchestre ». Le langage est en effet surchargé, puisant dans le style
de Richard Strauss mais aussi de Max Reger. Ces pages qui n'entrevoient la
clarté que de manière fugace (solo du premier violon, par exemple), oscillent
entre complexité et lyrisme exacerbé. Elles resteront cependant comme un essai
nécessaire pour le cheminement vers la Deuxième symphonie. Cette
dernière marque une étape significative dans l'affirmation du style du
musicien. Datant de 1911, elle sera remaniée plus tard. Cet op. 19 est la plus
longue de ses pièces symphoniques. Si l'influence des deux musiciens cités est
encore plus que perceptible, la forme est désormais assurée et la maîtrise de
Szymanowski éclate avec force : un allegro moderato clair, introduit par le
solo du premier violon, ce qui est osé, un second mouvement construit sur le
schéma du thème et variations, où le thème, introduit par les cordes
extatiques, évolue au long de six variations contrastées, traversées de
sections enjouées aux bois et de modes de danse, gavotte et menuet. La fugue,
en guise de finale, n'a rien à envier à celle de la Sinfonia domesticade Strauss, l'exaltation de Scriabine
en plus. Valery Gergiev se prend de passion pour
cette musique, comme naguère Simon Rattle, et nous
immerge dans un festin de timbres, d'autant qu'avec le LSO, il dispose d'une
phalange habituée aux défis.

Jean-Pierre Robert.
Arno
BABADJANIAN : Trio pour violon, violoncelle & piano. Concerto pour piano.
Edouard BAGDASSARIAN : Rhapsodie pour violon & piano. Académie de Jeunes
Solistes. Christophe Boulier, violon. 1CD Promusica Association Artistique: P1308. TT : 63’.
Un disque pour découvrir deux compositeurs
arméniens. Arno Babadjanian (1921-1983) dont
Christophe Boulier nous présente le Trio
pour violon, violoncelle & piano composé en 1952 et le Concerto pour piano, dans sa forme
originale pour violon & piano, datant de 1949, dédié à Aram Khatchaturian. S’y associe sur ce CD la Rhapsodie pour violon & piano (1957) d’Edouard Bagdassarian (1922-1985). Deux compositeurs fortement
influencés par Khatchaturian, tous deux formés à
Moscou avant de retourner à Erevan afin de mener une double carrière de compositeur
et de pédagogue. Une musique aux allures quelque peu romantiques, loin de tout
« formalisme », qui n’a
probablement ni le génie ni l’attrait ou la modernité des compositions des
grands maitres de l’époque comme Chostakovitch ou Prokofiev, mais parfaitement
conçue, peut-être un peu désuète, et qui s’inscrit totalement dans la tradition
souhaitée par le pouvoir stalinien… Une interprétation pleine de ressenti,
engagée et virtuose de Christophe Boulier, Cécile Guillon, Hitomi Nishioka et Héloïse Bertrand-Oleari,
où l’on regrettera parfois le jeu un peu dur du violon. Un disque document qui
intéressera tous les musiciens curieux.

Patrice Imbaud.
La Caja Magica. Pièces pour piano de Alberto GINASTERA, Pedro Humberto ALLENDE, Enrique ITURRIAGA, Celso GARRIDO-LECCA, Mauricio ARENAS-FUENTES, Miguel FARIAS. Maria-Paz Santibanez, piano. 1CD ARS HARMONICA : AH 228.
TT : 58’56.
Original et
surprenant que ce disque de la jeune pianiste chilienne Maria-Paz Santibanez dont on connait les affinités particulières pour
la musique contemporaine. Un enregistrement qui propose de découvrir les
compositions de musiciens latino-américains du XXe siècle. Un répertoire
injustement méconnu, bien loin des musiques traditionnelles, que Maria-Paz Santibanez interprète, ici, avec brio. Des œuvres, souvent
inédites, d’Alberto Ginastera (1916-1983), de Pedro Humberto Allende
(1885-1959), Enrique Iturriaga (°1918), Celso Garrido-Lecca (°1926), Mauricio Arenas-Fuentes (°1964) et Miguel Farias (°1983). A découvrir !

Patrice Imbaud.
Goffredo PETRASSI : Magnificat. Salmo IX. Sabina Cvilak, soprano. Orchestra & Coro Teatro Regio Torino, dir. Gianandrea Noseda. 1CD Chandos : CHAN 10750. TT :
65’58.
Un disque consacré à la musique sacrée du
XXe siècle -ce qui n’est pas si fréquent- où Goffredo Petrassi (1904-2003) fait montre de tout son savoir-faire en matière de musique
vocale, chœur et soliste, avec deux œuvres magistrales composées en début de
carrière. Le Magnificat, ici présenté
au disque en première mondiale, composé en 1939-1940, oscillant entre
théâtralité et ferveur, sachant utiliser avec justesse le timbre du soprano
léger de la chanteuse slovène Sabina Cvilak pour
apporter poésie, luminosité et transparence, dans laquelle apparait en
filigrane l’image de la Vierge. Le Psaume
IX, antérieur de quelques années, composé en 1934-1936, alors que Petrassi
venait de découvrir Oedipus Rex de Stravinsky, une influence
revendiquée par le compositeur italien comme le démontre le choix d’un instrumentarium limité à un chœur, cordes, cuivres,
percussions et deux pianos. Une œuvre comme une réminiscence des souvenirs
anciens de la Schola cantorum dans laquelle Petrassi
enfant chantait, mêlée aux accents de la modernité stravinskienne, notamment
rythmique. La réalisation musicale est dans ce CD à la hauteur de l’enjeu. Gianandrea Noseda sait mener ses
troupes avec son entrain habituel, sans sombrer dans la précipitation qui,
parfois, le caractérise. Le Chœur et Sabina Cvilak sont en tous points excellents malgré la difficulté de la partition. Un disque découverte à ne pas manquer

Patrice Imbaud.
***
MUSIQUE ET CINEMA
ENTRETIENS
Robin
Foster, compositeur de « MetroManila », film de Sean Ellis
Robin Foster est un guitariste et
compositeur anglais. Ancien guitariste du groupe Beth, il commence une carrière
solo à partir de 2006. Installé en Bretagne depuis 1997, il connait une
certaine popularité en France. Son dernier album a été produit par ses fans. Il
a fait la musique de plusieurs publicités et autres événements avec le
réalisateur Sean Ellis. Il a composé pour ce dernier la musique du film « Metro Manila »
primé à Sundance. Son style musicale est du rock assez
planant.
Comment avez-vous rencontré Sean
Ellis ?
« C’est
un pur hasard. Il est venu présenter au festival de Brest la version courte de Cashback, qui sera nommé aux Oscars en 2004, et je n’étais
pas là. Je l’ai entendu sur une radio locale. Grâce à MySpace,
j’ai pu le contacter. Je lui ai envoyé des musiques que j’écrivais. Puis il a
présenté la version longue de Cashback en 2006. On
s’est vu. Il appréciait mes musiques. On a commencé à travailler ensemble sur
des publicités, sur un concert avec un montage d’extraits de films sur des
monstres au cinéma. Il trouvait ma musique très cinématographique.
« Metro Manila »
est donc votre première musique de long-métrage
Oui,
ça a été une expérience passionnante. On se connaissait bien avec Sean. Il
avait aimé un morceau que j’avais écrit, « Life and Death »,
que chantait Dave Pen. C’est devenu le thème du film et c’est Emiliana Torrini qui chante le
générique.
Comment s’est passée votre collaboration ?
Très,
très longue. Sean est très exigeant et il sait vraiment ce qu’il veut. J’ai
travaillé sur le montage image et c’était important que ma musique se fonde
avec les ambiances très riches de cette ville incroyable qu’est Manille. Il l’a montée à Cognac. Le premier thème que
j’ai écrit est celui de la douche avec les quatre notes du thème puis une
ambiance cool derrière, mais avec une montée dramatique. Ces quatre notes sont
le leitmotiv. J’y ai ajouté ma guitare, des claviers et du
ukulélé amplifié. Il a voulu une musique très épurée. Une musique
presque subliminale, pour créer une tension. Le film est quasi documentaire au
début, puis devient une sorte de thriller noir. Avec Sean, il faut être très
réactif. C’était aussi comme une affaire familiale
car on est devenu père au même moment.
Et votre collaboration continue ?
Oui,
avec des pubs. Comme il est aussi photographe, il a fait la pochette de mes
derniers albums. Sur mon album « Where do We go from Here »
il a mis la photo du mariage de ses parents. Sur l’autre, « Life is Elswhere », c’est la mise
à mort d’un taureau dans une corrida. Sean Ellis est un type bourré de talent
qui vit à cent à l’heure, de temps en temps à Cognac, et a toujours quinze
mille projets. Il y a une sorte d’osmose entre nous. Il voit les choses comme
je les entends.

© DR
Propos recueillis
par Stéphane Loison.
METRO MANILA. Réalisateur Sean Ellis. Musique Robin Foster. 1CD Queenbeemusic.
Aspirant à une vie meilleure, Oscar Ramirez
et sa famille quittent les montagnes du Nord des Philippines pour s’installer à
Manille. Proie idéale dans cette ville impitoyable, Oscar va devoir tout
risquer pour les siens. Cette histoire de convoyeurs de fond nous entraîne dans
cette ville bruyante, sale, corrompue, où les bidonvilles côtoient les Palaces,
et la misère le luxe insolent. C’est dans cet univers qu’Oscar et sa famille
tentent de survivre, de garder la tête hors de l’eau, comme beaucoup de gens
dans cette ville tentaculaire où à chaque carrefour la violence est présente.
Sean Ellis nous dépeint cette ambiance avec un réalisme quasi documentaire. Il
nous entraine peu à peu dans une sorte de polar néoréaliste où aucune clé nous
n'est donnée pour se faire une petite idée sur la manière dont l’histoire va
évoluer et finir. Le scénario est malin et la fin est inattendue. C’est un
thriller, mais aussi une belle histoire d’amour. C’est filmé par un cinéaste de
grand talent, et fait avec un petit budget. « Metro Manila » est bien ficelé, a un rythme particulier, ses acteurs sont très justes.
Peut-être sont-ils connus dans leur pays ? Ils méritent qu’on les découvre
grâce à ce film. La musique du guitariste Robin Foster, qui fait sa carrière en
France, est tout à fait à l’unisson avec le déroulement du film et ajoute à la
solitude, à l’angoisse des personnages et à la dramaturgie typique des polars
d’aujourd’hui. Une superbe chanson, « Life and Death »,
est interprétée par Emiliana Torrini,
pour le générique de fin. Le thème de cette chanson se devine plus qu’il ne
s’entend à travers le film tant le travail de Robin Foster, pour qu’il ne soit
pas envahissant, est précis. Voir deux convoyeurs de fonds qui écoutent Callas
à Manille au cours de leur tournée, il faut oser ! Nous surprendre, tout
le talent de Ellis est là. Écouter la BO c’est aussi entrer dans l’univers de
Robin Foster ; c’est pour cela que Sean Ellis l’a choisi. Édité par un petit
label de Bretagne, elle vaut d’être écoutée ainsi que les albums de Robin
Foster. Metro Manila a remporté le prix du
public au festival de Sundance 2013. C’est tout à fait mérité.

Rencontre avec Philippe Dupouy,
producteur. MUSIQUE & TOILE. 150, rue Saint-Maur,75011,
Paris. Tel. : +33(0)1 47 00 04 15.
info@musique-et-toile.fr ciné-trio@musique-et-toile.fr
Comment est née cette association « Musique
& Toile » ?
« Elle
est née en 2001. C’était mon projet de fin d’études de l’ESCP, anciennement Sup
de Co Paris. Depuis que je suis tout petit, je suis un fana de musique de
film. « Il Était Une fois dans l’Ouest » a été ma première
musique de film. Je passais en boucle le 33 tours de
mes parents. J’ai fait des études musicales classique et j’étais frustré de ne
jamais entendre ce type de musique dans les concerts. J’avais l’idée de créer
un festival de musique de film à Paris. C’est donc ce projet de fin d’études
que j’ai proposé avec d’autres étudiants. Le festival d’Auxerre s’est créé à
cette époque. On a eu des sponsors, des lieux, des orchestre.
On a conçu l’association « Musique & Toile ». Mais six mois avant
de commencer on a reculé car ils nous manquait de
l’argent. Sans subvention on ne peut pas faire un festival qui dure. On a quand
même fait un concert à l’ESCP avec un orchestre et un pianiste avec qui je
travaille régulièrement, Enguerrand-Friedrich Lühl.
Notre soutenance, on l’a faite ainsi dans l’atrium de l’ESCP avec des extraits
de musiques de films et la conception « papier » du projet du
festival. En septembre 2001, on a décidé de tout arrêter. On a ensuite produit
un disque, des transcriptions pour piano des musiques de John Williams. J’ai
décidé alors de produire des concerts de musique de film tout au long de
l’année avec l’association et des formations plus ou moins variables. Je suis
bénévole dans le cadre de cette association, j’ai d’autres activités pour
vivre.

(Le
CD peut être acheté sur le site de Musique & Toile)
Musique & Toile est donc votre
danseuse ?
En
quelque sorte. Au départ, je ne faisais que des concerts de musique de film,
puis j’ai développé des spectacles avec des artistes. Au départ, j’ai produit
des concerts avec Enguerrand-Friedrich Lühl, puis
avec Philippe Barbey-Lallia.
Ce dernier est un chef d’orchestre qui aime la musique de film et qui a monté
« L’Orchestre Cinématographique de Paris », un orchestre à géométrie
variable avec des musiciens qui sortent tous de CNSMDP. Il fait aussi les
arrangements. On a fait des concerts avec 20 musiciens, et même jusqu’à 80.
Tout dépend de la demande et du budget alloué par les organismes qui nous
contactent. Le premier concert a eu lieu en 2004. Il s’appelait Voyage(s),
voyage à travers l’histoire, l’amour, la science fiction. Il y avait 60
musiciens. C’était à la Mairie du 13ème à Paris. C’était archi plein.
Aujourd’hui c’est plus compliqué, il y a des problèmes de billetterie. On a
fait un concert en 2005 à la salle Olympe de Gouge, dans le 11ème, sur le thème
du dessin animé. La salle fait 700 places. On a joué l’après midi pour les élèves
de CM2 et le soir pour tout public. Les deux étaient complets. Il y avait 27
musiciens sous la direction de Philippe, qui jouait au piano en même temps, et
trois chanteurs dont une japonaise. La première partie était sur les musiques
de Joe Hisaishi, des films de Hayao Miyazaki, avec « Princesse Mononoke », le « Voyage de Chiro » et le
« Château dans le Ciel ». La deuxième partie, comprenait des
musiques de films français avec « Le Roi et l’Oiseau », qui n’avait
pas été joué depuis plus de 20 ans, « Tintin », « Astérix »
de Vladimir Cosma, « L’Enfant qui Voulait être
un Ours » de Bruno Coulais, et « Les Enfants de la Pluie » de
Didier Lockwood. Ensuite les deux chanteurs français
ont interprété les musiques de films d’animation américains.
Comment cela se passe concrètement pour
l’organisation ?
Compliqué,
car il faut payer l’orchestre, louer des instruments, trouver une salle, faire
la communication, payer les droits SACEM… Il y a des risques financiers
énormes. Depuis plusieurs années c’est une commande, un organisateur tiers qui
fait appel à l’orchestre, notamment en événementiel ou pour une convention. Le
prix est indépendant du nombre d’auditeurs.

© DR
Vous ne pouvez donc pas produire
régulièrement des concerts de musique de film ?
Si,
mais pas forcément avec l’orchestre tout entier. On a monté une petite
structure, le Ciné-Trio, qui peut, elle aussi, être à géométrie variable. Elle
est constituée d'un piano, d'un violon et d'un hautbois. Le pianiste, c’est
Philippe Barbey-Lallia, qui
fait toutes les réductions pour la formation, le violon c’est le premier violon
de l’Orchestre Cinématographique de Paris, Cyril Baleton,
jeune recrue de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, et le hautbois
c'est Timothée Oudinot, qui joue dans plusieurs formations. Ciné-Trio joue des
thèmes qui peuvent être en phase avec celui de la manifestation. Par exemple, à
Auvers-sur-Oise où il y avait un salon du livre sur le roman policier. Au
château, on a fait un concert pour la clôture. Il s’appelait
« Rififi ». Avec la Mairie, qui avait organisé cette manifestation,
on avait fait un quizz en rapport avec le concert et les gagnants recevaient
des livres. Aujourd’hui l’orchestre n’a pas encore assez de visibilité pour se
produire. Pour des manifestations publiques, un orchestre coûte très cher. Il y
a encore un effort de pédagogie à faire auprès des organisateurs. Que cela soit
pour un festival, un théâtre, une collectivité, ce n’est pas encore dans les
mœurs. Les initiatives se multiplient, mais il y a encore des réticences. Il y
a des directeurs de théâtre qui pensent que la musique de film n’intéresse
personne. C’est stupide, car c’est aussi un bon moyen pour amener les gens à
écouter de la musique de répertoire.
Et Aujourd’hui ?
Musique
& Toile a fait plus de 700 représentations. On a monté des spectacles
musicaux où la musique de film est présente. Ciné-Trio propose avec des
chanteurs, ou seul, toute une série de concerts à thème. Il a à son répertoire
plus de 200 arrangements inédits. On a deux spectacles, par exemple, qui s’appellent,
l’un « Paris je t’aime », un hommage à Paris à travers le cinéma
français et américain, avec deux chanteurs français, et l’autre « Trois
Américains à Paris », un hommage à « Un Américain à Paris » à
travers les plus grandes comédies musicales américaines portées au cinéma,
interprété par trois chanteurs américains. Ces concerts ont été donnés plus de
150 fois dans un hôtel du Marais. Les pianos Magne étaient coproducteurs. Comme
ils ont déménagé on n'a plus de lieu pour nous produire.

Pourquoi
l’Orchestre Cinématographique de Paris n’enregistre-t-il pas de la musique des
films en production ?
Il y a deux cas de figure. Il y a des
productions qui ont beaucoup d’argent, et le reste qui n’a rien. Entre les
deux, les moyennes sont inexistantes. Les gens qui ont de l’argent vont à
Londres et tous les autres enregistrent dans les pays de l’Est. On a eu trois
demandes en dix ans ! On a fait avec des petites formations, mais les
charges sont telles qu’il est impossible de prendre en charge l’orchestre. Très
honnêtement, on ne se bat pas pour ça. Aujourd’hui enregistrer de la musique de
film ce n’est pas rentable en terme d’énergie, de temps, même pour les
musiciens.
Propos
recueillis par Stéphane Loison.
Pour
la rentrée, Musique & Toile propose une fois par mois un concert en rapport avec la musique de film, au
Temple de l’Annonciation, 17, rue Cortambert, 75016
Paris :
-
le
Samedi 28 septembre 2013, à 18h30, « Musique de films » avec le
ciné-trio et la sortie de son 1er album

-
le
Samedi 19 octobre, à 18h30 « Made In USA », Hollywwod à Paris avec la chanteuse Lexie Kendrick et le
Ciné-Trio.

© DR
BO en CDs
MUSIQUES EN SERIES
DOWNTOWN ABBEY. Musique de Jon Lunn. 1 CD Decca
GAME OF THRONES. Musique de Ramin Djawadi.
1 CD Varese Sarabande n°3020671482
VIKINGS. Musique de Trevor Morris. 1 CD Sony Classical n°88883734572
TREME. Musique de John
Bouté. 1 CD Geffen 06025227508450
SPARTACUS Vengeance. Musique de Joseph LoDUCA. 1 CD Varese Saraband VSD 7184
ROME. Musique de Jeff
Beal. 1 CD Rykodisc n°RCD 10896
BOARWALK EMPIRE. 1 CD Elektra records n°628266
Aujourd’hui les séries américaines, surtout
celles produites par HBO, « cartonnent » au box office, et surtout sur
internet. Il y a des années, quand, en France, la télévision était en noir et
blanc, de nombreux compositeurs étaient devenus célèbres pour des génériques de
feuilletons, comme on disait alors. Lalo Schifrin avec « Mission
Impossible, Mannix, Starsky et Hutch…. », Richard Markowitz avec « Les
Mystères de l’Ouest, Les Envahisseurs… ». Puis, plus récemment, Angelo Badalamenti et « Twin Peaks ». Actuellement, vu le succès
phénoménal des séries, surtout auprès d’une clientèle jeune, leurs musiques
sont éditées en CD et même par saison. On peut ainsi retrouver « Lost » (Varese Sarabande VSD 7040-2) de
John Corigliano qui a composé le dernier « Star Trek », « Xfiles », et Mark Snow qui
compose actuellement pour Alain Resnais, Eric Neveu pour la série des « Borgia » de Canal Plus, ou Trevor
Morris pour la canadienne et qui compose aussi pour la magnifique série des
« Tudor ». La plupart des
séries sont éditées par Varèse Sarabande. Jon Lunn,
compositeur britannique d’opéras et d’un concerto pour violon, a écrit sa
première et très élégante partition pour la série « Downton Abbey » qui a explosé l’audimat en
Grande Bretagne et a reçu une multitude d’Awards. La
musique est éditée chez Universal Decca.
Elektra records propose un CD sur les musiques de « Boardwalk Empire ». C'est une compilation de
musiques des années trente au temps de la prohibition. Dans le genre jazz, rap,
R&B plus « black », on peut trouver une compilation de musiques
de la série « Treme » qui se passe après les
inondations de la Nouvelle Orléans. C’est une série contemporaine avec un vrai
contexte social et politique. Le générique est de John Bouté. Jeff Beal, Joseph LoDuca, Ramin Djawadi ont écrit les génériques, respectivement,
de « Rome »,
« Spartacus », et « Game
of Thrones », qui sont
devenus aussi célèbres que celui de « Mission
Impossible ». Chaque saison a droit à l’édition d’un CD. Est-ce à dire que toutes ces musiques ont un
intérêt ? On n’est quand même pas loin de la musique au mètre. Il faut
produire ! Ce sont plutôt les génériques qui sont les moteurs de l’édition
de ces CD. Une compilation des thèmes serait suffisante, comme il en existe sur
les feuilletons d’antan. Une nouvelle série vient de faire son apparition,
« Vikings ». La chanson du
générique est chantée par le suédois Fever Ray. C’est de nouveau le canadien
Trevor Morris qui en est le compositeur. Il a fait partie de l’écurie de Remote Control de Hans Zimmer . Il faut bien
vivre…


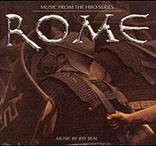

BLOCKBUSTERS EN SERIE
WORLD WAR Z Réalisateur Marc
Foster. Compositeur Marco Beltrami.1 CD Warner Bross n°936249350
THE WOLVERINE Réalisateur James Mangold. Compositeur Marco Beltrami. 1CD Sony Classical n°88883712542
PACIFIC RIM Réalisateur
Guillermo del Toro.
Compositeur Ramin Djawadi. 1CD Sony Classical n°88883736302
Trois blockbusters sont sortis cet été :
« World War Z », « The Wolverine » et « Pacific Rim ». Les deux premiers
réalisateurs ont choisi comme
compositeur Marco Beltrami. Avec James Mangold,
celui-ci avait composé la superbe musique de « 3 :10 pour Yuma », nommé aux Oscars. Élève du grand
compositeur Jerry Goldsmith, Beltrami est assez éclectique dans ses choix,
comme son maître. Il passe du film d’horreur au thriller, et aux grosses
machines avec un égal bonheur. « World War Z », film aseptisé de zombies pour tout
public, se laisse voir et le travail de Beltrami est très réussi. Dans les
moments calmes, où le héros est avec sa famille, les thèmes écrits portent en
filigrane la puissance du drame inexorable qui se produit sur toute la planète.
Grâce à cette musique le climat angoissant est installé dès le début du film et
ne se relâche pas. Dommage que dans le CD il n’y ait pas les deux chansons de
Muse tirée de l’album « The 2nd Chance » : « Follow Me » et « Isolated System ».
Pour « The Wolverine », un des héros du Comic de Marvel, Xmen Hugh Jackman est toujours
l’interprète de l’homme aux griffes. Le précédent volet était sans intérêt
ainsi que la musique. L’homme loup a eu du mal à sauver le film. Comment Marco
Beltrami arrive-t-il à produire autant de musique en une année (5 en 2013) et
pour des films à gros budget ? Sûrement grâce à ses trois arrangeurs, Pete
Anthony (un des chefs d’orchestre et arrangeurs les plus demandé à Hollywood,
avec plus de trois cents films à son actif !), Rossano Galante, et Mark Graham. Ils avaient aussi participé au désastreux dernier
« Die Hard, a good day to die ». A croire que lorsque le film est
nul, la musique l’est aussi. « The Wolverine » est intéressant à plus d’un titre. Il
se passe au Japon et le style de la musique s’en ressent par l’emploi de
certains instruments, les arrangements et la diversité des thèmes. Le climat
musical est très sombre, comme le film. Les thèmes lents sont prenants et
ajoutent cette dimension de désespoir que « trimballe » tout le long
du film ce non humain qu’est Wolverine. De la belle
œuvre un CD, à écouter. A noter que le CD est produit par le réalisateur, ce
qui n’est pas fréquent. Un pari sur le succès de la BO ?
Ramin Djawadi est
devenu célèbre auprès du public pour avoir écrit le thème de la série culte
« Game of Thrones ».
Il fait partie de l’écurie de Hans Zimmer, Remote Control. Guillermo del Toro a fait une infidélité sur « Pacific Rim » à son musicien attitré Marco Beltrami qui
l’accompagne depuis son premier film « Mimic », de 1997. Peut-être
est-ce un problème de production chez Warner ? Ou simplement Beltrami
avait-il trop de projets ?
Djawadi, avec le
guitariste Morello, offre une musique très hard Rock. Morello était le guitariste du groupe Rage Against the Machine pour ensuite faire une carrière solo. Djawadi n’est pas Beltrami, mais sa musique fonctionne
bien. Il y en a toujours trop, mais elle colle au film, qui ressemble à un
grand jeu vidéo. Décors, costumes, trucages sont époustouflants et on se laisse
emporter dans un déluge d’images dantesques. Guillermo del Toro a du talent, et même arrive à exister dans ce
genre de grosse machine. Il parvient à faire cohabiter Godzilla et Freud ! La présence de Morello est un plus
pour la BO qui, de temps en temps, flirte avec Zimmer.
Une BO pour ceux qui ont vu le film.



LE JOUR LE PLUS LONG Réalisation Ken Annakin,
Andrew Marton, Bernhard Wicki.
Compositeurs : Paul Anka et Maurice Jarre. 1CD Milan
/ Universal 399485-2
Les
Editions Milan Music proposent une réédition de la compilation de quelques
musiques de films sur la seconde guerre mondiale aussi célèbres que « Le Jour Le Plus Long », « Un Taxi pour Tobrouk », « Paris Brûle-t-il », et « Jeux Interdits ». Si elles sont
très connues, elles n’étaient plus disponibles. Mais le générique de « La Bataille du Rail » composé par
Yves Baudrier, et celui du « Père
Tranquille » par René Cloërec, étaient
introuvables en CD. Un disque indispensable pour ces musiques magnifiques de
Maurice Jarre, et la guitare de Narciso Yepes.

LE CONGRES Réalisateur
Ari Folman. Compositeur Max Richter. 1 CD Milan / Universal 399 489-2
Ari Folman et Max Richter avaient collaboré sur le précédent
film d’animation « Valse avec Bachir » qui avait fait une forte
impression. Ce nouveau film, présenté à Cannes, a lui aussi été bien accueilli.
La musique seule de Max Richter, sur CD, n’a aucun intérêt. Les extraits de
musiques classiques sont mal interprétés (entre autres, le fameux trio de
Schubert qui avait fait le succès de la BO de « Barry Lindon »). Max Richter est un musicien britannique de
musique classique et électronique contemporaine, rattaché au mouvement
minimaliste. Il a étudié avec Berio, écrit des œuvres qui ne sont pas
mémorables, et fait quelques compositions pour le cinéma. Musicien à la mode,
il a fait un arrangement des Quatre Saisons de Vivaldi. On est loin des
arrangements de Berio pour Monteverdi. L’intérêt du CD réside dans les deux
chansons de l’inoubliable actrice de « Princess Bride » (Musique magnifique de Mark Knopfler toujours trouvable en CD), à savoir Robin Wright, l’actrice mise en abîme dans
ce film.

LEAVE IT
ON THE FLOOR Réalisation Sheldon Larry. Musique
de Kimberley Burse. Scénario et Chansons de Glenn Gaylord *.
Si
ce film, le premier de Sheldon Larry, n’a pas une grande valeur au niveau de la
réalisation, il est par contre très intéressant par l’univers qu’il décrit, à
savoir celui du Voguing. Il s'agit d'une « urban dance » dont la paternité est attribuée aux
prisonniers afro-américains gays dans les années 60. Aujourd’hui, la communauté
des ballrooms de Los Angeles, répartie en
« Maisons », organise chaque mois des concours dans les salles de
quartiers. Chaque membre de ces communautés gays danse, défile déguisé,
participe à des « battles », pour faire
gagner la Maison à laquelle il appartient. Le film, sous forme de comédie
musicale qui se passe dans le milieu homosexuel afro-américain, nous montre une
réalité sociale très concrète où des jeunes homosexuels blacks subissent
quotidiennement des discours dégradants les poussant au désespoir. La
population afro-américaine est très conservatrice et homophobe vis à vis de ses
membres. Le héros du film, superbe danseur, rejeté par sa famille du fait de
ses préférences sexuelles, va trouver refuge dans une Maison, lieu d’accueil
pour gays. Il y trouvera l’amour et participera à ces concours sous l’égide
d’une « maman ». Les danses, les défilés des drag queens, sont filmés comme dans un documentaire. C’est
la partie la plus passionnante du film. Les chansons vont du rap à la chanson
de Broadway, en passant par le R&B. On peut comprendre que ce film a eu de
mal à être produit, compte-tenu du sujet qu’il traite. Les participants du film
sont tous en devenir et certains sont déjà connus dans le milieu de la danse
(Franck Gatson Jr. est chorégraphe de Beyonce), du clip et de la scène musicale américaine. Phyllip Evelyn, mannequin, réellement membre d’une Maison,
est assez incroyable dans son jeu et ses déguisements, et la drag queen Miss Barbie (Queef Latina), qui joue le rôle d’une « mother »
très stricte d’une maison, est stupéfiante. C’est un vrai film underground qui
mérite le détour et qui a besoin d’être soutenu face à toutes
ces drag queens qui remplissent aujourd’hui
les écrans en 3D de la maison Marvel…

* C’est uniquement par téléchargement qu’il
est possible de se procurer, pour l’instant, les chansons interprétées par Miss Barbie-Q, Andre Meyers, Clent Bowers, Ephraim Sykes et la troupe
des chanteurs-comédiens.
Stéphane Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Passer une publicité. Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
maite.poma@leducation-musicale.com
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale
·
La librairie de L’éducation
musicale
En préparation
 |
Analyses
musicales
XVIIIe siècle – Tome 1
L’imbroglio
baroque de Gérard Denizeau
BACH
Cantate BWV 104 Actus tragicus Gérard Denizeau Toccata ré mineur Jean Maillard Cantate BWV 4 Isabelle Rouard Passacaille et fugue Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu Janine Delahaye Phœbus et Pan Marianne Massin Concerto 4 clavecins Jean-Marie Thil La Grand Messe Philippe A. Autexier Les Magnificat Jean Sichler Variations Goldberg Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses Gérard Denizeau Apothéose Corelli Francine Maillard Apothéose de Lully Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus Sabine Bérard Israël
en Egypte Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile Jacques Michon L’alleluia du Messie René Kopff
Musique feu d’artifice Jean-Marie Thill |
***
Paru en juillet
·
Où trouver le numéro du Bac ?
Les analyses musicales de L'Education Musicale