L'ARTICLE DU MOIS : Jean-philippe rameau et la "FETE DU SOLEIL" des INDES GALANTES
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
À RESERVER SUR L'AGENDA
Au gré
des festivals d'Été
La saison estivale approche, porteuse de
son lot de manifestations musicales alléchantes quant aux lieux des concerts et
à l'originalité des programmes. Voici quelques suggestions, non exclusives bien
sûr de toutes les autres propositions, fort nombreuses, fleurissant dans
l'hexagone. Qui a osé prétendre que la France n'était pas un pays musical ! Au
moment où la crise que l'on sait défraie la chronique, souvenons-nous de ce mot
de Romain Rolland : « Toi seule ne passe pas, immortelle Musique. »
11 / 7 – 23 / 8
Musique et Nature en Bauges

Au cœur de la Savoie, au sein du Parc
naturel régional du massif des Bauges et d'un triangle qui relie Annecy, Alberville et Chambéry, musique et nature ont un rendez
vous particulier : un festival épousant un environnement naturellement
généreux. Pendant quelques cinq semaines, dans de magnifiques églises de
villages, éclectisme et qualité s'unissent pour accueillir des formations
prestigieuses : les Arts Florissants et Paul Agnew dans un programme Purcell (11/7), ou le Concert Spirituel et Hervé Niquet, pour
une soirée de splendeurs vénitiennes (23/8). Mais aussi une myriade de solistes
de renom : Vox Luminis (15/8), le Chœur Les Eléments
qui vanteront l'âme slave (25/7). Trois cartes blanches, l'instant d'un week end, rythmeront cette édition : au pianiste
François-Frédéric Guy, pour des sonates pour piano de Beethoven, et avec Tedi Papavrami pour des sonates
violon et clavier (31/7 et 1/8) ; puis aux solistes de l'Orchestre
Philharmonique de Berlin qui honoreront Brahms et ses trois quatuors avec
piano, et Dvořák et ses deux quintettes (9 et 10
/8), enfin à l'ensemble Chanticleer de San Francisco
(18 et19/8). On fêtera aussi Rameau avec les meilleurs spécialistes : Bruno Procopio, Alexis Kossenko,
Patrick Bismuth et Emmanuelle Guigues joueront des
pièces de clavecin en concerts.
Renseignements et réservations : Musique et
Nature, Mairie, 73630 Le Chatelard ; par tel.: 04 79
54 84 28 ; en ligne : festival@lesbauges.com ou www.musiqueetnature.fr
14 - 25 / 7
Musique de chambre à Belle-Ile

Pour sa 9e édition,
le festival de musique de chambre de Belle-Ile-en-mer, Plage Musicale en
Bangor, propose 12 concerts en douze jours, frappés au coin de l'éclectisme, de
Vivaldi à Beethoven, de Mozart à Debussy, de Brahms à Rimsky-
Korsakov ou Tchaikovski. Deux invités d’honneur
seront à l’affiche : le pianiste Jean-Marc Luisada,
pour deux concerts Schubert (21 et 22/7) et une master-class (20/7), et la
comédienne Marie-Christine Barrault pour trois programmes, dont une promenade
poétique et musicale (16/7), une évocation de Sarah Bernhardt et la musique, en
souvenir des années passées par l'actrice à Belle-Ile (17/7) et un concert pour
les plus jeunes autour du Petit Prince de Saint-Exupéry (19/7). Comme
chaque année, outre les églises de Bangor, de Locmaria ou de Sauzon, des lieux insolites se verront investis
par la musique, valorisant ainsi le patrimoine naturel et humain de l'île, comme le Grand phare de Goulphar,
le fameux jardin La Boulaye au Grand Cosquet et le fort Sarah Bernhardt à la
Pointe des Poulains. Chacun pourra y
trouver de la musique à son goût : les grands classiques, et parfois des
œuvres rares, mis en miroir avec la musique d'aujourd'hui : de nombreux
compositeurs seront présents, comme Pierre Bernard, Laurent Camatte,
Alexandre Gasparov, Benoît Menu ou Philippe Manoury. L'Académie d'été, qui se déroulera du 16 au 26
juillet, donnera son concert le 24 juillet autour de la symphonie
« Pastorale » de Beethoven.
Églises
de Bangor, de Locmaria et de Sauzon,
et autres lieux, du 12 au 25 juillet 2014, horaires variables.
Réservations : Office du tourisme, le
Palais, 56 360 Belle-Ile-en mer ; par tel : 02 97 31 81 93; en ligne : www.belleilemusique.com
24 au 27 / 7
Itinéraire baroque en Périgord vert

Plusieurs célébrations figurent au
calendrier de la 13 ème édition d'Itinéraire en
Périgord Vert. Ainsi, seront fêtés les 70 ans de son directeur artistique, Ton Koopman, qui depuis 13 ans insuffle au festival une énergie
débordante; de même que les 35 ans de l'orchestre créé par lui, l’Amsterdam
Baroque Orchestra ; enfin, le festival participera à la célébration nationale du quadri centenaire du chroniqueur de la Renaissance, Pierre de Bourdeille, dit Brantôme, périgourdin de pure souche et
personnage haut en couleur. Son château de Richemont où il repose, ouvrira ses
portes pour un concert le jour de l’Itinéraire. Durant ce long week end, on entendra, entre autres, des cantates pour alto
de Bach et autres pièces de Marcello et de Telemann, chantées par le contre
ténor Maarten Engeltjes (24/7, Église de
Champagne-Fontaine), les Fables de La
Fontaine (25/7, 12H, Cercles, théâtre de l'Incrédule), ou encore une soirée aux
saveurs d'Orient, avec La marche des
Turcs de Lully, extraite du Bourgeois
Gentilhomme et des airs d’opéra de Haendel, Vivaldi, Hasse (25/7, 20H30).
L'édition se terminera par le chef-d’œuvre mythique de Claudio Monteverdi, les Vêpres de la Vierge, sous la baguette de
Ton Koopman (27/7, 17H, Église de Saint-Astier).
L'événement le plus original du festival, sera la journée de l'itinéraire, qui
après un concert d'accueil durant lequel Ton Koopman jouera des pièces d'orgue de Bach, Buxtehude et Stanley, présentera 5 concerts
promenades dans 5 lieux différents, selon un module répété 5 fois, où
l'auditeur aura l'occasion de savourer successivement des sonates de JS. Bach
autour du dulcimer, un hommage à Jean-Marie Leclair, de la musique de chambre
des maîtres allemands, des pièces du baroque italien et danois, enfin des airs
de Cour au temps de Brantôme. De nombreux artistes seront présents pour toutes
ces célébrations, des habitués, d’autres venant pour la première fois, comme
Benjamin Lazar, Louise Moaty et Thomas Dunford qui feront apprécier, grâce à la
prononciation et à la gestuelle baroque, la musicalité des Fables de La Fontaine.
Les
24, 25, 26 et 27 juillet 2014.
Renseignements et location : 36, rue du
Four, 24600 Ribérac. Par tel. : 05 53 90 05 13 ; en ligne : www.itinerairebaroque.com
1 / 8
Les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly en concert

Fondée en 1956, la maîtrise des Petits chanteurs
de Sainte-Croix de Neuilly réunit des garçons qui désirent pratiquer
intensément le chant choral. Actuellement dirigée par François Polgár, elle assure le service musical du collège de
Neuilly-sur-Seine, se produit dans les grands festivals et interprète
régulièrement les grandes œuvres du répertoire avec orchestre. Elle pratique également un
répertoire de chants sacrés et profanes a cappella. La tournée estivale du
chœur de garçons des Petits Chanteurs de Sainte-Croix le mènera, à partir du 14
juillet, en Picardie, Vendée, Charente, région Paca et en Haute Savoie. Elle
s'achèvera lors d'une soirée festive, le 1er août, à Évian, dans la mythique
salle de La Grange au Lac. Au programme du concert, accompagné au piano par
Louis Absil, lui-même ancien choriste, des pièces de Toma Luis de Victoria,
Rameau, Mozart, Saint-Saëns, Franck, Fauré, Duruflé, mais aussi de Ben Britten
ou de Pau Casals.
Salle
de la Grange au Lac, Évian, le 1er août 2014, à 20H.
Location : Office du tourisme d'Évian ; par
tel : 04 50 26 87 87 ; en ligne : info@petitschanteurs.com ou www.petitschanteurs.com
2 / 8 – 14 / 9
Le classique se met au vert au Bois de Vincennes

Au Parc floral de Paris la
musique se met au vert : beautés botaniques et fine fleur musicale se donnent
rendez-vous sept week end durant. Dans une belle
diversité de talents confirmés ou de jeunes pousses, comme de programmation :
musique d'aujourd'hui, couleurs d'Amérique latine, art du violon,... A noter le
récital du pianiste Andrei Korobeinikov associant JS.
Bach à Keith Jarrett, Beethoven à Scott Joplin (2/8),
le Quatuor Modigliani jouant Haydn et de Beethoven le 3èmr quatuor Razoumovsky (10/8), Didier Lockwood aux talents protéiformes (16/8), le fameux trompettiste Romain Leleu et l'Ensemble Convergences (17/8). Le violoniste
Augustin Dumay et l'altiste Miguel da Silva se
produiront dans la symphonie concertante de Mozart (30/8), puis Michel Portal,
Miguel da Silva et Michel Dalberto joueront, entre
autres, de Poulenc la sonate pour clarinette et le trio des Quilles de Mozart
(31/8). Une carte blanche sera donnée aux lauréats de la Fondation Banque
Populaire, permettant de découvrir le Quatuor Giraud, dans La jeune fille et
la mort de Schubert, et avec Patrice Fontanarosa et Antoine de Grolée au piano, le sublime Concert de Chausson (6/9), ou le
Quatuor Morphing qui offre la particularité de rassembler quatre saxophones,
dans des œuvres de Thierry Escaich, Karol Beffa et Philippe Geiss (7/9). Un
« week end spécial » sera dévolu à
l'Orchestre français des jeunes, sous la direction de Dennis Russell Davies,
aussi bien dans Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss et la Symphonie
pour orgue de Saint-Saëns (23/8), que dans le Concerto pour piano et
instruments à vent de Stravinsky et la 2 ème symphonie de Brahms (24/8). L'ultime week end rendra
hommage à la Première guerre mondiale : le 13/9, l''Ensemble Calliopée jouera les musiciens de la grande guerre, Lucien Durosoir et Lili Boulanger, et le 24/9, les percussions de
Strasbourg concluront en beauté cette saison estivale.
Parc Floral de Paris, Bois de
Vincennes, 75012 Paris, les samedis et dimanches, du 2 août au 14 septembre
2014, à 16H ( sauf le 23/8 : 20H). Concerts gratuits.
Renseignements ; ww.classiqueauvert.paris.fr
21- 24 / 8
Rencontres musicales de Vézelay

Fêtant leur 15ème édition, les
Rencontres musicales de Vézelay profitent d'un lieu unique et magique, la
basilique Sainte-Marie-Madeleine perchée sur la colline éternelle. La petite
cité bourguignonne, devenue la Cité de la Voix, mettra à l'honneur la musique
baroque française, italienne et allemande comme la grande tradition chorale
anglaise. Du baroque français, on entendra un hommage à Rameau, avec le chœur Arsys Bourgogne et l'Ensemble La Fenice sous la direction de Jean Tubéry (23/8, 21H,
Basilique), mais aussi un inédit, La Peste de Milan de Marc-Antoine
Charpentier, qui sera ressuscitée après plus de trois siècles d'oubli, par
l'Ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé (23/8, 16H, Collégiale Saint-Lazare, Avallon). Des extraits de la Selva
morale de Monteverdi seront donnés par la Chapelle Rhénane et Benoît Haller
(21/8, 21H, Basilique). L'ensemble Scorpio Collective
s'attachera à faire découvrir des compositeurs de l'Allemagne du nord à
l'époque de la guerre de Trente ans, dont Samuel Scheidt, Johann Hildebrand ou
Johann Schein, sans oublier Dietrich et Buxtehude (22/8, 16H, Église
Saint-Jacques, Asquins). Quant aux BBC Singers, ils chanteront Vaughan Williams, Holst, Taverner, Tippett, Stanford ou
Britten (22/8, 21H, Basilique). Les auront précédé, le New York Polyphony, mettant en perspective la musique de William
Byrd et de Thomas Tallis avec celle de compositeurs contemporains (21/8, 16H,
Église Notre-Dame, Saint- Père sous Vézelay).
Du 21 au 24 août 2014, à 16H et 21H, à Vézelay, Saint-Père, Asquins et Avallon.
Renseignements et location :
Cité de la Voix, 4 rue de l'hôpital, 89450 Vézelay ; par tel .: 03 86 94 84 40 ; en ligne : billetterie@rencontresmusicalesdevezelay.com ou www.rencontresmusicalesdevezelay.com
21 – 31 / 8
Le Festival Berlioz de la Côte-Saint-André

« Berlioz en Amérique, au
temps des révolutions industrielles », tel est le thème de l'édition 2014
du festival de La Côte-Saint-André. Au centre des manifestations
l'ode-symphonie Christophe Colomb de Félicien David, qui sera dirigée
par François-Xavier Roth avec son orchestre Les Siècles (22/8, 21H), comme la
reconstitution du concert extraordinaire imaginé et dirigé par Berlioz pour le
Festival de l'Industrie à Paris en 1844, qui réunira quelques 1000
participants, annonce-t-on (21/8, 21H). Le maître de céans se verra encore
honoré par sa Symphonie fantastique, donnée par l'Orchestre des jeunes de l'État de Sao Paulo
(26/8, 21H), Les Nuits d'été chantées par Kate Lindsey, accompagnée par
Le Cercle de l'Harmonie, dirigé par Jérémie Rhorer (28/8, 21H), des extraits de Roméo et
Juliette par le LSO et John Eliot Gardiner, qui se joindront aussi à
Gautier Capuçon dans le concerto pour violoncelle de
Schumann (30/8, 21H), et enfin La Damnation de Faust, en concert de
clôture, avec Anna Caterina Antonacci et Michael Spyres, et dirigée par François-Xavier Roth, à la tête du
Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz et des Chœurs et solistes de Lyon
(31/8, 21H). A noter que l'Orchestre Poitou-Charente,
sous la houlette de Jean-François Heisser, donnera Des
Canyons aux étoiles, ultime œuvre pour l'orchestre de cet autre
enfant du pays, Olivier Messiaen ; l'occasion de lancer le projet artistique de
la «Maison Messiaen». Dans le domaine de la musique de chambre, en matinée, on
pourra entendre l'intégrale des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven
par François-Frédéric Guy et Xavier Phillips (23, 24/8) et l'ensemble des
sonates pour violon par le même pianiste et Tedi Papavrami (29,30, 31/8) ; comme un bouquet de sonates
violon et piano d'Ysaÿe, Canteloube, Chausson et
Franck, par Nicolas Dautricourt et Jean-Frédéric Neuburger (22/8), ou encore des pièces pour saxophone par le Quatuor « Inédits» (24/8).
Église de La Côte-Saint-André,
Cour du Château Louis XI, et autres lieux, du 21 au 31 août 2014, à 17 H et 21
H.
Renseignements et location :
Billetterie du festival Berlioz - AIDA, 38, place de la Halle, 38260 La
Côte-Saint-André ; par tel. : 04 72 20 20 79 ; en ligne : billetterie@aida38.fr
12 / 9 au 5 / 10
Ambronay célèbre
son 35 ème festival

Une nouvelle direction et de nouvelles
orientations ne feront pas dévier de sa ligne d'offres toujours aussi
alléchantes le festival d'Ambronay, la manifestation
baroque incontournable de la fin de l'été. Pour cette saison anniversaire, on a
fait choix de célébrer plusieurs thématiques. Et d'abord, les musiciens dont on
fête en 2014 les anniversaires, tels Jean-Philippe Rameau, bien sûr, et CPE.
Bach, mais aussi Jean-Marie Leclair, Pietro Locatelli, Niccolò Jommeli. Plusieurs œuvres emblématiques du répertoire
sacré, après celui de l'opéra, résonneront avantageusement sous les voûtes de
l'abbatiale : La Passion selon Saint Jean de JS. Bach (Le Concert
étranger, dir. Itay Jedlin, 19/9 20H30), Israël en Égypte de Haendel (Le
Concert lorrain, dir. Roy Goodman, 21/9 17H), le Dixit Dominus de Haendel et le Beatus Vir de
Jommelli (27/9 20H30), les Leçons de Ténèbres de Scarlatti, avec en
complément le Miserere de Thierry Pécou ( 27/9,
22H30), le Requiem de Mozart et le concerto pour clarinette, dans des
interprétations de référence dues à Leonardo García Alarcón (2 et 3/10, 20H, à l'Auditorium de
Lyon), les grands Motets de Rameau et de Mondonville par les Arts Florissants
et William Christie (4/10, 20H30), enfin un concert de cantates des trois Bach,
le Cantor, le fils CPE, et l'oncle Johann Christoph (5/10, 17H). Leonardo García Alarcón, désormais artiste associé, aura ouvert le
festival par une production originale, « Amore siciliano », proposant des madrigaux de Scarlatti et
de Gesualdo et des mélodies traditionnelles siciliennes (12/9, 20H30). Fêtes et
musiques du monde, sous le chapiteau, relooké pour l'occasion en une forme
carrée, promettent des rencontres insolites (jazz et baroque) et des spectacles
pour la famille.
Enfin ce millésime voit l'inauguration d'un
festival dans le festival, consacré aux jeunes ensembles émergents européens de
musique ancienne : eeemerging (Emerging European Ensembles), qui
aux côtés du CCR d'Ambronay, réunit huit co-organisateurs à travers l'Europe. Le 4 septembre, quatre
ensembles en résidence feront ainsi revivre l'incroyable vitalité de la musique
baroque en Europe. La musique instrumentale ne sera pas en reste : Enrico Onofri et l'Ensemble Imaginarium (Vivaldi, Marini, Jannequin, Biber, 20/9, 20H30),
l'Ensemble Les Surprises et son programme fétiche « Rebel de père en
fils » (25/9, 20H30), Jordi Savall et son Hespèrion XXI dans des œuvres de Dowland, Gibbons, Schein,
Guerrero, Purcell (26/9, 20H30), Fabio Biondi et
Europa Galante ou « le violon virtuose » (Leclair, Vivaldi,
Locatelli, Corelli (3/10 à 20H30, au Monastère de Brou). Durant quatre longs week end, Ambronay sera comme
toujours le pourvoyeur des musiques les plus diverses et de bien des talents.
Centre culturel de rencontre d'Ambronay, Place de l'Abbaye, 01500 Ambronay,
les WE des 12 au 14 septembre, 18 au 21 septembre, 25 au 28 septembre, et 2 au
5 octobre 2014.
Renseignements et Location : Service
location, Place de l'Abbaye, BP 3, 01500 Ambronay ;
par tel. : 04 74 38 74 04 ; en ligne : contact@ambronay.org ou www.ambronay.org
Jean-Pierre Robert.
***
L'ARTICLE DU MOIS
JEAN-PHILIPPE
RAMEAU
ET
LA « FÊTE DU SOLEIL » des INDES GALANTES
Au sein de la deuxième entrée, « Les Incas du Pérou », de
l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau Les
Indes Galantes, la « Fête du Soleil » constitue un véritable ensemble,
d’une grande unité. Avant d’examiner ce magnifique extrait, il parait opportun
de retracer les grands traits de la vie de Rameau afin de replacer l’œuvre dans
son contexte.
L’AUTEUR
Sa
vie :
-
25 septembre 1683 : Naissance à Dijon de
Jean-Philippe Rameau, 7ème enfant de Jean Rameau, organiste en titre de la
cathédrale St Étienne, et de Claudine de Martinecourt,
qui eurent 11 enfants en 20 ans. Sa mère est musicienne aussi et l’enfant
apprit ses notes avant ses lettres ; son frère Claude fut également musicien
(père du fameux « Neveu de Rameau » illustré par Diderot)
-
Jean-Philippe fait ses études au Collège
des Jésuites. Ses études générales sont médiocres, il passe son temps à chanter
ou écrire de la musique sur ses livres ou ceux de ses condisciples (son
camarade ne pleure pas en mesure !, dit-il) Il ne dépasse pas la 4ème.
Son niveau est bon en latin, mais mauvais en français. Une anecdote raconte
qu’il écrit vers 18 ans des lettres d’amour « criblées de fautes » à
une jeune veuve !
-
1701 – Après avoir étudié dans son enfance
le clavecin, le violon, l’orgue et la composition, son père l'envoie en Italie
oublier cet amour impossible (et le perfectionner dans son art). Il ne dépasse
pas Milan et revient en jouant du violon dans une troupe nomade. Il suit cette
troupe en France et donne des concerts d’orgue à Marseille, Lyon, Nîmes, Albi,
Montpellier. Là, il apprend d'un maître obscur, Lacroix, la fameuse « règle d'octave », sorte de
recette empirique pour l’accompagnement.
-
1702 – Il est organiste à Avignon (N.D. des
Doms), mais quitte ce poste au retour du titulaire.
-
Mai 1702 – Il signe un contrat de 6 ans
comme organiste à Clermont. Mais ce contrat lui pèse et l’empêche de se
consacrer à ses travaux.
-
On raconte l’incident d’un vacarme
déclenché à dessein dans les orgues devant l’Évêque qui lui rend sa liberté et
le recommande à Paris (l'anecdote est contestée, car elle est aussi attribuée à
Claude Rameau, à Dijon).
-
Rameau a alors écrit ses premières cantates
: Médée, L’Absence, et le Premier Livre de pièces de Clavecin
(terminé à Paris).
-
Juin 1706 – Il s’installe à Paris et
travaille avec l'organiste Louis Marchand. Il est organiste chez les Pères de
la Mercy et les Jésuites du collège de Clermont, rue Saint Jacques. Il fait paraître son Premier Livre de Pièces de Clavecin
(débutant par un très beau Prélude non mesuré).
Il travaille dans des
traités de Zarlino et de Mersenne, illustres théoriciens
anciens, et bien qu’ayant été reçu premier au concours, n’accepte pas les
orgues de Sainte Madeleine en la Cité, car le service est trop absorbant.
-
1709 – De retour à Dijon, il succède à son
père aux orgues de l’Église Notre-Dame qu’il quittera bientôt.
-
1713 – Il devient alors Maître-organiste
aux Jacobins de Lyon, mais quittera ce poste en 1715 au mariage de son frère
Claude dont il courtisait aussi la fiancée.
(!)
-
1714 – Mort de son père, Jean Rameau – Il
écrit à cette époque ses premiers motets et des cantates : Thétis (1715), Aquilon et Orithie (1715).
-
1715 (?) – Retour à Clermont où il sera un
« grand et digne organiste » et où il va élaborer son traité
d'harmonie. Compose le motet Laboravi en 1722.
-
1722 – Parution du Traité de l’Harmonie
réduite à ses principes naturels. (« La musique est une science qui doit
avoir des règles certaines »). Il y fixe les principes de l'harmonie
moderne. Ce traité est suivi de nombreux articles qui développent ses
doctrines.
Plan du traité : 4 parties :
ž
Rapport
des sons et des proportions harmoniques.
ž
Nature
et propriété des accords.
ž
Principes
de composition.
ž
Principes
d'accompagnement.
-
1723 – Il se fixe à Paris.
-
1724 - Second Livre de Pièces de Clavecin
suivi d'un complément didactique sur La Méchanique des doigts.
-
1725 – Exhibition au théâtre italien, de sauvages caraïbes (écrit des airs de
danses à cette occasion qui deviendront sa pièce de clavecin Les Sauvages).
-
25 février 1726 – Se marie à 43 ans avec
une jeune fille de 19 ans, Marie-Louise Mangot, gentille, douce, aimable,
musicienne et dotée d'une jolie voix. Le ménage fut heureux : ils eurent 3
enfants.
-
1726 – Écrit des farces pour la Foire
St-Germain (L’Enrôlement d’Arlequin).
-
1727 – Il concourt pour l’orgue de St Paul,
mais est vaincu par Daquin ; il en veut à
Marchand qu'il rend responsable de son échec.
Il se sent alors attiré
par le théâtre et écrit à un librettiste célèbre, Houdar de la Motte qui ne lui répond pas (Rameau dit entre autres dans sa lettre
« qu'il cache l'art par l'art »).
-
1728 – Écrit la cantate Le Berger Fidèle.
Rencontre Monsieur de La Pouplinière, riche financier qui va devenir son mécène. Les
Rameau habitent chez lui, soit à Passy, soit à Paris et Rameau a à sa
disposition un théâtre, un orchestre, un orgue. Il a alors de nombreux élèves.
-
1731 – Présenté à Voltaire avec qui il veut
écrire un opéra biblique Samson. Ce projet n'aboutit pas à cause du refus des
Jésuites qui n’admettent pas la position anti-religieuse de Voltaire.
La Pouplinière le présente alors à l'abbé Pellegrin, librettiste d'une Jephté, musique
de Michel Pignolet de Montéclair, qui avait beaucoup
intéressé Rameau. Leur collaboration aboutit cette fois à la tragédie-lyrique Hippolyte
et Aricie, première grande œuvre dramatique de
Rameau, âgé de 50 ans.
-
1er octobre 1733 – Première d'Hippolyte
et Aricie à l’Opéra. L'accueil du public est
mitigé et déclenche la « Querelle des Lullystes et des Ramistes ».
On reproche à Rameau d'écrire une musique trop compliquée et trop savante.
Rameau, découragé, veut abandonner, mais sans doute fut-il réconforté par
l'avis de Campra qui aurait dit : « Il y a dans cet opéra plus de musique
que dans dix des nôtres. Il nous éclipsera tous ».
-
1735 — Les Indes Galantes,
opéra-ballet (ou ballet héroïque) sur un livret de Fuzelier.
-
1737 – Génération harmonique ou Traité de
Musique théorique et pratique.
-
24 Octobre 1737 – Castor et Pollux (tragédie-lyrique sur un livret de
Gentil-Bernard) ; déchaînement nouveau des Lullystes.
-
Rameau ouvre son école de Composition où
« il réunit trois fois par semaine de 3 à 5 heures, douze élèves qui lui
donneront 20 francs par mois ».
-
1739 — Rameau compose alors Les
Fêtes d’Hébé (opéra-ballet), puis Dardanus (tragédie-lyrique, sur un livret de Leclerc
de la Bruyère) qui ravive la querelle des Lullystes et des Ramistes.
Pourtant, le public se presse en foule aux 26 représentations successives. (En
1760, reprise triomphale de Dardanus.)
-
1741 – Publication des Pièces de clavecin
en concert, et des Six concerts transcrits en sextuor (d’après ces derniers).
-
23 février 1745 – La Princesse de
Navarre (comédie-ballet sur un livret de Voltaire) (commande pour le
mariage du Dauphin avec l’Infante Marie-Thérèse). Rameau obtient alors les
faveurs du Roi qui lui accorde une pension de 2 000 livres.
-
31 mars 1745 – Platée (comédie-lyrique sur un livret de Autreau) ; son côté
bouffon déplait à la Cour.
-
Le Temple de la Gloire (Fête
en 3 actes, sur un livret de Voltaire).
-
Les Fêtes de Polymnie (opéra-ballet, sur un
livret de Cahuzac).
-
Les Fêtes de Ramire (opéra-ballet sur un livret de Voltaire).
-
1748 – Zaïs (Ballet), Pygmalion (Ballet), Les Surprises de l’Amour (Ballet).
-
1749 – Naïs (Opéra) et le 5 décembre
1749, Zoroastre (tragédie-lyrique sur un livret de Cahuzac).
-
1750 – Démonstration du principe de
l’harmonie qui reçoit l’approbation de l’Académie, ce qui lui vaut une nouvelle
pension du Roi.
-
1751 – La Guirlande (ballet sur un
livret de Marmontel), qui fait suite aux Indes Galantes – Acanthe et Céphise (Pastorale héroïque)
-
1752 – Nouvelles réflexions sur le Traité
d'Harmonie auxquelles d’Alembert répond par un magnifique hommage aux théories
de Rameau, dans un article célèbre.

Portrait
de Jean-Philippe Rameau par Joseph Aved
(Musée des Beaux-Arts Dijon) / DR
-
Août 1752 – Représentation à Paris de la Serva Padrona de
l'italien Pergolèse, qui déclenche la « Querelle des Bouffons »,
opposant les partisans de la musique italienne à ceux de la musique française.
Cette querelle fut fomentée par Grimm, Diderot et J.J. Rousseau, partisans de
la musique italienne.
-
Octobre 1752 – Représentation à
Fontainebleau devant la Cour, partagée aussi en 2 clans, du Devin du Village de J.J. Rousseau qui se pique de composition musicale et de connaissances en
musique. Rameau ne prend pas part à cette querelle, bien que ses œuvres y
soient mises en cause.
-
1753-1754 – Il écrit 5 courtes œuvres
(pastorale et ballets). Il sent venir en lui le déclin, la fatigue, la
vieillesse. Il retrouve pourtant des forces pour combattre ses détracteurs
(Rousseau, par exemple qui a écrit des articles contre lui dans l’Encyclopédie)
et il publie une brochure :
-
1754 – Erreurs sur la Musique dans
l’Encyclopédie.
-
1756 – Riposte de d'Alembert qui persifle
Rameau ; discussions, polémiques.
-
1757 – Compose 2 petits actes et mûrit le
plan d‘un important ouvrage théorique : Méthode pour apprendre la musique même
à des aveugles.
-
1760 – Les Paladins (Opéra) qui a
peu de succès. Rameau sait reconnaître le déclin de ses facultés créatrices :
« de jour en jour, j'acquiers du goût, mais je n'ai plus de génie ».(1)
-
1760 – Ovation à l'Opéra (lors de la
reprise de Dardanus). Le Roi veut le décorer
de l'Ordre de St Michel et l’anoblir, mais Rameau meurt avant.
-
1762 – Lettre aux philosophes, concernant
les corps sonores (dernier écrit théorique).
-
1764 – Abaris ou Les Boréades (Tragédie-lyrique en 5 actes),
mise en répétition à l'Opéra, mais jamais représentée de son vivant. (2)
-
23 Août 1764 – Rameau tombe malade (fièvre
et scorbut).
-
12 septembre 1764 - Mort de Rameau. Cette
mort est considérée à l'époque comme un deuil national. De nombreuses
manifestations musicales à sa mémoire sont organisées dans plusieurs villes. Il
est enterré à St Eustache, près de Lully.
Ses œuvres :
(on trouvera le détail des principales œuvres dans la biographie qui précède)
-
I – Œuvres théoriques : Une vingtaine
d’écrits dont son Traité de l’Harmonie réduite à ses Principes
Naturels (1722)
-
II – Œuvres musicales :
1)
Musique
de clavecin (3 Livres de Pièces de Clavecin (1706 - 1724 - 1731) dont le second
est suivi de la Méthode pour la Méchanique des
doigts.
2)
Musique
instrumentale : 5 Pièces de clavecin en Concert et 6 Concerts en sextuor
(les 5 mêmes œuvres, suivies d’un dernier Concert, datant de 1741)
3)
Musique dramatique :
a)
10
cantates environ (1702 - 1727)
b)
Environ
30 ouvrages dramatiques.
Dans cet ensemble, on
relève entre autres 5 tragédies-lyriques et 6 opéras-ballets, ou
ballets-héroïques auxquels s’ajoutent des ballets, des Pastorales, des Pastorales
héroïques, des comédies-ballets…
4)
Musique religieuse : 6 motets (pour
solistes, chœurs et orchestre).
Notons que Rameau,
organiste notoire, ne nous a pas laissé de musique d’orgue. On pense qu’il
devait improviser à ses claviers, lorsqu’il n’exécutait pas des pièces
anciennes ou contemporaines. Mais ses fonctions principales d’organiste
consistaient bien sûr à accompagner et à commenter les prières liturgiques des
principaux offices.
Deux éditions monumentales des œuvres complètes de
Rameau ont été entreprises :
-
Le première, chez Durand, sous la direction
de Saint-Saëns dès 1895 et à laquelle participèrent entre autres Vincent
d’Indy, Paul Dukas, Alexandre Guilmant, Claude Debussy, Maurice Emmanuel…
-
La seconde est en cours actuellement chez Billaudot puis Bärenreiter : Rameau opera omnia,
sous la direction de Sylvie Bouissou.
L’ŒUVRE
Les Indes Galantes sont un opéra-ballet ;
pourtant cette œuvre fut représentée pour la première fois le 23 Août 1735 à
l’Opéra de Paris sous le titre de Ballet-héroïque en trois entrées et
un Prologue. La 4ème entrée, « Les Sauvages », fut ajoutée pour la
reprise de 1736 sous le nom de Nouvelle Entrée. La raison en est que le public
aimait la pièce de clavecin du même nom, inspirée à Rameau en 1725 (nous
l’avons dit) par une exhibition d’Indiens Caraïbes (pour laquelle il avait
écrit quelques « airs » dansés, imités de la musique originale(?) des
Indiens).
La forme :
« L’opéra-ballet est
un opéra en forme de ballet » disait Paul-Marie Masson. À l’opéra, que son
créateur J.B. Lully en France, nommait «tragédie-lyrique », il
emprunte :
a)
La structure :
ž
Ouverture
d’orchestre « à la française », formée des mouvements lent-vif-lent.
ž
Prologue.
ž
Un
certain nombre d’actes (appelés ici « Entrées »).
ž
Une
chaconne, danse lente formée de variations, exécutée tantôt au cours de
l’action, tantôt à la fin de l’œuvre.
b)
Les éléments :
ž
Le
récitatif (sorte de déclamation chantée, proche de la parole, accompagné à la
basse continue). Le récitatif fait progresser l'action.
ž
L’air, plus mélodique et chantant,
accompagné par l'orchestre, il est souvent de coupe ternaire (l’air est dit
alors « a da capo » (a-b-a) ou « en rondeau » en France,
formé de couplets et refrains).
ž
Les ensembles vocaux, chantés par plusieurs
solistes. Lorsqu’ils sont d'accord, l’ensemble est dit « unanime ».
Lorsque leurs avis sont différents, l'ensemble est dit « divergent ».
ž
Les
chœurs.
ž
Les symphonies ou passages d’orchestre
(ouverture, symphonies guerrières, symphonies de sommeil et surtout symphonies
de danse).
Au ballet il emprunte son rôle essentiel : la
danse, qui revêt ici deux aspects :
- La pantomime, sorte de théâtre muet où la musique qui
à elle seule « peut tout exprimer » s’adjoint à la mimique des
danseurs.
- Les danses traditionnelles de l’époque (menuets, gavottes,
bourrées, sans oublier la traditionnelle chaconne) de rythme et structure
propres à chacune.
Enfin, dans l’opéra-ballet, les Entrées ont une action
indépendante les unes des autres.
Histoire de l’Opéra-ballet :
Le créateur de la forme
est André Campra (1660 – 1744) qui écrit L’Europe Galante en 1697. Après lui, nous avons, entre
autres, Les Sens et Les Grâces de Jean-Joseph Mouret, ainsi que Les
Éléments de André Cardinal Destouches. Rameau en
écrira six, sans compter les ballets et autres formes voisines.

DR
PLAN ET ANALYSE
Les Indes Galantes,
opéra-ballet héroïque, représenté pour la première fois à l'Opéra le 23 Août
1735, sur des paroles de Louis Fuzelier, comporte une
Ouverture, un Prologue et 4 Entrées aux actions indépendantes.
-
L’ouverture a la forme à la Française
(lent-vif-lent).
-
Dans le Prologue, nous assistons aux fêtes
qu’Hébé, déesse de la jeunesse, donne, dans ses jardins enchantés, aux jeunes
gens et jeunes filles des quatre nations alliées européennes (France, Italie,
Espagne, Pologne). Le caractère pastoral de ces réjouissances est souligné par
l’emprunt à l’instrument traditionnel des bergers, la musette. Cette petite
cornemuse de salon, très en vogue au XVIIIème siècle, accompagne ici un air
d’Hébé « Musettes résonnez », un chœur et une Musette en rondeau ;
mais ces innocentes festivités sont troublées et interrompues par l’arrivée de
Bellone, déesse de la guerre ; elle entraîne à sa suite tous les garçons
présents. Hébé, furieuse, appelle à l’aide l’Amour, dont l’intervention reste
sans effet : la guerre l’emporte ! Les Amours n’ont donc plus rien à faire
en Europe ; ils décident alors d’émigrer aux Indes pour y exercer leurs
tendres activités.
Ce prologue est donc le
seul lien, bien ténu, qui rattache les quatre Entrées les unes aux autres. (Rappelons qu’au XVIIIème siècle on avait un goût très vif
pour les pays exotiques : l’Amérique et l’Asie étaient baptisées
« Indes »).
Suivent alors les quatre Entrées consistant le corps de
l’œuvre.
-
Dans la première Entrée : « Le Turc
Généreux », nous assistons aux aventures d'une jeune esclave provençale
Émilie, prisonnière du sultan Osman. Son fiancé, Valère, vient la délivrer.
Osman leur fait grâce et les laisse partir, en souvenir d’un acte de générosité
de Valère à son égard, autrefois. Des fêtes et des danses célèbrent cet heureux
dénouement.
-
La deuxième Entrée : « Les Incas du
Pérou » est la plus dramatique. Le Grand Prêtre du Soleil, Huascar, s'apprête à célébrer, dans les temples dévastés
par les Conquistadors, le culte du Soleil. Mais il veut profiter de cette
grande fête pour convaincre la jeune fille qu’il aime, Phani (qui lui préfère l'officier espagnol Carlos), que les Dieux sont irrités de ce
choix. Pour cela, il provoquera une éruption factice
du volcan. Seulement, la nature se venge, et c’est un véritable cataclysme qui
se déclenche : un tremblement de terre engloutit Huascar, tandis
que tout le monde s’enfuit.
-
La troisième Entrée : « Les
Fleurs », Fête Persane, nous fait assister à un aimable chassé-croisé de
deux couples d’amoureux qui se prennent les uns pour les autres, grâce à des
déguisements. Finalement tout s'arrange et la Fête des Fleurs peut déployer
tous ses charmes (costumes et danses ravissants).
-
La Nouvelle Entrée, ajoutée lors de la
reprise, intitulée « Les Sauvages » se situe en Amérique. Une jeune
« Sauvagesse », Zima, est courtisée par un français, Damon, et par un
Espagnol, Alvar. Chacun vante la façon d’aimer de son pays, mais Zima leur
préfère Adario, un « Sauvage » de sa tribu.
L'Entrée se termine par La Danse du Grand Calumet de la Paix (repris de la
Pièce de clavecin Les Sauvages de 1725). Duo et chœur sur cette danse, prétexte
à de grandes réjouissances.
L’œuvre entière se termine par une très belle chaconne,
formée de 10 variations et dans laquelle le courant guerrier et le courant
pastoral alternent.
LA FÊTE DU SOLEIL
Elle forme l’ensemble de la scène V de la 2ème entrée,
« Les Incas du Pérou », et réalise à l’intérieur de cette entrée un
tout homogène (malgré les différents épisodes), sans doute dû au fait que la
majorité des morceaux sont dans le même ton (la majeur ou mineur). Elle ne
comporte pas de récitatif, mais 4 Airs de Huascar (dont 2 soulignés par un chœur), 5 danses (dont 2 de pantomime pour le culte du
soleil et 3 sur des rythmes de danses traditionnelles), une Symphonie
descriptive pour le Tremblement de Terre et un superbe chœur décrivant le
cataclysme.
1)
Air
de Huascar : « Soleil, on a détruit tes
superbes asiles, Il ne te reste plus de temple que nos cœurs ».

Ce premier air de
caractère recueilli et grave est déjà sur le chemin du grand récitatif d’opéra.
Il a la forme « a da capo » et est en la mineur. La partie A débute par un prélude d’orchestre qui annonce toute la
mélodie. Elle s’ouvre sur une sorte d'appel sur la dominante (mi, mi) auquel
répondra à l'octave grave 3 mi suivis de la tonique la. La voix reprendra cet
appel à découvert sur le mot « Soleil ». Une conclusion d'orchestre
termine ce 1er volet. La partie B débute au relatif, do majeur (insistance sur
cette note répétée six fois : « Daigne nous écouter »), puis module
en sol majeur puis en mi majeur, dominante de la pour redire le 1er volet au da
capo, intégralement. Remarquons, dans ce 2ème volet, l'écho orchestral en canon
de la phrase « Déserts tranquilles ».
2)
Prélude pour l'adoration du soleil :
« Les Pallas et Incas font leur adoration au Soleil ».
C'est une danse de
pantomime religieuse à 2/2, en la mineur, jouée « gravement ». On peut y déterminer 4 parties :
- Les intervalles de 4te, répondent aux 5tes dans un style d'imitations
serrées à 5 voix (écriture savante et très riche), repos à la
dominante mi.

-
Dialogue entre les bois (en 3ce) et les cordes, évoquant des saluts, des
révérences, repris 2 fois.
- Quatre marches d'harmonie à la basse avec réponses contrepointiques
des autres voix, aboutissant à une cadence parfaite puis à un repos à la
dominante.
- Une
gamme ascendante en rythme pointé de la flûte conclut cette première pantomime.
3)
Air
de Huascar et chœur : « Brillant
Soleil ».

C’est une vaste invocation
au Soleil, pleine d’autorité et d’énergie à laquelle le peuple des fidèles mêle
sa voix. Au point de vue musical, trois éléments vocaux seront utilisés, soit
isolément, soit superposés : Les appels sur « Brillant Soleil »
au rythme énergique, puis des gammes descendantes sur « N’ont vu tomber de
noirs frimas » (figuralisme), enfin des vocalises plus ou moins
développées sur « Répands » (encore le figuralisme)
L’Air,
« animé », en la majeur, à 2/2, débute par des appels par la voix à
découvert sur les notes du 2ème renversement de l’accord parfait de la
« Brillant Soleil » auxquels l’orchestre répond par une fanfare très
rapide en rythme pointé sur les notes de l’accord parfait.

Deux gammes descendantes
commençant l’une par mi, dominante, l’autre par la, tonique, évoquent la chute des frimas. Arrêt, après un
rappel orchestral, sur la tonique la. Puis apparition de la vocalise sur
« Répands » et modulation vers la dominante, mi majeur. Cadence
parfaite en mi. (notons les interventions fréquentes
du thème de fanfare à l’orchestre pour ponctuer les diverses fins de phrase.)
La vocalise « Répands » s’amplifie, tandis que nous revenons au ton
principal de la. La voix s’appuie sur mi, dominante, sur les mots « ta
plus éclatante lumière », et conclut par une solennelle cadence parfaite à laquelle fait suite la fanfare orchestrale et une
gamme descendante en fusée.
Le Chœur est une reprise
amplifiée et modifiée de l’air. On peut y voir quatre parties, avec toujours
les trois mêmes éléments, ponctués de la fanfare orchestrale.
A – a) Les appels donnés
par les soprani sont repris par le reste du chœur et suivis par les gammes
modifiées.
b) La vocalise, différente
elle aussi, module tout de suite en mi. Cadence en mi, suivie de la fanfare
orchestrale et de la gamme-fusée descendante.
B – Passage central modulant :
a) L’appel en la, est
repris au relatif fa# mineur, suivi de la gamme descendante (tomber). Cadence
en fa# mineur.
b) Dans la vocalise qui
suit, intervient une modulation en si mineur. Cadence en si mineur.
C – a) Superposition des
deux premiers éléments : deux appels, l’un en la, l’autre en ré aux
soprani sont accompagnés par les gammes de la et de ré aux basses. Puis les alti et les ténors font entendre les appels, tandis que les
gammes sont chantées par les soprani.
b) La vocalise apparaît
ici en canon pour aboutir à une phrase conclusive homorythmique de tout le
chœur sur une cadence en la.
D – Dans cette conclusion,
tous les éléments se superposent : les appels aux alti qui tiennent une longue pédale de tonique tandis que les soprani divisées
chantent la vocalise en tierces et que les basses descendent leur gamme.
Reprise des appels par deux fois aux alti et aux
ténors, tandis que les soprani et les basses chantent la vocalise pour aboutir
sur une majestueuse cadence parfaite de tout le chœur et l’orchestre (en la majeur) sur les mots définitifs « ta plus éclatante
lumière ». Après un court rappel de la fanfare à l’orchestre, une ultime
redite de cette phrase par le chœur, syllabiquement, donne une conclusion
somptueuse à ce magnifique hommage au Dieu Soleil. L’orchestre y met le point
final avec un retour de la fanfare, suivi de la gamme descendante en fusée.

DR
4) Air des lncas pour la dévotion du Soleil – danse de Péruviens et de
Péruviennes.
Il s’agit à nouveau d’une pantomime religieuse en la majeur, de forme « suite ». La structure y
obéit presque entièrement à la carrure (succession de groupes de 4 mesures).
Elle s’exécute gravement.

A – Un premier thème A1
répétant 4 fois la tonique la aux 2 octaves sur un rythme énergique est suivi
d'un groupe martelant 4 fois la dominante. Ce premier élément de 8 mesures
s’achève sur un repos à la dominante et enchaîne sur une modification adoucie
(A2) du premier thème A1 qui amène la modulation à la
dominante mi (cadence en mi).
B – Débute sur A2 modulant
en fa# mineur ; un retour au ton initial (souligné par une cadence parfaite),
est suivi de près par une autre modulation en si mineur (cadence parfaite). Ici
la carrure se rompt. Une série d’accords se prêtant à des attitudes mène à un
arrêt à la dominante mi et à une grande cadence
rompue, suivie d’une grande cadence parfaite en la majeur.
5) Hymne au Soleil et
Chœur en rondeau : « Clair Flambeau du monde ».
Ici encore, le peuple des fidèles va mêler sa voix à celle
de Huascar, mais de façon moins majestueuse, moins
pompeuse que dans le 1er chœur. La forme rondeau est déjà plus familière. Huascar énonce seul le refrain puis les deux couplets
tandis que le chœur reprend « en rondeau » le refrain.
Cet air est « modéré », en la majeur, à 3 temps.

A – Refrain, énoncé par Huascar ; il comporte deux parties. La première
s’achève sur un repos à la dominante, la seconde sur une cadence parfaite.
Remarquons le rythme caractéristique « L’air, la terre et l’onde »
ainsi que la dissonance sur le mot « terre » (à l’accord parfait
de ré, Rameau ajoute un mi, appogiature du ré suivant).
Refrain repris par le chœur.
B – 1er couplet – il comporte 3 parties :
-
Début en fa# mineur sur un accord dissonant
analogue à celui du refrain (sur « toi ») Cadence parfaite en fa#
mineur.
-
Passage modulant en si mineur
(« Chantons-les seulement »).
-
Retour au ton de la majeur avec repos sur mi, dominante, pour enchainer sur le refrain repris par le
chœur.
C – 2ème couplet – il comporte deux parties :
-
Élan initial sur le deuxième renversement
de l’accord parfait ascendant de la, suivi par une chute (« dans une nuit
profonde ») et une modulation à la 5te inférieure, ré majeur –
« lorsque tu disparais » – (impression d’assombrissement). Cadence en
ré majeur.
-
La seconde partie ramène le ton de la dominante mi, pour enchaîner sur le refrain.
6) Loure en rondeau
À la fête religieuse succède maintenant la fête
populaire : les divertissements du peuple Inca vont commencer ici. Apparue en France au XVIème siècle, la loure
était à l’origine accompagnée par la « loure » (sorte de cornemuse ou de grande musette
normande.) Son rythme caractéristique à 6/4, exigera, lorsqu'elle sera confiée
aux instruments à cordes dans les diverses suites ou compositions ultérieures,
une accentuation spéciale sur chaque noire : ainsi naîtra le style
« louré ». Les loures garderont toujours une allure rustique ou
paysanne due à leur origine.

Le refrain de cette loure est en deux parties ainsi que les
deux autres couplets. Il est confié aux cordes et débute en fa# mineur. Son
rythme à 6/4 avait fait taxer cette pièce d' « extravagante »
par les Lullystes.
La première de ces deux parties s'achève sur une cadence
parfaite en fa# mineur (donc pas de modulation). Il en est de même pour la
deuxième.
Le 1er couplet, en la majeur est
exécuté par un ravissant trio d’anches : deux hautbois et un basson, à qui un
rôle important est dévolu : il semble gambader sur de joyeux arpèges. La 1ère
partie s'achève sur un repos à la dominante mi : la
2ème retourne au la, tonique, après un bref emprunt à ré majeur.
Le 2ème couplet, après la reprise du refrain, est confié aux
mêmes bois, traités similairement. II est en do# mineur. La 1ère partie
s’arrête sur sol#, dominante de do#, et la 2ème revient à do#, pour enchainer
une dernière fois sur le refrain, aux cordes, en fa# mineur.
7) Air de Huascar : « Permettez, Astre du
jour »
Il s’agit là d’un air gracieux et galant, en rondeau, en fa#
mineur construit sur le schéma de la loure précédente. Rameau utilise ici
l’ossature de la danse, mais va modifier l'orchestration et la réalisation. Les
3 éléments (refrain et 2 couplets) seront de structure binaire, comme la loure
et les tonalités seront aussi les mêmes. Dans cet air, Huascar demande au Soleil de permettre qu'à côté de son propre culte, on célèbre aussi
celui de l’Amour.

Le refrain, à 3/4, en fa # mineur, débute par une phrase
vocale seule, avec le rythme caractéristique de la loure, suivie d’une phrase
d’orchestre qui reprend la loure orchestrale. Après un arrêt en fa# mineur, la
2ème partie se déroule comme dans la danse.
Le 1er couplet, à 6/4, (« Le soleil, en guidant nos
pas ») est en la majeur et s’achève par une cadence en la, après un arrêt
médian à la dominante mi.
Le refrain est repris identiquement en fa # mineur, mais à
6/4 et sur d’autres paroles « Vous brillez, Astre du jour ».
Le 2ème couplet, en do # mineur diffère un peu de celui de
la loure instrumentale ; après une première partie comparable s'achevant par
une cadence en do # mineur, la 2ème partie débute par une jolie modulation, une
tendre inflexion en si mineur (« De la nuit, le voile sombre »),
suivie d’une redite de cette tendre phrase en la majeur (marche d’harmonie à la
basse). Le couplet s’achève sur un arrêt sur do #, dominante de fa #, ce qui
amène le dernier retour du refrain sur les paroles initiales.
Admirons ici le génie de Rameau qui, au cœur même de la
scène, entre les solennelles cérémonies et le déclenchement du cataclysme,
intercale ces deux pièces, dont le charme, la grâce et la tendresse, (dues en
partie à l'utilisation du doux fa # mineur), sait ménager une belle diversion.

Production
au Palais Garnier (Huascar : Laurent Naouri) / DR
8) 1ère et 2ème gavottes
La gavotte, apparue à la
fin du XVIème siècle, nous vient de la ville de Gap. Elle fut très en vogue
dans les salons. Sur un rythme binaire, on procède par petits sauts. On en trouve
de nombreux exemples dans les opéras, les ballets et les suites de danses
instrumentales (clavecin et orchestre).
Ici, deux gavottes se succèdent, la 2ème, en rondeau,
avec 2 couplets.
-
1ère gavotte, en la majeur à 2/2, se joue « gaiment ».

Elle est en deux
parties : La 1ère partie débute par les notes de l'accord parfait de la majeur et comporte deux phrases presque identiques
avec repos à la dominante. La 2ème partie, qui débute par les notes de l'accord
parfait de mi est reprise deux fois et s’achève par une cadence parfaite en la
majeur.
-
La 2ème gavotte, en rondeau, est en la mineur.
ž
Le refrain, où les cordes répondent aux
flûtes en une sorte de salut compassé, comporte deux parties presque identiques, l’une s’achevant sur un arrêt
à la dominante mi, l’autre par une cadence parfaite en
la mineur.
ž
Le 1er couplet (« 1ère
reprise »), est en do majeur et comporte 2 parties : la 1ère,
construite sur un thème formé de notes répétées 2 par 2, s'achève sur un arrêt à la dominante sol, tandis que la 2ème conclut au hautbois
par une cadence en do.
ž
Le 2ème couplet (« 2ème
reprise »), après la redite du refrain est construit sur un thème analogue
à celui du 1er couplet, mais utilise une harmonie bien plus colorée. La 1ère de
ses deux parties débute par une phrase en ré majeur, redite en do majeur
(marche d'harmonie); dans la 2ème partie, on revient au ton de mi mineur avec
arrêt sur le premier renversement de l'accord de 7ème de dominante de mi ;
puis, une formule reprise trois fois en marche ascendante par le hautbois et le
basson, conclut sur une cadence parfaite en mi mineur puis majeur pour
enchaîner sur un dernier retour du refrain.
9) Tremblement de terre
Mais … « On
danse et la fête est troublée par un tremblement de terre ».
Il débute par un prélude orchestral « nourri
d'harmonie » en fa mineur : remarquons la brusque saute de tonalité. A
trois fa graves joués d’abord « piano » (la terre tremble et frémit
dans ses fondations), vont s'adjoindre l’une après l’autre les notes du 1er
renversement de l'accord de 7ème diminuée : sol, si b, ré b, mi
bécarre ; l’orchestre s'amplifie dans un crescendo puissant jouant en
trémolos cet accord, tandis que les deux fa graves continuent de gronder. Nous
avons ici un exemple d'accord sur-tonique, très
audacieux à cette époque. Les accords se modifient, mais la tonique grave roule
toujours au bas de l'édifice harmonique créant avec les divers accords développés en traits rapides des dissonances terrifiantes.
L’orchestre contribue à évoquer le séisme : au grondement
des basses s‘adjoignent bientôt les traits stridents des petites flûtes
figurant les « vents qui se déclarent la guerre ».
Le chœur se superpose alors une première fois à la symphonie
descriptive. Les alti et basses d’abord, puis les
soprani et ténors clament une phrase descendante « Dans les abimes de la
terre ».

Ensemble, le chœur complet
achève cette première intervention, sur un arrêt à la
dominante do, syllabiquement, afin d’évoquer l’unanimité de la terreur
des assistants.
Après un silence angoissant et lourd d'inquiétude, la
symphonie reprend, car il s’agit bien sûr d’une fausse accalmie (nous
retrouverons le même procédé dans l’Orage de la Symphonie Pastorale).
« L’air s’obscurcit, le tremblement redouble, le volcan s’allume et jette
par tourbillons du feu et de la fumée ».
-
Débutant par des notes répétées
« piano » en croches, la symphonie s’amplifie dans un vaste
crescendo, les croches faisant suite à des trémolos rapides en accords sans
cesse renouvelés dans une succession très hardie. Basses chromatiques,
opposition de nuances, tout concourt à accroître le pittoresque de cette page
saisissante, qui se termine piano, puis forte par une formule
conclusive de cadence parfaite en fa mineur.
-
Au point d’aboutissement de cette cadence,
le chœur intervient à nouveau sur un rythme précipité à 6/8, chantant presque
toujours syllabiquement : « Les rochers embrasés s’élancent dans les
airs, Et portent jusqu’aux cieux les flammes des enfers ».

-
La première phrase est redite à une 3ce
supérieure. Cet effet d’ascension s’accentue avec les élans sur le mot
« cieux » qui sera tenu longuement par les soprani, sur le sol aigu
formant dissonance avec le la b des alti. Ce chœur,
bref mais saisissant, soutenu par le commentaire de l’orchestre, s’achève en
une longue cadence parfaite dans le grave (« enfers »).
-
Une conclusion d'orchestre adoucie, mais
comportant encore des sursauts de nuances d’intensité, pourvue encore de riches
harmonies, de dissonances, de chromatismes à la basse, d’enharmonie (la # – si
b) conclut de façon magistrale en fa mineur, puis majeur, ce grand déploiement
de forces déchaînées, évoquant avec elles l’épouvante des assistants et leur
fuite éperdue.
*
*
*
Dans la Fête du Soleil, superbe parenthèse au centre de
l’entrée des Incas des Indes Galantes, le génie dramatique de Rameau,
parvenu à son entière maturité, s’exprime dans toute sa plénitude. Il se
manifeste en premier lieu dans la progression expressive des airs de Huascar, passant de la gravité des regrets et de la
fidélité aux antiques croyances, aux invocations énergiques au Dieu, soulignées
par les chœurs qui les amplifient, pour en arriver enfin à des prières plus
familières. Les danses suivent aussi la même évolution, allant des évocations
de rites cérémonieux et graves à des attitudes plus simples, élégantes et
gracieuses. Mais c’est surtout dans la symphonie descriptive du Tremblement de
terre, commentée elle aussi par le chœur saisissant des assistants affolés de
terreur, que l’invention créatrice de Rameau atteint son apogée ; grâce à une
écriture orchestrale riche et colorée mais surtout grâce à des audaces
harmoniques, révolutionnaires pour l’époque, bien que toujours au service de
l’expression dramatique, Rameau signe là une page vraiment prémonitoire.
C’est en cela que l’on peut penser que l’auteur des Indes
Galantes ouvre ici la voie, en vrai précurseur, aux grandes œuvres
dramatiques à venir. Les chefs-d’œuvre de Gluck, les premiers opéras
romantiques portent à coup sûr la marque de l’héritage de Jean-Philippe Rameau.
Francine
Maillard.
(1) Pourtant,
la postérité en jugera autrement grâce à la recréation de l’œuvre pour
l’ « année Rameau » en 1983, date où John Eliot Gardiner crée les
Paladins au Festival d’Aix-en-Provence. Plus tard, en 2004, William Christie
présente à son tour l’opéra au Châtelet, puis à Londres et à Caen, avant qu’il
ne s’envole pour Shanghai et Tokyo où il connut un succès international.
(2) Elle
vit le jour, elle aussi, bien plus tard, inscrite en 1999 au programme du
Festival de Salzburg et enfin à celui de l’opéra Garnier en 2003 avec William
Christie.
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
La confusion de certains décideurs
politiques français
à l’égard des écoles et conservatoires de musique, de danse et d’art dramatique
Ces quelques lignes représentent la volonté
d’évoquer les problèmes d’un univers particulier – l’enseignement artistique
spécialisé (les écoles et conservatoires de musique, de danse et d’art
dramatique) – pour les acteurs d’un autre univers artistique, parfaitement
complémentaire, celui de l’éducation musicale (au sein de l’enseignement
général). Le présent texte s’adresse à tout lecteur intéressé par
l’enseignement artistique, mais surtout à ce qu’il est convenu d’appeler de nos
jours, en matière de système culturel, les médiateurs et les
décideur : il ambitionne de braver l’inquiétant constat qu’une grande
partie du personnel politique, tellement occupée à cimenter son empreinte dans
les médias, ne consacre pas – ou plus – de son temps à se cultiver.
Quelques
mots d’introduction
À cause du
« Yalta » historique qui sépare les mondes de l’éducation
musicale (ministère de l'Éducation Nationale) et de l’enseignement
artistique spécialisé (ministères de la Culture et,
en partie, de la fonction publique territoriale), il nous est apparu utile de
rappeler d’abord aux acteurs du premier la situation et les différents
problèmes qui frappent le second. Les propos qui suivent ne nous permettant pas
de traiter de la totalité de ces aspects en un seul article, avons-nous décidé
de nous centrer déjà sur la confusion qui marque la réflexion politique à
propos de quelques-uns de ces aspects seulement.
Un rappel : la situation française des
établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique
(l’enseignement artistique spécialisé)
À côté de l’enseignement artistique
dispensé au sein de l’enseignement général – notamment la discipline musique dénommée éducation musicale – prodigué par les 65.000 établissements de
l’Éducation nationale (écoles primaires, collèges, lycées) et ceux placés sous
la tutelle du ministère de l’Agriculture (lycées agricoles) ou au sein de
certaines universités et grandes écoles (enseignement supérieur), il existe un
autre domaine, qualifié d’enseignement artistique spécialisé, relatif à
l’enseignement de la musique (majoritaire), de la danse et de l’art dramatique,
délivré au sein d’un ensemble qui rassemble environ 4.500 établissements en
France : les écoles et conservatoires de musique. Ceux-ci ne sont bien
sûr pas à confondre avec des centres de loisirs ou des centres
d’animation ! [en cette matière, relire le texte
fondamental de Hannah Arendt : La crise de la culture (Paris, Gallimard, Folio essais, 1972, 380
p.)].
Le nombre de ces établissements
d’enseignement s’est progressivement accru à partir des années 1970, lorsque la
notion de culture est devenue une composante importante du développement
économique des collectivités locales : les responsables politiques de terrain –
notamment les maires – ont alors commencé à prendre conscience d’une forte
demande de politique(s) culturelle(s) de la part de leurs populations
administrées, constituées de classes moyennes émergentes. À la suite d’une
vague de premiers équipements (centres sociaux, crèches, cantines, gymnases,
stades…), se sont ainsi multipliés les équipements dits culturels :
centres culturels, MJC, écoles et conservatoires de musique, salles
polyvalentes, auditoriums, salles de théâtre, etc. À Paris par exemple, il a
fallu attendre la décennie 1980-1990 pour voir enfin s’édifier des locaux
spécifiques offerts aux dix-sept conservatoires municipaux d’arrondissement de
la Ville (CMA), soit près d’un siècle après la création des premiers
cours municipaux de musique (en 1900, dans le 18e arrondissement).
La rénovation, l’extension ou le renouvellement de ces locaux, qui aujourd’hui
se révèlent insuffisants ou inadaptés, commencent à se mettre très doucement en
place (2e mandature municipale du XXIe siècle :
2008-2014).
Contrairement à l’enseignement général, placé sous la tutelle directe de
l’État (des ministères de l’Éducation nationale; de l’Agriculture; de l’Enseignement
supérieur) qui le finance dans sa quasi-totalité (ses personnels – professeurs
des écoles, des collèges, des lycées, des universités – dépendent
majoritairement de la fonction publique d’État, soit pour 2013, 41 % du budget
total du ministère de l’Éducation nationale : ce qui représente, après le
remboursement de la dette, le premier poste de dépense de l’État [90 milliards
d’€]), l’enseignement artistique spécialisé reste un domaine éclaté,
essentiellement du ressort des collectivités territoriales : une grosse moitié
des établissements du domaine relève du droit privé (secteur associatif, peu ou
prou subventionné par les collectivités locales, qui se doit d’appliquer et
respecter la convention collective nationale de l’animation) ; une petite
moitié des établissements du domaine est constituée d’établissements
territoriaux (essentiellement gérés en régie directe par des communes ou par
des établissements publics de coopération intercommunale [EPCI]).
La structure polymorphe de l’enseignement artistique spécialisé est due à l’histoire même de sa constitution et de sa mise en place
progressives sur le territoire [sur l’histoire de ces établissements, consulter
l’essai de l’auteur : L’Enseignement de la musique en France ]. Vouloir
gérer ces deux domaines – enseignement
général et enseignement spécialisé – d’une semblable manière (relire pour exemple les textes réglementaires
produits par le ministère de la Culture) en laissant ces spécificités
fondamentales de côté, restera voué à l’échec.
Pour clore cette introduction, précisons que les
appellations école de musique ou bien conservatoire de musique,
qui semblent traduire des structures différentes, ne délimitent en fait aucune
différence et n’ont aucun fondement juridique particulier, hormis depuis 2006 [arrêté du 15 décembre 2006, J.O. du 29 décembre 2006, fixant les critères du
classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse
et de l’art dramatique] pour les quelque 300 établissements dits « classés par
l’État », qui utilisent les sigles CRR, CRD, CRC ou CRI. Pour la clarté de l’exposé, rappelons la signification de ces sigles
: CRR (conservatoire à rayonnement régional, anciennement conservatoire
national de région) ; CRD (conservatoire à rayonnement
départemental, anciennement école nationale de musique de danse et d’art
dramatique) ; CRC (conservatoire à rayonnement communal,
anciennement école ou conservatoire municipal) ; CRI (conservatoire
à rayonnement intercommunal, anciennement école intercommunale de musique,
de danse et d’art dramatique) (en soulignant qu’il s’agit d’établissements
qui demeurent malgré tout financés en quasi-totalité par des collectivités
territoriales). De plus, le recours à l’une ou l’autre de ces
appellations – école ou conservatoire – diffère selon des usages
locaux, suivant que l’on se trouve dans la région parisienne – ou sa banlieue –
ou que l’on réside en province.
I. - Les établissements d’enseignement de
la musique, de la danse et de l’art dramatique : leurs maux
Pour une commune ou un EPCI, son école de musique ou son conservatoire de musique représente
le premier poste – ou l’un des tout premiers postes – de dépense budgétaire. De
ce fait, ne nous étonnons pas que ces établissements spécialisés attirent les
regards et concentrent sur eux l’attention des décideurs politiques, car ils
leur procurent à tout le moins quelques préoccupations. En effet,
indépendamment d’un budget d’investissement non négligeable
(construction du bâtiment ou mise à disposition de locaux [le cas échéant],
achat d’instruments de musique divers [pianos, percussions, contrebasses…], de
matériels pédagogiques, de musique imprimée [partitions, manuels et méthodes,
partitions d’orchestre et d’ensembles instrumentaux], de livres,
d’enregistrements audio/vidéo [CD, DVD]…), le budget de
fonctionnement d’une école ou d’un conservatoire de musique se trouve
affecté d’un accroissement régulier et inéluctable, ce pour au-moins deux
raisons :
·
Le
salaire des enseignants – part la plus importante du fonctionnement – subit une
revalorisation mécanique (suivant en cela les évolutions fixées soit par la
convention collective de l’animation [droit privé], soit par les barèmes des
carrières de la fonction publique territoriale [droit public], fonction du GVT : glissement vieillissement technicité)
;
·
Les
élèves se doivent de recevoir un temps d’enseignement alloué qui augmente
fatalement en fonction de leur progression dans le cursus (temps des cours
individuels rallongé ; rajout de plusieurs disciplines théoriques et collectives
[écriture, culture musicale, orchestres, ensembles vocaux ou instrumentaux,
musique de chambre, improvisation, MAO…]).
Il faut aussi se rendre compte qu’une
augmentation du nombre d’élèves débutants pour bénéficier à court terme d’une
masse financière plus importante constituée de leurs frais de scolarité (droits
d’inscription acquittés par les familles), ne sera en aucun cas une solution
puisque ce plus de recrutement en début de cursus ne fera que faire refluer le
problème dans le temps, en encourageant à terme une augmentation différée mais
fatale du budget de fonctionnement de l’établissement, non compensée par les
départs des plus grands élèves.
Face au constat de l’accroissement
inévitable du poids financier d’une école ou d’un conservatoire de musique,
qu’advient-il alors inévitablement : le(s)
responsable(s) politique(s) – quelle que soit son (leur) orientation – se sent(ent) subséquemment investi(s)
d’une mission de réforme ou de réorganisation de son (leur) établissement local.
Et c’est là que le bât va blesser, puisque, à partir de ce moment, la
structuration pédagogique de l’établissement va presque toujours endurer des
considérations et/ou des contraintes sérieuses, qui lui seront extérieures,
formulées et impulsées par des décideurs qui ne connaissent pas grand-chose aux
exigences pédagogiques de l’enseignement artistique spécialisé, habités qu’ils
sont de représentations mentales en général assez éloignées de la réalité. Au
mieux, ces décideurs accepteront-ils peut-être de prendre l’avis de leurs
équipes enseignantes (au minimum celui du directeur ou du responsable
coordinateur).
Les conséquences de cette prise de
conscience se retrouveront presque toujours les mêmes et ouvriront
inlassablement sur les quelques éternelles questions vite posées. Ainsi,
puisque le responsable politique constate qu’entretenir un tel établissement
revient « toujours trop cher », il se dit in petto ou bien déclare haut et fort :
·
« Quel
est le retour sur investissement du
financement par notre collectivité d’une école ou un conservatoire de
musique » ? À combien revient un élève ; Faire préciser à l’établissement quelle est son ouverture
réelle sur la cité ; Voir s’il poursuit bien la réalisation
d’un projet d’établissement cohérent.
·
« L’établissement
ne prodiguerait-il pas un enseignement élitiste, qui ne serait donc pas
en phase avec notre volonté politique de démocratisation culturelle » ? Ne
pourrait-on pas multiplier les cours collectifs en chargeant leurs effectifs
d’élèves, car ces cours sont moins onéreux et donc plus rentables ? D’autant que, d’après les textes officiels du
ministère de la Culture (« source » qui, dans ce cas, est
immanquablement appelée en secours !), la mission première de ces
établissements serait de former des amateurs ?
·
« L’enseignement
prodigué par l’école ou le conservatoire de musique est-il réellement en prise
directe avec notre époque ou ne reste-t-il pas trop conservateur »
? L’établissement ne peut-il avoir davantage recours au numérique à tous les niveaux pour réduire et limiter le nombre d’enseignants ?
Ne peut-on pas développer, dans une plus grande proportion, l’accès
aux musiques actuelles, aux
musiques extra-européennes, aux autres cultures communautaires ?
·
« Les
enseignants (musiciens, danseurs, comédiens) ne bénéficient-ils pas d’un statut
dérogatoire par trop avantageux (16 heures d’enseignement pour les professeurs
territoriaux, 20 heures pour les assistants territoriaux) » ?
Ne pourrait-on pas les utiliser davantage (comprendre hors du légendaire
« face à face pédagogique »(1)) ?
·
etc.
II.
- Les confusions des politiques : quelques propositions pour les réduire.
Passons en revue quelques-unes des
réflexions – ces quasi-réflexes ? – politiques rappelées ci-dessus, que nous ne
manquons pas de continuer à rencontrer aujourd’hui un peu partout en France
(mais depuis presque une trentaine d’années maintenant !), peut-être à
cause – mais pas seulement – des effets de la « crise », et
n’hésitons pas à en commenter certains, en espérant que nos remarques pourront,
un tant soit peu et en toute humilité, éclairer – ou, à tout le moins, faire
réfléchir – quelques-uns des décideurs politiques (élus municipaux ou
associatifs) encore enfoncés dans une certaine confusion, et qui accepteraient
d’examiner d’une manière un peu plus juste ces différents éléments.
La
confusion en matière de « retour sur investissement »
Il va de soi que les investissements
réalisés en matière de culture doivent faire l’objet de deux considérations
parallèles, l’une sociale, l’autre économique.
·
L’investissement social doit être regardé
à l’aune de son impact indirect, mais fondamental, sur les citoyens. Comme le
rappelle si bien Pierre Moulinier,
« A la
décharge des responsables des politiques culturelles nationales ou locale, rappelons
que […] l’impact majeur d’une action culturelle est immatériel,
qualitatif et, s’il y en a un, il est indirect. Travailler au développement
culturel, c’est œuvrer pour l’expansion de la beauté, de l’intelligence, de la
créativité artistique, de l’agrément de la vie, pour le mieux-être, le
renforcement de l’identité personnelle et collective, le développement du sens
critique ou de la participation citoyenne » [Pierre Moulinier, Les politiques publiques de la culture en France, Paris, P.U.F.,
« Que sais-je » 3427, 1999, 128 p., p. 105.].
·
L’investissement
économique doit être évalué au moyen d’outils adaptés, par exemple grâce à
l’analyse d’impact économique en matière d’action culturelle (technique
économique développée à partir des années 2000 en Amérique du Nord et encore
peu connue ou peu maîtrisée en France) : cette démarche permettra d’évaluer ce
que « rapporte » réellement l’investissement d’un euro de la part du financeur-décideur d’un projet culturel sur
un territoire donné (1,10 € ? 1,20 € ? 1,50 € ?…)
[consulter notamment de Yann Nicolas : Les Premiers Principes de
l’analyse d’impact économique local d’une activité culturelle, Paris, Département
des études, de la prospective et des statistiques (DEPS), ministère de la
Culture, avril 2007, document CM-2001-1, 8 p.].
Aujourd’hui, les premiers – souvent les
seuls – arguments avancés par de nombreux responsables politiques se réduisent
à :
Combien de
citoyens touchés ? : c’est évidemment
toujours beaucoup trop peu en regard
de la population totale et surtout du nombre des supposés électeurs desdits
responsables ;
Quel est
le coût par élève pour la collectivité ? : c’est évidemment toujours beaucoup trop en
regard du budget de ladite collectivité.
De là, ces responsables s’estiment
tout-à-fait « fondés » à demander en retour beaucoup et plus encore à
l’établissement.
La confusion en matière
d’« élitisme » supposé des écoles et conservatoires de musique et de
leur enseignement
« Qui veut noyer son chien l’accuse de
la rage ». Ce proverbe, très ancien, semble qualifier les critiques
souvent entendues contre les écoles ou les conservatoires de musique, de danse
et d’art dramatique. Rappelons d’abord que les mots « élitisme » et
« élitiste », dans leurs sens récents (1967, 1968), sont « devenus usuels pour évoquer la tendance à
maintenir et développer les hiérarchies socio-intellectuelles. » [d’après Le Dictionnaire
historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert,
1992, volume I, 1 156 p., p. 673.]. Il s’agit donc d’un problème
inhérent à l’organisation structurelle de la société et non pas du rôle supposé
des établissements d’enseignement artistique qui adopteraient une telle
démarche en ce domaine. D’ailleurs, il va de soi pour tout observateur un tant
soit peu objectif et lucide, qu’aucune structure d’enseignement artistique
spécialisé ou qu’aucun de ses maîtres de musique, de danse ou d’art dramatique
n’affiche ni ne se réfère à un tel programme aux relents de « culture
bourgeoise » : tous les élèves qui le souhaitent doivent pouvoir s’y
inscrire – et le peuvent –, sauf si l’insuffisance de moyens mis en œuvre par
le décideur-financeur les en empêche (en termes d’insuffisance de locaux et/ou
de budget accordés).
D’ailleurs, s’agirait-il là du seul
« élitisme » rencontré, car cette insuffisance de moyens n’autorisera
une place qu’aux enfants des seules familles arrivées en premier et bien au
fait des procédures d’inscription mises en œuvre (queues d’attente – campements
– devant l’établissement, appels téléphoniques réitérés sans interruption par
plusieurs membres des familles mobilisés pour cela…). À l’évidence, accuser les
écoles et conservatoires de musique d’aider au « renforcement » des
inégalités socioculturelles de la société est une absurdité pitoyable.
La
confusion en matière de publics enseignés
Les textes officiels du ministère de la
Culture, relatifs à l’enseignement artistique spécialisé et que d’aucuns
appellent à leur secours comme déjà écrit, présentent depuis quelques années
une assertion quelque peu spécieuse qui définirait comme leur mission
principale le fait que les écoles et conservatoires de musique, de danse et
d’art dramatique ont à former des amateurs.
Le recours assez systématique à l’opposition amateur/professionnel est apparu,
notamment depuis les années 1970, dans les études développées par les
sociologues de la culture et des « pratiques culturelles », et adopté
sans trop de précautions par beaucoup de décideurs politiques. Les pouvoirs
publics ayant eu besoin d’évaluer la portée et les résultats de l’action
culturelle mise en œuvre dans leurs politiques culturelles,
plusieurs administrations chargées de réaliser de telles études se sont trouvé
mises en place. Au travers de leurs travaux(2) sont ainsi
apparues différentes taxinomies, parmi lesquelles ont émergé les notions de pratiques culturelles et la
classification afférente de pratiques
amateurs (notons que dans ces études, on n’utilise d’ailleurs assez peu ou
même pas du tout la notion de pratiques
professionnelles).
Cette proximité avec les sciences humaines
a fait que, par quelque incohérence intellectuelle et par démagogie certaine,
les pouvoirs publics ont alors décidé de s’occuper des adeptes des « pratiques culturelles amateurs »,
cohortes nombreuses s’il en est, notamment en matière de jardinage. De
ce fait, beaucoup de politiques serinent-ils aux responsables et aux
enseignants des écoles et conservatoires de musique que leur public est
constitué d’amateurs. C’est
évidemment inexact : ces établissements forment des élèves artistes, au moyen d’un enseignement artistique de qualité.
D’ailleurs, qui pourrait définir ce que devrait être un « enseignement
pour amateurs » ? Au cours préparatoire, si les élèves étaient considérés
en tant qu’amateurs, leur apprendrait-on alors à ne lire que le nom des
rues ?
La
confusion en matière d’adéquation avec l’époque
La période actuelle, imbibée par la
propagation de produits culturels standardisés, fabriqués de manière industrielle (musiques de variété, sons
Internet compressés, littérature commerciale…), et soumise à la mode du
« tout-numérique », qui semble être devenu un progrès indispensable
[alors qu’en 2013 il ne nous est déjà plus possible de consulter des disquettes
informatiques (Mini Floppy Disks)
inventées il y a seulement trente ans en 1984, nous arrivons cependant
toujours à accéder à un texte écrit il y a 2000 ou 3000 ans (sous forme de
hiéroglyphes sculptés, ou sur un papyrus…) !]), cette période,
disions-nous, permet aux politiques – dont certain baignent déjà dans une
« inculture » certaine (nous n’aurons point la cruauté de rappeler
certains exemples venus de très haut…) – d’exiger de leurs établissements
d’enseignement artistique qu’ils suivent ces mode : ils se devront de
réserver une plus grande part à l’enseignement des musiques dites
« actuelles » (qui resteront actuelles jusqu’à quand,
d’ailleurs ?), à la MAO (musique
assistée par ordinateur), au recours au tout-numérique, mais aussi prendre en
compte les cultures de différents groupes communautaires environnants, afin de
satisfaire – sans le dire – davantage d’électeurs potentiels (cours de oud, de danse orientale…).
·
Il
s’agit là encore d’une confusion des genres : sous couvert d’ouverture sur la
société contemporaine, le politique « mord » sur le domaine technique
de l’enseignement artistique, animé par le temps contraint de la durée de son
mandat et par l’espérance de sa réélection, se mêlant de choses qui n’entrent
évidemment pas dans ses compétences. Selon l’Adjoint à la Culture de la Ville de
Paris, qui s’exprime dans un article de La
Lettre du Musicien devenu célèbre [signé de Pierre Wolf-Mandroux : « Paris reporte la réforme
de ses conservatoires », La Lettre du Musicien, n° 431, avril
2013, pp. 81-83], les enseignants des conservatoires auraient « fait
des progrès » ! : « Je ne considère pas du tout que les
conservatoires sont élitistes. Leurs professeurs ont d’ailleurs réalisé des
progrès pédagogiques considérables à ce niveau. » De quels progrès
s’agirait-il ? Sous quelle forme ? Parmi les « multiples »
compétences artistiques de ce décideur, lesquelles lui permettent d’estimer une
telle chose ?
La
confusion en matière de statut
Les discussions des années 1990/91,
préparatoires à la création de la filière culturelle de la fonction publique
territoriale, avaient fixé le temps plein du travail des enseignants
artistiques spécialisés à 16 heures pour les professeurs et à 20 heures pour
les assistants. Ce statut, dûment argumenté par le fait qu’il s’appliquait à
des artistes tenus de continuer à travailler leur discipline pour la qualité de
leur enseignement (instruments, danse, comédie, voix), n’a pas manqué de créer
une jalousie certaine de la part de plusieurs autres cadres d’emploi.
Les actuelles contraintes budgétaires et
cette jalousie ancienne aidant, les écoles et conservatoires de musique font
ainsi aujourd’hui l’objet d’attaques en règle, tant des politiques de gauche
que de ceux de droite : parmi plusieurs questions récentes discutées au
Parlement à ce sujet, consulter par exemple la question écrite n° 04121 du
sénateur du Calvados (UMP) Ambroise Dupont, posée à la ministre de la réforme de
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique (J.O. du Sénat
du 24/01/2013, p. 252) sur la situation des professeurs de musique
territoriaux.
De plus et simultanément, réapparaît aussi
dans les tentatives de réécriture ou d’amendement des textes statutaires des
enseignants artistiques territoriaux, la très dangereuse notion de face à face pédagogique. Pour bien comprendre
le danger inhérent qu’elle recèle, soulignons que cette notion laisse subodorer
qu’il pourrait exister une possibilité d’employer les enseignants artistiques
« hors » de leur seul face à face pédagogique (d’autant que le temps
de congé d’un fonctionnaire n’est que de cinq fois son temps de service
hebdomadaire). D’où la très forte tentation – récurrente chez certains
décideurs – de « rentabiliser » les horaires – dérogatoires, mais
dûment justifiés – des enseignants artistiques, « en utilisant » ces
derniers notamment pendant les vacances scolaires. Cela a été le cas pour la
Ville de Paris [avec le risque de créer un précédent pour le reste du pays]
(délibération 2013 DAC 468, soumise
au vote du Conseil de Paris et adoptée le 9 juillet 2013).
Rappelons aux plus jeunes lecteurs, qu’en
1990/91, grâce à une très forte mobilisation des acteurs de l’enseignement
spécialisé, la notion de « face à face pédagogique » avait pu être
retirée des textes préparatoires à la création de la future filière culturelle
de la fonction publique territoriale. Car, il va de soi qu’en dehors de ce face
à face pédagogique, l’enseignant se doit de toujours travailler son instrument,
préparer ses cours, se produire [spectacle vivant], etc.
Pour conclure
Nous continuons à constater qu’en matière
d’enseignement artistique spécialisé, de nombreuses confusions perdurent dans
l’esprit de moult responsables politiques. Il s’avérerait donc nécessaire que
certains parmi ceux-ci révisent et actualisent les chromos qu’ils entretiennent
quant à cet enseignement et quant aux établissements – écoles ou conservatoires
de musique, de danse et d’art dramatique – dont ils ont la tutelle : face à
l’inexistence d’une centralisation régalienne de ce secteur au niveau national
(contrairement à l’enseignement général), une concertation étroite avec des
responsables compétents et des pédagogues et personnels représentatifs de ces
établissements s’impose impérieusement à eux, afin de ne pas obérer plus avant
le devenir d’un très important secteur de la vie culturelle française, que
beaucoup d’autres pays nous envient (Rappelons qu’il y a quelques années, un
célèbre Secrétaire d’état américain a demandé et obtenu d’assister et de
participer à un cours de « solfège » à la Française dans un conservatoire
parisien).
Gérard Ganvert.*
* Musicologue et essayiste,
auteur de L’enseignement de la musique en France, Situation – Problèmes –
Réflexions, Paris, L’Harmattan, 1999, 230 p. Ancien professeur associé
(1997-2012) à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Chargé d’enseignement
à l’Université de Versailles-Saint-Quentin (depuis 2010). Formateur auprès du Centre
national de la fonction publique territoriale CNFPT (projet de e-learning FOREMI France) et d’UNIFORMATION.
Chargé de mission en matière de formation, d’information et d’inspection au
sein de la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) (depuis
1997). Membre fondateur (1985) de la revue Analyse Musicale. Ancien
directeur général de la FNUCMU (aujourd’hui FFEM) (1984-1998).
Professeur de conservatoire à Paris (depuis 1976).
(1) Lire infra, p. 9
(2) Lire par
exemple les travaux devenus célèbres du DEP – actuel DEPS – et
d’Olivier Donnat, Les Amateurs. Enquête sur les activités artistiques des Français, Paris,
ministère de la Culture, DEP, Département des études et de la
prospective, La Documentation française, 1996 ou Les Pratiques
culturelles des Français. Enquête 1997, Paris, ministère de la Culture, DEP, Département des études et de la prospective, La Documentation française,
1998 ou Regards croisés sur les pratiques culturelles, DEP, Paris, La Documentation
française, 2003 ou encore Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 2008, Paris,
La Découverte/ministère de la Culture, DEPS, Département des études,
de la prospective et des statistiques, 2009.
***
Don Giovanni au Conservatoire de Paris
Wolfgang Amadé MOZART : Don Giovanni. Dramma giocoso en deux actes. Livret de Lorenzo Da Ponte. Olivier Cesarini/Alexandre Artemenko, Jérôme Collet, Julie Prola,
Adèle Charvet, Alexandre Pradier, Alan Picol, Armelle Mousset/Justine Vultaggio, Antoine Foulon. Chœur : Oneyda Bigot, Élodie Bou, Florian Cahuzac,
Claire Cervera-Lenert, Augustin Chemelle, Lucie Curé, Clarisse Dalles, Martin Davout, Robin Duval,
Adrien Fournaison, Alejandro Gil Garcia-Marquez,
Cyrille Lerouge, Quentin
Monteil, Valentin Morel, Claire Naessens, Parveen Savart, Fanny Soyer. Corps de
ballet : Cloé Alexandre, Clarisse Mialet, Mélodie Gouel, Henriette Wolf, Amélie Canton, Charlotte Arnould, Léozane Wachs. Pianiste, directrice musicale : Agnès
Rouquette. Pianiste-répétitrice : Kiyoko Inoue. Florence Guignolet, mise en œuvre.

Donna Anna
(Julie Prola)
et Don Ottavio (Alexandre Pradier)/cliché
Florence Guignolet
Les 19 et 20 mai dernier,
auditorium Landowski de la rue de Madrid, le Département supérieur pour jeunes
chanteurs s’est lancé, sous la conduite de Florence Guignolet, dans l’étonnante
aventure d’une double représentation du Don
Giovanni de Mozart. Musiciens et mélomanes l’auront compris, cet
affrontement de la partition mythique du plus bel opéra jamais écrit ne pouvait
relever, dans ces conditions de risque maximal, que de la gageure.
L’inconscience figurant fort heureusement au chapitre des plus belles qualités
de la jeunesse, c’est avec un rare brio que nos aspirants à la gloire lyrique
ont relevé le défi, enchantant à deux reprises un public conscient d’assister,
dans l’acception stricte du terme, à une performance exceptionnelle. Peut-être
pourrait-on en conclure que tout ce qui est ôté à Mozart sans être du Mozart
ajoute à Mozart. Ou, pour parler français, que Mozart n’est jamais plus
enchanteur que lorsque tout ce qui nous sépare de lui disparaît. Ces deux
soirs-là, plus rien de physique ne nous désunissait du génie de Salzbourg.
L’orchestre, par exemple. À force de saluer, sans se donner la peine de les
nommer, les féeries de la phalange mozartienne, on en vient trop aisément à les
juger aussi naturelles que spontanées. Or ici, plus d’orchestre ; seulement le
piano, laboratoire d’une vérité musicale qu’aucun filtre ne saurait altérer.
Sous les doigts d’Agnès Rouquette, tout un monde inattendu surgit ainsi,
musique dont chacun, à force de l’avoir entendue, croit posséder tous les
secrets et qui se révèle pourtant à chaque mesure, neuve, brute, d’une poésie
dont la délicatesse raffinée n’aurait d’égale que la pureté sauvage. Toutes les
audaces d’écriture s’affirment ici dans leur joyeuse insolence, dissonances,
irrégularités… dont Schoenberg prétendait, non sans raison, qu’elles
constituent l’un des principaux formants de l’esthétique mozartienne ! Mais
aussi ces particularités techniques qui, exigeant de la pianiste virtuosité
digitale et intelligence musicale, sollicitent toutes sortes d’équivalences :
notes répétées pour les batteries, changements de registre pour les mutations
de timbre, équilibrage des accords aux deux mains pour les harmonies tenues,
etc. Rien de plus saisissant que cette restitution de l’univers instrumental mozartien, toute de clarté, de vigueur et
de lyrisme. Paradoxalement, la version pianistique exalte ainsi, d’un bout à l’autre de sa
partition, cette intelligence du figuralisme si propre au compositeur : notes
détachées pour les gouttes de sang quittant le corps du Commandeur mourant,
fausse naïveté de l’arpège de Leporello pour son
apostrophe à Donna Elvira, Voi sapete quel che fa, etc.
Compagne du texte, la musique devient action en soi, plus dramatique et
expressive que les mots qu’elle vêt de sa diaprure sonore.

Donna Elvira
(Adèle Charvet) / Cliché Florence Guignolet
Maîtresse d’œuvre, Florence
Guignolet met magistralement en lumière la subtile ambiguïté de ce dramma giocoso, “drame badin”, à mi-chemin entre
insoumission enjouée et mutinerie perverse. Sa mise en scène d’une étonnante
efficacité illustre à merveille la chronique, plus dramatique que tragique,
d’une course au plaisir frénétique, défi dont le héros s’autorise pour donner
libre cours à ses provocations. Athéisme, indifférence, cruauté et libertinage
ne s’accompagnent-ils pas d’un réel amour, tout aussi subversif, de la liberté
(« Viva la libertà », clame notre homme à la fin du
premier acte, menace à peine voilée à l’endroit d’un régime monarchique miné
par la pensée des Lumières). Ayant probablement médité sur le mot de Mozart
(« Un opéra doit plaire d’autant plus que le plan de la pièce aura été
mieux établi et que les paroles auront été écrites pour la musique »),
Florence Guignolet a bien pris soin de souligner qu’à la chute du rideau (la
suppression de la scène finale ne fait qu’en accentuer l’évidence), le destin d’aucun
protagoniste n’est scellé, à l’exception de celui du héros. Comment s’en
étonner face à cette galerie de portraits dont le premier caractère semble être
l’ambiguïté ? Ainsi de Donna Anna à laquelle Julie Prola confère, tant par la beauté du timbre que par la justesse dramatique, une
dimension prodigieusement sensuelle, du chevaleresque Don Ottavio, dont la
magnifique interprétation d’Alexandre Pradier met en lumière tous les
désordres, ou encore d’Elvira, dont Adèle Charvet traduit avec un souverain talent les continuels balancements de la détresse
farouche à la fureur obscure. Quant à Don Giovanni lui-même à qui, par un trait
de génie dramatique, Mozart accorde si peu d’airs pour lui conserver sa
mystérieuse neutralité, les interprétations respectives d’Olivier Cesarini et d’Alexandre Artemenko,
visages contrastés d’une élégance toute florentine et d’une brutalité tonique,
ne témoignaient-elles pas du caractère polymorphe et mutagène de l’impénitent
libertin, statue aux mille hypostases ? En miroir, mais de façon tout aussi
pertinente, les brillantes prestations d’Armelle Mousset et de Justine Vultaggio mettaient tout aussi bien à
jour, à mi-chemin entre espièglerie rebelle et pétillante gravité, les
indicibles tourments d’une Zerlina dont le cri de terreur et de
refus sonne l’hallali du héros à la fin du premier acte… Une Zerlina renonçant finalement au mirage aristocratique pour
en revenir à la fière humanité d’un Masetto auquel
Antoine Foulon confère une heureuse prestance, en rupture avec la rusticité dont
il est ordinairement accablé.

Don
Giovanni au bord de l'anéantissement (Olivier Cesarini)
/ Cliché Florence Guignolet
Il y aurait tant encore à
signaler dans les didascalies de cette singulière production : le trio des
Masques, moment de grâce absolue, l’ingestion de Don Giovanni par les
délicieuses créatures aux bras tentaculaires, la fausse hallucination de Leporello face aux fantômes qu’il refuse de voir, le quatuor Non ti fidar, o
misera, entre fusion déchirée des couples et dissipation des énergies, la
fantasmagorie d’un Commandeur superbement campé par Alan Picol, etc. Que la magie ait opéré au gré des deux soirées, leur public peut
l’attester ; quant à savoir pourquoi elle a opéré… À plusieurs reprises, entre
lumière et mystère, la grande ombre du compositeur semble avoir plané sur la
scène de son chef-d’œuvre, occasion de rappeler, pour ceux qui, à l’instar de
l’auteur de ces lignes, méprisent le hasard, que la partition d’orchestre manuscrite
du Don Giovanni a longtemps été
conservée dans la bibliothèque de la rue de Madrid.
Gérard Denizeau.
Ali Baba va bon train à l'Opéra Comique
Charles LECOCQ : Ali
Baba. Opéra-comique en trois actes. Livret d'Albert Vanloo et William Busnach. Tassis Christoyannis, Sophie Marin-Degor, Christianne Belanger, François Rougier, Philippe
Talbot, Mark Van Arsdale, Vianney Guyonnet,
Thierry Vu Huu. Chœurs : Accentus / Opéra de Rouen
Haute-Normandie. Orchestre de l'Opéra de Rouen Haute-Normandie, dir. Jean-Pierre Haeck. Mise en
cène : Arnaud Meunier.

© Pierre
Grosbois
Créé en 1887, à Bruxelles, Ali Baba connut
d'emblée un vif succès, mais sombra vite dans l'oubli de ce côté-ci de la
frontière belge. Aussi sa présentation à l'Opéra Comique fait-elle figure de
quasi exhumation. Son auteur, Charles Lecocq (1832-1918), dont la postérité a
plutôt retenu un autre titre, La fille de Madame Angot,
allait en effet pâtir de la perte de lustre d'un genre léger porté au zénith
par Offenbach. Le sujet, plutôt bien ficelé par des librettistes connaissant
leur affaire, est tiré du conte des Mille et Une Nuits, « Ali Baba et les
quarante voleurs exterminés par une esclave ». Qui voit un pauvre hère
témoin d'une invraisemblable découverte, une caverne emplie des trésors et
investie par une bande de voleurs, s'emparer du code magique, « Sésame,
ouvre-toi », pour accéder à ces improbables richesses. Il fera main basse sur
elles avec d'autant plus de bonne conscience qu'après tout, ce n'est sans doute
pas un mal « de prendre sur les voleurs »! On connait la suite : le cousin Cassim, qui ayant surpris le mot de passe, se rend
dans la grotte pour y puiser lui-aussi, mais oubliant la formule, se fait
lui-même prisonnier, est découvert par les voleurs qui le ligotent ; les
débordement amoureux de la femme dudit, qui s'éprend de la richesse d'Ali Baba
; et surtout la destinée de l'esclave Morgiane qui va
déjouer les plans assassins des voleurs et sauver son maître vénéré, s'assurant
au final à la fois la liberté et l'hymen. L'adaptation des librettistes adoucit
considérablement la violence du conte, et la musique ne fait volontairement pas
dans l'orientalisme, à la différence de la contemporaine Lakmé de Delibes. Il s'agit en fait d'un opéra-comique et non d'une opérette.
Encore que l'œuvre réponde au canon du grand spectacle par ses vastes proportions,
chœurs fournis, distribution nombreuse, composante chorégraphique. Les dimensions réduites du
plateau de la salle Favart n'autorisant pas la débauche d'effets, on a fait
œuvre d'ingéniosité. Arnaud Meunier, qui signa naguère à Aix une version chambriste
de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, propose une adroite mise en
scène. Il transpose l'histoire dans le milieu des grands magasins, façon
« Au bonheur des dames », Ali
Baba devenant un ouvrier d'entretien dans l'établissement géré par son frère Cassim. Ce qui introduit une pincée de satire sociale. La
direction est vive et souvent accrocheuse : ainsi de l'arrivée des 40 voleurs
se trémoussant sur le rythme saccadé de la musique, les postures avantageuses
de Zobéide, la femme de Cassim,
qui a tôt fait de comprendre le parti à tirer de la fortune subite d'Ali Baba,
et s'avère autrement plus futée que son propre époux, qui mort-vivant se voit
cocufier en règle. Les scènes d'action sont vives et il s'en dégage une
vivacité communicative, en particulier à travers un travail fouillé sur les
chœurs lors de la scène de la vente aux enchères des maigres biens d'Ali Baba,
dont les couplets ne sont pas sans rappeler ceux de l'auction du Rakes' Progress de Stravinsky : le
clou n'en est-il pas l'esclave Morgiane elle-même,
comme Baba the Turk dans l'opéra de ce dernier ?
L'humour se veut discret et le pittoresque reste de bon goût. Les échanges, un
peu contrits au début, cèdent vite la place à un naturel enviable, et l'on se
prend au jeu, séduit par l'entrain général, qui trouve son apogée dans un finale
proprement endiablé.
![]()

© Pierre
Grosbois
Cet entrain on le doit tout autant à la
direction musicale. Jean-Pierre Haeck, qui
habituellement fait les beaux soirs de l'Opéra de Liège, s'enflamme pour la
musique suave et raffinée de Lecocq. Toujours très mélodieuse, plus parisienne
qu'exotique, elle cherche à flatter l'oreille de l'auditeur et ne requiert pas
d'efforts de concentration. L'invention n'est, certes, pas toujours au
meilleur, mais la diversité rachète un léger déficit d'originalité. Encore que
le cocasse motif énergique rythmant les frasques des 40 voleurs ne manque pas
de panache. Dans le rôle titre, Tassis Christoyannis se taille un franc succès, car à la conduite
agile de la voix dans le registre aigu de la tessiture de baryton répond un
engagement de tous les instants et une vraie crédibilité. Sophie Marin-Degor, passé un début précautionneux, prête à l'esclave Morgiane à la fois résolution et lustre vocal. L'élan
lyrique d'un air comme « Adieu l'humble et pauvre chaumière » nimbe
le personnage de grâce ingénue. Au Cassim un peu
contrit de François Rougier fait écho la désopilante Zobéide de Christianne Belanger, une chanteuse de la deuxième
promotion de l'Académie maison. Celle-ci pourvoie encore les rôles du jeune
Saladin, dû au joli ténor de Mark Van Arsdale, et de
l'imposant chef des brigands, Vianney Guyonnet. A
distinguer aussi la prestation de Philippe Talbot, Zizi, qui offre la
savoureuse composition d'une petite main de voleur, passé maître dans l'art de
jouer du destin de plus faible que lui.
Jean-Pierre Robert.
La Passion de Simone au Festival de Saint-Denis
Kaija SAARIAHO : La Passion de Simone. Chemin musical en quinze
stations. D'après la vie l'œuvre de Simone Weill. Livret d'Amin Maalouf. Karen Vourc'h, Raquel Camarinha, Magali Paliès, Johan Viau, Florent Baffi. Isabelle Seleskovitch, comédienne. Compagnie La Chambre aux échos. Secession Orchestra, dir. Clément
Mao-Takacs. Direction scénique : Aleksi Barrière.

Kaija Saariaho / DR
Comme ce fut le cas de son
opéra Émilie, Kaija Saariaho (*1952) traite dans La Passion de Simone du parcours d'une femme hors du
commun : après Émilie du Châtelet, ce nouvel opus, créé à Vienne en 2006, est
un vibrant hommage à la philosophe et militante Simone Weill (1909-1943). Ni
opéra, ni même oratorio, l'œuvre se veut un « chemin musical en quinze
stations ». On pense aux Passions de Bach, mais plus encore aux mystères
médiévaux, pour narrer un cheminement spirituel, plutôt qu'une action à proprement
parler : celui de la philosophe qui dès 1932, s'engage aux côtés des premiers
grévistes en usine, et va, sa courte vie durant, lutter contre les inégalités
et littéralement se consumer pour l'accomplissement de ses idéaux de liberté,
aidée par une force intérieure puisée dans le mysticisme religieux. D'un seul
tenant, La Passion de Simone mêle, au fil de ses quinze courtes
séquences, chant et déclamation, à l'image du personnage titre appréhendé à la
fois par une chanteuse et une comédienne. Un dédoublement éminemment signifiant
qui fonctionne à l'inverse de la dramaturgie d'une Passion de Bach : c'est à la
chanteuse, qu'il revient, telle une récitante, de brosser la figure engagée de
Simone, au fil d'une évocation subtile, par petites touches, tandis que la
comédienne, personnification de cette dernière, l'appuie de courtes lectures.
Celles-ci couronnent ainsi les passages chantés, plus développés, et conçus
dans une forme libre, ne s'apparentant pas à l'aria ; ce qui confère au
discours une étonnante fluidité. Le Chœur commente et renchérit sur les versets
chantés. La huitième station, centre de gravité de l'œuvre, est purement
instrumentale, tel un moment de répit. L'écriture musicale est extrêmement
virtuose, ce que renforce la réduction pour formation de chambre, récemment
préparée par Kaija Saariaho,
et dont c'était lors de ce concert, la première française. Elle agit comme un
orchestre de solistes, dont les bois émergent souvent. Le langage est, comme
toujours chez la compositrice finlandaise, très personnel, alternant des
explosions sonores et des plages de lyrisme, parées de glissandos venant en
atténuation du son. Confié à quatre voix seulement, soprano, mezzo-soprano,
ténor et baryton-basse, le chœur complémente la partie de la soliste. L'exécution
donnée à la Basilique de Saint-Denis, en prélude au Festival annuel, propose
plus qu'une mise en espace, une vraie présentation scénique : tandis que le
personnage titre est représenté à sa table de travail (rôle parlé), son double
chantant évolue sur une aire dégagée devant l'orchestre, parmi les personnages
du chœur. Des éclairages étudiés sur l'environnement architectural et des
projections en arrière plan (visions de chaîne d'usine, de champs de guerre, ou
encore portrait de Simone Weill) parachèvent une visualisation intelligente. Une direction
d'acteurs discrète mais efficace confirme l'impression de déroulement d'un
rituel, ponctué de superbes arrêts sur image, comme celle rapprochant dans une
douce effusion le visage des deux interprètes de Simone. Tant la voix éthérée
de Karen Vourc'h que la déclamation non emphatique de
la comédienne Isabelle Seleskovitch traduisent ce
chemin de vie qui se consume, d'une grande fragilité physique et d'une vraie
force de l'âme. Elles sont entourées par un quatuor vocal valeureux. La
vingtaine de solistes du Secession Orchestra, sous la
direction précise et attentive de Clément Mao-Takacs enluminent une partition plus qu'attachante.
Jean-Pierre
Robert.
Les Dialogues des Carmélites ou le suprême dépouillement
Francis POULENC : Dialogues
des carmélites. Opéra en trois actes. Livret du compositeur, d'après
Georges Bernanos, adapté de la nouvelle de Gertud von Le Fort, « La Dernière à l'échafaud », et du
scénario du révèrent Père Brückberger et de Philippe Agostini. Sally Matthews, Deborah Polaski,
Sophie Koch, Anna Prohaska, Emma Bell, Thomas Allen,
Yann Beuron/Luis Gomes, Neil Gillespie, John Bernays, Catherine Carby,
Elisabeth Sikora, Alan Oke,
David Butt Philip, Michael De Souza, Craig Smith. Royal Opera House Community Ensemble. Royal Opera Chorus. Orchestra of the Royal Opera House, dir. Sir Simon Rattle. Mise en scène :
Robert Carsen.

Deborah Polaski & Sally
Matthews © Donald Cooper
Cent fois sur le métier : la production des Dialogues des carmélites conçue par Robert Carsen,
qui tourne depuis la fin des années 1990, atteint le Royal Opera de Londres. Le grand œuvre de Poulenc n'y avait plus été représenté depuis
1983, dans la régie alors de Margarita Wallmann et
les décors solidement architecturés de Georges Wakhévitch. Carsen reste fidèle à l'esprit de ce singulier texte
sublimé par la musique. Sa mise en scène est extrêmement dépouillée, voire
minimaliste dans son aspect visuel : sur le plateau nu, ceint d'immenses murs
gris, seuls quelques accessoires signalent tel ou tel lieu ou situation. Les
modifications sont souvent infimes, à l'image de ce fauteuil capitonné du
marquis, qui recouvert d'un linceul, devient le siège austère de la Première
Prieure, ou de ces longs bancs de bois qui délimitent l'espace dans le carmel
autant qu'ils servent à leur usage premier. Dans cet univers sévère, presque
janséniste, la lumière (Jean Kalman) sculpte les
scènes qui se succèdent dans un continuum naturel, tout en révélant chacune sa
signification particulière. Carsen modèle la trame
dramatique par un travail minutieux sur le groupement des personnages, dont le
plus pertinent est sans doute ce mur humain formé par les sœurs durant la scène
du parloir, séparant physiquement Blanche et le Chevalier de la Force durant leur
ultime explication, et que l'un et l'autre parviendront à franchir comme malgré
eux. La régie offre cette idée originale de conférer un rôle essentiel à la
foule dont la présence est renforcée, notamment au début de l'opéra, durant les
deux premières scènes entre la marquis de La Force et
son fils, et lors de l'échange entre le marquis et sa fille Blanche. Pour ce
faire, le chœur est décuplé par des figurants, pour lesquels on a fait appel à
un recrutement spécifique par le truchement d'un « Community ensemble ». De fait, l'effet est saisissant de cette masse dont se
détachent les personnages principaux, par exemple lors de l'évocation par le
Chevalier de la Force de l'attaque du carrosse familial au carrefour Bucy, préfiguration des événements tragiques à venir. La
foule menaçante, on la retrouvera au dernier acte, lors des scènes
révolutionnaires, investissant l'espace pour réduire à presque rien le groupe
des carmélites blotties les unes contre les autres. Paradoxalement, durant la
scène finale, cette foule, d'abord cantonnée à l'arrière-plan en un long et
régulier alignement, va s'effacer peu à peu, pour ne laisser que la vision des
sœurs s'en allant vers la mort dans ce qui s'apparente à une transe rituelle.
Le tableau sera parachevé en une sorte de transfiguration de Blanche aux
ultimes mesures, parmi les corps inertes de ses compagnes. Peu avant, le moment
crucial où celle-ci revient pour rejoindre Constance, n'aura pas livré
l'émotion qui doit alors étreindre le spectateur aux larmes, le martèlement sec
et bien sonore du couperet de la guillotine n'ajoutant pas au pathétique de la
situation. On touche là aux limites de la conception du metteur en scène
canadien : de ce schéma d'épure ne jaillit pas toujours l'étincelle de
l'ébranlement intérieur si consubstantiel à la pièce.

Scène finale ©
ROH-Stephen Cummiskey
L'empathie de Simon Rattle pour la musique française trouve dans cette exécution une nouvelle flagrance.
Cette partition lui tient particulièrement à cœur. De ce qui, selon Poulenc,
doit être une « orchestration très claire pour laisser passer le texte »,
il fait son miel. On entend presque Debussy dans son approche tant elle
privilégie une absolue transparence, comme la part de séduction que contient la
partition et ses brusques élans d'optimisme, ou même ses accents presque
voluptueux. Rattle favorise les contrastes extrêmes,
ceux-là même qui forgent le drame intérieur de ces êtres forts, en même temps sensibles : de la
discrétion à la violence, des pianissimos d'une grande tendresse aux éclats
vifs et anguleux. L'Orchestre du Royal Opera répond
avec magnificence, se pliant aux multiples couleurs et fascinantes inflexions
de cette musique si gallique, comme à son infinie richesse instrumentale,
singulièrement des bois. On sait que Poulenc attachait une importance toute
particulière à la distribution des voix de « ces dames carmélites ».
Le présent cast a fait l'objet d'un soin particulier.
De Madame de Croissy, la première Prieure, Deborah Polaski,
hier une fameuse Brünnhilde, dresse un magistral
portrait : sa voix de soprano dramatique, à la sombre moirure, déploie autorité
et pathétisme, quoique avec une certaine retenue lors de la terrible agonie de
la prieure. De même, Sophie Koch, Mère Marie, sait-elle être glaciale. Le large
timbre de mezzo remplit ce rôle, de manière plus convaincante que lors des
récentes représentations parisiennes. Emma Bell campe une Nouvelle prieure,
Madame Lidoine, toute de simplicité émue, et le
soprano n'est pas taxé par les terribles écarts qui lui sont réservés. Anna Prohaska, qui aborde le rôle de Constance, lui prête des
accents d'une touchante spontanéité, quoique n'atteignant pas cette évidente
vérité que peut ici apporter une voix française. La jeu est en tout cas
sincère, empreint de tendresse et dénué de mièvrerie, et le soprano solaire à
la hauteur de cette partie délicate. Sally Matthews défend le rôle de Blanche
avec conviction. Le timbre, chaleureux et expressif, est dans l'exact braquet
corsé qu'avait en tête Poulenc, qui pensait bien sûr à Denise Duval.
L'appropriation du rôle est rélle, dégagée de toute
affectation : la résolution, l'assurance d'une foi assumée et en apparence
inébranlable, mais aussi la fêlure survenant malgré tout devant l'épreuve. La
scène qui l'oppose à Mère Marie, alors que rentrée au domicile paternel
dévasté, est poignante dans sa fureur à peine contenue. N'étaient çà et là
quelques soucis d'articulation, qui ne rendent pas toujours le texte aussi
intelligible qu'il le faudrait, voilà assurément un sans faute, quoique sans
atteindre la formidable intensité d'une Patricia Petibon dans la production due à Olivier Py au Théâtre des
Champs-Elysées (cf. NL de 1/2014). Si le Marquis de Thomas Allen est un peu
pâle vocalement, souvent proche du sprechgesang, le Chevalier de la Force de
Yann Beuron fait montre d'une diction précise qui
fait mouche. Une indisposition le fera renoncer après le premier acte. Sa
doublure, Luis Gomes, propulsé en hâte, sauvera le show, et grâce à une diction
aisée, conférera à l'échange du frère et de la sœur cette aura de déchirement
réciproque, au-delà du détachement, qui porte cette scène au nombre des
réussites du spectacle.
Jean-Pierre Robert.
Deux opéras de Gounod et de Milhaud à l'Athénée
Charles GOUNOD : La
Colombe. Opéra-comique en deux actes. Livret de Jules Barbier et Michel
Carré. Darius MILHAUD : Le Pauvre Matelot,
complainte en trois actes. Paroles de Jean Cocteau. Gaëlle Alix, Jean-Christophe
Born, Sévag Tachdian, Lamia Beuque. Sungoo Lee,
Kristina Bitenc, David Oller,
Fernand Bernadi. Musiciens de l'orchestre Lamoureux, dir. Claude Schnitzler. Mise en scène : Stéphane Vérité.

La Colombe /
DR
Intrigante idée de rapprocher deux opéras
de Gounod et de Milhaud que rien ne prédestinait à être joués à la suite l'un
de l'autre ! Encore qu'à y regarder de près, la thématique véhiculée par chacun
ne soit pas si différente : on châtie bien ce que l'on aime. Gounod a écrit La
Colombe en 1860, un an après Faust, pour le Théâtre de Baden-Baden.
Inspiré de la longue fable « Le Faucon » de La Fontaine, revisitée
par les librettistes experts que sont Barbier et Carré, cet opéra-comique narre
un conte cruel : le triomphe de l'amour au prix du sacrifice d'un objet aimé,
un oiseau, chéri par son propriétaire, Horace, et convoité par celle qui
l'aime, Sylvie. Il finira en rôti pour alimenter le dîner que le pauvre jeune
homme ne peut offrir à sa belle. Mais, miracle, il a été sauvé de cette piteuse
posture par le sacrifice d'un autre volatile, et tout finit bien... Cette
histoire bien ténue, Gounod l'agrémente d'une musique pleine de naïveté, mais
d'une réelle fraîcheur mélodique qui aligne quelques morceaux concertants
habiles, duos, trios et quatuors vocaux joliment enchaînés aux airs, et
nullement affectés par les courts intermèdes parlés. La production de Stéphane
Vérité est ingénieuse, grâce à une véritable scénographie d'images numériques
projetées en guise de décor. La formation réduite d'une douzaine de musiciens
de l'Orchestre Lamoureux confère au débit une vraie transparence et on admire
les solos instrumentaux, dont celui du violoncelle durant l'Ouverture. Le
quatuor vocal connaît des fortunes diverses, mais l'engagement de ces
mousquetaires de l'Opéra studio de l'Opéra National du Rhin ne saurait être
dénié.

Le Pauvre
Matelot / DR
Le Pauvre matelot (1926) a été
composé durant la période où Darius Milhaud (1892-1974) faisait partie du
Groupe des Six. Premier de sa quinzaine d'opéras, cette
« complainte », malgré ses trois actes, fait figure d'opéra-minute
puisque dépassant à peine la demi-heure. Un rare condensé dramatique pour une
tragique méprise : le meurtre du mari par une épouse demeurée vertueuse malgré
l'absence de celui-ci depuis 15 ans, qui ne le reconnait pas lorsqu'il
réapparait à l'improviste, et croit pouvoir, en le dépouillant de ses
richesses, combler les dettes de celui dont on lui annonce le retour, et qui
avait préféré ne pas se faire connaître pour « voir son bonheur du dehors ».
Jean Cocteau qui a signé les paroles, use volontairement d'un langage simple
mais terriblement efficace. A cette force, presque rudimentaire, fait écho la
musique de Milhaud tout en arrêtes vives et maniant les rythmes syncopés et les
accents populaires ; un univers sonore aux antipodes de la veine mélodieuse, un
peu facile, de Gounod. Cuivres et percussions s'y taillent la part du lion. Et
quel sens du drame ! Là encore, la formation instrumentale réduite détaille les
angles vifs à l'envi, sous la baguette rigoureuse de Claude Schnitzler. Les
quatre chanteurs sont à l'unisson de ce parcours tragique, en particulier
Kristina Bitenc, la femme, déployant une formidable
intensité sous un calme apparent. La régie de Stéphane Vérité est aussi
tranchante que la musique, sorte de huis clos menaçant pour un dénouement
inexorable dont on sent à peine l'arrivée tant il est amené avec une lenteur
calculée. Un joli tour de force !
Jean-Pierre Robert.
Merveilleux Quatuor Mosaïques !

DR
Depuis plus de 25 ans, le Quatuor Mosaïques
fait figure de leader des formations jouant sur instruments anciens. Ces trois
viennois (Erich Höbarth, Andrea Bischof, Anita Mitterer) et
le français Christophe Coin cultivent avec une rare distinction le jardin des
classiques viennois, mais aiment aussi se pencher sur les chefs d'œuvres
méconnus du répertoire français du XIX ème. C'est
précisément de cela qu'il était question lors du concert inaugural de la
deuxième édition du Festival Palazzetto Bru Zane à
Paris au Théâtre des Bouffes du Nord. Pour méconnu qu'il soit (encore), l'art
du quatuor à cordes en France au XIX ème, n'en a pas
moins été florissant : de nombreux musiciens s'y sont adonnés, tels Boëly, les
frères Jadin, Baillot, Onslow ou encore Lesueur, le mouvement s'accentuant vers la fin du siècle avec des
noms tels que Fauré ou Franck. La disposition topographique alors en usage
était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui du placement en
éventail face au public, car les quatre concertistes étaient disposés par deux,
face à face autour d'un lutrin central à quatre dossards. On privilégiait ainsi
le plaisir de la conversation en musique et du jeu entre amis plus que la
satisfaction de l'agrément du public. Les compositeurs produisent souvent dans
une volonté de quantité, publiant des quatuors à la série, mais quelques uns
déjà se mettent à produire à l'unité, tel Onslow. Le
programme des Mosaïques débutait par l'« Ouverture générale pour les
séances des quatuors » d'Antoine Reicha qui, en 1816, coucha sur le papier
ce qui s'apparente à une plaisanterie musicale : une parodie de mise en
condition, d'échauffement, durant laquelle les quatre partenaires s'accordent
et s'apprêtent. Ce qui a tout l'air d'une improvisation est pourtant fixée sur la papier à la note près. Cela prend peu à peu une
forme de mélodie et s'envole en une manière délicieusement naïve. Le Quatuor N°
2 de Louis-Emmanuel Jadin (1768-1853) appartient au
genre dit du quatuor brillant qui confie au premier violon un rôle prééminent,
les trois autres musiciens étant cantonnés à un accompagnement, parfois non
dénué d'intérêt. Cette pièce qui fait partie des « Trois grands Quatuors
dédiés au roi de Prusse », cultive un ton sombre, en particulier au
maestoso moderato initial, tendu, et plus tard à l'andante, court mais d'une
belle profondeur. Le deuxième mouvement est un menuet de curieuse allure,
asymétrique par l'alternance de deux mesures à trois temps et de deux mesures à
deux temps. Le finale ne manque pas d'entrain. Félicien David (1810-1876), compose
son 3 ème quatuor en 1868/69. Demeuré à l'état de
manuscrit, il a été publié récemment
grâce aux travaux éditoriaux du Centre de Musique romantique française Palazzetto Bru Zane. Là encore, le premier violon se voit
assigner une partie saillante. Mais l'équilibre se modifie déjà vers une plus
grande autonomie des quatre instrumentistes, du violoncelliste en particulier.
L'œuvre a une ampleur qui la situe sur un autre braquet en termes
d'expressivité et les échanges de thèmes d'un instrument à l'autre y sont
fréquents. L'adagio exhale un large lyrisme qui cède la place à des pages plus
agitées. Le scherzo propose des modes divers dont le jeu avec sourdine, qui
confèrent une belle plasticité au discours, et le finale, allegro leggero, combine élan dramatique et accents populaires du
meilleur effet. De ces œuvres contrastées, les Mosaïques livrent des lectures
sensibles et habitées d'un sens du phrasé hors du commun, nimbées de
pianissimos éthérés et d'une respiration merveilleuse. En bis, ils donneront le
scherzo d'un quatuor de Pierre Baillot, dans le goût espagnol, discret hommage
à un musicien qui introduisit en France l'italien Boccherini, madrilène
d'adoption, puis le mouvement lent du 2 ème quatuor
de Gounod, dans le ton nocturne. Un grand merci au Centre Bru Zane de nous
avoir donné le bonheur d'entendre cette formation à Paris, où elle se fait si
rare !
Jean-Pierre Robert.
Un trio ad hoc d'exception

Edgar Moreau
/ DR
Le festival de Saint-Denis présentait à
l'Institution de la Légion d'Honneur un concert de musique de chambre hors des
sentiers battus. Le genre du trio à cordes n'est pas aussi célébré que celui du
trio pour piano. A de rares exceptions près, tel le Trio Grumiaux,
s'y consacrent plutôt des formations ad hoc. Celle réunissant Renaud Capuçon, Gérard Caussé et Edgar
Moreau devrait, si elle perdure, tenir une place sérieuse dans le paysage
musical français, à en juger par le degré d'aboutissement qui transparait des
présentes exécutions. Le choc de trois générations de musiciens en somme et une
même assurance souveraine : le violon solaire du fringant Capuçon,
l'alto charnu du presque vétéran Caussé, et le cello combien chantant du tout jeune Moreau, qui du haut de
ses vingt ans se hisse sans peine au diapason de ses deux collègues ! Le Trio à
cordes K 563 est sans doute l'un des chefs d'œuvre absolus de la musique de
chambre de Mozart. Écrit en 1788, il est dédié à l'ami bienfaiteur et frère de
Loge Michaël Puchberg. Il s'agit d'un divertimento,
ou « cassation », genre pourtant abandonné par Mozart depuis
longtemps, auquel il revient de manière inattendue, surtout après les trois
grandes symphonies de cette même année. Ses six mouvements relèguent vite au
second plan l'archaïsme désuet de la forme tant les idées musicales sont frappées
au coin du génie. Le dialogue entre les trois instruments, en un vrai travail
concertant, est d'une maîtrise absolue, chacun se voyant accorder une primauté
qui n'est donc pas réservée qu'au seul violon. Le violoncelle, en particulier,
assume un rôle qui dépasse celui de pure basse d'accompagnement, annonçant la
place éminente qui sera la sienne dans les derniers quatuors à cordes. Nos
trois interprètes s'emparent de cette pièce avec gourmandise et lui assurent un
fini instrumental qui place sans peine cette exécution auprès des grandes
interprétations d'hier, telle précisément celle, au disque, du Trio Grumiaux (Philips). On est immergé avec ravissement dans sa
profusion thématique, comme émerveillée par la liberté rythmique qui transpire
des mouvements rapides, qu'ils n'hésitent pas à bousculer à l'occasion pour un
plus grand effet dramatique : les deux menuets sont ouvragés avec soin et
nantis d'imaginatifs trios, et le finale se fait irrésistible d'entrain, qui
transfigure son allure pastorale. Les séquences lentes, de même, découvrent une
musicalité fastueuse : l'adagio, un des plus profonds laissés par Mozart,
découvre une méditation inouïe sous ces trois archets inspirés, et l'andante
sera vivement contrasté dans ses diverses variations à partir d'un refrain
d'aspect folklorique. De la belle ouvrage ! Le concert
avait débuté par un mouvement d'un trio de Schubert (D. 581, annoncé sur le
programme dans son intégralité ; à moins que ce ne soit le seul mouvement du
trio inachevé D. 471, car rien ne fut annoncé), suivi du Duo pour violon et
alto N° 1, K 423 de Mozart. Dans ce dernier, les deux archets dialoguent sur un
pied d'égalité et cet échange est si dense qu'on a l'impression d'entendre un
trio, pour ne pas dire un quatuor à cordes. L'adagio médian annonce par la
puissance de sa cantilène le divertimento de 1788. C'est là une différence
essentielle avec le modèle prisé par un maître du genre, Michaël Haydn, qui
accorde la prééminence au violon. L'histoire rapporte que Mozart aurait rendu à
celui-ci le service de compléter, avec cette pièce et le duo K 424, une série
de six promise à l'archevêque Colloredo et non menée à son terme par le vieux musicien !
Jean-Pierre Robert.
Un
concert d’une subtile délicatesse.

Mikko Franck
/DR
Un concert d’une subtile délicatesse qui
nous fit amèrement regretter que Mikko Franck, pour des raisons de santé, ne
puisse poursuivre son exploration de l’œuvre du compositeur finlandais
contemporain, Einojuhani Rautavaara.
Initialement deux concerts avaient été prévus, un seul en définitive nous fut
donné à entendre, cela suffisant toutefois à juger de l’étonnante et très
réelle affinité du chef finlandais pour l’œuvre de son compatriote compositeur. Rautavaara est un compositeur finlandais, né en 1928,
enseignant à l’Académie Sibelius depuis 1966 où il fut notamment le maître
d’Esa-Pekka Salonen et de
Magnus Lindberg. Auteur d’une œuvre considérable
comprenant œuvres vocales et concertos pour divers instruments, opéras, musique
de chambre et huit symphonies. Pour ce concert deux de ses œuvres majeures
avaient été choisies, le Cantus Arcticus (Concerto pour Chant d’oiseaux et orchestre) et le Concerto pour violon,
interprété par la violoniste américaine Hilary Hahn. Cantus Arcticus, composé en 1972, est une
œuvre originale, audacieuse et probablement la plus populaire du compositeur.
Elle met au même niveau sonore l’orchestre et la bande magnétique dans un
dialogue constant. Sorte de contrepoint orchestral au chant des oiseaux
nordiques, pour un résultat musical d’une troublante sérénité, empreinte de la
magie des grands espaces, comme un périple en montgolfière dans un ciel sans
nuage au-dessus du cercle polaire, ou encore une promenade solitaire sur les
falaises de Latrabag en Islande par un matin de
commencement du monde. Bien différent, le Concerto
pour violon, composé en 1977, délicat et véhément, alternant violence et
lyrisme, comme une invitation au voyage où se succèdent différents paysages,
différentes situations, tranquille dans le premier mouvement, énergique dans le
second. Musique de l’ineffable, de l’impossibilité du dire, comme une
méditation portée par la sonorité élégiaque du violon, d’une subtile
délicatesse, sur laquelle éclatent et se développent des jaillissements
orchestraux, dans un dialogue serré conduit par la main et les bras experts de
Mikko Franck. Après une prestation violonistique et musicale de cette qualité,
le « bis », emprunté à Bach (comme toujours chez Hilary Hahn !),
parut bien fade…En deuxième partie, un programme Debussy pour souligner l’inspiration
debussyste du compositeur finlandais : Le
Prélude à l’après midi d’un faune (1894) et La Mer (1905). Deux œuvres mettant en avant toute la richesse,
l’élégance, le scintillement, la subtilité et la beauté de l’orchestration du
compositeur français. Des œuvres bien connues qui valorisèrent la talentueuse petite harmonie du « Philar » et notamment Magali Mosnier à la flûte solo, sans oublier le pupitre des cors, infaillible, et la belle
prestation d’Amaury Coeytaux au violon solo. Un
superbe concert alliant talent et découverte, et une complicité palpable entre
le « Philhar » et son nouveau directeur
musical, Mikko Franck. Voilà qui nous promet de belles soirées pour la saison
prochaine…
Patrice Imbaud.
Daniele Gatti clôt magistralement son cycle Tchaïkovski

Daniele Gatti / © Picture-Alliance OBS
Dernier épisode d’un cycle Tchaïkovski
parfaitement conduit qui permit au public d’entendre, sur l’ensemble de la
saison, l’intégrale des six symphonies avec notamment les trois premières
symphonies du compositeur russe, rarement données, à l’inverse de la trilogie
du fatum, à juste titre, beaucoup plus connue. Tchaïkovski, héritier des classiques, dont les dernières symphonies sont
chargées de puissance et de pathos, une musique naturellement cantabile, digne,
rappelant ses splendides ballets, mais sous-tendue par le drame et le mystère,
empreinte du poids du destin et d’angoisse métaphysique. La symphonie n° 6 dite « Pathétique » pour clore ce cycle, composée en 1893, créée le 28 octobre de la même année,
quelques jours avant la mort du compositeur, le 6 novembre 1893. Une symphonie
qui prendra de ce fait une coloration tragique où se mêlent désespoir, amours
impossibles, culpabilité et pressentiment funeste. Une forme atypique se
concluant par un long adagio se déployant comme un chant d’adieu… Daniele Gatti nous en livra une lecture très aboutie,
engagée, alliant désolation et lyrisme, parfaitement dans l’esprit de l’œuvre,
concluant son cycle sur un triomphe mérité. En première partie, la Musique funèbre pour cordes « à la
mémoire de Béla Bartók » donnait le ton de la soirée. Une œuvre
magnifique de Witold Lutoslawski (1913-1994),
composée en 1954, associant, là encore, désespoir et méditation, que la
sonorité un peu âpre des cordes du « National » rendit excellemment,
faisant montre d’une précision rythmique et d’une virtuosité sans faille. Seul
élément un peu festif de ce concert marqué du sceau de la désolation, le Concerto pour violon et orchestre (1905)
de Sibelius, interprété par le violoniste américain Joshua Bell. Une prestation
époustouflante comme rarement entendue, sans pathos (!), tendue, vibrante,
engagée, presque violente par instant, virtuose, expressive, habitée de bout en
bout, où la sonorité exceptionnelle du mythique Gibson-Huberman Stradivarius de 1713 de Joshua Bell répondit avec un bonheur extrême aux assauts orchestraux du
« National » mené de main de maître par le chef milanais.
Magistral !
Patrice Imbaud.
Naufrage
d'un Fidelio au Théâtre des Champs-Elysées.
Ludwig
van Beethoven : Fidelio. Opéra en deux actes.
Livret de Joseph Sonnleithner et Friedrich Treischke d’après Léonore
ou l’amour conjugal de Jean-Nicolas Bouilly. Malin Byström, Joseph Kaiser, Sophie Karthäuser,
Andrew Foster-Williams, Robert Gleadow, Michael
Colvin, Mischa Schelomianski. Choeur de chambre Les Eléments. Le Cercle de l'Harmonie, dir. Jérémie Rhorer. Version de
concert.

Jérémie Rhorer/ DR
Fidelio, opéra unique de
Beethoven, méritait assurément mieux que le traitement qui lui fut infligé par
Jérémie Rhorer à la tête de ses troupes du Cercle de
l’Harmonie. Une prestation calamiteuse, frisant l’amateurisme, où se sont succédés décalages instrumentaux, défaut de justesse,
sonorité terne, absence de nuances, tempi inadaptés, direction brouillonne et
hystérique, pour un résultat musical confus et décevant, fruit probable d’un
manque de préparation. Dans ces conditions, bien difficile de faire entendre sa
voix ! Force est d’avouer que l’ensemble de la distribution vocale fut
emportée dans ce naufrage où seul, peut- être, Robert Gleadow (Rocco) parvenait à sortir la tête de l’eau par sa puissance vocale, sa présence physique et la rondeur de son
timbre. Malin Byström (Leonore)
chanta les notes mais son chant parut constamment rigide, figé, comme emprunté.
Son grand air fut totalement gâché, ce qui n’aide pas, par un solo de cor digne
des plus mauvaises harmonies municipales… Joseph Kaiser (Florestan)
fut en permanence à la peine, le souffle court, à l’extrême limite de ses
possibilités dans l’aigu. Andrew Foster-Williams (Pizarro) lutta inlassablement
et de façon parfaitement vaine contre les torrents orchestraux accompagnant ses
colères. Mischa Schelomianski (Fernando) se montra inexistant vocalement et sans charisme scéniquement. Sophie Karthaüser (Marzelline)
déçut par son timbre métallique et son émission étriquée, répondant au faible Jaquino de Michael Colvin. Les
ensembles vocaux, pourtant sublimes, ne firent que confirmer les faiblesses
individuelles en les majorant, confirmant ainsi le manque de répétition : décalages constants, confusion…
Seul le Chœur de chambre les éléments fut exempt de toute critique, semblant se
demander ce qu’il faisait dans cette galère ! Un naufrage à oublier
rapidement !
Patrice Imbaud.
La scala di seta ou la conclusion festive
du festival Rossini au Théâtre des Champs-Elysées
Gioachino Rossini : La scala di seta. Farce comique en un acte. Livret de Giuseppe Maria
Foppa. Irina Dubrovskaya, Bogdan Mihai,
Christian Senn, Rodion Pogossov,
Carine Séchaye, Enrico Casari Orchestre National d'Ile de France, dir. Enrique Mazzola.

Enrique Mazzola / DR
Ambiance festive pour La scala di seta (L'échelle de soie), dernier opus du festival
Rossini au Théâtre des Champs-Elysées, rondement mené par Enrique Mazzola à la tête de l’Orchestre National d’Ile de France,
servi par un casting vocal de grande
qualité. Ce petit ouvrage, largement inspiré d’Il Matrimonio segreto de Cimarosa, fut longtemps délaissé et partiellement méconnu, ne devant sa
réapparition sur les scènes lyriques qu’à la redécouverte de la partition
autographe en 1973. Heureuse découverte qui nous permit d’entendre dans sa
version originelle ce petit bijou belcantiste, créé à Venise au Teatro San Moisè le 9 mai 1812,
Rossini avait alors vingt ans ! On
retiendra de cette œuvre la remarquable Ouverture où s’exprime déjà l’appétence
du maître de Pesaro pour la virtuosité des vents (hautbois et clarinette) ainsi
que l’originalité et le génie précoce de Rossini dans l’écriture des voix avec
de magnifiques ensembles vocaux comme le quatuor comique « Si che unito a cara sposa » ou
encore l’air brillant du ténor « Vedro qual incanto »,
les couplets de Lucilla « sento talor nell’anima » et la grande scène de Giulia « Il mio ben sospiro », sans
oublier le valet Germano, personnage le
plus singulier de la farce, qui déploie, ici, toutes les ressources drolatiques
de la basse bouffe rossinienne de haut vol. Bref, une petite farce contenant en
germe tout le Rossini futur et une heureuse conclusion pour ce festival, au
demeurant fort réussi. Il faut bien reconnaitre que chacun participa de bon
cœur à la fête. L’orchestre rutilant, parfaitement en phase avec les chanteurs
et l’intrigue, chef et musiciens ne rechignant pas à prendre part à la farce
dans cette mise en situation des plus réussies avec, pourtant, le peu de moyens
qu’impose une version de concert ! Une distribution vocale de tout premier
ordre : Irina Dubrovskaya (Giulia)
à la vocalité facile, claire et puissante, Bogdan Mihai (Dorvil) ténor au timbre lumineux, et Christian Senn,
irrésistible en Germano. Un ton en dessous, Rodion Pogossov (Blansac) et Carine Séchaye (Lucilla). Une soirée
triomphale pour conclure ce beau festival Rossini.
Patrice Imbaud.
Hommage à
Henri Dutilleux à la Cité de la musique

DR
Le compositeur Henri Dutilleux est disparu
il y a juste un an. C’était une des figures les plus importantes de la musique
contemporaine de la deuxième moitié du XXème siècle. La Cité de la Musique a eu
la bonne idée de programmer quelques œuvres majeures de ce musicien et des
tables rondes pour mieux le faire connaître et apprécier. Lors d'un premier
concert, le Quatuor les Dissonances a interprété « Ainsi la Nuit ».
C’était au départ une succession de cinq études pour quatuor à cordes. Ce
projet initial, daté de 1974, a donné lieu à un prolongement de l’écriture vers
une organisation de l’œuvre en un ensemble de « sept sections reliées pour la plupart les unes aux autres par des
parenthèses souvent très brèves mais importantes pour le rôle organique qui
leur est dévolu », précise Dutilleux, qui ajoute dans la préface de sa
partition « Des allusions à ce qui
va suivre - ou ce qui précède - s’y trouve placées et elles se situent comme
autant de point de repères ». Aujourd’hui, ce quatuor fait partie du
répertoire, il est devenu un classique au même titre que la plupart des œuvres
de cet immense compositeur. Le Quatuor les Dissonances l’a abordé avec beaucoup
de gravité, peut-être avec plus d’émotion que d’habitude. Cette musique abrupte
et en même temps d’une facilité d’écoute a été accueillie dans un silence
impressionnant dans cette salle où l’acoustique nous permet d’en apprécier
toutes les nuances. C’est une œuvre où chaque interprète a son chemin musical
bien particulier et la difficulté réside d’arriver à unir ces quatre discours,
d’où la complexité extrême de la jouer. Les quatre interprètes ont fait une
belle démonstration de leur qualité d’instrumentiste. L’orchestre Les
Dissonances, qui existe depuis une dizaine d’années, a enchaîné avec
« Mystère de l’Instant ». Cette œuvre, commande de Paul Sacher, fut
créée en 1989. Il n’y a pas mystère à dire que Dutilleux était un Debussyste
convaincu. Les références à ce musicien, à la peinture impressionniste, à la
littérature de Baudelaire sont des concordances de pensées que l’on trouve dans
cette œuvre et dans plusieurs autres compositions. « Mystère de
l’Instant » est une succession d’instantanés, de séquences de proportions
variables avec des types de matières sonores qui ne répondent à aucun canevas
préétabli. C'est un kaléidoscope d’impressions, qui engendre, comme le dit le
compositeur, la « spatialisation
imaginaire de la matière sonore ». L’orchestre atypique les
Dissonances, sans vrai chef d’orchestre mais avec un premier violon très
présent en la personne de David Gaillard, a pris l'œuvre avec beaucoup
d’imagination et l’a portée jusqu’à l’embrassement final avec conviction et
enthousiasme.

François-Xavier
Roth / DR
Un autre concert proposait « Muss es sein », « Pièce sans titre », interprétée pour la première fois le 28
septembre 2000 par l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo sous la direction
de Marek Janowski. Cette œuvre a été commandée par la
Fondation Prince Pierre de Monaco. Pour Dutilleux c’était une pièce pour
inciter l’auditeur à un sentiment de recueillement. Elle est très courte et
écrite sans la présence des violons. Elle privilégie des effets
d’instrumentation assez étonnants et donne des résultats acoustiques
saisissants. Elle a été jouée avant « Métaboles » et le concerto pour
violoncelle « Tout un Monde Lointain », comme pour annoncer la suite
du programme. Elle a donc mis le public dans un état d’écoute particulier.
L’orchestre Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth a donné
ensuite « Métaboles », une œuvre compliquée. Il n’est pas aisé de
trouver une certaine cohésion dans cette œuvre qui est toujours en mouvement,
en déformation de la cellule initiale, un principe qu’aime Dutilleux. A vouloir
être trop le nez dans la partition, on peut perdre le sens de l’œuvre et sa
fulgurance, c’est l’écueil, et par moment l’orchestre s’est perdu. Gauthier Capuçon enchaîna avec le concerto pour violoncelle
« Tout un Monde Lointain ». C’est une œuvre qu’il interprète depuis
des années. Ici aussi l’écriture est très exigeante et de grande précision.
Elle demande une totale fusion entre le soliste et l’orchestre. Bien que très à
l’écoute du chef, Gauthier Capuçon paraissait jouer
seul. Pourtant, l’orchestre offrait une très belle sonorité et François-Xavier
Roth était très à l’aise dans la direction de l'œuvre. Malgré ces quelques
petits points de détail, cette hommage à notre plus
grand compositeur contemporain était à la hauteur de l'événement. A noter que ce concert est diffusé
gratuitement pendant six mois sur www.citedelamusiquelive.tv
Stéphane Loison.
Un
Concert Érotique !

DR
Après vingt-deux ans passés au service du
duc Vincenzo Gonzaga, Claudio Monteverdi quitte
Mantoue en 1612. Il obtient la direction de la chapelle ducale de San Marco de
Venise en 1613. Ce n’est que six ans plus tard qu’est publié le Settimo libro madrigali dédicacé à la duchesse de Mantoue. Ce livre tourne le dos aux précédents. Le
compositeur propose là un large éventail de dispositifs vocaux et instrumentaux
qui se révèlent être totalement nouveaux. Le recueil comprend vingt-neuf
compositions savamment mises en ordre. Dès l’écoute de la première pièce la polyphonie fait place à la monodie,
la voix se mêle aux instruments. C’est Paul Agnew qui
dirige les Arts Florissants, ce concert s’inscrivant dans le cadre d’une
intégrale des madrigaux de Monteverdi présentés sur quatre saisons par ces
interprètes. Cet artiste de renommée internationale est dès 1992 l’interprète
privilégié des rôles de haute-contre du répertoire baroque français, aux côtés
de William Christie. Il se produit sous la direction de Marc Minkowski, Ton Kopman, Jean-Claude Malgloire,
John Eliot Gardiner… C’est en 2007 qu’il prend une nouvelle voie et assure la
direction musicale de certains projets des Arts Florissants. Cette intégrale
des madrigaux fait partie de ces projets. Duos, trios, quatuors, c’est une
succession de bijoux baroques qu’on a plaisir à
entendre, dont le magnifique « Se pur destina e vole » pour voix
seule. Le ténor Zachary Wilder en donne une interprétation émouvante et d’une
exceptionnelle expressivité. On a pu entendre chanter ce ténor américain, en
résidence à Paris, sur de nombreuses scènes internationales. La fin du recueil
propose des compositions d’une grande originalité dont deux monodies, deux
lettres d’amour, émaillées de sentiments contradictoires et passionnés, entre
douleur et bonheur. La toute jeune contralto Lucile Richardot est très émouvante dans cette lettera amorosa « Se I languidi miei sguardi ». Le recueil
s’achève en apothéose avec tous les membres de l’orchestre et tous les
chanteurs dans un ballo « Tisi e Clori ». C’est avec une grande précision,
simplicité, cohésion, que Paul Agnew, ses chanteurs,
ses musiciens ont fait « suonare » ce très
beau et émouvant « Concerto, Settimo libro de Madrigali ». A l’année prochaine pour le dernier libro
qui parle de guerre et d’amour…On pourra suivre ce concert sur la chaîne culturebox.
Stéphane Loison.
***
L'EDITION MUSICALE
FORMATION
MUSICALE
DIVERS
AUTEURS : Tour de chants. Livre de
mélodies recueillies par Jean-Clément Jollet. Vol. 9.
Cycle 3. 1 vol. 1 CD. Billaudot : G 8634 B.
On est vraiment
impressionné par l’éclectisme du choix proposé par J-C. Jollet.
Certes, on y trouve Bach et Rossini, mais également Poulenc, Chausson, Wolf et
bien d’autres certainement moins connus de nos élèves. Comme dans les volumes
précédents, chaque œuvre est précédée d’une mise en voix indispensable. Le CD
ne contient pas moins de 63 plages d’accompagnement pour ces 19 mélodies :
toutes les « mises en voix » sont également accompagnées. Ajoutons
que l’enregistrement a été fait par Philippe Lefèvre, c’est en dire la qualité.
C’est un régal musical… Cet ouvrage est donc à recommander chaudement comme
tous ceux de cette collection.

Marie-Hélène
SICILIANO : Faisons de la musique en
F.M. Vol. 1. 1 vol. 1 CD. Hcube (Lemoine) : HC49.
Marie-Hélène Siciliano a raison de dire qu’elle
propose une manière nouvelle d’aborder les différents domaines de la première
année de Formation Musicale. On ne peut que souscrire au titre de sa méthode.
Même si il est possible de rester dubitatif devant tel ou tel parti-pris
(notamment pour la lecture des notes), nous nous garderons bien de critiquer a
priori une méthode que nous n’avons pas expérimentée. Il y a de toute façon
énormément de choses positives, ne serait-ce que l’utilisation de l’instrument
en classe de FM, et le remarquable CD qui fournit à la fois un support à
certains exercices de la méthode et une ouverture sur les répertoires les plus
variés (classique, jazz, musique contemporaine). Il s’agit donc d’une méthode
qui ne peut laisser indifférent.

Marguerite
LABROUSSE & Jean-Paul DESPAX : Atout
Rythme. 3ème cycle et cycle spécialisé. Lemoine :
29 130 HL.
Voici un ouvrage précieux
et rédigé par des praticiens éprouvés. Le grand mérite de ce copieux volume est
de ne jamais séparer le rythme de la musique et de se garder d’en faire un
exercice abstrait et mécanique. Les conseils de mise en œuvre donnés par les
auteurs sont fondamentaux pour tirer le meilleur de cet ouvrage qui est fait
d’abord pour former des musiciens.

CHANT
Leonello CAPODAGLIO : Trois poèmes pour voix et piano. Fortin-Armiane : EFA 75.
Quelle belle et délicate musique
à la hauteur des textes et qui les met si bien en valeur. Successivement, voici Le soleil blanc de Paul Eluard, Il s’est tu de Henri Barbusse et Avril de Gérard de
Nerval. Que dire de plus ? Voici une œuvre qui fait du bien… On souhaite
que ces trois mélodies soient très vite au répertoire de nos chanteurs,
d’autant plus qu’elles sont techniquement très abordables.

CHANT
CHORAL
Sophie
ROUSSEAU : Chansons pour mener la
danse. Polyphonies et monodies. Recueil de danseries. Delatour :
DLT2394.
Ce recueil réunit deux
recueils précédemment publiés. A la fois savant par la qualité des textes
établis et la clarté de leur présentation, et remarquablement pratique, ces
recueils sont avant tout destinés à une mise en œuvre par des chanteurs et des
danseurs : textes originaux, transcription moderne à trois ou quatre voix,
chorégraphies, notions d’interprétation et de prononciation, tout est fait pour
faciliter l’exécution de ces « standards » de la Renaissance.

PIANO
Austin
WINTORY : Journey. Extraits de la bande originale du jeu
vidéo. Arrangé pour piano solo par Laura Intravia.
Alfred : 41091.
Les amateurs du jeu retrouveront avec plaisir leurs
thèmes musicaux favoris. Les autres pourront les découvrir car ils ne sont pas
sans intérêt. L’ensemble est de difficulté moyenne.

Daniel ROSENBERG : Minecraft – Volume alpha. Sélection de morceaux extraits de la
bande originale du jeu vidéo. Alfred : 42252.
Cet album permettra aux
pianistes moyens de recréer l’ambiance du jeu vidéo. Les arrangements sont très
bien faits, ni trop simples ni trop compliqués. Et, comme pour le précédent, si
on ne possède pas le jeu vidéo, on peut toujours aller écouter la musique
originale sur You tube.

SMETANA : Die Moldau pour piano à quatre mains. Urtext. Edité par Hugh Macdonald, avec une préface
d'Olga Mojžíšová. Bärenreiter : BA 9549.
Cette transcription pour
piano à quatre mains a été réalisée par Smetana lui-même, ce qui lui confère
une valeur particulière. L’auteur de la préface nous rappelle à juste titre que
ces transcriptions n’étaient pas essentiellement faites pour être jouées en
concert mais constituaient, à une époque où l’enregistrement sonore n’existait
pas, le seul moyen de faire connaître une œuvre dans les provinces : peu
de villes pouvaient se permettre d’avoir un orchestre symphonique. De plus, au
XIX° siècle, le piano se diffuse dans tous les salons et l’on se doit, dans la
grande et petite bourgeoisie, de jouer convenablement de cet instrument. De nos
jours, certes, nous bénéficions des enregistrements des œuvres. Mais les
connaître à travers ces transcriptions à quatre mains n’est pas
superflu et permet de mieux pénétrer les intentions de l’auteur et la
structure de l’œuvre.

BRAHMS : Variationen und Fuge über ein Thema von Händelop. 24 pour piano. Urtext. Bärenreiter :
BA9607.
Cette édition très soignée
et très claire est précédée d’une préface tout à fait intéressante de Christian Köhn qui a également doigté la partition. Après avoir
présenté la genèse de l’œuvre, celui-ci en fait une analyse et donne ensuite
des conseils pour l’interprétation. Bien sûr, des notes détaillées permettent
de comprendre les options de l’éditeur.

SATIE : 3 morceaux en forme de poire (à
quatre mains) avec une Manière de Commencement, une prolongation du même &
Un En Plus, suivi d’une Redite. Urtext. Bärenreiter : BA 10809.
Certes, on est un peu
déçu, après une couverture trilingue, de ne trouver préface, indications
d’interprétation et glossaire que dans la langue de Goethe et celle de
Shakespeare. Les éditions Bärenreiter nous avait
habitués à ce que la langue de Molière soit aussi employée pour la musique
française… Ceci dit, ne boudons pas notre plaisir : l’édition est soignée
et les présentations intéressantes et judicieuses.

Célino BRATTI : Sonatine pour Wippypour piano.
Elémentaire. Lafitan : P.L.2593.
Dans une harmonie très
« début de siècle » (le XX°, évidemment), de très jolies et très
fraiches mélodies se déroulent, qui demandent une finesse de toucher et de
phrasé qui départageront immédiatement les interprètes. Il y a donc beaucoup de
charme et de délicatesse dans cette œuvre au parfum un peu suranné mais si
envoutant…

Arletta
ELSAYARY : Profundum Maris pour piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2787.
Flots grondants,
ondulants, gouttes d’écume, tous les paysages marins se succèdent au profond de
la mer. Le jeune interprète devra, pour rendre pleinement justice à cette
œuvre, faire preuve d’imagination et d’un sens certain du maniement des timbres
sur son instrument.

Arletta
ELSAYARY : Trois danses polonaises pour
piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2728.
De caractère fort
différent, mais bien polonais, ces trois danses évoquent chacune un aspect de
ces danses si typiques. On y retrouve bien sûr le rythme de mazurka, mais pas
seulement… C’est un peu l’âme de la Pologne qu’Arletta Elsayary réussit à nous transmettre. Et ce sera une excellente transition vers d’autres
danses polonaises d’un certain Chopin…

GUITARE
Jean-Pierre
SEMERARO : Fleurs d’automne. Pièce
pour guitare. 1er cycle. Lafitan :
P.L.2726.
Ces charmantes fleurs
permettront au guitariste de montrer qu’il est capable de se dédoubler pour
jouer une véritable mélodie accompagnée. Ce n’est pas si facile et suppose
qu’on a une écoute intérieure structurée, autrement dit, qu’on est musicien. Quoi
qu’il en soit, ces fleurs d’automne sont fort jolies.

VIOLON
Alain Louvier : Air
enfantin et variations. Duo de violon. Dhalmann :
ISMN: 9790560244280.
La « note de
l’auteur » présente mieux la pièce que tout autre commentaire :
« Ce duo pour deux violons
est conçu pour être abordable en 2è cycle de violon (6 à 8 ans d’étude
environ). Les deux violons ont des parties de difficultés comparables sur
l’ensemble de la partition.
Néanmoins, certains
passages pourraient être abordés à la fin du 1er cycle :
- le début avec l’Air joué
deux fois (mesure 1 à 18)
- la Variation 5 (mesure
49 à 55)
On pourrait dans ce cas
enchaîner ces deux extraits.
Cette œuvre est dédiée à
ma petite fille Ariane (9 ans) qui, sur le chemin de l’école, chantait cette
mélodie toute spontanée.
Note pour
l’exécution : On devra accorder les instruments ainsi :- Violon 1 : sol
+¼ de ton, mi -¼ de ton (ré et la normaux) - Violon 2 : ré +¼ de ton, la
+¼ de ton, sol et mi normaux.
Il est recommandé
d’utiliser la partition en doigtés habituels, une flèche avant une note (ou sur
tout un passage) indiquant l’effet de la scordatura,
qui ne doit pas perturber le doigté indiqué. ».

Jean-François
PAULÉAT : Caprice pour violon et
piano. Niveau moyen. Delatour : DLT2245.
Ce joli Caprice commence par une longue
introduction au violon seul, d’un caractère énergique et agreste. Puis piano et
violon dialoguent en s’échangeant le thème, d’abord en mineur puis en majeur.
Le tout est très varié et plein de charme. On peut écouter l’ensemble sur le site
de l’éditeur.

Jean-François
PAULÉAT : Sérénade pour violon
et piano. Niveau moyen. Delatour : DLT2219.
On pourrait dire que cette
pièce est la sœur de la précédente. On peut d’ailleurs les jouer à la suite
l’une de l’autre. Cette fois, violon et piano vont immédiatement de concert.
L’ensemble se présente très vite comme un double thème et variations. Très
expressive et très poétique, cette Sérénade devrait charmer ses interprètes… et leur public !

CONTREBASSE
Daniel
MASSARD : La contrebasse dans
l’orchestre. Méthode basée sur les traits d’orchestre. Cycle 1. Combre : CO 5767.
Contrebassiste au sein de
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse ainsi que professeur au CRD de
Montauban, l’auteur fait profiter les jeunes contrebassistes à la fois de son
expérience de musicien d’orchestre et de pédagogue. Bien loin des exercices
arides, cette méthode ne contient, même pour les études techniques
préparatoires, que des textes tirés des meilleurs auteurs. Chacun est présenté
et mis en situation. Il ne reste plus à l’élève qu’à aller écouter l’œuvre mais
c’est si facile à l’heure actuelle ! Bref, on ne saurait trop recommander
cette approche profondément musicale de l’instrument.

HAUTBOIS
Bernard
de VIENNE : Dual. Pour deux
hautbois. Fin cycle 2, début cycle 3. Dhalmann :
FD0298.
L’auteur précise qu’il
s’agit d’une véritable œuvre « au sens formel du terme ». Et il
ajoute : « Une grande exigence est requise ici et les instrumentistes
devront veiller à jouer très précisément ce qui est noté sur la partition, dans
le moindre détail, sans ajouter quoi que ce soit et avec sensibilité. »
L’œuvre se déroule dans un mouvement vif et joyeux et est pleine de contrastes
et de surprises.

SAXOPHONE
Francis
COITEUX : Maloula pour saxophone alto et piano. 1er cycle. Sempre più : SP0098.
Le titre de cette jolie
pièce est-il le nom de ce village syrien qui a connu des heures si
douloureuses ? On pourrait le penser devant cet allegretto cantabile aux
rythmes et accents orientaux. Quoi qu’il en soit, l’œuvre est vraiment très
belle et mérite d’être connue et jouée. Elle montre une fois de plus qu’on peut
écrire pour un petit niveau en faisant de la belle et bonne musique…

BASSON
Francis
COITEUX : Jeux à marée basse pour
basson et piano. Premier cycle. Sempre più :
SP0099.
Ces jeux divers forment
comme une petite sonate dont les mouvements s’enchaînent. A un Allegro deciso fort bien venu avec un thème qui a des allures de
chanson populaire succède un Andante cantabile qui évoquerait plutôt la sieste
pour déboucher sur un Allegro scherzando qui clôt ces jeux d’une manière tout à
fait vigoureuse. Il s’agit donc d’une pièce variée, fort agréable et pleine de
charmants imprévus.

TROMPETTE
Pierre-Richard
DESHAYS : L’énigme suisse pour
trompette et piano. Deuxième cycle. Sempre più :
SP0094.
De quelle énigme
s’agit-il ? Le saurons-nous jamais… Ce qui est sûr, c’est que l’auteur
nous invite à un très agréable voyage en chemin de fer aussi varié que
plaisant. Il s’agit d’une musique joyeuse et rythmée qui devrait beaucoup
plaire.

SAXHORN/EUPHONIUM/TUBA
Rémi
MAUPETIT : Angel pour saxhorn
basse/euphonium/tuba et piano. Niveau 1er cycle, 1ère année. Lafitan : P.L.2767.
Voici une jolie pièce
pleine de charme. Une mélodie pleine de grâce se déroule tandis que le piano
égrène ses arpèges soutenus par des octaves à la basse. Bref, on est séduit par
la tranquille beauté de cette pièce pour débutant.

PERCUSSIONS
Grégory
VANDENBROUCKE : Redondance pour
percussions et piano. Niveau préparatoire. Lafitan :
P.L.2690.
Voici une
« redondance » bien sympathique : piano et percussions (caisse
claire, tom basse et cymbale suspendue) dialoguent, se complètent dans un
rythme allant et dynamique. La tonalité de la mineur ajoute un rien de
nostalgie au discours. Bref, l’ensemble est bien agréable.

David
LEFEBVRE : Xylotude n° 3 pour xylophone et piano. Débutant. Lafitan : P.L.2722.
Cette petite étude sans
prétention propose une petite mélodie simple mais non sans charme soutenue par
un accompagnement de piano extrêmement simple et dépouillé qui permettra de
faire appel à un pianiste également débutant ou peu avancé. Ce sera, pour les
deux interprètes, une excellente initiation à la musique d’ensemble.

Joe
ZAWINUL : Mercy, mercy. Arrangé pour Mallet Ensemble, guitare basse et Drumset par Oliver Molina. Alfred : 40962.
Cet arrangement suppose
sept exécutants. Il est très fidèle à la composition d’origine. On appréciera
notamment la complexité de la section rythmique. Il y a là beaucoup de plaisir
en perspective pour une classe de percussions.

Régis
FAMELART : AOLN. Percussion
solo. Dhalmann : FD0371.
Cette pièce difficile
demande à l’instrumentiste de faire preuve d’une réelle virtuosité. L’ensemble
joue avec bonheur sur les contrastes de timbres et de rythmes.

Chin-Cheng LIN : Wind 2. Duo de
Marimbas.Dhalmann : FD0278.
Cette pièce lyrique met en
valeur à part égale les deux instrumentistes. Assez difficile, elle devrait
leur donner beaucoup de plaisir par la richesse de ses harmonies et ses
mélodies délicates. On pourra d’ailleurs écouter la pièce à l’adresse
http://www.youtube.com/watch?v=2PeQ-FwkW8s

MUSIQUE
D’ENSEMBLE
Bruno
GINER : Ritorno. Duo pour flûte en sol et vibraphone. Dhalmann : FD00353.
Cette pièce difficile fait
appel à toutes les techniques contemporaines. Elle met en valeur l’expressivité
et les timbres variés que sont susceptibles de fournir les deux instruments.

Jean-François
PAULÉAT : Becs & ongles pour
quatuor de flûtes à bec (3 sopranos, 1 alto), piano et congas. Delatour : DLT2253. Pour quatuor de clarinettes (en si
bémol) : DLT2257. Pour quatuor de saxophones (1 soprano, 2 altos, 1
ténor) : DLT2258.
Cette courte pièce est
bien agréable et bien rafraichissante. On pourrait, dans une audition,
envisager de jouer les trois versions à la suite ; pas ensemble : les
tonalités diffèrent ! Un tempo allant s’allie à un air guilleret qui passe
d’instrument en instrument puis s’exprime en tutti et se termine en feu
d’artifice. La difficulté est moyenne mais les instrumentistes devront faire
preuve d’un bon sens rythmique, surtout le pianiste. Ne parlons pas du
percussionniste pour qui cela va de soi ! Précisons que la version pour
flûtes à bec est écoutable sur le site de l’éditeur.



Jean-François
PAULÉAT : Perc’fusion. 1ère trilogie pour 7
musiciens (piano, clavier, 4 percussions et batterie). Moyenne difficulté. Delatour : DLT2295.
La pièce est construite
autour du piano qui est quasiment l’instrument soliste. Chaque pièce évoque une
ambiance différente : flânerie dans un parc, danse tribale, plage au
soleil… bref, il s’agit d’une agréable invitation au voyage.

Jean-François
PAULÉAT : Perc’fusion. 2ème trilogie pour 9
musiciens (piano, clavier, guitare, 5
percussions et batterie). Moyenne difficulté. Delatour :
DLT2296.
Cette deuxième trilogie a
été écrite dans le même esprit que la première : le piano y joue toujours
un rôle prédominant. Mais cette fois-ci, la couleur est très volontairement
exotique, mêlant Afrique, Caraïbes, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Cuba, etc…dans une joyeuse ambiance cosmopolite.

Johann Sebastian BACH : Quatre danses pour quintette à cordes. Delatour :
DLT2391.
C’est une excellente idée
de transcrire et d’adapter pour quintette à cordes ces quatre pièces extraites
du Petit livre d’Anna Magdalena Bach. Nous ne chicanerons pas sur l’attribution
au Cantor de ces petites danses, attribution sur laquelle le transcripteur
revient fort judicieusement en quatrième de couverture. Quoi qu’il en soit, la
transcription de Régis Prudhomme est à la fois fidèle et inventive. Et de plus,
elle n’offre pas de grandes difficultés : ce sera l’occasion de faire
découvrir aux élèves des classes de cordes les joies et les bienfaits de la
musique de chambre.

Johan Sebastian BACH : Quatre danses pour consort de violes de gambe. Arrangement pour
deux dessus de viole et deux basses de viole. Delatour :
DLT2392.
Il s’agit des mêmes
arrangements que ci-dessus mais, cette fois, pour consort de violes ou,
pourquoi pas, pour quatuor à cordes. On y trouve les mêmes qualités que
ci-dessus et on ne peut que se réjouir de ce travail qui fera découvrir à
d’autres instrumentistes des œuvres faciles et plaisantes que pianistes et
clavecinistes affectionnent.

Antonin
SERVIÈRE : Car je croyais ouïr (…) pour
cor et trio à cordes. Delatour : DLT2334.
Tout le monde aura reconnu
dans le titre l’allusion au poème de Vigny Le
Cor
« Car je croyais ouïr
de ces bruits prophétiques
Qui précédaient la mort
des Paladins antiques. ».
C’est cette ambiance
romantique et sylvestre que s’efforce d’évoquer cette pièce difficile qui fait
appel à toutes les techniques de jeu contemporaines.

***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Frédéric de LA GRANDVILLE : Une histoire du piano au Conservatoire de
musique de Paris. 1795-1850. Paris, L’Harmattan (www.harmattan.fr ), 2014, 291 p. – 30 €.
Le Conservatoire de
Musique a été créé le 3 août 1795 par la fusion entre l’école Royale de chant
(François-Joseph Gossec) remontant à 1784 et l’Institut National de Musique (de
Bernard Sarrette) de 1792 avec, pour objectif, de former des chanteurs et des
clavecinistes. En fin connaisseur et s’appuyant sur de minutieuses recherches
d’archives, Frédéric de La Grandville a en rédigé une histoire institutionnelle
à partir d’un critère : le piano (instruments, facture, professeurs,
élèves, exercices et concerts…) pendant plus d’un demi-siècle d’activités. Il
relate la vie du Conservatoire au fil des années, précise que, sous l’angle
administratif, il dépendait depuis 1785 du Ministère de l’Intérieur. Les
lecteurs trouveront de nombreux renseignements concernant la réglementation des
classes de piano, les enseignants (carrières, salaires), leurs élèves
(statistiques), l’inspection des classes, les concours et jurys, ainsi que les
programmes interprétés lors des distributions des Prix. L’auteur localise ce
patrimoine instrumental en divers lieux, explique la facture des pianoforte et pianos, souligne la présence et le rôle du
piano lors des concerts du Conservatoire. Ce livre, qui s’impose par la clarté
du plan, la démarche logique et la méthode solide, aborde les problèmes avec
pertinence, par exemple : les élèves femmes, les élèves étrangers, le passage
objectif de la « musique militaire » à la « musique pour la
société », le rôle des pianistes : soliste, virtuose, accompagnateur
ou encore solfégiste et harmoniste. Il est complété
par une abondante iconographie et de nombreux documents : portraits,
signatures, façades, lettres, factures, emplois du temps, répertoire des
concours et exercices, état des pianos, registres matricules des élèves,
composition des jurys... De plus, Frédéric de La Grandville a eu l’excellente
idée d’interviewer quelques dames pianistes qui, avant 1912, ont fréquenté
l’ancien Conservatoire de la rue Bergère, notamment, en 1977, Aline von Barentzen, née en 1887 et
décédée en 1981 (p. 259). En conclusion, l’auteur dégage le « caractère
innovant de la création du Conservatoire » et démontre que « piano et
Conservatoire sont nés simultanément dans la conscience des Français » (p.
242). Les lecteurs apprécieront à plus d’un titre cet ouvrage sérieux, cette
démarche originale faisant preuve d’une grande curiosité d’esprit, et son
indéniable apport à l’histoire du Conservatoire à travers ses pianos pendant
plus d’un demi-siècle.

Édith Weber.
Nicolas
VIEL : La musique
et l’axiome. Création musicale et néo-positivisme au 20e siècle. Sampzon, DELATOUR FRANCE (www.editions-delatour.com ), Collection Musique/Sciences, 2014, 393
p. – 28 €.
La création musicale, son abord, sa
perception, sa finalité et sa compréhension à partir d’axiomes, figurent au
centre de cet ouvrage très dense, faisant appel à tant de concepts. Ce livre
retrace, en fait, leur histoire et leur succession, et illustre les
déplacements culturels dans la longue durée (plus d’un siècle) autour de la
notion de « calculabilité du musical ». L’axiomatisme succédera à la Gestalttheorie,
aux préoccupations de l’École de Vienne, à la théorie dodécaphonique et au
néo-positivisme. De nouveaux penseurs s’imposeront, par exemple le compositeur
américain Henry Cowell (1897-1965), le musicologue et
enseignant américain Charles Seeger (1886-1979). Abraham Moles (1920-1992), —
Ingénieur en acoustique (Université de Grenoble) et Docteur d’État en
Philosophie (La création scientifique dirigée, en Sorbonne, par Gaston Bachelard), l’un des précurseurs des sciences
de l’information — lancera la théorie de l’informatique et de la perception
esthétique, et influencera, entre autres, le compositeur français Tristan
Murail (*1947), vers la seconde moitié du XXe siècle. En France, cette période
verra aussi le retour du néo-positivisme avec Olivier Messiaen (1908-1992) et
Pierre Boulez (*1925), à côté du structuralisme de Pierre Schaeffer
(1910-1995), associé aux théories de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) —
spécialiste de la musique électroacoustique et de la spatialisation du son—,
sans oublier le physicalisme de Yannis Xenakis (1922-2001) — compositeur,
architecte et ingénieur — et la musique algorithmique pratiquée par Pierre Barbaud (1911-1990), l’un des premiers à utiliser
systématiquement l’ordinateur pour la composition musicale. Ce volume —
particulièrement dense et complexe — intéressera à plus d’un titre les
spécialistes de l’esthétique et de la perception musicales, les théoriciens et
mathématiciens, les compositeurs et créateurs, les psychologues et
comportementalistes. Il est complété par une bibliographie spécialisée, des
figures significatives, illustré par des graphiques musicaux très
représentatifs et des citations pertinentes. Comme l’a observé Jean-Marc Chouvel (Préface,
p. 9) : « Les axiomes dont il est question ici ne sont pas simplement
ceux d’un jeu de construction plus ou moins réussi. Ce sont surtout ceux qui
délimitent les conditions de possibilité d’un des arts les plus en prise avec
notre sensibilité et notre conscience. » Ce constat suscitera la réflexion
des lecteurs. Il en sera de même avec la conclusion prudente de Nicolas
Viel : « mais il ne sera pas dit ici que l’époque de la fascinante
synchronisation de la musique des humains sur le temps des machines fut une
bonne ou une mauvaise chose ». (p. 335). Le recul du temps devrait
trancher.

Édith
Weber.
Paul BADURA-SKODA : Dans
l'intimité des maîtres. Entretiens avec Antonin Scherrer. 1 vol 14x22
cm, La Bibliothèque des Arts, Lausanne (www.bibliotheque-des-arts.com),
166 p, 19 €.
Paul Badura-Skoda,
un des grands vétérans du piano, aime à se confier. N'est-il pas l'auteur de
nombreux articles et ouvrages, notamment sur l'Art de jouer Mozart au piano ?
Ses entretiens avec l'écrivain et chroniqueur musical suisse Antonin Scherrer
sont révélateurs d'une nature résolument optimiste et ouverte sur le monde.
Paul Badura-Skoda (*1927) aura traversé le XX ème siècle et en particulier connu les horizons sans
limites de l'immédiat après-guerre où les musiciens étaient accueillis à bras
ouverts. On pense aussi à ses collègues et amis Jörg Demus et Friedrich Gulda. Il a côtoyé les grands maîtres,
Cortot, pour lequel son admiration est grande, comme son amour pour la France
d'ailleurs, ou David Oïstrakh, « le roi David », dont l'art souverain
ne recherchait pas l'effet, et surtout Edwin Fischer, le maître et mentor, qui
rappelle-t-il, ne fut pas seulement un immense pianiste mais aussi un chef
d'orchestre vénéré par ses musiciens. Les compositeurs chers à son cœur ?
Mozart bien sûr, mais aussi Chopin, « un héritier du baroque », ou le
suisse Frank Martin avec lequel il noua une solide amitié qui lui valut de
créer plusieurs de ses œuvres. Au fil de ces entretiens, vivants et sans phare,
Paul Badura-Skoda livre son credo artistique et fait
sienne l'approche d'Edwin Fischer quant à la fidélité au texte, mais aussi à
l'adaptabilité au jeu moderne, pour « un respect absolu du texte sans
verser dans le dogmatisme sclérosant ». Lucide sur son art, il pense
qu'« il faut se renouveler pour ne pas reculer ». Et d'égratigner au
passage la carence d'imagination de ses jeunes collègues dans leurs choix
frileux de programmes de concerts. Pourtant, ces jeunes il leur a voué ses années
d'automne par son enseignement. Aux côtés de cette mission de transmission,
tout aussi essentiel est pour lui le travail d'édition, qui lui fait écrire
plusieurs cadences pour les concertos de piano de Mozart – ses récents disques
parus chez Transartlive attestent de la pertinence de
sa pensée. Il y a encore du chercheur chez lui en termes de facture
instrumentale. Sa collection d'instruments est une des plus riches du moment.
Mais nulle tentation « intégriste » de choix entre l'historique et le
moderne ne l'effleure, car l'interprète appartient à son temps et « joue
pour des auditeurs d'aujourd'hui ». Au demeurant, le raffinement du
toucher qu'autorisent le clavecin et le pianoforte, eu égard à leur faible
résistance, n'enrichit-il pas le jeu sur les pianos modernes ? Cet ouvrage est
essentiel en ce qu'il présente une expérience exceptionnelle de vie au service
de la musique, humble et sans concession, celle d'un homme qui maniant au
détour l'anecdote, ne se dépare jamais d'une vraie simplicité, apanage des grands.

Jean-Pierre Robert.
***
CDs et DVDs
« SILOS.
Portes du Ciel ». 1CD
JADE (www.jade-music.net) : 828-2. TT : 46’ 22.
En Castille, entre
le XIe et le XIIIe siècles, le Monastère de Santo
Domingo de Silos entretenait une école de copistes et de miniaturistes. Comme
l’Abbaye Saint-Pierre de Solesmes au XXe siècle, il a participé à la
renaissance du chant grégorien. Dans cette optique, entre 1956 et 1957, le
Chœur des Moines a réalisé une série d’enregistrements discographiques avec la
participation de jeunes moines formés au grégorien dès leur plus tendre
enfance. Elle a bénéficié de remastérisations (depuis
20 ans). Si l’émission vocale de Silos rappelle quelque peu celle de Solesmes
par sa suavité, elle gagne en spontanéité, vigueur et en dynamisme contenu. Le
programme sous-titré : Portes du
Ciel illustre des formes traditionnelles (composées dans les divers modes
d’église) : des antiennes, dont Paradisi portae/Eructavit, Facta est cum Angelo, Descendit… ; des hymnes : A solis Ortus Cardine de Caelius Sedulius (Ve siècle), Virgo Dei Genitrix, Vexilla Regis prodeunt… ; la célèbre séquence Victimae Paschali Laudes maintenue
par les Pères du Concile de Trente ; des extraits de messe : Kyrie XI, Gloria IX, Credo IV, Sanctus VIII (de la Messe des Anges), l’offertoire Ave
Maria ou encore l’Alleluia bien connu : Alleluia omnes gentes (en mode I), le trait : Absolve ;
les communions Gustate et videte et Lux Aeterna
et le répons Homo quidam. Belle
Anthologie de ce répertoire multiséculaire qui gagne à être relancé.

Édith
Weber.
«
L’Agneau Mystique ». 1
CD AQUARIUS PRODUCTION/JADE (www.jade-music.net) : 699
826-2. TT : 79’ 50.
Le programme de
cette coproduction AQUARIUS/JADE est centré autour de l’idée de L’Agneau Mystique évoquée en musique,
dans la longue durée, du Moyen-Âge à nos jours, aussi
bien en Allemagne qu’en Angleterre, Hongrie, Italie et France. Hildegard von Bingen (1098-1179)
exprime le miracle de la création dans O quam mirabilis est prescientiachanté
en souplesse par Mady Bonert. Le chant grégorien est
représenté, entre autres par l’Alleluia Hic est discipulus.
L’Agnus Dei est enregistré en 3
versions plus développées : celles de Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525/6-1594), Johannes Brahms (1833-1897) et Samuel Barber (1910-1981). Le
Psaume 122/121 : I was glad (Je suis dans la joie quand on me dit :
Allons à la maison de l’Éternel) de Henry Purcell (1659-1695) interprété
avec entrain, se termine par la Doxologie trinitaire. Plus proches de nous, le
verset Christus factus est pro nobis d’Anton Bruckner (1824-1896) côtoie l’incontournable Ave Maria de Giuseppe Verdi (1813-1901). Représentatifs du XXe
siècle : la version polyphonique du Veni, veni Emmanuel de Zoltan Kodaly
(1882-1967) dans la perspective de Noël, le Salve
Regina de Francis Poulenc (1899-1963) exploitant un large spectre vocal, le Magnificat avec quelques résonances
orthodoxes dû au compositeur estonien naturalisé autrichien Arvo Pärt (né en 1935). L’Amen du musicien polonais contemporain Henryk Gorecki (né en 1933) pose un lumineux point d’orgue
sur ces 17 différentes sources d’inspiration suscitées par le thème de l’Agneau
mystique.

Édith Weber.
« Cello con fuoco ». 1CD KLANGLOGO (www.klanglogo.de) : KL 1507. TT : 67’ 30.
Depuis un certain
temps, les éditeurs de disques privilégient des titres soit génériques, soit
énigmatiques : c’est le cas de Cello con fuocoqui propose plus d’une heure d’œuvres de Jean
Sébastien Bach, György Ligeti (1923-2006) et Zoltan
Kodaly (1882-1967), et permet d’écouter, en solo, la fougueuse violoncelliste Veronika Wilhelm, pleine de tempérament, d’où le
qualificatif : con fuoco. Née en 1971 à Schwerin, elle a fait ses études à
la Musikhochschule de Berlin, enseigné à Leipzig, est
actuellement violoncelle solo (remplaçante) à l’Orchestre du Gewandhaus de cette ville et membre de l’Orchestre du
Festival de Bayreuth. Le répertoire pour violoncelle solo n’est pas
abondant ; les premières références étant, bien entendu, les 6 Suites (Sei Solo à Violino senza Basso accompagnato) de
Jean Sébastien Bach (BWV 1007-1012), dans une conception novatrice pour
l’époque, mais renouant avec la tradition du XVIIe siècle. Il était alors
maître de chapelle à la Cour du Prince Leopold d’Anhalt-Cöthen. Veronika Wilhelm interprète la Cinquième Suite,
en do mineur (BWV 1011), en 7
mouvements issus de la danse selon l’usage ; elle leur confère un bel élan
et un caractère abstrait s’élevant des profondeurs avec une expressivité baroque
(notamment dans la Sarabande), et
ceci dans le plus grand respect du phrasé (Gigue).
Elle interprète également la Sonate pour
violoncelle solo (1948-1953) de György Ligeti, en
deux mouvements : Dialogo (plage 8), profond et mystérieux, plus
chantant, dans lequel le registre de basse expose son thème auquel répond celui
de ténor, et Capriccio (pl. 9)
faisant appel à la virtuosité et la vélocité. Quant à la Sonate pour violoncelle solo, op. 8 (1915) de Zoltan Kodaly, elle exige de nouvelles techniques :
percussion, en plus des cordes frottées et pincées. En parfaite connivence
esthétique et artistique avec son compatriote, Veronika Wilhelm tire le meilleur parti de cette redoutable œuvre, justifiant d’autant
plus le titre : Cello con fuoco donné par KLANGLOGO à cette incontournable réalisation.

Édith Weber.
Arthur HONEGGER : König David. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP 60 88. TT : 72’ 18.
Le Label leipzicois RONDEAU PRODUCTION propose un enregistrement particulièrement intéressant d’une
part avec le texte du Roi David en sa
version allemande (König David), et d’autre part, grâce à la
participation d’interprètes de tout premier plan tels que l’acteur Devid Striesow dans la fonction
de Récitant et l’actrice Irm Hermann dans le rôle de
la Sorcière. Par ailleurs, 3 solistes : Narine Yeghiyan (Soprano), Rowan Hellier (Alto) et Jan Remmers (Ténor) et le Junges Ensemble de Berlin assurent les parties vocales
accompagnées et soutenues par le Prometheus Ensemble
de cette ville. Arthur Honegger (1892-1955) a fourni plusieurs versions du
drame de l’écrivain et dramaturge vaudois René Morax (1873-1963). Le chef Frank Markowitsch a retenu celle pour 10 instruments à
vent, percussions, harmonium et célesta, conférant à l’ensemble une couleur
orchestrale très particulière. (Ce n’est que plus tard que le compositeur en a
réalisé la version bien connue pour orchestre symphonique). L’œuvre est
structurée en 3 parties et 27 tableaux. Une large part est réservée aux Psaumes et aux parties descriptives. Le
Récitant relate les événements au cours desquels les chanteurs
interprètent notamment un Psaume de louange et un chant célébrant la victoire
de David sur Goliath, puis d’autres Psaumes créent l’atmosphère et commentent l’action.
Différents protagonistes interviennent — dont la Pythonisse et la Servante. Aux
Lamentations de Guilboa, succèdent un Cantique de
fête et la célèbre Danse devant l’Arche,
point culminant de la partition. Le Couronnement
de Salomon marque un autre épisode important. Enfin, l’hymne, concernant la Mort de David fait allusion à la
Résurrection, au Paradis aboutissant à un vibrant Alleluia conclusif. Les
interprètes, s’investissant pleinement dans l’action et l’esprit de l’œuvre,
renforcent les effets dramatiques, sans négliger pour autant l’aspect lyrique
ou le contexte émotionnel. L’intérêt de cette version en allemand est
indéniable.

Édith Weber.
« Lost in transition ». Daarler Vocal Consort. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP 60 87. TT : 63’ 24.
Ce deuxième
enregistrement du Daarler Vocal Consort (sextuor) —
avec la participation d’Yvonne Zimmer (Soprano), de
Susanne Wagenmann (Mezzosoprano),
Marita Grasmück (Alto), Hermut Winkel (Ténor), Georg Grün (Baryton) et Stefan Paul ( Basse) — permet d’entendre des pages pour le moins
inattendues. Il est centré sur l’idée générale de la transition : « tout n’est que transition », titre du dernier morceau (plage 21).
En fait, pour sa composition éponyme, Georg Grün (né en 1960) s’est inspiré de
l’inscription figurant sur un pont à Vienne : « Alles ist nur Übergang… » « Tout n’est que transition…. Imprègne-toi de ces mots graves… La mort
est vie, la mort en est la porte : tout n’est que transition. »
Ce constat a donc déterminé le titre du disque sur les thèmes :
transition, mort, solitude, douleur... Le programme propose un vaste parcours
chronologique, avec, tout d’abord : le répons si douloureux des matines du
Samedi Saint : O vos omnesde Carlo Gesualdo (1566-1613) ; ensuite, le
verset Steh auf und nimm das Kindelein… (Matthieu,
2, verset 20) de Christoph Demantius (1567-1643), sur
les paroles de l’ange suggérant à Joseph de se rendre avec sa femme et l’enfant
en Israël. Les textes sont, d’une part, d’essence biblique (Évangile de Matthieu, Cantique des Cantiques) ; d’autre
part, de caractère plus lyrique (Johannes Scheffler (Angelus Silesius, 1624-1677) et
Hermann Hesse (1877-1962) — avec son poème Im Nebel, 1905). Ce CD présente également des
compositions romantiques de Peter Cornelius (1824-1874) et de Johannes
Brahms. Pour l’époque contemporaine, les mélomanes découvriront notamment
Wolfram Buchenberg (né en 1962), Kurt Bikkembergs (né en 1963), Jaako Mäntyärvi (né en 1963) et Ivan Moody (né en 1964). Une
mention spéciale pour la pièce : Lost in transition de Georg Grün, si impressionnante et intemporelle. Les chanteurs formant une
équipe équilibrée et soudée ont maîtrisé les traquenards techniques et se sont
adaptés à des esthétiques et des atmosphères si différentes émanant de ce
disque à thème autour du message philosophique et religieux : Tout n’est que transition.

Édith
Weber.
Claudio MONTEVERDI : Vespri solenni per la festa di San Marco ( Extrait des Vespri (1610)
et de la Selva Morale (1640, vol.1). Concerto Italiano, dir. : Rinaldo Alessandrini. 1CD Naive : OP 30557. TT.: 79'46.
Qu'on ne s'y méprenne pas, ces Vêpres sont
une reconstitution, imaginée par Rinaldo Alessandrini,
de ce qu'aurait pu être un office solennel dédié à la fête de San Marco à
Venise. Pour ce faire il utilise deux matériaux existants, les Vespri de 1610 et le recueil de la Selva
morale e spirituale de 1640. Ainsi structure-t-il
l'office en empruntant majoritairement aux psaumes de la Selva morale, tels le
« Beatus vir », le
« Laudate pueri »
ou le « Laudate Dominum »,
et au Magnificat à huit voix. Ces pièces vocales sont entrecoupées par des
sonates instrumentales de Gabrieli, Usper et Buonamente, ou d'extraits de motets de Monteverdi. Les
enchaînements sont magistraux. C'est le triomphe du faste pour glorifier Dieu,
à la différence de l'immobilité contemplative du langage en usage à la
Renaissance : la louange divine passe désormais par la richesse sonore autant
instrumentale que vocale. Une attention particulière a été portée à la
restitution de la fonction spatiale du son, qu'autorisait l'acoustique de San
Marco à Venise par le truchement de ses diverses tribunes. L'enregistrement a
ainsi été effectué dans la basilique Santa Barbara de Mantoue, dont
l'acoustique généreuse donne tout son sens à la splendeur sonore de ces pièces
; ce que Rinaldo Alessandrini qualifie d'« onde
sonore imposante » qui doit submerger l'auditeur. Les solistes vocaux et
instrumentaux du Concerto Italiano font honneur aux prouesses techniques et expressives
de ces pièces, et on admire la luxuriance des cuivres, cornets et trombones
rutilants, comme la virtuosité vocale. Le parti de distribuer un seul chanteur
par pupitre permet une extrême clarté et évite les effets de masse.

Jean-Pierre Robert.
Antonio VIVALDI : L'incoronazione di Dario. Dramma per musica en trois actes. Livet de Adriano Morselli. Sara Mingardo, Anders Dahlin, Delphine Galou, Roberta Mameli, Lucia Cirillo, Sofia Soloviy, Riccardo Novaro, Giuseppina Bridelli. Accademia Bizantina, dir. Ottavio Dantone. 3CDs Naïve : OP 30553. TT.: 64'32+68'55+43'50.
Ce nouvel opus de la collection opéra de
l'Édition Vivaldi de Naïve révèle une pièce aussi inconnue que passionnante.
Créé en 1717, au Teatro San Angelo de Venise, époque
faste sur la lagune pour Antonio Vivaldi, L'incoronazione di Dario (le couronnement de Darius) narre une curieuse histoire, tirée du
vieux fonds théâtral vénitien du drame pseudo historique : alors qu'à la mort
de Cyrus, roi de Perse, trois prétendants convoitent le trône, l'un d'eux,
Darius, propose que la couronne revienne à celui qui se fera épouser par Statira, la fille aînée du défunt. S'en suit un
enchevêtrement de situations conflictuelles qui vont diviser âmes et cœurs,
surtout grâce à la machination amoureuse ourdie par Argene,
la sœur cadette. Tout finira bien, après avoir frôlé la catastrophe prévisible.
Sur cette trame alambiquée, quoique déjà simplifiée par le librettiste Morselli, Vivaldi a conçu une musique finalement très
novatrice qui semble d'une inventivité inépuisable et brille d'un extrême
raffinement. Vivaldi offre là un exemple unique de son art de créer le juste
climat pour épouser le fait dramatique. Les récitatifs sont très développés eu
égard à la complexité de la trame, mais les arias rivalisent de variété, le
plus souvent dégagées du modèle da capo. Beaucoup sont construites sur une
forme concertante, rappelant la prolixité du compositeur de musique
instrumentale et de concertos. Ici, c'est la viole all'inglese,
dans l'évocation d'un chant d'amour, là, c'est la viole de gambe ou la flûte à
bec sur un accompagnement des violons en sourdine et un léger contrepoint de
basses, ou encore le basson associé au violone pour le plus piquant effet. Une
des plus merveilleuses arias est dévolue au personnage de Statira,
au III ème acte, où la voix roucoule dans le registre
piano avec le violon, là encore sur des cordes en sourdine, suprême alchimie
sonore. La profusion ne s'arrête pas à ces morceaux de choix : on trouve de
courts ariosos, pour de véritables petites scènes expressives, des duos, et
même des ensembles plus rares, comme ce terzetto des trois prétendants
invoquant le soleil pour savoir qui d'entre deux règnera sur l'Asie. La
présente interprétation, captée à la Musikfest de
Brême, en 2013, rend pleine justice à cette œuvre par une distribution
magnifique. S'en détachent les deux voix graves de Sara Mingardo, Statira, qui ajoute à un timbre mordoré une
profondeur expressive de tous les instants, et de Delphine Galou, Argene, l'intrigante, qui impose elle aussi un style
accompli au service d'un timbre tout aussi envoûtant. Anders Dahlin prête au rôle de Darius une voix de ténor aigu bien
conduite, et les sopranos font montre d'extrême agilité. Cette interprétation
doit beaucoup à la direction d'Ottavio Dantone, qui à
la tête des excellents solistes de l'Accademia Bizantina, délivre une manière naturelle de bouster le tempo, sans pour autant heurter le rythme, et
une aisance certaine du discours.

Jean-Pierre Robert.
George Friedrich HAENDEL : Orlando. Opéra en trois
actes. Livret anonyme d'après un canevas de Carlo Sigismondo Capece. Bejun Metha, Sophie Karthäuser,
Kristina Hammarström, Sunhae Im, Konstantin Wolff. B' Rock Orchestra Ghent, dir. René Jacobs. 2CDs Universal Archiv : 479 2199. TT.:
77'15+82'46.
Pourvue de la même distribution que celle
des représentations données à la Monnaie en 2012 (cf. NL de 6/2012), cette
version d'Orlando s'impose par sa haute tenue. Elle le doit d'abord à
l'élan que lui insuffle René Jacobs. Dans un de ses opéras les plus inspirés,
Haendel ne recycle pratiquement pas et offre une profusion d'arias d'une
désarmante beauté, de coupe da capo, bien sûr, quoique revisitée en une
étonnante diversité et d'une inventivité constamment renouvelée. L'opéra s'enorgueillit
encore de brillants duos. Celui, au dernier acte, entre Angelica et Orlando est
d'un effet très original puisqu'il unit deux modes, implorant chez la première,
vindicatif pour le second. Pour traiter le sujet, mille fois revisité à
l'époque, en particulier par Antonio Vivaldi et Josef Haydn, du « Roland
furieux » de l'Arioste, partagé entre amour et gloire, le saxon conçoit
une partition qui cultive le versant élégiaque et magique de l'histoire, auquel
la scène de folie d'Orlando apporte un contraste saisissant. René Jacobs offre une direction ample et pacifiée,
dont tout excès semble banni, dessinant avec amour la mélodie. Le continuo,
bien étoffé, est imaginatif et les appogiatures toujours originales. Les ornementations
vocales sont tout aussi soignées. La plénitude sonore du B' Rock Orchestra de
Gand répond au souci du chef d'une instrumentation très travaillée, même si ne
se voulant pas « historique ». Quelques bruitages judicieux rappellent que nous
sommes dans l'univers de la magie. Le quintette vocal frôle la perfection.
D'Orlando, créé par le castrat Senesino, Bejun Metha offre un portrait
d'une saisissante éloquence, en complète identification avec les affects
différenciés du personnage. L'agilité gracile de la vocalise n'a d'égale que
l'absolue pureté de la ligne de chant. Celle-ci trouve son apogée dans la
grande scène de folie de l'acte II, suite de morceaux enchaînés, récitatifs,
cavatine et aria. Quand le personnage se fait hyperbolique, le timbre
légèrement acidulé n'est pas sans rappeler celui de Dominique Visse. Une
interprétation de référence. Le soprano solaire de Sophie Karthäuser prête à Angelica des accents tragiques d'une force confondante. La Dorinda de Sunhae Im est piquante
à souhait, nullement maniérée, et le timbre sombre de Kristina Hammarström confère une grande richesse vocale au
personnage grandiose de Medoro. On a apporté un soin
particulier à l'agencement des récitatifs, contribuant à restituer au drame
musical le frisson de la représentation. Une incontestable réussite.

Jean-Pierre Robert.
Jean-Philippe RAMEAU : Les Indes galantes. Ballet héroïque en un Prologue et
quatre Entrées. Livret de Louis Fuzelier. Valérie Gabail, Stéphanie Révidat,
François-Nicolas Geslot, Reinoud van Mechelen, Aimery Lefèvre, Sydney Fierro. Le
Chœur du Marais. La Simphonie du Marais, dir. Hugo Reyne. 3CDs Musiques à
la Chabotterie : 605013. TT. : 77'21+ 58'21+65'46.
Cette version est la bienvenue car Les
Indes galantes n'avaient pas connu de nouvelle interprétation au disque
depuis quelques vingt ans. Son principal artisan est Hugo Reyne qui a mené un travail de fourmi pour retrouver la physionomie originelle d'une
des œuvres emblématiques de Rameau et renfermant ses plus belles pages
orchestrales. Reyne a réalisé sa propre édition complète,
basée sur les sources conservées à la bibliothèque de l'Opéra de Paris. Cette
nouvelle édition modifie l'ordre des pièces du Prologue et du ballet des Fleurs
de la III ème entrée, réintroduit une air de Bellone et rétablit l'intégralité du « Tremblement de terre »
qui clôt la fête du soleil au tableau des « Incas du Pérou ».
L'ambition est de retrouver le goût français pour ce que Claude Debussy
appelait « la clarté légère ». La direction rigoureuse se caractérise
en effet par l'extrême netteté des attaques et la précision dans les
articulations, ce qui permet au chant de s'épanouir naturellement et aux danses
de distiller leur profusion rythmique et mélodique. L'œuvre opère dans des
registres différents : de la tragi-comédie (« Le Turc généreux »), de
la tragédie (« Les Incas du Pérou »), du marivaudage (« Les
Fleurs »), et de ce que Sylvie Bouissou appelle la « comédie pacifique »
(« Les Sauvages»). Le continuo est traité avec un égal souci de densité
dramatique. La Simphonie du Marais, qui aligne une
formation peu nombreuse, favorise une sonorité transparente des cordes et
dispense des couleurs mirifiques aux bois. La flûte en particulier,
l'instrument favori de Reyne, se voit offrir un sort
enviable, souvent proche de l'effet hypnotique. Quand aux cuivres ils sont
resplendissants d'énergie. Depuis l'Ouverture à la française jusqu'à la vaste
Chaconne finale, on voyage dans un univers où triomphe une virtuosité
orchestrale aux climats sans cesse renouvelés. Reyne ménage les danses avec doigté, rendant justice à l'originalité de
l'orchestration et à sa modernité (le « Tremblement de terre » et sa
texture accidentée), à son raffinement extrême (Ballet des fleurs, aux
séquences si différenciées dans leurs rythmes divers) ou encore à ses modes originaux,
telle la « Danse du calumet », vrai tube du baroque français. Seul
manque peut-être, un certain mordant, pour ne pas dire ce clin d'œil gourmand
que sait insuffler un William Christie. Six chanteurs de la jeune génération,
rompus à la prosodie ramiste et à ses ornements
raffinés, se partagent l'affiche, nullement gênés de devoir affronter une
multiplicité de rôles, au fur et à mesure des diverses entrées. De sa voix
idéalement placée de baryton-basse, Aimery Lefèvre
campe successivement un Bellone à l'aigu claironnant, puis les personnages
hauts en couleurs d'Osman, de Huascar, d'Ali et d'Adario, tous gratifiés d'une ardente déclamation. Les deux
hautes-contre font montre d'agilité dans les vocalises, avec des atouts
différents : François-Nicolas Geslot, timbre très
clair aux éclatantes envolées (Valère, Tacmas),
Reinoud van Mechelen, plus corsé et un peu âpre (Carlos, Damon). Les deux
sopranos rivalisent aussi d'éloquence, Stéphanie Révidat (Hébé, Emilie, Zaïre) et surtout Valérie Gabail (Amour, Phani, Fatime,
Zima) dont l'esprit et la fraîcheur, dans ces deux dernières parties, s'inscrivent dans la lignée des Dessay et Petibon qui marquèrent
ces rôles dans la dernière production de l'Opéra Garnier. Le Chœur du Marais,
n'était un placement un peu en arrière du champ sonore, dispense une fine
clarté d'émission. Un beau tribut à l'année Rameau.

Jean-Pierre Robert.
Gioachino ROSSINI : Otello ossia Il moro di Venezia. Opéra en trois actes. Livret de Francesco
Maria Berio di Salsa, d'après la pièce de Shakespeare « Othello, the Moor of Venice ». Cecilia
Bartoli, John Osborn, Javier Camarena, Edgardo Rocha, Peter Kálmán, Liliana Nikiteanu, Nicola Pamio, Ilker Arcayürek. Chœur de l'Opernhaus Zürich. Orchestra La Scintilla de l'Opernhaus Zürich, dir. Muhai Tang. Mise en
scène : Moshe Leiser & Patrice Caurier. 1 DVD Universal Decca :
074 3863. TT.: 156'.
Captée à l'Opernhaus de Zürich en mars 2012, cette version d'Otello de
Rossini se distingue avant tout par sa prestation musicale. Comme constaté lors
de la représentation (cf. NL de 4/2012), la distribution assemblée est sans
faille, dominée par la Desdemona de Cecilia Bartoli,
dont la vocalité incandescente est une mine de bonheur, et un trio de ténors
valeureux, trait qui fait toute l'originalité de la pièce. Surtout, à la
différence de la récente reprise du spectacle à Paris (cf. NL de 5/2014), la
direction vibrante de Muhai Tang apporte à la musique
son cachet. Les musiciens experts de l'Orchestra La Scintilla savent trouver
les vraies couleurs et possèdent cette sûreté du trait, notamment pour ce qui
est du département des vents, petite harmonie savoureuse et cuivres justes, qui faisait cruellement défaut à leurs collègues de
l'Ensemble Mattheus au Théâtre des Champs-Elysées. On savoure aussi les
ensembles, tel le quintette du Ier acte, et les finales. La mise en scène du
tandem Moshe Leiser et Patrice Caurier est habilement filmée. La transposition dans l'Italie des années 1960
fonctionne plutôt bien, et les excès ne sont pas soulignés : au contraire, la
caméra resserre le schéma de haine qui se tisse autour d'Othello dont la
couleur de peau n'est décidément pas en odeur de sainteté dans la famille
patricienne du noble Elmiro, qui n'hésite pas à
rudoyer sa fille Desdemona pour lui faire partager
ses vues. De même le personnage de Rodrigo, qui prend chez Rossini une place
autrement plus dramatique que dans l'opéra de Verdi, est-il saisi avec
infiniment de pertinence, en particulier lors du pathétique duo avec une Desdemona qui ne veut rien entendre des déclarations
pourtant sincères de cet amoureux sincère. Le ballet des portes ouvertes et
fermées durant le premier acte, sur fond de réception dans la pièce adjacente,
n'est pas aussi intrusif qu'à la représentation. Même l'aspect lépreux et sans
âme de la taverne, au II ème acte, où semble s'être
réfugié Othello, ne parvient pas à distraire le spectateur d'une suite de
joutes hors du commun entre les trois ténors : Othello et Iago,
d'abord, ou comment instiller le poison du doute et en recueillir les sûrs
effets en termes de réaction hors de contrôle, entre le maure et Rodrigo
ensuite, expression passionnée d'une vindicte non contenue de rivaux en amour,
blessés dans leur amour propre. Le surgissement de Desdemona tentant de les séparer ressortit du vrai coup de théâtre. Et le dernier acte,
dans sa sobriété décorative et sa direction d'acteurs millimétrée, est un
formidable achèvement dramatique : les deux protagonistes et victimes y sont
d'une vérité criante.

Jean-Pierre Robert.
Igor STRAVINSKY : Oedipus Rex,
opéra-oratorio en deux actes. Texte de Jean Cocteau. Apollon
musagète, ballet en deux tableaux. Jennifer Johnston, Stuart Skelton, Gidon Saks, David Shipey, Benedict Quirke, Alexander
Ashworth. Fanny
Ardant, récitant. Monteverdi Choir. London Symphony Orchestra, dir. Sir John Eliot Gardiner. 1 CD LSOLive : LSO0751. TT.: 79'13.
Oedipus Rex est une œuvre
hybride, à la fois opéra par son argument et oratorio si l'on considère son
aspect délibérément statique. L'idée d'une œuvre chantée en latin, d'après une
tragédie antique familière, revient au compositeur qui en confia la réalisation
textuelle à Jean Cocteau. Créée en 1927, en version de concert, au théâtre
Sarah-Bernhardt à Paris, elle ne connut de version scénique que l'année
suivante à Vienne, puis à Berlin, cette dernière sous la direction d'Otto
Klemperer. Due à John Eliot Gardiner, qui signe ici son premier disque pour le
label LSOlive, la présente exécution, captée live au Barbican Hall de Londres, favorise une approche extrêmement
contrastée, souvent chambriste ou lâchant les forces, notamment dans la scène
finale. Ce qui est souligné par une prise de son très immédiate. Les vents du
LSO brillent tout particulièrement. Les solistes sont de qualité, sans être
mémorables : Jennifer Johnston, Jocaste, de son timbre de mezzo grave épouse le
côté un peu histrion du personnage, et le Créon de Gidon Saks est bien sonore, rappelant que l'emploi n'est
pas éloigné de celui de Nick Shadow du Rake's Progress, dont cet artiste s'est fait
une spécialité. Mais Stuart Skelton n'est pas toujours à l'aise avec la
tessiture tendue de ténor d'Oedipe. Le Monteverdi Choir, dans un répertoire qui
ne lui est pas familier, fait merveille de précision dans les attaques et la
diction. Dans la partie du récitant, dont Stravinsky condamna la pertinence
dans ses réflexions critiques de 1963 (« Dialogues and a Diary »), Fanny Ardant fait montre de
sensibilité et de nuances. Il est judicieux de coupler la pièce avec Apollon
musagète dont la composition la suit immédiatement dans le catalogue straviskien (1928). Pour ce premier ballet écrit pour
une compagnie autre que celle de Diaghilev, Stravinski a conçu une pièce sur un
sujet abstrait, car il n'y a pas d'argument à proprement parler. Il en va de
même de l'organisation de ses diverses parties, succession de danses de forme
très classique, à mille lieux des aspérités du Sacre du printemps. On
admire la richesse mélodique des seules cordes et un savant contrepoint,
particulièrement efficace dans le « Pas d'action » qui propose un canon
à quatre voix. John Eliot Gardiner en offre une interprétation inspirée,
s'attardant avec délice sur les inflexions souples et presque complaisantes de
la musique, mises en valeur par l'élasticité des cordes du LSO. La rythmique
est franche (« Variation de Polymnie ») et le trait sait être raffiné
lors du « Pas de deux », délicatement mélancolique.

Jean-Pierre Robert.
Béla BARTÓK : « Piano works ». Suite de Danses. Quatre
lamentations anciennes, extraits des Quinze chants paysans hongrois. Sonate pour piano. Six Danses
populaires roumaines. 14 Bagatelles.
Alain Planès, piano. 1CD Harmonia Mundi : HMC 902163. TT.: 78'59.
Ce disque propose une passionnante
anthologie de la musique de piano de Béla Bartók. Son instrument de
prédilection, Bartók lui confiera des pièces de choix, sous forme de cycles,
tels les Mikrokosmos, mais aussi à travers
nombre de courts morceaux dont la thématique est puisée dans le folklore
paysan. Sans relâche, parcourra-t-il les contrées d'Europe centrale pour
collecter auprès des paysans leurs authentiques chants populaires. Les 14
Bagatelles (1908), marquent déjà une évolution stylistique décisive chez le
jeune musicien qui se détache des grands anciens, Liszt et Brahms, pour se
forger une manière très personnelle, puisée aux racines de ce folklore paysan.
Ces pièces courtes préfigurent le style de la maturité, avec de forts
contrastes et un jeu percussif de l'instrument. Le souci d'authenticité
populaire se retrouve dans les Six Danses populaires roumaines de 1915,
plus tard arrangées pour orchestre. Ces pièces, devenues familières, dont les
thèmes ont été collectés en Transylvanie, frappent par leur métrique
irrégulière, leur donnant une allure d'improvisation. Tout autant habitées des
airs populaires, les Quatre lamentations anciennes (1914/1918),
extraites des « Quinze chants paysans hongrois », sont un mémorial à
ce chant hongrois que le musicien n'aura de cesse de célébrer, au point d'en
publier un traité en recensant plus de 350, fruit de ses inlassables
collectages. Ces pièces, d'une grande difficulté technique, ouvrent la porte à
l'avant garde. Ce même souci d'inspiration folklorique, et pas seulement
hongroise et roumaine, mais aussi arabe, on le trouve dans la Suite de
danses, première commande publique
de Bartók, à l'occasion des fêtes commémorant la réunion de Pest et de Buda. Destinée à
l'orchestre (1923), elle sera transcrite pour le piano en 1925. Les danses sont
rythmées par une ritournelle revenant en boucle au fil des six pièces qui
possèdent chacune une identité particulière. Enfin, la Sonate pour piano,
de 1926, une année faste en matière de compositions pianistiques, revisite le
modèle de la sonate classique, à l'aune des récentes recherches bartokiennes :
rythmique serrée, densité du contrepoint, dissonances prononcées. Une pulsation
irrépressible irrigue les deux allegros extrêmes, alors que le mouvement lent,
marqué « sostenuto e pesante » déploie de larges accords résonnants
sans pour autant renoncer à l'aspect volontariste qui domine cette pièce. Tous
ces morceaux, Alain Planès les aborde avec une
rigueur qui ne cherche pas à masquer leur âpreté. Son jeu en souligne aussi la
beauté de l'harmonie et les saisissantes inflexions.

Jean-Pierre Robert.
Francis POULENC : « Les anges musiciens » : Deux poèmes de Louis Aragon. Bleuet. Voyage à Paris. Montparnasse. Hôtel. Trois Poèmes de Louise Lalanne. Ce doux petit
visage. Main dominée par le cœur. Tel jour telle nuit. Vocalise-Étude. Fiançailles pour rire. Fancy. La courte paille. Deux chansons pour Yvonne Printemps. Sophie Karthäuser, soprano. Eugène Asti, piano. 1CD Harmonia Mundi : HMC 902179. TT.: 66'06.
La mélodie est au cœur de la production de
Francis Poulenc, pièces isolées ou cycles sur les textes empruntés à ses
contemporains, Aragon, Apollinaire, Éluard, Louise de Vilmorin. Poulenc, qui
aimait passionnément la poésie, excelle dans l'art de capturer l'essence
poétique d'un texte, sa douce mélancolie, sa verve, voire son côté grotesque.
Et sa musique offre, ici comme dans tant d'autres domaines, ce mélange
inimitable de gravité et de nonchalance. Le présent CD offre d'abord quatre
cycles essentiels. Les Trois Poèmes de Louise Lalanne (1931), pseudonyme qui cache en réalité des textes d'Apollinaire et de
Marie Laurencin, alors épouse de celui-ci, annoncent les chefs d'œuvre à venir
tant le musicien y tutoie cette union naturelle entre prosodie et ligne
musicale qui caractérisera en particulier le cycle Tel jour telle nuit (1937). Ce dernier est sans doute le
sommet de l'univers de la mélodie chez Poulenc : neuf morceaux où le lyrisme
des poèmes d'Éluard est transcendé tour à tour sur le ton de la confidence ou
d'une violence à peine contenue, au sein d'une organisation qui fait penser en
termes de structuration aux grands cycles du Lied allemand, comme les Dichterliebe de Schumann. Une longue péroraison
pianistique renforce cette comparaison. Les Fiançailles pour rire, de
1939, constituent un pendant féminin au cycle précédent : empruntant à Louise
de Vilmorin, et sous une apparence désinvolte, ils laissent percer des arrières
plans tragiques et une indicible nostalgie. Enfin, La courte paille, sur
des poèmes de Maurice Carême, de 1960, dédiés à Denise Duval, qui ne les créera
pas, offre un cycle miniature aux géniales inflexions, mélange d'esprit (« Le
carafon ») et de profondeur (« Les anges musiciens », « Lune
d'avril »). Quelques pièces isolées complètent cette anthologie, dont
plusieurs sur des textes d'Apollinaire, comme « Montparnasse » ou
« Hôtel », dÉluard (« Ce doux petit
visage ») et d'Anouilh, tels « Les chemins de l'amour », écrits pour
Yvonne Printemps, sur un rythme de valse irrésistible. Pour son premier disque
de mélodies poulenquiennes, Sophie Karthäuser affronte une concurrence sévère. La diction est
impeccable et nulle affectation ne vient troubler un discours qui ne cherche
jamais à solliciter le texte, mais se cantonne dans une réserve assumée. Reste
qu'au-delà d'une vocalité accomplie et d'une appréhension certaine de la
poétique, on eût aimé plus d'abandon, comme un dépassement de mots.
L'accompagnement d'Eugène Asti est valeureux, qui met en valeur la merveilleuse
écriture pianistique de Poulenc, même si, là aussi, l'ultime poésie n'est
parfois pas assez en évidence.

Jean-Pierre Robert.
« Motherland ». Pièces de JS. Bach, Pyotr Iliych Tchaïkovski, Felix Mendelssohn, Chaude Debussy, Giya Kancheli, György Ligeti,
Johannes Brahms, Franz Liszt, Antonin Dvořák,
Maurice Ravel, Frédéric Chopin, Alexandre Scriabine, Domenico Scarlatti,
Edouard Grieg, Georg Friedrich Haendel, Arvo Pärt, Traditional/ Khatia Buniatishvili. Khatia Buniatishvili, piano. 1CD
Sony Classical : 88883734622. TT.: 65'50
.
La volcanique Khatia Buniatishvili ferait-elle dans la modération ?
Emprunté au modèle de la compilation introspective concoctée par plus d'une
chanteuse, titrée « Les chansons que me contait ma mère », son album
« Motherland » rapproche des pièces pour piano
évocatrices de souvenirs personnels, résolument inscrites dans le registre de
l'intimité. Autant de feuilles d'album qui n'ont d'autre fil rouge que celui
des sentiments enfouis. D'où le choix de pièces sur le mode lent, celui de la
confession nostalgique, de l'allusion à quelque paysage choisi, ou du rêve
d'enfance. Comme à son habitude, Khatia Buniatishvili livre
une conception très personnelle des œuvres jouées. Ainsi « Clair de
lune », tiré de la Suite bergamasque de Debussy, fleure-t-elle un
déconcertant alanguissement qui en vient à priver ce pur moment de grâce de sa
substance même, et la Pavane pour une infante défunte, bien que débutant
au juste tempo, se perd vite dans la quasi immobilité d'une mélancolie appuyée.
La modeste Étude op 25/7 de Chopin, par contre, s'enfle en un déferlement
sonore digne de Lizst. Trop plein d'expression dans
l'un et l'autre cas ? Les enchaînements, arbitraires en apparence, ne le
seraient pas autant qu'on le croit, car il semble qu'on ait voulu que les
pièces s'éclairent les unes par les autres, comme le morceau cité de Debussy et
tel Intermezzo de Brahms. Mais conclure le récital sur « Für Alina » d'Arvo Pärt, composition quasi minimaliste et jouée dans l'extrême
pianissimo, atteint le comble du paradoxe chez une artiste habituellement plus
à l'aise dans l'abattage ; comme il en est de la transcription, de son cru, d'un chant
folklorique de l'ouest de la Géorgie, « Ne m'aimes-tu pas ? », qui se
distingue par son emportement sonore. Quelques brefs moments de gaieté
évanescente traversent ce panorama nostalgique : une romance sans paroles de
Mendelssohn, une danse slave de Dvořák, en forme
de dumka, à quatre mains, avec Gvantsa Buniatishvili, sa sœur, ou une Sonate de Scarlatti.
Quelques pièces peu connues dérident l'atmosphère aussi : ainsi de Giya Kancheli (*1935),
« lorsque fleurissent les amandiers », thème principal du film
éponyme de sa compatriote Lana Gogoberidze. Au fil de
ces morceaux, on navigue entre sentiment d'évasion à la recherche d'imaginaire,
et plus prosaïquement bis de fin de concert. Décidément, une offre pour les fans
de la pianiste géorgienne.

Jean-Pierre Robert.
« Je n'aime
pas la guitare classique, mais çà j'aime bien! ». Pièces pour
guitare seule et pour guitare et orchestre de Joaquín RODRIGO, Isaac ALBENIZ,
Manuel DE FALLA, Heitor VILLA-LOBOS, Narciso YEPES, JS. BACH, Domenico SCARLATTI,
Claude DEBUSSY, Stanley MYERS, Billy STRAYHORN. Julian Bream, John Williams, Alexandre Lagoya, Ida Presti, Thibault Cauvin, guitare. Chamber Orchestra of Europe,
dir. John Eliot Gardiner. Orchestre de chambre RCA, dir. Leo Brouwer.
2CDs RCA : 88843067072. Distribution : Sony Classical. TT.: 61'15 +60'43.
Sur le modèle du concept des livres
« (ex. :la musique) pour le nuls », RCA/Sony
a lancé en CD celui de « Je n'aime pas (ex.: la guitare classique), mais çà
j'aime bien ! ». Autrement dit une collection conçue sur des thèmes
suffisamment généraux susceptibles d'intéresser le plus large public, à partir
de morceaux choisis, d'accès facile, et dans le braquet « mid price ». Après l'opéra,
le piano, le violon, et aux côtés des éternels adagios, dont le coffret paraît
simultanément, le présent volume est consacré à la guitare classique,
l'instrument le plus pratiqué des français, dit-on. Il propose un florilège de
pièces archi connues, comme l'inusable Concierto de Aranjuez de Rodrigo, et sa non moins rebattue Fantaisie pour un
Gentilhomme, et des pièces isolées d'Albeniz, d'Heitor Villa-Lobos ou de Manuel de Falla. Pour ce faire on a puisé dans les trésors
d'archives de la firme RCA. On n'échappe pas à « Asturias »,
« Mallorca », « Granada » ou encore « Sevilla »,
extraits de la Suite espagnole op. 47 d'Albeniz. De
Manuel de Falla, on peut entendre la non moins célèbre première Danse espagnole
pour deux guitares. Pour faire bonne mesure, on a convoqué les 'classiques' JS.
Bach et Domenico Scarlatti dont sont offerts quelques bourrée,
gavotte ou mouvement de sonates. On n'a eu garde d'oublier l'incontournable
romance « Jeux interdits », composée en 1952 par Narciso Yepes, un prodigieux interprète. Quoique
on puisse se demander si cette pièce emblématique d'un film culte n'est
pas quelque peu passée d'actualité. Les interprétations ne souffrent pas de
contestation puisque servies par les princes de l'instrument que furent et
restent Julian Bream, John Williams ou Alexandre
Lagoya. Voisine avec eux un représentant inspiré de la jeune génération,
Thibault Cauvin. Les transferts sont de qualité variable, eu égard aux aléas
des prises de son d'origine. Mais les deux pièces concertantes ne trahissent
pas leur âge. Et pour encore mieux capter le regard de l'acheteur, on a fait
appel au crayon de l'humoriste Sempé.

Jean-Pierre Robert.
Frédéric
CHOPIN. Dernier concert à Paris : 16 février 1848. Yves Henry, piano Pleyel 1837. Gilles Henry, violon. Adrien Frasse-Sombet, violoncelle. Julie
Fuchs, soprano. Xavier Le Maréchal, ténor. 2CDs Soupir Éditions : S226.
TT : 53’25 + 39’11.
Dernier concert à Paris de Frédéric Chopin,
le 16 février 1848, voilà une thématique originale pour ce beau coffret de deux
CDs. Berlioz lui-même signalait la rareté des apparitions de Chopin, en tant
que soliste, toujours dans le cadre rassurant de concerts de chambre et
toujours chez Pleyel. Durant les seize années de son séjour à Paris, Chopin ne
fera que quatre de ces apparitions mi publiques, mi privées, se situant entre
concert et salon, seules adaptées à sa personnalité aristocratique et
introvertie, à son jeu laissant une large place à l’improvisation, et à son
désir d’échapper à la carrière de virtuose itinérant : de la présentation
inaugurale de 1832, de son retour sur l’estrade en 1841 et 1842, jusqu’à
l’ultime soirée de février 1848, qui fait l’objet de cet enregistrement, dans
un programme varié où le compositeur interpréta certaines de ses œuvres
associées à quelques airs de concert empruntés à Mozart, Bellini ou Meyerbeer.
Un enregistrement doublement original, car effectué dans le grand salon
d’apparat de la maison Chaumet, place Vendôme, à
Paris, tout près de l’appartement où Chopin s’éteindra le 17 octobre 1849, et
utilisant, de plus, un de ses chers pianos Pleyel. Une interprétation
brillante, chargée d’émotion, cantabile où transparait par instant, en
filigrane, l’indicible souffrance du compositeur exilé. Une invitation à un
concert hors du temps, un fragment d’histoire baigné de nostalgie, à ne pas
manquer !

Patrice Imbaud.
Philippe
GAUBERT. Musique de chambre avec flûte. Vincent
Lucas, flûte, Laurent Wagschal, piano. 2 CDs Indésens : INDE059. TT : 69’42 + 53’02.
Un bien bel hommage rendu par Vincent Lucas
et Laurent Wagschal au compositeur français Philippe
Gaubert (1879-1941). Compositeur mais également chef d’orchestre, flûtiste,
pédagogue, directeur de la Musique à l’Opéra de Paris, un des chefs de file de
l’école française de flûte dont l’excellence est reconnue, encore aujourd’hui,
dans le monde entier. Un nom toutefois un peu oublié de nos jours du grand public,
une omission heureusement réparée par ce superbe coffret de deux CDs proposé
par le label Indésens qui poursuit son inlassable
promotion de la musique française et des vents français. Le présent
enregistrement présente l’intégralité des duos pour flûte et piano. Dans le
premier CD différentes œuvres courtes (Berceuse,
Esquisses, Madrigal, Sicilienne, Divertissement, Romance, Nocturne et Fantaisie),
ainsi que la remarquable Suite datant
de 1921, dont chacun des quatre mouvements est dédié à un grand flûtiste
(Georges Barrère, Louis Fleury, Marcel Moyse et Georges Laurent). Le deuxième CD propose les trois Sonates et la Sonatine pour flûte et piano. Une musique typiquement française,
élégante, limpide, déroulant son fil poétique tout au long d’amples mélodies au
charme certain, bien qu’un peu désuet. Une musique délicieuse et délicate,
chargée de rêve et de mélancolie, de virtuosité, de joie et de mystère,
magnifiée par les deux interprètes installés dans un dialogue parfaitement
équilibré où la rondeur et le chant élégiaque de la flûte répond aux attentes
d’un piano discret mais omniprésent. Superbe !

Patrice Imbaud.
« Une mort
mythique ». Albéric MAGNARD : Sonate pour violoncelle et piano.
Pièces pour piano. Alain meunier, violoncelle. Philippe Guilhon-Herbert,
piano. 1 CD Hortus. Collection Les Musiciens et la
Grande Guerre I : HORTUS 701. TT : 70’37.
Bel esprit d’à propos de la part du label Hortus qui profite de cette année 2014, année de la
célébration du centenaire de la Grande Guerre, pour éditer une collection
spécialement dédiée aux musiciens de cette époque. Une collection qui devrait
compter trente volumes à paraître jusqu’en 2018. En voici, ici, le premier opus
consacré au compositeur français Albéric Magnard (1865-1914). Un compositeur
qui périt les armes à la main le 3 septembre 1914 en défendant sa maison contre
l’envahisseur allemand. Fusillé devant sa demeure incendiée de Baron dans
l’Oise, il fut immédiatement héroïsé par toute la nation, la postérité
conservant de lui une image de martyr et oubliant quelque peu celle du
compositeur. Voila un oubli réparé avec ce disque qui présente plusieurs œuvres
de son catalogue, somme toute assez réduit (21 opus). La grande Sonate pour violoncelle et piano datant
de 1910, dense et profonde, tourmentée, romantique, aux accents brahmsiens un
peu surannés. Le violoncelle et le piano y soutiennent un dialogue en quatre
mouvements énergiques, non exempts de charme et de poésie. En Dieu mon espérance et mon épée pour ma défense (1888), Trois Pièces op. 1 (1887) et Promenades op. 7 (1893) constituent l’Intégrale
de l’œuvre pour piano dont une partie est présentée, ici, pour la première
fois. Ces œuvres variées, à la fois classiques et modernes, témoignent du savoir faire du compositeur, en même temps
qu’elles reflètent les différentes facettes et scintillements de la musique
française à la veille de la Grande Guerre. Un disque qui sera pour beaucoup une
découverte, une musique pleine de charme et une interprétation de qualité. Que
demander de plus ?

Patrice Imbaud.
« 1913 : Au carrefour de la modernité ». Igor
STRAVINSKY : Le Sacre du printemps. Ferruccio BUSONI : Fantasia Contrappunstistica. Claude DEBUSSY : En blanc et Noir. Jean-Sébastien Dureau & Vincent Planès, piano. 1CD Hortus. Collection Les Musiciens et la Grande Guerre
II : HORTUS 702. TT : 70’37.
1913, effectivement une année magique
portant tous les germes en devenir de la création artistique du XXe siècle. Une
année marquée par une extraordinaire floraison artistique, littéraire et
philosophique. Il suffit de rappeler Le
Grand Meaulnes d’Alain Fournier, Jean
Barrois de Martin du Gard, Du Coté de
chez Swann de Proust, Stèles de
Segalen, Alcools d’Apollinaire, La Prose du transsibérien et de la petite
Jeanne de France de Cendrars, Ève et L’Argent de Péguy, mais également, la
fondation du Théâtre du Vieux Colombier par Copeau et de la Roue de bicyclette par Marcel Duchamps. Rajoutons
pour mémoire la structuration de la psychanalyse, la scission de Jung, la
publication par Freud de Totem et Tabou.
Parallèlement, Albert Einstein devient incontournable, le cinéma prend son
essor à Hollywood, la bande dessinée est reconnue, succédant aux comics. 1913, l’année de l’entrée dans la
modernité, l’année qui verra s’ouvrir des expositions qui feront date comme Der Sturm à Berlin ou l’Armory Show à New York, sans oublier une
effervescence générale où différents courants artistiques s’entremêlent et se
disputent, tels le futurisme italien, l'expressionnisme allemand, l’imaginisme londonien, l’acméisme russe, le cubisme et le
simultanéisme à Paris. Alors que Debussy, Fauré, Ravel composent des œuvres
majeures…Schönberg fait scandale à Vienne le jour même du concert inaugural du
Théâtre des Champs-Elysées, le 31 mars. Quelques mois plus tard, Le Sacre du Printemps de Stravinski et
Nijinski exalte la vie, valeur dominante chez Nietzsche et Bergson, tandis que
s’opposent encore les tenants du positivisme et ceux du spiritualisme, laissant
cette année chargée d’espoir et lourde d’interrogations… 1913, une année qui pourrait
pour certains, comme Pascal Ory, résumer l’ensemble
du XXe siècle culturel en devenir. 1913, année de la naissance du Théâtre des
Champs-Elysées, théâtre à l’architecture révolutionnaire, construit en béton
armé par les frères Perret, temple emblématique du modernisme triomphant.
Un choix judicieux donc du label Hortus pour ce deuxième opus de la collection « les
Musiciens et la grande Guerre », qui présente le Sacre du printemps de Stravinsky (dans sa version pour piano à
quatre mains) qui restera dans l’histoire, avec Déserts de Varèse, comme un des plus grands scandales musicaux
du XXe siècle. Jean-Sébastien Dureau & Vincent Planès en
donnent, ici, une interprétation haletante et captivante, d’une exceptionnelle
qualité pianistique, soutenue par une précision rythmique époustouflante et la
sonorité très ample du Pleyel à double clavier en vis-à-vis, utilisé pour cet
enregistrement. En Blanc et Noir de
Debussy et la Fantasia Contrappunstistica de Ferruccio Busoni complètent agréablement ce disque superbe.

Patrice Imbaud.
« Hommage à Maurice Maréchal ». Johannes BRAHMS : Sonate pour violoncelle op. 38. Gabriel FAURE : Élégie.
Claude DEBUSSY: Sonate N° 1 pour violoncelle et piano. Arthur HONEGGER :
Sonate. Alain Meunier, violoncelle. Anne Le Bozec,
piano. 1 CD Hortus, Collection Les Musiciens et la
Grande Guerre III : HORTUS 703. TT : 60’40.
Troisième volume de cette collection
spéciale du label Hortus consacrée aux musiciens de
la grande guerre, tous genres confondus, compositeurs et interprètes. Un disque
conçu comme un hommage rendu au grand violoncelliste Maurice Maréchal par son
élève Alain Meunier. Maurice Maréchal (1892-1964) violoncelliste international
et pédagogue reconnu fut mobilisé trois ans après avoir obtenu le premier prix
de violoncelle au Conservatoire de Paris. Il raconte dans ses carnets intimes
comment deux camarades menuisiers lui taillèrent un violoncelle rudimentaire
dans le bois d’une caisse de munitions ! Dénommé « le Poilu »
cet instrument fut joué au front pour des offices religieux et des concerts
destinés aux officiers, en soliste, ou en petit ensemble (Les musiciens du
général) avec d’autres musiciens mobilisés comme André Caplet, Lucien Durosoir. Alain Meunier et Anne Le Bozec lui rendent ici un vibrant hommage, à l’occasion du cinquantenaire de sa mort,
en interprétant la Sonate op. 38 de
Brahms qu’il adorait jouer, la Sonate n°
1 de Debussy composée en 1915 et apportée au front par Caplet, jouée par
deux fois à Debussy lors de permissions parisiennes, la Sonate d’Honegger et l'Élégie de Fauré. Là encore une interprétation d’une grande qualité où l’on regrettera
parfois la sonorité assez sèche du Bechstein 1888
d’Anne Le Bozec faisant contraste avec le lyrisme et
la rondeur du jeu d’Alain Meunier.

Patrice Imbaud.
***
MUSIQUE ET CINEMA
GREAT
BLACK MUSIC et CINEMA
Jusqu’au mois d’août la Cité de la Musique
propose une magnifique exposition sur la vitalité de la musique noire et son
importance dans la société urbaine aujourd’hui. Du blues au rap en passant par
le jazz, le R&B, la musique cubaine, africaine, tous les courants de la
musique noire y sont exprimés. De concert avec cette exposition notre rubrique
musique et cinéma va s’intéresser aux BO des films en rapport avec la Black
Music. A l’origine, le jazz est présent
comme support des films « noir » (sans jeu de mots), des films
policiers, des casses (cf. NL de 6/2014), mais les acteurs noirs, eux,
n'interprétaient que des rôles d’esclave, de jardinier, de domestique, de
danseur ou de musicien, de petit gangster et pour les femmes, de nounou ou de
prostituée. Très peu de films étaient joués par des noirs. En 1943, on trouve
« Stormy Weather » de Andrew L.
Stone, et « Cabin in the Sky »
de Vincente Minnelli, totalement joués et chantés par des noirs. En 1954, la
nouvelle star de la chanson, Harry Belafonte, et la sublime métis Dorothy Dandridge chantent dans une « Carmen Jones » noire réalisée par Otto Preminger. Le film est
interdit en France par les héritiers de Bizet jusqu’en 1981 ! En 1957,
avec « Island of the Sun »
de Robert Rossen, le couple récidive. La musique du
film et la chanson interprétée par Belafonte sont un succès. Le film fait
scandale et il est interdit dans certains États des États-Unis.
Il faut attendre les années 70 avec le
courant « black exploitation », ou « blaxploitation »,
pour que soit revalorisée l’image du Afro-Américain au
cinéma. Il offre aux acteurs noirs de vrais rôles. Mais ce qui fait le succès
de ces films c’est avant tout leur BO. Tous les genres sont déclinés : du polar
à la comédie en passant par le cinéma fantastique. Jazzmen ou artistes de soul,
de funk, participent à cette aventure. En 1971, Melvin van Peeble tourne « Sweet Sweetback’s Baadasss Song ». Le film est comme un coup de tonnerre dans l’industrie du cinéma hollywoodien.
Melvin van Peeble a lui-même composé la musique et on
y entend un groupe qui à l’époque est peu connu, Earth Wind and Fire. L’industrie hollywoodienne s’engouffre
dans ce marché juteux. La MGM renfloue ses caisses grâce à « Shaft »
réalisé par Gordon Park, un journaliste et réalisateur noir. Le film sera un
succès planétaire à cause de la BO écrite par Isaac Hayes. Hayes écrira trois
ans plus tard la musique du film de Tuccio Tessari, « Three Tough
Guys ». Tessari était connu comme réalisateur de
western spaghetti (co scénariste « D’une Poignée
de Dollar » et réalisateur des « Ringo »). Chaque film, au
scénario généralement médiocre, sera l’occasion d’une bande sonore de grande
qualité qui aura souvent plus de succès que le film lui-même. Ainsi pour
« Superfly »
l’auteur est Curtis Mayfield. La BO devient culte avec des tubes comme Superfly ou Pusher Man. Le
jazzman, vibraphoniste Roy Ayers compose une superbe
musique pour « Coffy la Panthère Noire de Harlem ». Ce
sont les débuts à l’écran de Pam Grier et de Dee Dee Bridgewater dans la bande son. Tarantino,
grand connaisseur de ce cinéma, reprendra quelques titres de la blaxploitation dans « Jackie Brown ». Il fera revivre en 1997 Pam Grier, actrice oubliée. Un autre grand du jazz, le
tromboniste bebop J.J. Johnson, compose en 1973 la BO
de « Cleopatra Jones » de Jack Starrett, ainsi que « Willie Dynamite » de Gilbert Moses et «Across 110th Street » de Barry Shear.
Edwin Starr, chanteur et compositeur de chez Motown compose celle de « Hell Up in Harlem », et Willie Hutch de
« The Mac ». James Brown,
en 1973, ne sera pas en reste et écrira la médiocre BO pour « Black Caesar » ; Marvin Gaye, plus
inventif, celle de « Trouble
Man ». Dans le dernier « Captain America, le Soldat de l’Hiver » (2014) on fait
comprendre à ce super héros que la seule chose qu’il a manquée pendant qu’il
était dans les glaces c’est la musique du film de « Trouble Man »
(sourires !)… Un film un peu oublié, mais une musique qui fait encore
danser les nouvelles générations, est celle de « Car Wash », réalisé en 1976, par Michael Schultz.
Elle a été écrite par un des fondateurs de la Motown,
Norman Whitfield. C’est une des plus belles bandes
sonores de l’époque disco et une des seules musiques récompensées au festival
de Cannes. Le célèbre Barry White sera le compositeur de « Together Brothers »
dirigé par William A. Graham, mais ne chantera qu’une chanson.
Toutes ces musiques
de films sont pratiquement faites sur le même moule : cordes lancinantes et
cuivres très présents avec la guitare whawha et la
basse très en devant dans les mixages. Une ou deux chansons sont en général
interprétées par le compositeur-chanteur soul. Le rythme syncopé à la Curtis
Mayfield et la whawha à la Shaft seront les références de toutes ces BO. En l’espace de seulement quelques
années le nombre de films de la blaxploitation a été
impressionnant mais le public s’est vite lassé de la médiocrité de ce cinéma.
La musique, elle, est restée. Tarentino a ressuscité
ce genre comme il l’a fait sur d’autres styles de cinéma. Plusieurs albums de
compilation « music from blaxploitation »
se trouvent offerts sur internet mais certains proposent des morceaux de soul
ou de funk qui n’ont rien à voir avec les bandes originales elles-mêmes. Pour
ceux qui veulent en connaître un peu plus sur ces musiques, nous proposons en
premier, mis à part « Sweet Sweetback’s Baadasss Song », les albums de « Superfly »,
« Shaft », « Car Wash », « Coffy » et « Cleopatra Jones ». Il est aussi intéressant d’écouter la BO de
« Jackie Brown » de Tarentino. « Can
You Dig It ! » est la seule bonne
compilation sur les films de cette époque.




https://www.youtube.com/watch?v=LSpvY9K5STE
https://www.youtube.com/watch?v=NiwoFK8nwZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zNnD7ZzoyJw
Stéphane Loison.
ENTRETIEN
RENAUD
BARBIER, compositeur du film « Le
Dernier Diamant » d'Éric Barbier.
Cette musique avait été analysée récemment
(cf. NL de 5/2014). Pour compléter nous avons réussi, ce moi-ci, à obtenir un
entretien avec le compositeur.

DR
Comment
êtes-vous entré dans le monde de la musique ?
« A
huit ans à Brignoles, petite ville du Var, j’entends Beethoven, une musique
avec une telle énergie qu’elle me donne envie de faire du piano et de jouer ce
compositeur ! Je me débrouille pour acheter un piano par le biais de mes
grands-parents, de la famille. Mes parents étaient assez ouverts sur l’art. Mon
père était psychanalyste et ma mère maîtresse de maternelle. Elle accueillait
les enfants le matin avec la musique de Morricone. Je pense que cela a dû jouer
pour la suite. Dix ans de piano classique, pas de conservatoire, un professeur
privé, pas d’harmonie, pas de solfège. Je faisais aussi beaucoup de sport et à
un moment il a fallu que je choisisse, et j’ai choisi la musique. A 16 ans et
demi je monte mon premier groupe sans connaître l’harmonie. On a mélangé nos
styles : moi le classique, eux le rock, c’est parti sur une envie de
créativité. On répétait deux fois par semaine, fin des années 80. J’ai
découvert le jazz rock, le Weather Report, Coréa et Jarret qui m’ont beaucoup marqué, puis Coltrane,
Miles…Notre groupe, « Sixième Sens », m’a amené à faire beaucoup de
concerts, puis je suis entré en 1990 au Centre Créatif Musical de Nancy en jazz
et fusion. J’avais passé mon bac, commencé la fac en math physique chimie et
j’ai tout arrêté. J’ai fait un an à Nancy qui était un peu le Berklee de l’époque. C’était une école internationale,
privée. J’avais eu une bourse par l’AFDAS. A Nancy, j’étais tellement ouvert à
la musique que j’ai tout appris au niveau de l’harmonie, du rythme. Je suis
sorti major de ma promotion avec Franck Aguhlon, le
célèbre batteur de jazz. J’ai eu une formation jazz et puis je suis devenu prof
dans l’école et j’ai écrit une méthode de piano, car pour moi, avant le
solfège, il faut être à l’écoute de la passion des enfants. Ça a superbement
marché. J’avais 22 ans lorsque je suis parti à Barcelone avec un copain
auditionner pour avoir une bourse pour Berklee. Je
vous passe les détails de cette folle aventure de Bourse. Je suis parti quand
même à Boston sans savoir si j’allais pouvoir suivre les cours, n’ayant pas
encore l’argent. Je me retrouve dans la classe du professeur de Keith Jarret !
J’ai eu mon financement et j’ai pu rester à Boston pendant quatre ans. En 1995
j’ai pu assister à la classe de Pomeroy et c’était une révolution pour moi.
J’ai étudié la composition symphonique, la musique pour l’image et le piano
jazz. En dehors des cours j’ai écrit des compositions orchestrales et des
musiques de films. A partir de là j’ai pu grâce à un agent et une bourse
m’installer à Los Angeles. J’avais écrit un ballet et j’ai eu une commande
d'une pièce symphonique pour la ville de Marseille pour ses 26 siècles
d’existence. J’ai donc eu un dilemme entre Marseille et Los Angeles. Finalement
je suis allé à Marseille.»
Quelle a été votre première composition
importante pour l’audiovisuel ?
Un
téléfilm pour M6 grâce au réseau de mon frère : « Peur Blanche »
d’Olivier Chavarot, qui a été primé à Cognac en 1998.
Parlez moi un peu de votre
frère ?
On a
dix ans de différence d’âge avec Éric. J’avais sept ans quand il a quitté la
maison. Il est réalisateur, il avait fait « Brasier » puis après
l’échec de son film il a fait de la publicité. On a travaillé ensemble sur son
deuxième long-métrage « Toreros » en 2000, qui n’a pas bien marché
aussi.
Travailler
avec son frère est-ce compliqué ?
Ce
n’est pas évident, on est très différent, et puis il y a notre différence
d’âge. Il regardait ce que je faisais avec bienveillance. Il me disait qu’il
n’aurait pas eu le courage de faire ce que j’avais fait. On a travaillé
ensemble sur « Toreros » parce qu’il n’y avait plus d’argent pour
faire la musique. J’étais en tournée dans le sud, il m’a donné dix jours pour
faire le score. Heureusement j’ai pu engager deux amis arrangeurs pour m’aider.
Avec « Le Dernier Diamant », et comme dans tous les films de casse,
pourquoi met-on du jazz ? C’était une volonté de votre frère ?
Non
c’était plutôt inconscient. Après « Toreros » j’ai travaillé sur
« Le Serpent ». Il m’a demandé de faire un essai musical et il a
adoré ainsi que les producteurs. Les critiques ont été bonnes. C’est après ce
film qu’il m’a demandé de continuer avec lui, et on a fait quelques publicités
ensemble. « Le Serpent », ce n’était pas mon univers mais j’aime bien
entrer dans l'univers des gens et apporter ce qui peut le faire exister. J’ai
lu toutes les moutures du scénario de « Le Dernier Diamant ». Éric
était ouvert sur toutes les propositions musicales que je pouvais lui faire.
Moi, je voulais beaucoup de cuivres, quelque chose de charnue, enregistrer en
live et en analogique, avec du grain ; quelque chose d’un peu sale, brut ; d’où
cette volonté d’enregistrer en direct. C’était plus compliqué. On a fait deux
mix, un pour le film et un pour le CD. On a enregistré à Rochefort-sur-Mer avec
un quintette de vents, avec des cordes et les cuivres plus devant. Le but
c’était de mettre en avant la bande des casseurs, le côté noir, et faire le
contraire pour Bérénice Béjo avec les cordes plus
romantiques. On n’a pas complètement poussé à fond les cuivres pour le film car
ça saturait, mais on l’a fait pour le CD. A Rochefort on a enregistré sur bande
magnétique, pas en numérique, d’où ce résultat assez spécial.
C’est
un superbe CD, c’est CristalRECORDS qui l’a produit ?
En
fait, j’ai ma boîte de production et j’ai produit la musique du film. On est
coproducteur avec Cristal et Vertigo.
Vous avez fait beaucoup de belles musiques
pour la télévision dont une que j’apprécie particulièrement, « Vauban la Sueur Epargne le Sang »,
le documentaire de Pascal Cuissot. Elle est totalement différente de ce que
vous composez et elle ne fait pas copie de la musique du XVIIIème.
Oui
j’en suis assez content. Je venais de faire un film avec Jérôme Boivin,
« Vital désir », un téléfilm sur l’hormone de croissance, assez dur.
Judith, sa femme, est luthière, elle fabrique des violes de gambe. Je l’ai
rencontrée, je voulais faire une musique pour « Vauban » assez
moderne avec des instruments anciens. Elle m’a trouvé des solistes. La
composition était pour viole de gambe, clavecin et orchestre moderne. J’aime
enregistrer tous les instruments ensemble. Il y a une magie qui s’opère entre
les musiciens. Inutile de vous dire que ça été une galère car la viole de gambe
se désaccorde tout le temps. C'était mon premier contrat avec Cristal. Il y a
eu une belle audience sur Arte.
Et
aujourd’hui vous travaillez encore pour Arte ?
Oui,
sur un documentaire, « Les Impunis », d’Agnès Gattegno,
réalisatrice très engagée, et qui a pour thème les narcotrafiquants. C’est un
choc ! Je l’ai rencontrée grâce à la monteuse du Serpent. Le film a été
monté sans musique. Je compose une musique avec seulement deux instruments.
J’ai aussi un autre projet pour Arte, sur la préhistoire du cinéma avec Pascal
Cuissot, le réalisateur du « Vauban ».
Comment se faire connaître dans ce milieu
où la plupart des réalisateurs sont incultes au niveau musical ?
Il
faut travailler sur un film qui a du succès. J’ai deux projets de cœur, un avec
un mexicain, Mauricio Isaac, avec qui j’avais fait « Mejor es que Gabriela no se Muera » qui a eu un grand prix à LA, et un autre
avec un réalisateur d’animation le peintre Borislav Sajtinac pour qui j’avais composé la musique de “ Le
Tueur de Montmartre”, qui a reçu de nombreux prix.
Quel compositeur appréciez-vous le plus,
celui avec qui vous vous sentez le plus proche ?
En
musique de films, c’est sans hésiter Bernard Hermann, mais aussi Ennio Morricone.
En musique contemporaine j’aime beaucoup Henri Dutilleux, c’est un immense
compositeur.
Desplat a Audiard, Bource a Hazanavicius, Hetze a Desplechin, Rombi a Ozon, Serra a Besson.
Espérons que Barbier trouvera son Hitchcock. On le lui souhaite de tout cœur.
Peut-être est-ce son grand frère ?


https://www.youtube.com/watch?v=quqyN-k0gOo
Propos recueillis
par Stéphane Loison.
BO EN CD
LOUIS DE FUNES Musiques de film 1963-1982. 4CD Collection
Écoutez le Cinéma : 378 2239.
En
juillet 2014 Louis de Funès aurait eu cent ans. Les films dans lesquels il a
joué dans la deuxième partie de sa carrière ont été d’immenses succès et
continuent à faire rire les nouvelles générations. La collection « Écoutez
le cinéma ! » a réuni chronologiquement dans une même anthologie les partitions
emblématiques qu’elle avait proposées au cours des
années. En cinq heures de musique, tous les grands films défilent : « Fantômas », « Les Gendarmes », « Le Corniaud », « La Grande Vadrouille », « Oscar », « La Folie des Grandeurs », « Les Aventures de Rabbi Jacob »…
ainsi que les grands noms de la musique pour le cinéma, Georges Delerue, Michel
Magne, Raymond Lefèvre, Michel Polnareff, Vladimir Cosma…
C’est un bel hommage et une manière de se remémorer les grands moments d’un
cinéma populaire.

https://www.youtube.com/watch?v=4UUgVAoleEY
https://www.youtube.com/watch?v=oijunPaCRZo
https://www.youtube.com/watch?v=g1uCUtIwU9U
DRAGON
2. Réalisateur : Dean Deblois.
Compositeur : John Powell. Sony Classical n°88843071602
Le film sort le 7
juillet 2014
John
Powell est un habitué des films d’animation. « L'Âge de Glace, Happy Feet, Rio 1 et 2, Kung Fu
Panda, Chicken Run, Shrek, Fourmiz », tous
ces films sont de DreamWorks, donc de haute qualité
au niveau scénario et animation. « Dragon »
était déjà un excellent film et le numéro 2 a les mêmes qualités. Le
réalisateur canadien Dean Deblois a une grande
habilité pour réaliser ce genre de cinéma. Il a commencé chez Walt Disney avant
d’intégrer DreamWorks. Il a été le scénariste de
« Mulan ».
Un esprit irlandais règne dans cette musique, - « For The Dancing And The Dreaming », chanson interprétées par Gerard Butler, Craig Ferguson et Mary Jane Welles. On
trouve aussi une chanson du chanteur du groupe Sigur Rós Jónsi, « Where No One Goes ». Dean Deblois avait fait un documentaire sur ce groupe. John Powell nous offre des
compositions larges, épiques, joyeuses avec voix, flutiaux, flûtes, cornemuses
irlandaises, ambiances moyenâgeuses dansantes. On s’envole, on est dans un
monde mythique nordique. Bien sûr, il doit y avoir quelques moments d’émotion
avec violon, harpe celtique ou piano solo. John Powell ne cherche pas à nous
épater, il possède un bon savoir faire et cela se sent dans ses orchestrations.
Lorsqu’on ne sait pas de qui est la musique, on peut dire c’est du John Powell,
car sa particularité est d’arriver à se fondre dans l’univers qu’on lui demande
de créer. On est loin avec « Dragon
2 » de « Braquage à
l’Italienne », de « Robots »,
de « Volte/face » ou des
« Mémoire dans la Peau ».
On lui doit la belle musique pour le mélo « PS I Love You », à l’opposé de celle-ci. L’écoute de ce CD est
très agréable, on a comme une sorte d'image symphonie entre Grieg et Ravel.
Pour notre part on avait beaucoup apprécié ce qu’il avait écrit pour un film
français « Au Bonheur des
Ogres » de Nicolas Barry. Un film à voir ainsi que « Dragon 2 », et à découvrir ces deux
musiques.

https://www.youtube.com/watch?v=n30rxe3_xFQ
LUIS MARIANO. 1 CD Milan n° 399 574-2
Voilà
d’abord une voix qui a subjugué toute une génération. Luis Mariano aurait pu
être un grand ténor d’opéra, mais il s’est dirigé vers l’opérette et a y eu un
succès phénoménal. Pour le centième anniversaire de sa naissance, les éditions
Milan Music sortent un CD de ses grands succès. Toutes ses chansons on les
retrouve dans les films où il a joués. C’est Richard Pottier qui a filmé les
opérettes telles que « Violettes
Impériales », « Le Chanteur
de Mexico » ou « Rendez-vous
à Grenade ». Gilles Grangier, Raymond
Bernard, André Berthomieu, tâcherons du cinéma
français, l’ont utilisé dans des films insipides dont les seuls moments de
grâce sont ceux où Mariano chante. Ce disque est surtout destiné aux
nostalgiques des opérettes de Lopez et d’une certaine époque supposée
insouciante.

https://www.youtube.com/watch?v=cZNUgC2gkJE
UNE
PROMESSE. Réalisateur : Patrice Leconte. Compositeur : Gabriel Yared. 1CD Fidélité pl n°404287
Le
scénario est basé sur la nouvelle de Stefan Zweig : « Le Voyage dans
le passé ». En Allemagne, en 1912, dans la Ruhr, un jeune secrétaire
pauvre tombe amoureux de la jeune femme de son patron, un industriel âgé.
« Une Promesse » est un beau mélo, bien réalisé, superbement joué par
un trio d’acteurs - Richard Madden, l’intrépide Robb Stark de la célèbre série « Game of Thrones », Alan Rickman, le
fameux Rogue de la série « Harry
Potter », et Rebecca Hall, lancée au cinéma par Woody Allen dans Vicky
Christina Barcelona - et accompagné par une musique de Gabriel Yared. Sa musique colle parfaitement aux images, à
l’action, aux sentiments des personnages. Elle nous transporte dans cette folle
histoire d’amour qui ne nous laisse pas insensible. Patrice Leconte change
souvent de compositeur au grès de ses films, ce qui assez rare au cinéma. On peut citer parmi la dizaine de
compositeurs qui ont collaboré avec lui : Alexandre Desplat,
Pascal Estève, Étienne Perruchon, et Antoine Duhamel
qui a écrit la magnifique musique de « Ridicule ».
Avec « La Promesse », Yared nous entraîne dans une musique simple, intime et qui
vous envahit dès la première note. Comme le dit Leconte à propos de Yared, « Dans
son écriture, j'aime passionnément sa capacité à traduire la complexité des
mouvements du cœur, avec pudeur et retenue ». Le CD restitue bien
cette ambiance. Un film et un CD coup de cœur.

GOLDEN
NEEDLES. Réalisateur : Robert Clouse.
Compositeur : Lalo Schifrin. Music box records n° MBR-050
Afin de
célébrer le 50ème album de sa collection, Music Box Records propose pour la
première fois en CD la bande originale du film « Golden Needles » (Les 7 aiguilles d'or / L'aventurière de Hong-Kong) composée et
dirigée par Lalo Schifrin. Réalisé en 1974 par Robert Clouse, ce film d'aventures est interprété par Joe
Don Baker, Elizabeth Ashley, Ann Sothern, Jim Kelly
et Burgess Meredith. À Hong-Kong, Dan, un détective privé Américain est chargé
de récupérer une statuette en or contenant sept aiguilles d'acupuncture en or
volées par Lin Toa, chef de la mafia locale. Plantées
selon un schéma très précis, les aiguilles rendraient la jeunesse éternelle,
mais mal utilisées, elles provoqueraient la mort. Le milliardaire Winters et la mystérieuse Felicity convoitent également ce fabuleux trésor. Essentiellement connu pour ses films
d'action / aventure et d'arts martiaux, dont le dernier film de Bruce Lee
« Opération Dragon » (1973), Robert Clouse fait de nouveau appel au célèbre Lalo Schifrin. Tous
les codes du genre sont respectés : éléments orientaux, percussions
électroniques, riffs de jazz et motifs syncopés. Transférée à partir des bandes
master issues des archives de la MGM, la partition totalement inédite de Lalo Schifrin propose l'intégralité de la musique du film. Les
notes du livret sont signées par Gergely Hubai. Un CD pour les fondus de Schifrin et les collectionneurs. L’album est en série limitée.

BIRD
PEOPLE. Réalisatrice : Pascale Ferran. Compositrice :
Béatrice Thiriet. Cristal Records n°B0016
Béatrice Thiriet a composé pour de nombreux réalisateurs tant au
cinéma qu’à la télévision : Dominique Cabrera, Jacques Deschamps, Radu Miailheanu, Joêl Farges, Marc Esposito, Pierre Javaux, Xavier Durringer, Eyal Sivan. Elle écrit aussi des œuvres symphoniques, de la
musique de chambre et de l’opéra. Pour la musique de « Bird People », Béatrice Thiriet joue les
parties de piano et a fait appel au Star Pop Orchestra dirigé par Mathias Chartron, orchestre à géométrie variable qui, comme
l’illustre Boston Pops dirigé par John Williams dont il tire son nom, a pour
vocation de démythifier les concerts classiques. Elle avait composé pour cette
même réalisatrice une belle musique pour accompagner « L’Amant de Lady Chatterley ».

L’ETAT SAUVAGE / LE GRAND FRERE. Réalisateur : Francis Girod.
Compositeur : Pierre Jansen. Music box records.com MRB 045.
Musicbox qui a déjà proposé des musiques de
films de Francis Girod, offre
aujourd’hui sur un même CD « L'État Sauvage »(1978) et le « Grand
Frère ». « L’État Sauvage » est adapté du roman de Georges Conchon (prix Goncourt 1964) et traite des premières heures de la décolonisation dans
un État africain imaginaire, à travers le destin tourmenté de cinq personnages
principaux. « Le Grand
Frère » (1982) est une adaptation du roman de Sam Ross, Ready for the Tiger.
Trahi par un compagnon, Gérard Berger, ancien légionnaire, le retrouve et le
tue. Témoin du meurtre, le jeune Ali va se lier d'amitié avec Berger.
Pour
la musique de « L’État
Sauvage » Pierre Jansen ne fait aucune allusion musicale à
l’Afrique. L’écriture est, comme il en a l’habitude, très dissonante, sans
thème, une musique rugueuse, résolument contemporaine. Pour « Le Grand Frère », la musique
est plus traditionnelle. On y distingue deux volets : d’une part, les
plages symphoniques destinées à mettre en relief la dramaturgie du scénario et
la psychologie des protagonistes, et d'autre part, les musiques de source. Ces
partitions sont, comme souvent, de grands moments de musique. Jansen a
abandonné la musique de film pour n’écrire que de la musique de concert. On
peut se souvenir qu’il était le compositeur attitré de Chabrol dès les années
1960 avec « Les Bonnes Femmes ».
Suivront de superbes partitions telles que celles de : « Le Boucher », « La Décade
prodigieuse », « Les Noces Rouges », « Violette Nozière »… ». La présente édition est limitée
à 500 exemplaires. Les notes du livret sont signées par Laurent Perret qui a pu
recueillir les souvenirs du compositeur.

Les japonais Joe Hisaishi et Hayao Miyazaki se retrouvent une dixième fois pour un
nouveau film d'animation de Studio Ghibli. Yumi Arai signe la chanson “Hikoki Gumo” (issue de son tout
premier album), présente en générique de fin. L’un comme l’autre n’ont plus
rien à prouver. Ce film sera le dernier de Miyazaki. La partition est sans
surprise mais toujours aussi lyrique, mélancolique, très bien orchestrée, et
elle a le don de nous émouvoir, de nous enchanter. Le film n’est pas à proprement
parler un film pour tout public et la musique est moins évidente à l’écoute que
les précédentes. Bien sûr, il y a une certaine filiation avec un autre film
d’animation, à savoir « Porco Rosso ». Le
film et le CD s’ouvrent par une mélodie d’inspiration italienne, avec mandoline
et accordéon. C’est ce thème mélancolique à souhait que nous entendrons pendant
tout le film avec différentes variations orchestrales. Le piano est toujours
présent chez Hisaishi, il donne une certaine unité à
la partition. Il y a beaucoup de douceur et de tristesse dans cette musique
ainsi que dans le film. Comme pour tous les autres CD de musique de Hisaishi, il faut se procurer cette BO. Hélas elle n’est
pour l’instant qu'en import.

https://www.youtube.com/watch?v=sKeoLNJKmo0
THE
BLUE MAX. Réalisateur : John Guillermin.
Compositeur : Jerry Goldsmith. La-la land Records n° llmvd 1296
Au
cœur de la première guerre mondiale, un jeune pilote allemand ne recule devant
rien, y compris séduire la femme de son général, pour obtenir la "Blue
Max", la plus haute des distinctions militaires. 20th Century Fox et La-La
Land Records ont remixé la bande sonore de ce film qui date de 1967 et
proposent 2CD avec des scores inédits. C’est une très belle partition de Jerry
Goldsmith qui pour l’interpréter a eu des moyens colossaux - un orchestre de
cent musiciens - et même une machine à vent. Il fallait un compositeur de cette
envergure pour accompagner les impressionnantes scènes de bataille aérienne.
Cette musique grandiose, brillante, contemporaine, jouée par le National Philharmonic Orchestra méritait une ressortie. La-La land
l’a fait. Il n’y aura pas beaucoup d’heureux car c’est une édition limitée.

https://www.youtube.com/watch?v=fG5ulty8y9k
JERSEY BOYS. Réalisateur : Clint Eastwood. Compositeur : Bob Gaudio. NEW YORK MELODY.Réalisateur :
John Carney. Compositeur : Greg Alexander
Deux
comédies musicales sortent dans les salles en ce moment : « Jersey
Boys » et « New York Melody ». L’une se passe dans les années
60, l’autre aujourd’hui. Elles ont un point commun, l’ascension de chanteurs
dans la grande tradition des comédies musicales d’antan. La route pour arriver tout
en haut de l’affiche est semée d’embûches, mais avec persévérance, avec
énergie, « yes we can »! C’est toute la philosophie américaine qui se
dégage de ces deux films.
« JERSEY BOYS » retrace
l'ascension et le déclin du groupe de rock légendaire The Four Seasons avec le chanteur à la voix haut perchée Frankie Valli. Comme pour le spectacle de Broadway dont s'inspire
le film, les comédiens ont rompu la convention cinématographique et s'adressent
directement à la caméra, et donc au spectateur. Frankie Valli est celui qui chante le thème de « Grease »,
pour ceux qui n’ont pas connu les années soixante. La mise en scène d’Eastwood est très académique mais son film se laisse
regarder avec beaucoup de plaisir. Le sujet est intéressant car il montre
comment grâce à la chanson, même si cela a été difficile, des petits malfrats
ont pu se sortir de leur ghetto. La bande sonore est faite des chansons écrites
par Bob Gaudio pour la musique et Bob Crewes pour les paroles. Elles sont devenues des classiques
de la culture populaire américaine : Sherry, Big Girls Don’t Cry, Walk Like a Man, et le succès
planétaire Can’t take My Eyes off You, reprise par
Sinatra, Gaynor, Hill, et même par le groupe Muse. On
les écoute une fois et on est bon pour les avoir dans la tête toute la
journée !
« NEW YORK MELODY » est un peu
plus complexe dans le scénario. Gretta et son petit
ami Dave débarquent à New York pour y vivre pleinement leur passion : la
musique. Leur rêve va se briser et leur idylle voler en éclats quand, aveuglé
par son succès naissant, Dave va plaquer Gretta pour
une carrière solo et une attachée de presse. Son billet de retour pour Londres
en poche, Gretta décide de passer une dernière nuit
sur place. Encouragée par son meilleur ami, elle se retrouve à chanter sur une
scène d’un pub de la ville. Dans la salle, un producteur de disques revenu de
tout et en perte de vitesse va tomber sous le charme de la voix de Gretta. Malgré les embûches de toute sorte, il parviendra à
réaliser un disque avec Gretta, qui sera un vrai succès.
Outre Keira Knightley, Gretta la chanteuse, Mark Ruffalo, Dan le producteur, Adam Levine, Dave la rock star, il y a,
comme on le trouvait dans certaines anciennes comédies musicales, une autre
actrice très présente : la ville de New York. John Carney sait l’utiliser dans sa mise en scène. Le scénario est original et on a
beaucoup de tendresse pour ce couple improbable (dans le film) que forme Gretta et Dan. Réunis par
une même passion et un même désespoir, ils vont entamer une collaboration
musicale qui va se muer en une profonde amitié et changer le cours de leur vie.
Bien sûr, la musique est au centre du film. Elle est due à Gregg Alexander. Il
est plus connu en tant que chanteur du groupe New Radicals avec qui il a fait l’album « Maybe You’ve been Brainwashed Too » qui s’est vendu à plus de deux millions
d’exemplaires dans le monde. Pour le film, il a composé plusieurs chansons
originales reflétant les différents styles de musique populaire d’aujourd’hui
mais aussi l’état émotionnel des personnages. Les chansons devaient évoquer
l’atmosphère et le rythme effréné de la métropole la plus animée des
États-Unis. Le travail musical d’Alexander est exceptionnel. Enregistrer en
direct l’album de Gretta dans des lieux mythiques de
New York, sortir des fameuses scènes de studio, est une belle idée de scénario.
New York Melody est une vraie comédie musicale contemporaine. La musique du
film peut être téléchargée sur le site de Polydore.
https://www.youtube.com/watch?v=08ziDo8Luws

Stéphane Loison.
LIVRES
Vincent
Amiel : LANCELOT DU LAC de ROBERT BRESSON. 1 vol. PUF Collection « Le Vif du Sujet », 112 p.
Quatrième
de couv’ : « L’objet
de cette étude est double : d’une part mettre en perspective les images de Lancelot du Lac de Robert Bresson et celles qui ont traité
du même cycle arthurien, des enluminures médiévales au cinéma hollywoodien,
d’autre part tenter de situer les innovations poétiques et formelles de ce film
dans son temps, dans le contexte du cinéma contemporain. Approche
iconographique et esthétique, l’étude du film met en avant l’extrême rigueur
formelle de Robert Bresson, et la beauté rare de ses choix de montage. Une
analyse des rythmes, des répétitions, des mouvements propres au
« cinématographe » de Bresson voisine ici avec une réflexion sur les
thèmes des récits de la Table ronde, et la tragédie d’un monde qui disparaît
dans un désordre parfaitement mis en forme. »
Vincent Amiel est professeur
d’études cinématographiques à l’université de Caen-Basse Normandie. Directeur
de la revue Double
jeu, il est par ailleurs critique (pour les
revues Positif et Esprit en particulier) et essayiste dans les domaines du
cinéma, mais aussi de la télévision et des images en général. Il a publié
notamment « Les Ateliers du 7e art » (Gallimard, 1995),L »e Corps au
cinéma, Keaton, Bresson, Cassavetes » (PUF, 1998), « Esthétique
du montage » (Armand Colin, 2001, 2005), « Formes et
obsessions du cinéma américain contemporain » (Klincksieck,
2003), et « Joseph L.
Mankiewicz et son double » (PUF, 2010, Prix du meilleur livre de
cinéma, Syndicat de la critique de cinéma). Le problème de ce type de livre est qu’il faudrait pouvoir répondre
point par à point à ce qu’avance l’auteur. Il y a une telle subjectivité, un
tel ton professoral, des phrases tellement alambiquées qu’il est impossible de
s’y retrouver et même de le critiquer. Malgré tout son talent d’écrivain, il
faut bien reconnaître qu’à la lecture de cet essai, on a l'impression que
Vincent Amiel enfonce souvent des portes ouvertes. Il le dit d’ailleurs :
les portes ne sont là dans le cinéma de Bresson que pour être franchies !
Musset disait qu’elles doivent être ouvertes ou fermées. Comme il l’écrit,
c’est la simplicité et l’évidence des actions qui sont mises en action dans le
film de Bresson. Il aurait pu s’appliquer cette phrase à lui-même. Pour qui
écrit-il ce livre ? Pour ses quelques étudiants ? Pour lui ? Il
aurait pu au début de cet ouvrage dont la mise en page est très sympathique -
les illustrations, un clin d’œil à l’histoire du cinéma de Godard ?
-mettre au moins la fiche technique du film. Tout n’est pas à rejeter bien sûr.
L’introduction est intéressante, la suite est à feuilleter. J’ai apprécié toute
sa théorie filmique des gros plans de Bresson dans les scènes de tournois ou de
bataille. Bresson y était bien obligé vu le peu de budget qu’il avait pour
faire le film, et puis il n’a jamais été un adepte des plans larges, son
objectif préféré était le 50mm. Kenneth Branagh avait
eu les mêmes problèmes de budget dans « Henri V » pour filmer la
bataille d’Azincourt et les gros plans de cette
bataille sont devenus célèbres. La collection « Le vif du sujet » est
peut-être une collection intéressante et les autres albums plus attractifs mais
ne les ayant pas lus je ne peux porter un jugement.
Pour ceux qui aiment Bresson, il existe, chez Gallimard, un
livre de ses réflexions sur le cinéma où tout est dit. Bresson c’est le
mystère, alors il est difficile de tout vouloir expliquer …

Alexander Kluge : L’UTOPIE DES
SENTIMENTS. Essais et histoires de cinéma. 1 vol PUF Collection « Le Vif
du Sujet », 228 p.
Ce recueil
est une proposition théorique ambitieuse : pour introduire à l’œuvre
monumentale et multiple d’Alexander Kluge, il est composé à la fois d’essais
rédigés entre les années 1960 et 1980 et de textes littéraires des années 2000,
des « histoires » consacrées elles aussi au cinéma et aux médias (dont quatre
récits inédits). Sa forme n’est pas sans rappeler la technique même d’Alexander
Kluge, qui a constitué son œuvre en constellation de fragments, qu’il expose à
toutes sortes de montages et de remontages. Le titre lui-même, L’Utopie des
sentiments, rend hommage à la place centrale de la subjectivité dans la
vision de l’artiste qui y voit le lieu d’une rencontre dialectique et
révélatrice entre le privé et le public, entre le personnel et le politique. Sa
théorie du cinéma met au centre le rôle du spectateur : les films, comme les
médias, n’existent que par lui, au cœur de son imagination. Figure centrale de la culture allemande
contemporaine, Alexander
Kluge est tout à la fois
cinéaste, écrivain, enseignant, philosophe, sociologue, théoricien des médias
et homme de télévision. Maître de l’essayisme sous
toutes ses formes, il est l’un des héritiers les plus inventifs de la Théorie
critique de Theodor W. Adorno et conduit une
recherche inlassable et inclassable, traversant et réinventant les champs
disciplinaires. Parmi ses films les plus connus, on retiendra « Anita
G. » (1966), « La
Patriote » (1979), « Le
Pouvoir des sentiments » (1983) ou
encore « Nouvelles de l’antiquité idéologique » (2009).
Voilà un ouvrage unique qui permet de mieux faire connaître
ce cinéaste pratiquement inconnu en France. Dario Marchiori,
maître de conférences en histoire des formes filmiques à L’Université Lumière
Lyon 2, a fait un travail passionnant pour mieux nous le faire apprécier. C’est
un livre qui ne se lit pas comme un roman ; on peut le quitter, y revenir,
relire certains passages soit sur les réflexions qu’a Alexandre Kluge sur le
cinéma documentaire ou fiction, soit sur ses thèses philosophiques, ou encore
sur la place des sentiments dans le cinéma. On ouvre le livre au hasard et on
est tout de suite séduit par ce que nous raconte Kluge. Avec des mots simples,
avec des phrases limpides, il nous parle de choses compliquées. Il y a, bien
sûr, du Godard dans cet homme avec sa manière de jouer sur les mots.
« L’Utopie des sentiments » doit être au centre de votre bibliothèque
si vous aimez le cinéma.

Stéphane Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Passer une publicité. Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
maite.poma@leducation-musicale.com
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale
·
La librairie de L’éducation
musicale
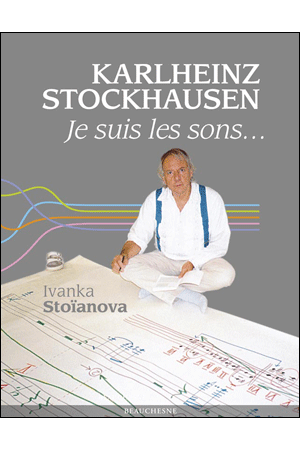 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite) |
 |
Analyses
musicales
XVIIIe siècle – Tome 1
L’imbroglio
baroque de Gérard Denizeau
BACH
Cantate BWV 104 Actus tragicus Gérard Denizeau Toccata ré mineur Jean Maillard Cantate BWV 4 Isabelle Rouard Passacaille et fugue Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu Janine Delahaye Phœbus et Pan Marianne Massin Concerto 4 clavecins Jean-Marie Thil La Grand Messe Philippe A. Autexier Les Magnificat Jean Sichler Variations Goldberg Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses Gérard Denizeau Apothéose Corelli Francine Maillard Apothéose de Lully Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus Sabine Bérard Israël
en Egypte Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile Jacques Michon L’alleluia du Messie René Kopff
Musique feu d’artifice Jean-Marie Thill |
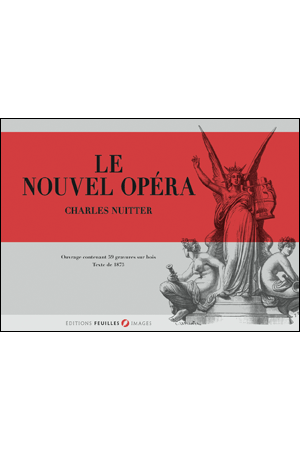 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
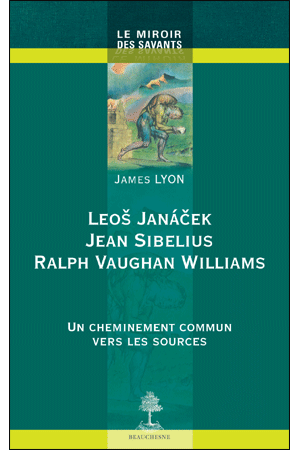 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque. Ils ont été confrontés aux tragédies de leur temps et y ont répondu en s'engageant personnellement dans la recherche de trésors dont ils pressentaient la proche disparition. (suite). |
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. Il prend la suite de La Recherche hymnologique (Guides Musicologiques N°5), approche méthodologique de l’hymnologie se rattachant à la musicologie historique et à la théologie pratique dans une perspective pluridisciplinaire. Nul n’était mieux qualifié que James Lyon : sa vaste expérience lui a permis de réaliser cet ambitieux projet. Selon l’auteur : « Ce livre est un USUEL. Il n’a pas été conçu pour être lu d’un bout à l’autre, de façon systématique, mais pour être utilisé au gré des écoutes, des exécutions, des travaux exégétiques ou des cours d’histoire de la musique et d’hymnologie. » (suite) |
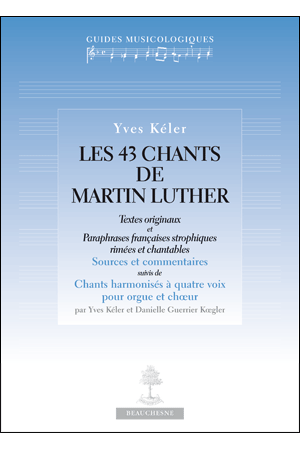 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. Aux hymnologues, musicologues, musiciens d'Eglise, chefs, chanteurs et organistes, ainsi qu'aux historiens de la musique, des mentalités, des sensibilités et des idées religieuses, il offrira, pour chaque choral ou cantique de Martin Luther, de solides commentaires et des renseignements précis sur les sources des textes et des mélodies : origine, poète, mélodiste, datation, ainsi que les emprunts, réemplois et créations au XVIè siècle... (suite) |
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ? Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui. Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ? Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique.
|
***
 |
Parution du numéro spécial BAC 2015 Courant Juillet 2014 CONFIEZ NOUS VOTRE PUBLICITE, VOS ANNONCES, VOTRE PROGRAMME
Plus de 4000 exemplaires. En vente durant 12 mois!
Contact : maite.poma@leducation-musicale.com Tel : 01 53 10 08 18
PS : N'hésitez pas à demander le sommaire
|
·
Où trouver le numéro du Bac ?
Les analyses musicales de L'Education Musicale



