L'ARTICLE DU MOIS : MOZART ET LA FRANCE A TRAVERS LA CORRESPONDANCE FAMILIALE
FESTIVALS PASCAUX A BADEN-BADEN ET A SALZBURG
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
À RESERVER SUR L'AGENDA
12, 14 & 15 / 6
Antar, Un inédit orientaliste de Ravel

Maurice Ravel s’attela en 1909 à un
étonnant travail : transformer la symphonie Antar de Rimski-Korsakov en musique de scène pour une pièce de théâtre de Chekri Ganem, auteur originaire
de Beyrouth. Entre les cinq actes narrant l’épopée du poète et guerrier arabe
du VI ème siècle, Ravel découpa la partition et
définit un nouvel agencement, lui adjoignant un extrait de l’opéra Mlada. il composera
une musique originale afin de lier entre eux les différents épisodes. Dans le
cadre de son cycle Ravel, avec l'orchestre de Lyon, Leonard Slatkin fait resurgir cette partition oubliée, créée à Monte-Carlo en 1910. L’immense
écrivain franco-libanais Amin Maalouf a accepté d’écrire un nouveau texte, qui
sera récité par André Dussolier. Cette rareté
s’accompagnera de deux cycles de mélodies au parfum oriental, chantées par
Véronique Gens, et de la luxuriante Seconde suite de Daphnis et Chloé, que distingue son sublime lever de soleil.
Auditorium
de Lyon, le 12 juin 2014 à 20H et le 14 juin à 18H
Salle
Pleyel, Paris, le 15 juin à 16H.
Location : Auditorium de Lyon, 149, rue
Garibaldi, 69003 Lyon ; par tel : 04 78 95 95 95 ; en ligne : www.auditorium-lyon.com
Salle Pleyel : billetterie, 252 rue du
faubourg Saint-Honoré 75008 Paris ; par tel. : 01 42
56 13 13 ; en ligne : www.sallepleyel.fr
14 -19 / 6
Festival Palazzetto Bru Zane aux Bouffes
du nord

Quatuor Mosaïques /
DR
Pour sa deuxième édition, le Festival Palazzetto Bru Zane, au Théâtre des Bouffes du Nord,
propose un parcours atypique dans le XIX ème siècle
musical français. On y découvrira des compositions inédites telles que le
Quatuor N °2 de Louis-Emmanuel Jadin et le troisième
Quatuor de Félicien David, joués par le Quatuor Mosaïque (14/6), le trio de
Gabriel Pierné et l'op 18 de Saint-Saëns, aux côtés du Trio de Ravel, par le
Trio Wanderer (15/6), le rare quintette pour piano et
vents d'Albéric Magnard, dont on célèbre, en 2014, le centenaire de la
disparition (17/6), ou encore des pièces pour violon et piano, comme le Poème
élégiaque d'Eugène Ysaÿe, le Poème de Joseph
Canteloube, joués par Nicolas Dautricourt et Dana Ciocarlie, qui donneront aussi la Sonate de Franck (18/6).
Une soirée autour du violoncelle sera l'occasion d'entendre des pièces de Max
d'Ollone, Fernand de La Tombelle, David Popper et
Jacques Offenbach, avec François Salque, Xavier
Phillips et l'Orchestre de violoncelles (16/6). Enfin, sera donné
l'opéra-comique Le Saphir (1865) de Félicien David, dans une transcription
et une adaptation pour neuf instrumentistes et six chanteurs dues à Alexandre
et Benoît Dratwicki. Ce compositeur est lui aussi
fêté cette année grâce aux passionnantes recherches du Palazzetto Bru Zane.
Théâtre des Bouffes du Nord, les 14, 16,
17, 18 et 19 juin 2014 à 20H30, et le 15 à 17H.
Location : au théâtre, 37 bis boulevard de
la Chapelle, 75010 Paris, ; par tel.: 01 46 07 34 50 ;
en ligne : www.bouffesdunord.com
17 / 6
Le Miroir de Jésus à Notre-Dame

André
Caplet / DR
La Maîtrise de Notre-Dame de
Paris et celle de Radio France, la soprano Delphine Haidan,
accompagnés d’Iris Torossian, harpe, d'Yves Castagnet,
orgue, et du Quatuor Parisii, sous les directions
partagées de Sofi Jeannin et d'Émilie Fleury, donneront en concert Le Miroir de Jésus d'André Caplet
(1878-1925). Chef d'œuvre de son auteur, la pièce mêle la voix aux cordes. Sur
des poèmes d'Henri Ghéon, reprenant les mystères du Rosaire, elle présente un
triptyque d'un profond mysticisme, « Miroir de joie, Miroir de peines, Miroir
de gloire », chaque partie étant précédée d'un court prélude confié aux seules
cordes. Cette exécution sera suivie de motets extraits du Livre de Notre-Dame, à l'occasion de la sortie du disque Le Livre de Notre-Dame aux éditions
MSNDP. On pourra entendra ainsi de Vincent Bouchot, Tantum ergo Sacramentum, de Michèle
Reverdy, Femme revêtue de soleil, et
de Benoît Menut, Un grand vent s’est
levé.
Cathédrale Notre-Dame de Paris, le 17 juin 2014 à 20H30.
Location :: http://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr/spip.php?article325
26 au 29/ 6
Les Pianissimes 2014

Le 9e Festival des Pianissimes,
qui comme chaque année fête l'arrivée de l'été, proposera ses concerts le
dernier week end de juin à Saint Germain au Mont d’Or
(69). Au fil des années, le festival a réussi à séduire les amateurs de piano,
tout en gardant son aspect convivial et détendu. Les concerts ont lieu en plein
air dans un amphithéâtre de verdure, et les contacts informels entre les
artistes et le public sont privilégiés. Ce petit village au bord de la Saône à
20 minutes au nord de Lyon, avec de charmantes maisons d’hôte et proche de
hauts lieux gastronomiques, s'est imposé comme un lieu idéal pour passer un
week-end ‘Nature & Musique’… Les étoiles montantes de la jeune génération
du piano et de la musique de chambre ont pris l’habitude de s’y retrouver. Le
programme rassemblera notamment les pianistes Emmanuel Christien, Lorenzo Soulès,
Thibault Lebrun, le violoncelliste Noé Natorp, le quatuor Hermès. Le jazz ne sera pas oublié, avec le
duo explosif Thomas Enhco / Vassilena Serafimova au piano et au marimba.
L’invitée d’honneur de cette édition sera une pianiste discrète, aussi
touchante par son jeu que par son histoire personnelle, Zhu Xiao-Mei.
Enfin, deux concerts pédagogiques gratuits seront offerts à 300 enfants des
écoles de la région, le 27 juin, à 10 et 14 H.
Domaine des Hautannes,
33, rue du 8 mai 1945, 69650 Saint-Germain-au-Mont d'Or, du 27 au 29 juin 2014,
à 18H et 20H30.
Location : Association Dièse, 5
rue des Hautannes, 69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or,
ou 204 rue Saint Martin, 75003 Paris ; par tel : 04 78 98 11 78 ou 06 03 02 14
29 ; en ligne ; www.lespianissimes.com
2 / 7
L'Élixir d'Hervé à Caen

L’opéra-comique en un acte L'Élixir,
d’Hervé (1825 -1892), sera créé au festival Viva Voce
à Caen, par la Compagnie des Frivolités Parisiennes. Concocté dans les années
1860 par celui qu'on appelait le "compositeur toqué »,
Louis-Auguste-Florimond Ronger de son vrai nom, l'ouvrage ne fut jamais joué.
Proposé à l'Opéra Comique, il fut refusé par le directeur d'alors. Si la trame
en est quelque peu invraisemblable - une aïeule absorbant un élixir pour aider
en amour sa petite fille - la musique est drôle et pétillante, comme souvent
chez ce compositeur qui manie comme personne un style lyrico-bouffe
humoristique. On se souvient de ses opéras-bouffe en un acte, tel Chilpéric,
ou ses opérettes, telle Mam'zelle Nitouche. Pour célébrer son dixième
anniversaire, le Festival Viva Voce s'offre cet
inédit. Leo Warynski assurera la direction musicale
de cette « création ».
Église
Saint-Nicolas, 23 rue Saint-Nicolas, Caen, le 2 juillet 2014, à 20H30.
Location : Office du Tourisme, 12, Place
Saint-Pierre, 14000 Caen ; par tel. : 02 31 27 14 14.
4 - 27 / 7
Le festival international d'opéra baroque de Beaune

Le festival international d'opéra baroque
et romantique de Beaune est un événement incontournable dans le domaine. Depuis
plus de trois décennies, la cour des Hospices résonne des drames lyriques des
XVII et XVIII ème, de Haendel, mais aussi de tous ces
compositeurs dont on a fini par découvrir qu'ils illustraient aussi
essentiellement le genre lyrique que les auteurs bien connus de l'époque
romantique ou du XX ème siècle. Ce furent Jommelli,
Porpora, Cavalli ou Pergolèse, et bien sûr Vivaldi, Campra, Lully ou Rameau.
Une politique d'invitation de chefs et d'ensembles experts comme d'artistes
renommés, et de présentation de talents émergents a contribué à faire de cette
manifestation un jalon essentiel du parcours festivalier de l'été. Sa 32 ème édition se déroulera sur les quatre week end de juillet. Le
festival proposera huit opéras et
oratorios dont trois productions consacrées à Rameau à l'occasion du 250e
anniversaire de sa mort : Zaïs, ballet héroïque, qui tient de la pastorale et de la
féérie, et interprété par Christophe Rousset et Les Talens Lyriques,
puis la tragédie lyrique Castor et Pollux, dans la version inédite de 1754, dirigée par
Raphaël Pichon à la tête de l'ensemble Pygmalion, et enfin les Grands Motets, en clôture du festival, dans la version de William
Christie et des Arts Florissants, qui fêtent leurs 30 ans de présence à Beaune.
Au programme également deux opéras de Haendel, dans le cadre de l'intégrale de
ses opéras et oratorios poursuivie par le festival depuis plusieurs années : Teseo, troisième opéra londonien de son auteur,
dirigé par Federico Maria Sardelli et Modo Antiquo, et Serse par
Riccardo Minasi et Il Pomo d'Oro. Une production de La Cenerentola, dernier opéra italien de
Rossini, sera interprétée par Jean-Christophe Spinosi et l'Ensemble Matheus, confirmant l'ouverture du
Festival vers le répertoire lyrique romantique sur instruments originaux. Andreas Scholl, contre-ténor dont le nom est fortement lié à Beaune
depuis 20 ans, chantera et fera ses débuts en tant que chef d'orchestre avec l'Accademia Bizantina, dans un
programme consacré aux Cantates pour
alto de JS. Bach. Les Odes à Sainte Cécile de Purcell seront données par
Paul McCreech avec son Gabrieli Consort & Players.
Par ailleurs, quatre récitals présenteront
la fine fleur de la jeune génération et des ensembles aussi prestigieux : la
mezzo-soprano Delphine Galou et Les Ambassadeurs,
conduits par Alexis Kossenko, le contre-ténor David
DQ Lee et Pulcinella, dirigé par Ophélie Gaillard,
les sopranos Julie Fuchs et Alphonse Cemin, au
pianoforte, et Gaëlle Arquez avec Thibault Noally et
ses Inventions.
Cour des Hospices de Beaune, salles de Pôvres, Basilique Notre-Dame, les week end des 4 au 6, 11 au 13, 18 au 20, et 25 au 27 juillet 2014, à 21 H.
Renseignements et location : Bureau du
Festival, BP 60071, 21202 Beaune cedex ; par tel.: 03
80 22 97 20 ; par fax : 03 80 24 90 09 ; en ligne : festival.beaune@orange.fr ou
www.festivalbeaune.com
Jean-Pierre Robert.
***
L'ARTICLE DU MOIS
Mozart et la France à travers la correspondance familiale(1)
« Cet acte
conférera à Son Excellence Monsieur le Comte von Podstatsky un grand honneur dans la biographie de notre
enfant que je ferai imprimer en son temps, car ici commence en quelque sorte
une nouvelle ère de sa vie.»
Ces lignes écrites à Olmütz par
Léopold Mozart à son propriétaire de la Getreidegasse,
Lorenz Hagenauer, le 10 novembre 1767, alors que
Wolfgang venait de vaincre la variole, dévoile la prise de conscience précoce
du père devant le génie de son fils dont il envisageait déjà de publier une
biographie alors que l’enfant n’était pas encore âgé de douze ans...
Sans doute n’existe-t-il pas d’autre personnage au monde
dont la vie soit couverte presque intégralement par des témoignages
épistolaires directs: à peine deux semaines après la naissance de l’enfant, le
9 février 1756, Léopold Mozart écrit à son éditeur Johann Jakob Lotter à Augsbourg: «Par
ailleurs, je vous annonce que le 27 janvier, à 8 heures du soir, ma femme a
heureusement accouché d’un garçon. [...] Notre fils s’appelle Joannes Chrisostomus,
Wolfgang, Gottlieb.» Et la dernière lettre de Mozart à sa «Très chére,
excellente petite épouse» est datée 14 octobre 1791, à peine deux mois
avant sa mort. Il la termine par les mots: « Porte-toi bien, à jamais, ton Mozart.»
Le grand voyage en Europe occidentale commence le 9 juin
1763 et conduit la famille dans les plus grandes Cours d’Europe. Léopold, le
père, Anna Maria, la mère, Maria Anna (« Nannerl »),
la sœur de cinq ans son aînée, et le petit Wolfgang, âgé de sept ans, qui se
nommait encore Gottlieb, sont accompagnés par un serviteur et voyagent dans une
voiture achetée quelques mois plus tôt, avec des chevaux de louage. On voyage
lentement, s’arrête dans les meilleures auberges, donne des concerts, étudie
les mœurs et les pays étrangers. Pendant ce voyage, Léopold rend compte de
tout, l’enfant prodige se fait les doigts sur un clavier de voyage acheté à
Augsbourg, découvre l’orgue, joue pour la noblesse et la bourgeoisie des lieux
traversés, et participe ainsi au financement du voyage. Mais « si les baisers donnés à mes enfants, et en
particulier à maître Wolfgang, étaient des Louis d’or tout neufs, nous
pourrions être bien satisfaits; mais ni l’aubergiste, ni le postillon ne se
contentent malheureusement de baisers », s’excuse-t-il dans une lettre à
Johann Lorenz Hagenauer qui était non seulement le
propriétaire de l’appartement, mais aussi un ami intime de la famille.
Commerçant, il facilita en grande partie l’organisation matérielle de ce grand
voyage et sans doute des autres tournées entreprises par Léopold Mozart et ses
enfants.
Les voyages n’étaient pas toujours agréables et les
routes faisaient souvent souffrir les suspensions, contraignant les voyageurs à
s’arrêter en des lieux non prévus au programme. Ainsi non loin de Louvain: « Il faisait un temps magnifique, mais nous
eûmes la malchance de casser la moitié du bandage de la 2ème roue
avant, 3 heures à peine après notre départ. [...] Nous avons donc dû déjeuner 2 heures plus tôt, en attendant que la
roue soit réparée. [...] Après nous
avoir installé une misérable petite table, on nous servit une soupe et de la
viande du chaudron accompagnés d’une bouteille de vin
rouge de Champagne sans que fût prononcé un seul mot d’allemand mais seulement
du pur wallon, c’est-à-dire du mauvais français. La porte était toujours
ouverte et c’est pourquoi nous eûmes souvent l’honneur de recevoir la visite
des cochons qui grognaient autour de nous. Vous ne pouvez mieux vous
représenter notre table de déjeuner qu’en pensant à la toile d’un peintre
hollandais.»
Léopold Mozart était un personnage extrêmement cultivé,
un digne représentant de l’époque des Lumières. Il s’intéressait tant à la
littérature qu’à la politique, à la médecine qu’à l’architecture (il détestait
les maisons à colombage), à la peinture qu’à la musique, et donne à son
propriétaire une liste des « peintres les
plus célèbres dont on peut admirer les œuvres d’art dans tout le Brabant »,
qui ne ferait pas rougir un historien de l’art.
Les mœurs religieuses sont également passées au crible et
tiennent une grande place: « Nous sommes
vraiment toujours dans des lieux qui connaissent 4 religions: catholique,
luthérienne, calviniste et juive. » Et il s’étonne: « J’ai constaté que depuis Wasserbourg, nous
n’avons plus trouvé de bénitier dans nos chambres. Car même en pays catholique,
on en a écarté de tels objets car de nombreux étrangers luthériens y sont de
passage et les chambres sont organisées de telle façon que des hôtes de toutes
les religions puissent y habiter.» Et donc pas non plus de tableaux
représentant des saints ou des scènes religieuses, qui ne manquaient sans doute
jamais dans la très catholique Salzbourg...
Le Catholicisme n’est d’ailleurs pas aussi strict à
l’étranger que dans la principauté du Prince-Archevêque Schrattenbach à Salzbourg. À Bruxelles déjà, il déplore l’absence du chapelet. Mais à Paris,
c’est bien pire : « Ici, on ne sait pas
ce qu’est un chapelet [...] non
seulement on n’en voit pas, mais on gênerait les gens dans leurs prières si
l’on tenait un chapelet à la main. Actuellement, cela va encore, nous pouvons
tenir le chapelet dans le manchon, sans éveiller l’étonnement des gens et les
divertir dans leurs profondes prières. [...] Tout d’ailleurs s’oriente ici sur le profane [...].»
À Paris, tout est cher sauf le vin, et les Mozart
consomment d’ailleurs « chaque jour 2
bouteilles de vin et pour 4 sols de pain ». La nourriture ne leur plaît
guère et ce qu’il y a de pire, ce sont les périodes de jeûne: « Les jours maigres, on pourrait tomber
malade, car on ne voit aucune pâtisserie; on emploie ici quatre fois plus de
poudre pour les cheveux que de farine, le poisson est cher.» «Messieurs les Français n’aiment que ce qui
fait plaisir! » ajoute-t-il dans la même lettre à Madame Hagenauer, au mois de mars 1764, en reprochant à ses hôtes
de ne pas respecter les coutumes religieuses et de renoncer à toute sorte de
mortification. « On m’a déjà parlé d’une
coutume très dévote de cette sainte période du Carême, à savoir qu’au milieu du
Carême, certains bals sont autorisés, à l’époque nommée Carnaval des Pucelles.
Et que je dise à la moitié du Carême ou au Carnaval des Pucelles, c’est la même
chose. Les deux signifient Mi-Carême. Bien sûr!
Déduisez-en la haute estime dans laquelle sont tenues les pucelles, et imaginez
la foule et la bousculade qu’il y aura à ce chaste bal.» Six ans plus tard,
Léopold appréciera encore moins les coutumes milanaises, dues au rite
ambrosien...

« Thé chez le prince de Conti au Temple » - le
petit Mozart est au clavecin - copie de Joseph Sedlacek d'après l'original de Michel Barthélemy (Musée du Louvre) © Fondation
Internationale Mozarteum Salzburg
À Paris, la vie est certes très chère, mais « les bâtiments sont construits de façon
incroyablement commode.» Le 10 novembre 1763, la famille Mozart arrive dans
la capitale et loge chez l’envoyé bavarois, le comte Maximilian Emanuel Franz
van Eyck, qui avait épousé une Salzbourgeoise, fille
du grand-chancelier, le comte Georg Felix Arco. Ils
sont accueillis de la plus aimable manière et ont « le clavecin de madame la comtesse » dans leur chambre, « car
elle n’en a pas besoin; il est bon et a, comme le nôtre, 2 claviers.»
Léopold semble ébloui par le confort parisien. On trouve dans les hôtels
particuliers « tout ce qui peut être
agréable au corps humain et à la satisfaction des sens.» Le confort des «
cabinets d’aisance » semble fort apprécié, en France, ce qui nous en vaut une
description quelque peu croustillante sous sa plume: « Avez-vous entendu parler de cabinets d’aisance anglais? – – On en
trouve ici dans presque tous les hôtels particuliers. Des deux côtés, il y a
des conduites d’eau que l’on peut ouvrir après s’être exécuté; l’une envoie
l’eau vers le bas, l’autre, dont l’eau peut être chaude, l’envoie vers le haut.
Je ne sais comment mieux vous expliquer cela avec des mots polis et bienséants,
je vous laisse le soin d’imaginer le reste ou de me poser des questions lorsque
je serai de retour. Ces cabinets sont en outre les plus beaux qu’on puisse
imaginer. Généralement, les murs et le sol sont en majolique, à la hollandaise;
à certains endroits [...] se trouvent
les pots de chambre de la porcelaine la plus fine et dont le bord est doré, à
d’autres endroits il y a des verres remplis d’eau agréablement parfumée et
aussi de gros pots de porcelaine remplis d’herbes odorantes; on y trouve aussi
généralement un joli canapé, je pense pour le cas d’un évanouissement soudain »...
Ici, Léopold Mozart se montre beaucoup plus pudique que dans bien des lettres à
sa femme ou à son fils, voire même à sa fille!
Un autre aménagement français trouve son aval: La poste,
qui distribue le courrier tous les jours. « Une
commodité non négligeable à Paris est ce que l’on appelle la petite poste, par
laquelle je peux envoyer toute la journée des lettres dans toutes les rues de
Paris et en recevoir. Cela est d’autant plus nécessaire que l’on met parfois
une heure et plus pour se rendre en certains lieux [...] c’est pourquoi on a l’habitude de s’aviser
mutuellement auparavant, grâce à la petite poste.» Car les « fiacres, qui portent un numéro afin que l’on
sache qui nous transporte », sont de « misérables
voitures » et « ne sont pas autorisés
à entrer dans la cour des grands princes.»
La mode vestimentaire est également observée et décrite,
plus particulièrement pour Madame Hagenauer: « Les femmes ne garnissent pas seulement en
hiver leurs vêtements de fourrure, mais également en mettent comme cols ou
tours de cou, et au lieu de fleurs dans les cheveux, elles y mettent de la
fourrure, de même qu’autour des bras à la place de rubans, etc. [...] Je ne puis vraiment vous dire si les femmes
sont belles à Paris, car elles sont peintes, contre toute nature, comme les
poupées de Berchtesgaden, de sorte que même celles qui sont belles à l’origine
deviennent insupportables aux yeux d’un honnête Allemand, à cause de cette
repoussante élégance.»
Madame de Pompadour semble toutefois avoir touché
Léopold, bien qu’elle soit « extrêmement
hautaine et régente tout, actuellement encore.» Il écrit à Madame Hagenauer: « Vous
voulez bien sûr savoir à quoi ressemble Mme la marquise de Pompadour, n’est-ce
pas? – – Elle a sûrement été très belle, car elle est encore bien. C’est une
grande personne, elle est grasse, bien en chair mais très bien proportionnée,
blonde, [...] et a dans les yeux
quelque ressemblance avec Sa Majesté l’Impératrice. Elle est très digne et a un
esprit peu commun. Ses appartements de Versailles sont un paradis, côté jardin;
et à Paris, elle a un magnifique hôtel Faubourg St. Honoré, qui vient d’être
construit.» Il s’agit du Palais de l’Élysée, mais on ignore si Mozart y fut
reçu.
La mode française est d’ailleurs vite adoptée et l’enfant
prodige la porte bien: «V ous devriez voir Wolfgang en costume noir avec un chapeau à
la française », annonce le père, plein de fierté, peu après leur arrivée à
Paris... Il aura sans doute porté un costume de ce genre lorsque la famille eut
le grand honneur d’être conviée au Grand Couvert à Versailles, à l’occasion du
Nouvel An 1764, et l’accueil qui leur fut réservé est naturellement décrit en
détail: « Il convient de remarquer qu’il
n’est ici nullement d’usage de baiser la main des altesses royales, ni de les
importuner en leur remettant des requêtes, encore moins de leur adresser la
parole au passage, comme l’on dit ici [...]. Il n’est pas non plus usuel de rendre hommage au roi ou à quiconque
de la famille royale en courbant la tête ou en faisant une révérence, mais on
reste droit sans bouger, on a ainsi le loisir de voir passer le roi et sa
famille devant soi. Vous pouvez facilement vous imaginer l’effet et
l’étonnement produits sur les Français si imbus de leurs usages de cour,
lorsque les filles du roi [...] se
sont arrêtées à la vue de mes enfants, s’en sont approchées et non seulement se
sont laissé baiser la main, mais les ont embrassés et se sont fait embrasser
par eux un nombre incalculable de fois. [...] Mais le plus extraordinaire pour MM. les Français a eu lieu au grand
couvert, le soir du Jour de l’An, où l’on a dû non seulement nous faire
place jusqu’à la table royale, mais où mon M. Wolfgangus a eu l’honneur de se tenir tout le temps près de la reine avec qui il put
converser et s’entretenir, lui baiser souvent la main et prendre la nourriture
qu’elle lui donnait de la table et la manger à côté d’elle. La reine [Marie Leszczynska] parle
Allemand comme vous et moi. Mais comme le roi n’y entend rien, elle lui
traduisit tout ce que disait notre héroïque Wolfgang. Je me tenais près de
lui ; de l’autre côté du roi, où étaient assis M. Dauphin et Madlle Adélaïde, se tenaient ma
femme et ma fille. Maintenant, il faut vous dire que le roi ne prend jamais ses
repas en public, sauf le dimanche soir où toute la famille royale dîne
ensemble. Toutefois, lorsqu’il y a une grande fête, comme le Nouvel An, Pâques,
la Pentecôte, les jours de fête des membres de la famille royale, etc., on
nomme cela le grand Couvert, où sont admises toutes personnes de
distinction; mais il n’y a pas beaucoup de place et la pièce est rapidement
pleine. Nous sommes arrivés tard, et la Garde suisse a donc dû nous faire la
place; on nous fit traverser la salle et nous conduisit dans la pièce qui
jouxte la table royale et par laquelle Leurs Altesses font leur entrée. En
passant, elles ont adressé la parole à notre Wolfgang et nous les avons suivies
jusqu’à la table.» De telles marques de respect envers un enfant d’à peine
8 ans devaient le marquer à jamais...
Les fastes de Versailles n’empêchent toutefois pas
Léopold Mozart de découvrir, sous le vernis, des sujets d’inquiétude: « Une centaine de personnes se partagent les
grandes fortunes, ce sont les grands Banquiers et Fermiers généraux;
et finalement, la majeure partie de l’argent va aux Lucrèces qui ne se poignardent pas elles-mêmes. [...] Il faut noter aussi le grand abandon à la commodité qui entraîne cette
nation à ne plus entendre la voix de la nature; c’est pourquoi tout le monde à
Paris donne les nouveau-nés à élever à la campagne. [...] Et cela se fait chez les personnes de haut
rang tout comme dans les classes plus basses, et l’on paye une bagatelle. Mais
on en constate aussi les conséquences misérables; vous ne trouverez pas
facilement un endroit qui soit aussi bondé de personnes miséreuses et
estropiées. À peine êtes-vous entré à l’église ou faites-vous quelques pas dans
la rue que viennent vers vous un aveugle, un paralytique, un boiteux, un
mendiant à demi couvert de vermine, ou bien vous voyez allongé dans la rue un
malheureux à qui les cochons ont dévoré la main quand il était petit, un autre
dont la moitié du bras a été brûlée en tombant dans le feu (pendant que le père
nourricier et les siens étaient aux champs), etc.» Et avec sa clairvoyance
habituelle, il semble vouloir prédire la Révolution française, 25 ans avant
qu’elle n’éclate. « Chacun vit à son gré
et (si Dieu n'est pas particulièrement bienveillant), il en ira de l’État français comme de l’ancien Royaume de Perse.»
Le succès remporté par ses enfants à Versailles n’estompe
pas non plus le sens critique de Léopold en ce qui concerne la musique. Il
conduit certes son fils à la Chapelle royale, pour lui faire entendre la
musique de la Cour, mais outre la qualité des chœurs, elle ne lui plaît guère:
« J’y ai entendu de la musique, bonne et
mauvaise. Tout ce qui était pour voix seule et devait ressembler à un air était
vide, glacé et misérable, c’est-à-dire français, en revanche les chœurs sont
tous bons et même excellents. Je suis pour cette raison allé tous les jours
avec mon petit homme à la messe du roi dans la Chapelle royale pour entendre les
chœurs qui chantent toujours les motets.» Cette objectivité critique
concernant la musique française devait continuer à marquer, quatorze ans plus
tard, les souvenirs de Wolfgang et contribuer à son échec en France.
De nombreux musiciens allemands séjournaient alors à
Paris, et ils produisirent sur le jeune Mozart un effet considérable qui devait
fortement influencer ses premières compositions. Ainsi Johann Schobert,
originaire de Silésie, Johann Gottfried Eckart, d’Augsbourg, comme Léopold
Mozart, et l’Alsacien Leontzi Honauer.
Tous sont cités dans la correspondance. Ils offrent en cadeau leurs
compositions imprimées aux enfants et inspirent Mozart à écrire ses premiers
concertos pour clavier, sur des thèmes qu’il leur emprunte.

Page de titre des Sonates K 6 & 7 © Fondation
Internationale Mozarteum Salzburg
L’influence de Schobert se fait également sentir dans les
premières œuvres de Wolfgang gravées à Paris en 1764: c’est lui en effet qui
fut le premier à publier pendant de longues années des groupes de deux sonates,
et non pas six comme c’était l’usage. Léopold Mozart reprit donc ce modèle et
fit publier les quatre premières sonates pour clavier de son fils (Op. I et
II), en indiquant, comme le faisait Schobert: « qui peuvent se jouer avec l’accompagnement de violon ». Cette
particularité de la musique française permettait d’enrichir la sonorité quelque
peu raide du clavecin par un instrument expressif comme l’était le violon, et
elle avait de plus l’avantage commercial de proposer de la musique imprimée
facile à interpréter par les amateurs et ceux qu’on nommait «dilettantes». La
partie de violon joue un rôle modeste, il accompagne généralement la partie de
clavier, unisono ou à la tierce, parfois aussi à
l’octave par rapport à la main gauche. Mais elle n’a que très rarement une
grande indépendance.
Les Op. I et II ont été conçus à l’origine comme sonates
pour clavier seul: ainsi le premier mouvement de la première sonate a-t-il été
noté par Léopold Mozart comme Allegro pour clavier seul (K. 6) dans le Cahier de Musique de Nannerl,
et a été composé à Bruxelles en attendant que la famille soit reçue par le
Prince Charles-Alexandre de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas
autrichiens. Les deux premières Sonates ont été dédiées à Madame Victoire de
France, l’une des filles du roi Louis XV, et les deux suivantes à Madame la
Comtesse de Tessé, dame de compagnie de la Dauphine.
Le 1er février 1764, Léopold Mozart écrit fièrement à Salzbourg: « Maintenant, 4 sonates de M. Wolfgang Mozart
sont chez le graveur. Imaginez le bruit que feront les sonates dans le monde,
lorsqu’on verra sur la page de titre que c’est l’œuvre d’un enfant de 7 ans [...]. Vous entendrez en son temps combien ces
sonates sont bonnes [...]. Et je peux
vous dire que Dieu accomplit tous les jours de nouveaux prodiges dans cet
enfant.» Les dédicaces de ces sonates ont été rédigées par le Baron
Melchior Grimm, de Ratisbonne, qui était « Secrétaire de S.A. Monseigneur le
Duc d’Orléans ».
Avant de poursuivre la route vers l’Angleterre, on fait faire
des gravures d’après l’aquarelle de Louis Carrogis de
Carmontelle, représentant le père et ses enfants, sans doute à des fins
publicitaires: « M. de Mechel, un graveur sur cuivre, travaille en toute hâte à
graver nos portraits que M. de Carmontelle (un amateur) a très bien peints. Le
jeune Wolfgang joue du clavecin, je me tiens debout derrière lui et joue du
violon, et Nannerl s’appuie d’une main sur le
clavecin. De l’autre, elle tient des feuillets de musique, comme si elle
chantait.»
Le premier séjour à Paris fut donc couronné de succès,
les enfants prodiges reçurent des cadeaux, des marques de respect, des baisers
en nombre infini, et firent « tourner la
tête de presque tout le monde ». La jeune princesse de Condé-Bourbon,
Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d’Orléans, âgée de treize ans, dédia même à
Wolfgang un « Rondeau de la composition
de S.A. Mademoiselle qui prend la liberté de dédier son ouvrage à M. Wolfgang
Mozart ».

Gravure de Carmontelle © Fondation Internationale Mozarteum Salzburg
Deux ans plus tard, lors de leur retour d’Angleterre et
de Hollande, les enfants étaient encore des petits prodiges. Le prince
Louis-Joseph de Bourbon-Condé les invita à Dijon où ils se produisirent
séparément et à quatre mains – ce qui était une sensation – dans la Salle de
l’Hôtel de Ville, à l’occasion de l’ouverture des États Généraux de Bourgogne.
Nous ne savons pas grand chose de ce séjour, si ce n’est que Léopold apprécia
fort le vin de Bourgogne: « Je n’ai pas
manqué de boire à votre santé un – – – non, plusieurs verres de bourgogne. Vous
savez que je suis un buveur acharné. Ô combien ai-je souhaité trouver dans la
cave d’un bon ami de Salzbourg les vins que l’on nous a proposés à profusion!»
Les Mozart visitèrent donc certainement quelques vignobles sur le chemin du
retour.
Représentant typique de l’époque rationaliste, Léopold
Mozart voyage toujours les yeux grand ouverts et s’intéresse à tout ce qui est
nouveau. Ainsi, on achète, en passant, des soieries à Lyon, et fait faire de
nouveaux costumes: « Les textiles de soie
sont certes encore un peu chers, mais on ne peut pas avoir été à Lyon pour
rien.» Nous sommes toutefois étonnés d’apprendre quelques années plus tard
que le jeune Wolfgang assista dans cette ville à une exécution capitale,
puisqu’il écrit en 1771 à sa sœur, de Milan: « J’ai vu pendre ici 4 lascars sur la place de la Cathédrale. On pend ici
comme à Lyon.»...
Douze ans à peine après son retour à Salzbourg – entre
temps, Mozart avait été trois fois en Italie où trois de ses opéras avaient été
créés avec succès, et sa Finta giardiniera avait également fait grand bruit à Munich en 1775 – le jeune compositeur
demande au prince-archevêque Colloredo de lui
accorder un congé. Il l’obtient non sans mal et quitte Salzbourg le 23
septembre 1777 à 6 heures du matin, en compagnie de sa mère, car son père n’a
pas été autorisé à quitter son poste. Léopold est malade d’inquiétude, car
c’est la première fois que son fils le quitte pour entreprendre un voyage. Sans
doute est-il aussi saisi par des pressentiments néfastes. Nannerl se couche, elle a la migraine. Mozart, lui, déborde de bonheur, il est ravi de
quitter enfin cette ville de Salzbourg qu’il déteste. Lors de la première
étape, il écrit à son père – ce qui ne le rassura sans doute guère: « Viviamo come i Principi.
Il ne nous manque que Papa, mais c’est la volonté de Dieu. Tout ira bien malgré
tout. J’espère que papa se porte bien et est aussi gai que moi. Je m’habitue
bien à ma situation et suis un autre papa.»
Le voyage n’était toutefois pas placé sous une très bonne
étoile... À Augsbourg, ville natale de son père, le fils du bourgmestre se
moque de Wolfgang à cause de l’ordre de l’Éperon d’or qui lui a été remis par
le pape, et qu’il porte sur les conseils de son père, afin d’en imposer aux
bourgeois de la ville. À Mannheim, il tombe amoureux d’Aloisia Weber et repousse sans cesse son départ, jusqu’à ce que son père perde
définitivement patience et lui enjoigne: « Va
à Paris! et bientôt. Prends place auprès des grands
seigneurs, aut Caesar aut nihil...» Wolfgang se plie de mauvaise grâce, et arrive à Paris le 23 mars
1778, après un voyage qui ne voulait pas finir, et au cours duquel il s’ennuya
« à mourir ».
Au début, il semble renouer avec le succès de ses deux
premiers séjours. Il doit écrire des chœurs pour un Miserere de Holzbauer, pour la Semaine
sainte au Concert spirituel. Il espère qu’ils feront bon effet. Mais au lieu
des 4 prévus, on n’en a joué que 2, « et
par suite on a laissé de côté le meilleur. Mais cela ne signifie pas
grand-chose car beaucoup ne savaient pas qu’une partie était de moi et beaucoup
ne me connaissent même pas.» Il faut peut-être y voir un présage néfaste
pour la collaboration espérée avec le Concert spirituel, et une première preuve
que Mozart aura du mal à s’imposer dans la métropole française, sans les
conseils de son père.
Entre temps, sa mère se morfond également, car elle ne
parle pas français. Début avril, elle se plaint pour la première fois: « Pour ce qui est de ma vie, elle n’est guère
agréable. Je reste seule toute la journée, comme aux arrêts, dans la chambre
qui donne sur une petite cour et qui est de plus si sombre qu’on ne peut voir
le soleil de la journée, ni même
savoir quel temps il fait dehors. [...] L’entrée
et l’escalier sont si étroits qu’il serait impossible d’y monter un piano.
Wolfgang doit donc composer au-dehors, chez Monsieur Legros, puisqu’il s’y
trouve un piano. Je ne le vois donc pas de la journée et finirai par perdre
totalement l’usage de la parole.»
Mozart sent bien qu’il est « en un lieu où l’on peut sûrement gagner de l’argent. Mais cela
nécessite un mal et un travail fous ». Il espère pouvoir écrire un « opéra tout entier de moi, en deux actes ».
L’époque est pourtant on ne peut plus mal choisie, puisque la Querelle des
Gluckistes et des Piccinnistes fait rage. Dans cette atmosphère empoisonnée, il
est clair que Mozart avait peu de chance de se faire un nom sur les scènes
lyriques...
De Salzbourg, Léopold lance ses injonctions: « Pour ce qui est de l’opéra, tu devras bien
t’orienter d’après le goût des Français » et il ajoute: « Avant de commencer à écrire, écoute et
réfléchis au goût de la Nation, écoute et vois leurs opéras. Je te connais, tu
es en mesure d’imiter tous les styles.» Wolfgang tempête: « Ce qui m’irrite le plus dans cette affaire,
c’est que Messieurs les Français n’ont amélioré leur goût que dans ce sens: ils
sont maintenant en mesure d’écouter aussi de la bonne musique. Mais
quant à reconnaître que leur Musique est mauvaise, ou tout au moins à remarquer
la différence, Dieu nous en garde! – Et le chant! – Oimè!
– Si seulement les Françaises ne chantaient pas d’airs italiens, je leur
pardonnerais volontiers leurs beuglements français, mais gâcher ainsi de la
bonne musique! – C’est insupportable » – et plus tard: «l es Français sont et restent vraiment des ânes, ils sont incapables –
et doivent toujours avoir recours à des étrangers [...] si seulement cette maudite langue française
n’était pas si misérable pour la Musique! – C’est abominable – la langue
allemande semble divine en comparaison! – Et puis les chanteurs et les
chanteuses – – on ne devrait même pas les nommer ainsi car ils ne chantent pas,
– ils crient, – braillent, – et à plein gosier, du nez et de la gorge » et
finalement, désespéré: « cette langue a
été faite par le diable, c’est certain! »
Le projet d’opéra échoue, Mozart doit donner des leçons,
ce qui « n’est pas une plaisanterie, ici »,
cela prend beaucoup de temps, et « est
contraire à mon génie et à ma façon de vivre; vous savez que je suis pour ainsi
dire tout immergé dans la musique – que je m’en occupe toute la journée – que
j’aime réfléchir – étudier – considérer.» Parmi ses élèves, il y a la fille
du Duc de Guines, mais elle manque de talent et « n’a pas d’idées ». Pour elle et son
père, Mozart écrit néanmoins le Concerto pour flûte et harpe K. 299, qui sera
sans doute mal payé, s’il le fut jamais...
Dès le début de son voyage, son père lui avait conseillé
de renouer avec le Baron Grimm. Mais Mozart n’a guère de patience et proteste:
« les gens font certes des compliments,
mais qui s’arrêtent là. Ils me demandent de revenir tel ou tel jour, je joue,
et ils disent: O c’est un Prodige, c’est inconcevable, c’est étonnant.
Et là-dessus, addieu» – et ses nerfs le lâchent
lorsqu’il doit faire antichambre chez la Duchesse de Chabot, à qui il était
allé rendre visite sur les conseils de Grimm: « Je dus attendre une demi-heure dans une grande pièce glaciale, non
chauffée et sans cheminée » raconte-t-il le 1er mai 1778. « Finalement la Duchesse Chabot arriva et me
pria avec la plus grande amabilité de me satisfaire du piano qui était là, du
fait qu’aucun des siens n’était en état; elle me pria d’essayer. Je dis:
j’aimerais de tout cœur jouer quelque chose mais c’est impossible dans
l’immédiat, car je ne sens plus mes doigts tant j’ai froid; et je la priai de
bien vouloir me faire conduire au moins dans une pièce où il y aurait une
cheminée avec du feu. O oui Monsieur, vous avez raison. Ce fut toute sa
réponse. Puis elle s’assit et commença à dessiner, pendant tout une heure, en compagnie d’autres messieurs, tous assis en cercle autour
d’une table. Ainsi, j’ai eu l’honneur d’attendre une heure entière. Fenêtres et
portes étaient ouvertes, j’avais froid non seulement aux mains mais également à
tout le corps et aux pieds; et je commençais tout de suite à avoir également
mal à la tête. [...] Finalement, je
jouai sur ce misérable affreux pianoforte. Mais le pire est que Madame
et tous ces messieurs n’abandonnèrent pas un instant leur dessin, le
continuèrent au contraire tout le temps, et je dus donc jouer pour les
fauteuils, les tables et les murs. Dans des conditions aussi abominables, je
perdis patience, – je commençai les variations de Fischer, en jouai la moitié
et me levai. Il y eut une foule d’éloges. Mais je dis ce qu’il y avait à dire,
qu’il m’était impossible de me faire honneur sur ce piano et qu’il me serait
très agréable de revenir un autre jour, lorsqu’il y aurait un meilleur
instrument. Elle ne voulut toutefois pas céder, je dus encore attendre une
demi-heure que son mari arrive. Lui s’assit près de moi et m’écouta avec toute
son attention, et moi – j’en oubliai le froid, le mal de tête, et me mis à
jouer, malgré le détestable piano, – comme je joue lorsque je suis de bonne
humeur. Donnez-moi le meilleur piano d’Europe mais comme auditeurs, des gens
qui n’y comprennent rien, ou qui ne veulent rien y comprendre et qui ne sentent
pas avec moi ce que je joue, j’y perds tout plaisir.»
Il n’est donc pas étonnant qu’il n’ait pas accepté le
poste d’organiste de la Cour qui lui fut proposé au mois de mai, et qui
l’aurait contraint à séjourner six mois de l’année à Versailles, bien que c’eût
été « le moyen le plus sûr de s’assurer
la protection de la reine ».
Entre temps survint l’événement le plus dramatique du
voyage: la mère de Mozart attrapa le typhus au mois de juin et mourut le 3
juillet. Il est vraisemblable qu’elle contracta cette maladie en buvant l’eau
de la Seine. Dès 1763, Léopold Mozart avait remarqué: « la chose la plus repoussante ici est l’eau potable que l’on tire de la
Seine (qui est répugnante).[...] Nous la faisons bouillir et la laissons
reposer pour qu’elle devienne plus belle. Presque tous les étrangers ont au
début un peu de diarrhée à cause de l’eau, nous l’avons tous eue aussi, mais
pas forte.» La maladie d’Anna Maria commença sournoisement, « elle fut prise de diarrhée – mais personne
n’y prêta attention parce qu’il est courant, ici, que les étrangers qui boivent
beaucoup d’eau attrapent la colique; c’est d’ailleurs vrai, je l’ai eue
moi-même les premiers jours; mais depuis que je ne bois plus jamais d’eau pure
et y mêle un peu de vin, je n’ai plus rien.»

Église Saint-Eustache où fut enterrée la mère de Mozart ©
Fondation Internationale Mozarteum Salzburg
Le 3 juillet, peu après la mort de sa mère, Mozart écrit
deux lettres: tout d’abord à son père, auquel il ne parle tout d’abord que de
maladie: « Je dois vous annoncer une
nouvelle très pénible et triste, et c’est aussi la raison pour laquelle je n’ai
pu répondre plus tôt à votre dernière lettre datée du 11 [juin]. – Ma chère maman est très malade...»
Puis il décrit brièvement la maladie – mais n’écarte pas l’idée que « tout va bien si c’est la volonté du
Tout-Puissant ». Puis, « passons
maintenant à autre chose» – il parle de sa Symphonie parisienne et de la
mort de Voltaire, « ce mécréant et fieffé
coquin, qui a crevé, pour ainsi dire comme un chien – comme une bête. – Voilà
sa récompense!» Même si cette nouvelle ne pouvait que plaire à Léopold
Mozart, qui détestait Voltaire, on ne manque pas de s’étonner de la violence de
ces paroles alors que sa mère était sans doute encore à ses côtés...
Puis il écrit à l’abbé Bullinger,
ami intime de la famille, et le prie de préparer son père à apprendre la
terrible nouvelle, ce que ce dernier fera de manière exemplaire. Enfin, six
jours plus tard, il écrit par le courrier suivant: « J’espère que vous serez en état d’apprendre avec constance une nouvelle
bien triste et douloureuse [...] ce
même jour, le 3, ma mère s’est endormie saintement en Dieu, à 10 heures 21.»
Ces lettres sont très poignantes, mais celle de Léopold, datée du 12 juillet,
l’est encore plus, car elle commence par des vœux de bonne fête pour sa femme
(le 26 juillet, Sainte-Anne), il l’interrompt une première fois lorsqu’il
reçoit la nouvelle de la « maladie », puis la termine sur un ton déchirant
après la visite de l’abbé Bullinger, qui lui apprend
la nouvelle avec tact. Si la situation n’était pas si douloureuse, on pourrait
penser à une scène d’opéra...
La lettre du 3 juillet a certainement été écrite en
plusieurs étapes, comme le prouve la graphie. Sans doute Mozart écrivit-il la
lettre à Bullinger avant de passer au récit de la
création de la Symphonie parisienne: « J’ai
dû écrire une symphonie pour l’ouverture du Concert Spirituel. Elle a été
interprétée le jour de la Fête-Dieu [18 juin 1778] et applaudie unanimement. D’après ce qu’on m’a dit, il en a été fait
mention dans le Courrier de l’Europe. [...] J’ai eu très peur à la répétition, car je n’ai de ma vie, rien entendu
de plus mauvais; vous ne pouvez pas imaginer comment ils ont bousillé et gratté
la symphonie, 2 fois de suite. – J’ai
vraiment eu très peur [...] Le
lendemain, j’étais même décidé à ne pas aller au Concert; mais le soir, il se
mit à faire beau, et je résolus finalement de m’y rendre, avec la ferme
intention, si c’était toujours aussi mauvais qu’à la répétition, d’aller à l’orchestre,
de prendre le violon des mains du premier violon, M. Lahoussaye,
et de diriger moi-même. Je priai Dieu de m’accorder que cela marche, puisque
tout se fait pour son plus grand honneur et sa gloire, et ecce, la symphonie
commença, [...] au milieu du premier
Allegro, il y a tout de suite un Passage qui, je le savais bien, devait plaire;
tous les auditeurs furent enthousiasmés – il y eut un grand applaudissement – mais comme je savais, en l’écrivant, quel effet il produirait, je l’avais
réintroduit à la fin – cela recommença da capo. L’Andante plut également, mais
surtout le dernier Allegro. –Comme j’avais entendu qu’ici, tous les derniers
Allegro commencent, comme les premiers, avec tous les instruments ensemble, et
généralement unisono, je le fis commencer piano avec les 2 violons seuls, sur 8 mesures uniquement – puis vint tout de suite un
forte de sorte que les auditeurs (comme je m’y attendais) firent ch- au moment du piano – puis suivit immédiatement le forte
– entendre le forte et applaudir ne fit qu’un.» Puis il se rendit au Palais
Royal pour déguster une glace, sans oublier d’aller dire le chapelet qu’il
avait promis!
Malgré cette description, il semble que l’Andante de la
symphonie n’ait pas plu à Joseph Legros, directeur du Concert spirituel. Mozart
en composa donc un second, qu’il trouva encore meilleur. Peu avant la création,
Mozart avait toutefois eu quelque doute quant au succès éventuel de l’œuvre: « à vrai dire, je m’en soucie fort peu. Car à
qui ne siérait-elle pas? – Je suis sûr qu’elle plaira aux quelques Français
intelligents qui seront là; quant aux sots – ce n’est pas un grand malheur à
mes yeux si elle ne leur convient pas, – mais j’ai encore l’espoir que les ânes
y trouvent aussi quelque chose qui puisse les satisfaire; et puis, je n’ai pas
manqué le Premier Coup d’archet! – Et cela suffit! Ces animaux en font
toute une affaire! – Que diable! je ne vois pas la
différence, – ils commencent ensemble – comme ailleurs. C’est ridicule. Raaff m’a raconté une histoire d’Abaco [Evaristo Felice dall’Abaco,
violoncelliste de la Cour de Bavière] à
ce sujet. Un Français lui a demandé à Munich, ou ailleurs, Mr. vous avés etè à Paris? – oui; est-ce
que vous étiés au Concert spirituel? – oui; que dites
vous du Premier coup d’archet? – avés vous entendu le
premier coup d’archet? – oui, j’ai entendu le premier et le dernier – coment le dernier? – que veut dire cela? – mais oui, le
premier et le dernier – et le dernier même m’a donnè plus de plaisir.»...
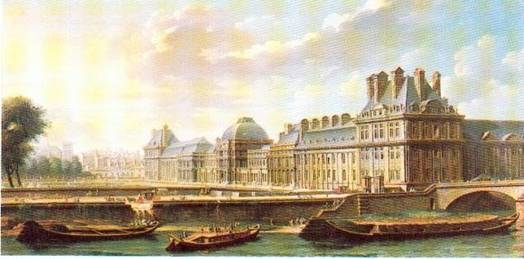
Le Palais des Tuileries où siégeait le Concert spirituel,
par Raguenet en 1757 (Musée Carnavalet)
/ DR
Avec cet état d’esprit et cette ironie sarcastique, il
est évident que Mozart ne pouvait se faire honneur à Paris. Au début, il ne
voulait pas s’y rendre, il était amoureux et ne pensait qu’à une chose: rester
à Mannheim. Grimm n’apporta pas à l’adulte Mozart le soutien que le père et le
fils attendaient de lui. «Mr Grimm est en
mesure d’aider des enfants mais pas des grandes personnes» – en fait, Grimm
aurait sans doute aimé avoir Mozart comme secrétaire, il voulait pouvoir se
parer de sa compagnie, mais le trouvait trop « confiant » et ne voulait sans doute lui concéder aucune liberté. Et
Mozart n’avait pas l’âme d’un valet...
Par ailleurs le compositeur a été plus ou moins trompé
par Legros qui semble avoir fait disparaître fin avril 1778 sa Symphonie
concertante pour flûte, hautbois, cor et basson: « Quant à la Sinfonie Concertante, il y a
encore un hic, mais je crois qu’il y a un autre obstacle. J’ai ici et là des
ennemis. Mais où ne les ai-je pas eus? – C’est toutefois bon signe. J’ai dû
écrire la Sinfonie en toute hâte, en y mettant tout
mon zèle, et les 4 concertants en ont été et en sont toujours très épris.
Legros l’avait depuis 4 jours pour copie, mais je la retrouve toujours à la
même place. Et en fin de compte, avant-hier, ne la voyant plus, je cherche bien
sous les partitions – et la découvre cachée. Je fais mine de rien et demande à
Legros : apropós, avez-vous déjà donné la Sinfonie Concertante à copier? – Non. Je l’ai oubliée.
Comme je ne peux naturellement pas lui donner l’ordre de la faire copier ni
jouer, je ne dis rien. Les 2 jours où elle aurait dû être jouée, je suis allé
au Concert. Ramm et Punto[hautboïste
et corniste] vinrent vers moi, tout
enflammés, et me demandèrent pourquoi on ne donnait pas ma Sinfonie Concertante. – Je ne sais pas. Première nouvelle.
Je ne suis au courant de rien. Ramm est alors devenu
enragé et s’est emporté, en français, contre Legros dans le salon de la
Musique, disant que ce n’était pas beau de sa part etc. Ce qui me contrarie le
plus dans toute cette histoire, c’est que Legros ne m’en a pas soufflé mot, je
ne devais rien apprendre. Si du moins il m’avait donné une excuse, disant que
le temps lui avait manqué ou autre chose comme cela, mais absolument rien – je
crois que Cambini, un maestro italien qui est ici, en
est la raison, car sans le vouloir, je l’ai discrédité aux yeux de Legros à la
première entrevue. Il a composé des quartetti et j’en
ai entendu un à Mannheim; ils sont très jolis et je lui en fis compliment. Je
lui en jouai le début; il y avait là Ritter, Ramm et Punto, ils n’eurent de cesse que je continue et que je
compose ce que je ne me rappelais plus. C’est ce que je fis. Cambini était hors de lui et ne put s’empêcher de dire: questa è una gran Testa! Mais cela ne lui aura guère plu. Si on était dans un lieu où les gens
ont des oreilles, un cœur pour sentir, où l’on comprend un tout petit quelque
chose à la Musique et où l’on a un peu de gusto, je rirais de bon cœur de tout
cela. Mais je suis entouré de bêtes et d’animaux (pour ce qui est de la
musique). Comment pourrait-il en être autrement, d’ailleurs, ils ne se
comportent pas autrement dans toutes leurs actions, amours et passions.»
Il avait également été trompé par le Duc de Guines, et ne reçut qu’un maigre salaire pour ses
compositions et ses leçons. Pourtant, au cours des 6 mois de son séjour dans la
capitale française, il composa un certain nombre d’œuvres de grande valeur:
·
le Concerto pour flûte et harpe,
·
la Symphonie concertante (perdue),
·
la Musique de ballet «Les
Petits Riens»,
·
des Variations pour piano sur divers thèmes, dont «Ah, vous dirai-je, Maman»,
·
une partie des six Sonates pour piano et violon qu’il
dédia à la princesse électrice de Bavière à laquelle il les remit sur le chemin
du retour,
·
la Symphonie parisienne, ainsi peut-être qu’une autre
symphonie perdue,
·
et, last but not least, la Sonate pour piano en la mineur, qui est souvent mise en rapport – non sans raison
sans doute – avec la mort de sa mère.
Au bout d’un an, il ne lui restait plus qu’une
perspective: revenir à Salzbourg, cette ville qu’il haïssait tant, accepter le
poste d’organiste de la Cour, avec, toutefois, un salaire triple de celui qu’il
avait eu en tant que Konzertmeister, avant son départ
pour Paris. Et là encore, il pria son fidèle ami Bullinger,
sur le ton incomparable qui lui est propre: « Faites votre possible pour que la musique obtienne bientôt un cul –
c’est le principal; elle a déjà une tête – et c’est bien là son malheur!»...
La prochaine rupture était donc programmée lorsqu’il
écrivit le 11 septembre 1778 à son père: « Mais
la seule chose qui me dégoûte à Salzbourg, je vous le dis comme je l’ai sur le
cœur, c’est que les relations avec les gens n’ont aucun niveau – que la musique
ne jouit que d’une piètre considération – et que l’archevêque ne croit pas les
gens sensés qui ont voyagé. – Mais je vous assure qu’on est vraiment une pauvre
créature si on ne voyage pas (tout au moins en ce qui concerne ceux qui se
consacrent aux arts et aux sciences). Je vous affirme que si l’archevêque ne
m’autorise pas à faire un voyage tous les deux ans, je ne peux absolument pas
accepter l’engagement. Un homme de talent moyen restera toujours médiocre,
qu’il voyage ou non – mais un homme de talent supérieur (ce que, sans renier
Dieu, je ne puis me dénier) deviendra – mauvais s’il reste toujours au même
endroit.»
Et cet état d’esprit rappelle les
paroles par lesquelles il finit par rompre définitivement avec la Cour de
Salzbourg, au cours de l’été 1781: « Si
je devais me charger de la musique, je devrais avoir entière liberté – le
premier majordome ne devrait rien pouvoir dire en ce qui concerne la musique.
Car un gentilhomme ne saurait tenir la place d’un maître de chapelle, mais un
maître de chapelle peut fort bien être un gentilhomme.»
Figaro n’est pas
loin...
Geneviève Geffray*.
* Geneviève Geffray, licenciée ès-Lettres de l’Université
Paris-Nanterre, a été de 1973 à 2011 Conservateur en chef de la Bibliotheca Mozartiana de la
Fondation Internationale Mozarteum à Salzbourg.
Depuis 1997 elle est responsable de l’édition de l’Almanach de la Semaine
Mozart de la Fondation Internationale Mozarteum. Elle
est, entre autres, l’auteur de la traduction et du commentaire musicologique de
l’édition intégrale de la Correspondance de la famille Mozart, publiée de 1984
à 1999 en sept volumes aux Éditions Flammarion à Paris, qui a reçu en avril
1999 le „Prix des Muses“ de Musicora pour la
meilleure documentation musicologique. Elle a également publié et commenté pour
une maison d’édition allemande le Journal de Nannerl Mozart 1775–1783 avec des annotations de son frère Wolfgang et de son père Leopold. Elle est l'auteur de divers articles pour des dictionnaires
parus au cours de l’Année Mozart 2006 et de publications en fac-similé de
quelques joyaux de la Fondation Internationale Mozarteum :
W. A. Mozart, « Allegro pour clavier » K. 6 noté par son père Leopold dans le Livre de Musique de Nannerl,
et « Le dernier portrait de Wolfgang Amadé Mozart.
Le dessin à la pointe d’argent de Doris Stock, Dresde, 16/17 avril 1789.
Contexte historique et fac-similé ».
(1) W. A. Mozart. Correspondance complète... Édition française et traduction de l’allemand par Geneviève Geffray. Paris, Flammarion 2011. 1908 p. Les citations sont tirées de cette édition, les mots soulignés sont en français dans le texte.
FESTIVALS PASCAUX A BADEN-BADEN ET A SALZBURG
L'organisation d'un festival de
musique à la période pascale n'est pas nouvelle. C'est Herbert von Karajan qui, en 1967, lança celui de Salzbourg, amenant
avec lui les fabuleux musiciens du Philharmonique de Berlin. Celui de
Baden-Baden, plus récent, fait partie des quatre manifestations annuelles de
prestige de cette scène allemande de renom. Hasard des choses, l'âme de la
manifestation salzbourgeoise, le Philharmonique de Berlin, a émigré, en 2013,
dans la cité du Bade-Wurtemberg, s'y trouvant sans doute plus à l'aise. Qu'à
cela ne tienne, Salzbourg tint bon en s'attachant le concours d'un autre
orchestre renommé, la Staatskapelle de Dresde. Aussi,
aujourd'hui, ces festivals pascals
rivalisent-ils d'aura dans les trois domaines de l'opéra, du concert
symphonique et de la musique de chambre, montrant l'extraordinaire polyvalence
de ces deux orchestres. Pour ce qui est de l'opéra, on a décidé à Salzbourg,
avec Arabella, de fêter Richard Strauss, en
cette année anniversaire. A Baden-Baden, tournant le dos à la volonté de
privilégier l'actualité immédiate, on affichait Manon Lescaut de Puccini.
LE FESTIVAL
DE PÂQUES DE BADEN-BADEN
Puccini servi par un orchestre flamboyant
Giacomo PUCCINI : Manon Lescaut. Drame lyrique en quatre
actes. Livret de Ruggero Leoncavallo, Marco Praga,
Domenico Oliva, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, Giulio Ricordi, Giuseppe Adami ; d'après le livret de Henri Meilhac et
Philippe Émile François Gille pour l'opéra « Manon » de Jules
Massenet, tiré de l'« Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut » de l'abbé Prévost. Eva-Maria Westbroek, Massimo Giordano, Lester Lynch, Liang Li, Bogdan Mihai, Reinhard Dorn, Magdalena Kožená, Kresimir Spicer, Arthur Espiritu, Johannes Kammler, Saulo Garrido. Philharmonia Chor Wien. Berliner Philharmoniker, dir. Sir
Simon Rattle.
Mise en scène : Sir Richard Eyre.

Acte II ©
Jochen Klenk
Créé en 1893, à Turin, Manon Lescaut est le premier grand opéra de Puccini. Si
le libretto, inspiré du roman de l'abbé Prévost, a connu quelques vicissitudes,
d'où le nombre de ses auteurs, et s'en écarte notamment plus que celui de la Manon de Massenet, la musique brille par sa profusion mélodique et respire la
passion. D'où l'intérêt que lui portent les chefs d'orchestre. On se souvient
de la production dirigée par John Eliot Gardiner à Glyndebourne,
sans parler des grandes versions discographiques, telle celle de Tulio Serafin, avec Callas, ou de
Guiseppe Sinopoli, avec Freni.
A son tour Simon Rattle s'y plonge avec délice. Pour
sa première incursion dans l'univers puccinien, le
chef britannique offre une lecture rien moins que flamboyante. Sa direction,
extrêmement tendue, est véritablement « énergétique », bardée de grands coups
de boutoir, assortie des fortissimos étourdissants, comme à la fin du troisième
acte. Mais sait aussi réserver des moments de répit d'un lyrisme lumineux,
cultivant une sonorité italienne racée, inespérée dans sa splendeur. À l'image
du fameux Intermezzo précédant l'acte III, lesté d'une atmosphère grandiose,
qui n'est pas sans évoquer le Tristan de Wagner. Il faut dire qu'avec
les Berliner Philharmoniker le son est constamment envoûtant, ennoblissant le matériau, en particulier à
travers l'intervention de magnifiques solistes, flûte, hautbois ou harpe, ou
d'ensembles instrumentaux, les violoncelles en particulier, d'une ligne ample
et chaleureuse. On reste émerveillé devant la magnificence dont Rattle entoure le chant. En pareil écrin, ses solistes
donnent le meilleur. Eva-Maria Westbroek n'est,
certes, pas la frêle jeune femme imaginée par Prévost au début de son récit.
Mais la consistance qu'elle apporte au rôle va en s'amplifiant au fil de la
soirée, pour atteindre le zénith au dernier acte, dans l'aria « Sola, abandonnata.. », d'une puissance émotionnelle vraie.
Pour sa prise du rôle de Des Grieux, Massimo Giordano
offre pareille assomption, une stamina tendue comme
un arc et une quinte aiguë bien sonnante. Le personnage, qui possède un relief
sans doute plus affirmé que celui de l'héroïne, et se voit offrir plus
d'occasions de briller, est jeune, plus impulsif qu'aristocrate. De Lescaut, le frère dissolu et arrangeant, le baryton
américain Lester Lynch livre un portrait débonnaire mais ne dégage pas d'aura
particulière vocalement. Il en va de même du terne Géronte de Liang Li. Les seconds rôles sont bien tenus, dont Bogdan Mihai, jeune et fringant Edmondo au premier acte, et
Magdalena Kožená, luxus casting dans la partie épisodique de la chanteuse du Madrigal de l'acte II, ou
encore Kresimir Spicer, qui abandonnant pour un soir
les rôles baroques, interprète un amusant maître de ballet. On saluera la
prestation du Philharmonia Chor de Vienne, une phalange créée dans les années 2000, à Salzbourg, par Gérard
Mortier, d'un bel engagement vocal et scéniquement fort convaincant aux actes I
et III.

Acte IV ©
Jochen Klenk
La production fastueuse de
Richard Eyre, laquelle doit plus tard faire les beaux soirs du MET de New York,
se veut démonstrative. L'idée, plus originale que réellement pertinente, au
demeurant devant un public en majorité germanique, est d'actualiser l'intrigue
qui, du Paris corrompu de la Régence, se vit dans celui de l'occupation
allemande des années 1940. La présence de soldatesque casquée et bottée apporte
une pression supplémentaire, sans pour autant renforcer l'impact dramatique.
Ainsi, au II ème acte, dans l'opulent et imposant
hôtel particulier de Géronte, quelques militaires zélés, et guindés à souhait,
offrent-ils leurs services pour introduire les invités du maître de maison,
puis le débarrasser lestement des amants infernaux. Le 1er acte, censé se
situer à Amiens, semblait déjà, de par ses vastes perspectives étagées et la
présence pesante de cette force armée au look peu amène, nous transporter dans
quelque autre plus grande ville : à la terrasse d'un grand café parisien, face
à la riche demeure de Géronte. Foin de voiture de poste d'où débarque Manon et
les autres voyageurs harassés, mais une locomotive se profilant dans le
lointain dans un épais nuage de vapeur. On est près de la gare du Nord ! Reste
que la différentiation entre scènes de foule et confrontations intimistes, dans
le cas de Manon et de Des Grieux, est ménagée avec un
sûr métier. Si la direction d'acteurs n'est pas des plus imaginatives, du moins
sert-elle la trame dramatique avec efficacité. La fin abrupte du II ème acte en est la démonstration, tandis que la pauvre
épousée, accusée d'avoir trahi la confiance du vieux barbon libidineux, est
prestement empoignée par deux militaires en faction, qui n'en demandaient pas
tant. Le faste grandiloquent et un peu froid bascule alors vraiment dans le
drame. Comme au troisième acte, dans la prison au Havre, où la litanie des noms
des prostituées envoyées au bagne américain tranche avec le ballet des marins
préparant, au-dessus, le funeste embarquement. Le dernier acte, censé se situer
dans une lande désertique de Louisiane, découvre une vision de chaos : les
ruines de l'hôtel particulier parisien, sans doute, où Manon coula des jours
heureux. Nonobstant le parcours acrobatique demandé aux deux protagonistes,
contraints d'enjamber des reliefs fort anguleux, le drame fonctionne puisque
c'est sur un duo quasi ininterrompu que Puccini clôt son drame lyrique. Reste
qu'en dernière analyse, cette mise en scène impressionne plus qu'elle n'émeut.
Elle laisse le dernier mot à la symphonie et aux effluves mirifiques qui
émanent de la fosse d'orchestre où, on l'a compris, se joue l'essentiel.
Peter Sellars met en espace la Passion
selon Saint Jean
Jean Sébastien BACH : Johannes-Passion BWV 245, pour solistes, chœur et orchestre. Mark Padmore, Camilla Timing, Magdalena Kožená, Topi Lehtipuu, Roderick Williams, Christian Gerhaher. Rundfunkchor Berlin. Berliner Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle. Présentation scénique : Peter Sellars.

Rundfunkchor Berlin © Monika Rittershaus
La Passion selon Saint Jean de JS Bach était jouée dans une mise en espace due à Peter Sellars.
Créée le Vendredi Saint de 1724, à Leipzig, la Johannes-Passion, malgré son
intimité et une intériorité plus marquée que la Matthaus-Passion,
développe un vrai drame musical, dont n'est pas absente une certaine
théâtralité, notamment pour ce qui est des interventions du chœur. La
dramaturgie en est délicate en raison même de sa structuration, faite de
nombreuses ruptures, d'interruptions dans le continuum du récit biblique. Il
n'est pas étonnant que Peter Sellars, dont on connaît
la profonde spiritualité (illustrée naguère dans le Saint François d'Assise de
Messiaen et plus récemment, avec l'oratorio The Gospel According to the Other Mary de John Adams), s'y soit
confronté. Avec son sens inné pour dégager les lignes de force du récit. Sans
jouer sur les mots, il est question ici de « présentation scénique »,
et non de mise en scène à proprement parler. Mais la manière va bien au-delà de
la simple mise en espace. « Il ne s'agit pas de théâtre. C'est une prière, une
méditation » souligne-t-il. Le plateau ménage une aire de jeu centrale, avec
pour tout élément décoratif une lampe projetant sur le sol un faisceau rond de
lumière. L'orchestre est disposé derrière sur plusieurs rangées, le chœur à
gauche, le continuo et l'orgue positif à droite. Les choristes, les solistes et
surtout l'Évangéliste, vont tour à tour investir cette aire pour donner vie aux
diverses séquences de la Passion. Le premier élément frappant est le traitement
du chœur, la « turba », cette foule souvent
déchaînée, le peuple ou les grands Prêtes, qui envahit la scène. On y retrouve une gestuelle, si signifiante chez Sellars,
faite de jeux de mains, et cet art combien maîtrisé de composer les groupes.
Ils unissent texte et musique en lui donnant une expression corporelle.
L'évangéliste est ici plus qu'un simple narrateur. C'est un passeur, une sorte
de régisseur, qui accouche les autres personnages. C'est à travers lui que les
événements sont explicités. Les « protagonistes », Jésus, Pierre, Pilate, les
vivent intensément ; ce qui donne lieu à d'admirables arrêts sur image, lors
des arias qui suivent les récitatifs : confusion et douleur de Pierre, après
qu'il eût renié, ambivalence de Pilate qui tente de se faire accommodant face
au peuple résolu, et en un ultime geste de déchirement, s'allonge auprès du
Christ terrassé par l'indignité. Il arrive aussi que le chef d'orchestre se déplace,
pour souligner telle intervention du chœur par exemple, ou simplement mieux
coordonner les diverses forces réparties autour de lui. A travers cette
dimension supplémentaire, le texte acquiert une vigueur expressive
insoupçonnée. Et la rhétorique de la Passion devient captivante. Il se dégage
de cette lecture une réelle ferveur, plus que spécifiquement religieuse, d'un
autre ordre, celle de la délivrance d'un message de compassion.

Mark Padmore, Camilla Timing et Simon Rattle © Monika Rittershaus
L'exécution proprement musicale est servie
par un plateau de choix. Elle est dominée par la prestation de Mark Padmore, bouleversant Évangéliste. A son chant immaculé et
combien émouvant, se joint une profonde empathie avec le texte. Ses
interventions marquées au coin d'une infinie douceur, vous empoignent aux
larmes. Celle des chœurs de la Radio de Berlin n'est pas moindre, qui habitent
le texte et par leurs mouvements, donnent au récit une consistance tangible. Si
elle est moins développée vocalement que dans la Passion selon Saint Matthieu,
la partie de Jésus est extrêmement caractérisée par la régie de Peter Sellars. Le baryton Roderick Williams s'y montre déchirant, alors que malmené, projeté à terre, bousculé
sans ménagement par les sbires de Pilate. Celui-ci est campé, tout comme le
rôle de Pierre, par Christian Gerhaher, superbe voix
grave, idéalement conduite, tout autant que dans les arias de basse. Celles
confiées au ténor, Topi Lehtipuu les emplit d'émotion. Il en va de même de celles de soprano, Camilla Timing, et
d'alto, Magdalena Kožená, contribuant à une
interprétation aussi pure qu'intense. Ces mêmes qualificatifs distinguent la
direction de Simon Rattle, portée par ses merveilleux
musiciens. Une approche baroquisante, des tempos relativement animés et
l'accent justement porté sur les solos instrumentaux, révélant les premiers
pupitres de l'orchestre, Andreas Blau et Michael Hasel, flûtes, Jonathan Kelly et Albrecht Mayer, hautbois,
Ulrich Knörzer, viole d'amour, font de cette
exécution un événement.
La grande fête des Berliner Philhamoniker

DR
C'est désormais une tradition, instaurée
depuis la résidence pascale à Baden-Baden, que la grande soirée festive, dite
« Musikfest », mettant en avant les
diverses formations de l'illustre orchestre. Bien sûr, le concert tient un peu
du pot pourri. Mais de ce braquet là, on en redemande ! Les choses commencent
en fanfare avec les Bläser der Berliner Philharmoniker, autrement dit les Vents. Qui vont
déployer des trésors d'ingéniosité dans
l'Ouverture du Barbier de Séville de Rossini, à laquelle la flûte
traversière et piccolo de Michael Hasel apporte un
indéniable zest. Si le concerto La notte de
Vivaldi, donné dans un arrangement dû à Andreas Tarkmann,
s'avère une curieuse mixture en pareille occurrence, la « Danse des
heures » de l'opéra La Gioconda retrouve
une verve communicative. Changement d'éclairage avec les « Quatre
saisons », confiées au Berliner Barock Solisten, et en soliste Daishin Kashimoto, premier violon
de l'orchestre. Cet ensemble est composé de 15 musiciens, dont le stupéfiant
celliste Stephan Koncz. On y trouvera des gemmes, tel
le mouvement lent du « Printemps », un concerto l'« Été »
tout en contraste, traversé par les traits pizzicatos rageurs du cello au 3eme mouvement, ou encore le largo hypnotique de
l'« Automne », là encore dû à l'archet enchanteur de Koncz, sans oublier un finale de l'« Hiver »,
pris dans un tempo étourdissant, à tombeau ouvert. Kashimoto se joue les trilles du diable avec un aplomb à couper le souffle. Un ensemble
de sept solistes, conduits par Simon Rattle, va
ensuite donner les Folk Songs de Berio,
chantés par Magdalena Kožená. En famille donc... On
notera les interventions de la harpe de Marie-Pierre Langlamet et les percussions incisives. Ces 11 Chants, composés pour Cathy Berberian, réunissent des éléments hétérogènes, de par les
textes, les langues et le matériau musical. Koženáe offre une interprétation chargée de sens et pleine d'esprit. La soirée
connaîtra de nouveau un changement de climat avec, cette fois, la formation des
cuivres. De Gabrielli (Sonate XV) à Rossini
(paraphrase du duo Figaro-Rosine « dunque io son » du Barbier de Séville), ces fabuleux
musiciens nous emmèneront aussi à travers la délicieuse Suite pour cuivres de Pergolèse (arrangement de Robert Szentpáli), que Stravinsly reprendra pour son fameux ballet Pulcinella. C'est festif en diable et d'un esprit fou.
Un bis, à « la Ungarese », follement
virtuose, conclura les festivités en beauté, sous l'œil du maestro Rattle au bord de la coulisse entr'ouverte. Tout cela plait
et amuse, car entrelardé de commentaires appuyés et cherchant à être
désopilants d'un Monsieur Loyal appliqué, Klaus Wallendorf,
ex corniste de l'orchestre, reconverti en animateur habilité à chauffer la
salle. Cela prend, à en juger par les « jokes »
déchaînant rires et applaudissements du public, allemand dans sa grande
majorité. Pour ceux-là, et les autres, le concert aura montré les vertus des
diverses formations d'un orchestre décidément au top de sa forme.
Concerts de musique de chambre

A. Ivič, S. Kermarrec, M. Biron, A. Bader, G. Jehl © DR
Ces vertus d'excellence, on les apprécie
encore au fils des concerts de musique de chambre organisés en cours de journée
dans divers lieux en ville. L'occasion aussi de mieux faire connaissance avec
les musiciens de l'orchestre. Ainsi de ce programme, donné dans la grande salle
du casino, autour de « I Crisantemi » de
Puccini. Ce court morceau instrumental, en forme d'andante, pour quatuor à
cordes, a été écrit en 1890, pendant les ébauches de Manon Lescaut. D'une tristesse indicible, cette élégie,
introduite par le violoncelle, montre une grande richesse harmonique. Puccini
reprendra sa veine mélancolique dans l'intermède de l'acte III de l'opéra. La Serenata op. 46 d'Alfredo Casella (1883-1947) fait
appel à un improbable quintette, violon, cello,
basson, clarinette et trompette ! On y
trouve, au cours de ses six mouvements, une étonnante profusion de climats,
dont l'humour, dans la marche introductive, l'esprit, à la gavotte, confiée aux
seuls vents, ou la grâce aérienne dans la cavatine, dévolue aux deux cordes. Le
« Notturno », de veine post puccinienne, développe une atmosphère angoissante, que
renforcent les coups d'archet frappés du cello. Le
finale, sur un rythme de tarentelle, « alla Napoletana »,
est entrainant. Le concert avait débuté sagement par le Quintette pour
clarinette et cordes K 581 de Mozart, magistralement joué par Aleksandar Ivič, Christoph von der Nahmer, violons, Joaquín Riquelme García, alto, Solène Kermarrec - la celliste brestoise de l'orchestre berlinois - et la superbe clarinette
d'Alexander Bader. Une exécution d'un fin classicisme et d'une perfection
instrumentale rare.

Iris
Vermillon et le Varian Fry Quartett © DR
Un autre concert, donné dans la magnifique Stiftkirche, la plus vieille église de Baden-Baden,
présentait le Varian Fry Quartett,
qui emprunte son nom à un écrivain et journaliste américain engagé. Ces quatre
jeunes musiciens, qui avaient donné leur premier concert public lors du festival
pascal de 2013, avaient choisi un programme italien, autour d'une pièce peu
connue d'Ottorino Respighi, Il Tramonto (le coucher du soleil). Ce poème lyrique pour mezzo-soprano et quatuor à
cordes a été composé en 1918, peu après les célèbres Fontaines de Rome,
sur un texte de Shelley, de 1826, « The sunset ».
Il célèbre quelques uns des thèmes chers à l'imaginaire romantique, l'amour et
la mort, les affres de la douleur, l'aspiration au repos, le passage du temps.
Respighi y développe une effusion musicale subtile par une instrumentation
claire et raffinée, aux harmonies choisies, dans le chant comme pour
l'accompagnement. Et créé des atmosphères contemplatives, mais où peut
s'exalter la passion. Iris Vermillon en donne une interprétation sensible et
d'un extrême fini vocal. En première partie, le Quatuor Varian Fry jouait le Quatuor N°5 de Luigi Cherubini. Cette pièce (1835), dans le
sillage de Joseph Haydn, se révèle un bijou de classicisme, auquel le son plein
et clair de notre jeune talentueux quatuor apporte quelque hédonisme.
Jean-Pierre
Robert.
L'OSTERFESTSPIELE
DE SALZBURG
Un couple de rêve pour Arabella
Richard STRAUSS : Arabella. Comédie lyrique en trois
actes. Livret de Hugo von Hofmannsthal. Renée
Fleming, Thomas Hampson, Hanna-Elisabeth Müller, Daniel Behle, Albert Dohmen, Gabriela Beňačková,
Benjamin Bruns, Derek Welton,
Steven Humes, Jane Henschel, Daniella Fally. Rafael Harnisch. Sächsischer Staatsopernchor Dresden. Sächsische Staatskapelle Dresden, dir. Christian Thielemann. Mise en scène : Florentine Klepper.

Renée
Fleming et Hanna-Elisabeth Müller © Creutziger
Ce que personne, pas même
Alexander Pereira à l'Opernhaus de Zürich, n'avait pu
réaliser, Peter Alward, l'intendant du Festival de
Pâques de Salzbourg, l'aura réussi : réunir dans l'opéra Arabella les deux stars américaines, éminents spécialistes du rôle-titre et de celui de Mandryka, Renée Fleming et Thomas Hampson.
D'où l'importance de l'événement. On n'aura pas été déçu ! Ces deux monstres
sacrés connaissent leur métier sur le bout des doigts et savent donner le
change, même lorsque le chef d'orchestre ne leur facilite pas la tâche. Ultime
collaboration avec Hugo von Hofmannsthal, Arabella déroule à Vienne une atmosphère bien
différente de celle du Chevalier à la rose : la société bourgeoise en
voie de décrépitude des années 1860. Ayant finalement adhéré à la description
du « milieu quelque peu faisandé » que lui proposait son librettiste,
Strauss portraiture des personnages bien réels. Ainsi de ce hobereau, Mandryka, venu des lointaines contrées slovènes, être
lucide, non corrompu, à la différence de cette famille de viveurs sur le
retour, qui cherche à marier la fille aînée à un riche parti pour redorer son
blason financier. La mise en scène de Florentine Klepper ne cherche pas à
sortir du cadre, imposé par l'intrigue, de ces hôtels au luxe décadent,
fleurons de la capitale autrichienne. Le premier acte est habilement représenté
dans une enfilade de pièces, permettant d'intéressants arrière plans et arrêts sur image, qui donnent une réelle consistance aux rôles
épisodiques de la tireuse de cartes ou
d'Adélaïde. Le deuxième, celui du bal des cochers, se passera, lui aussi, dans
un de ces hôtels réputés, au look modern style, lieu festif où se retrouvent la
bonne société et ses moins illustres éléments, tous masqués. Le lieu éclate
soudain vers quelque ailleurs obscur qui voit tout un chacun s'enfoncer sans
retenue dans des délices libérateurs. Le troisième acte, ouvrant sur ce même
lieu, ne découvrira ledit hôtel que lorsque le quiproquo se dissipera. La régie
est sobre et habile, pour laisser aux caractères leur force première : une
femme résolue à trouver « der Richtige »,
le vrai homme de sa vie. Celui-ci, qui sait sa destinée scellée avec elle, est
pourtant vite ébranlé par une jalousie outrancière. Les autres personnages sont
finement dessinés, dont ceux de la sœur, Zdenka,
habillée en garçon, et du lieutenant Matteo. Comme est évitée toute concession
à la facilité, voire à la caricature, pour ce qui est des parents en
particulier et autres amoureux éconduits par l'héroïne. Tout cela fonctionne
harmonieusement. Et on passe sur quelques images plus grotesques, en fin de bal
qui vire à la bacchanale.

Thomas Hampson et Renée Fleming © Creutziger
Bien sûr, le volet musical
capte l'attention. Un peu trop parfois, car Christian Thielemann place délibérément l'orchestre au centre du propos. Ainsi de l'intermède
symphonique entre les actes II et III, délivré tonitruant. La Staatskapelle de Dresde est superbe, aux vents en
particulier : l'idiome straussien, cette phalange ne la possède-t-elle pas dans
le sang ? La coulée est incandescente. Au point de prendre le pas sur les
chanteurs, phénomène accentué par l'acoustique délicate du Grosses Festspielhaus, qui peut conférer à un solo de violon autant
de poids qu'un tutti orchestral. On rage
à plus d'un moment de ne pas mieux discerner la ligne vocale, pourtant si
magistralement dispensée par le compositeur. Ainsi du personnage d'Arabella qui, dans l'interprétation souveraine de Renée
Fleming est tout en finesse, à fleur de peau. Et dispense généreusement ces
longues inflexions suaves, sensuelles même, qui illuminent une partie irradiant
de féminité et de douceur, un des plus tendres portraits conçus par Strauss.
Thomas Hamspson, lui aussi, doit quelques fois lutter
avec la masse orchestrale. Mais quelle figure, qui en impose par sa prestance
et se montre si aisément vrai dans le magnifique duo avec Arabella et lors de l'ultime échange, déclaration d'amour plus qu'émue. La découverte de
la soirée restera la Zdenka de Hanna-Elisabeth
Müller, jeune et frémissante, à l'image d'un chant immaculé. Il en est de même
du Matteo de Daniel Behle, un ténor qui a pour lui de
ne pas sombrer dans le banal. On a porté un soin particulier aux seconds rôles.
A commencer par le Waldner d'Albert Dohmen, un luxe pour celui qui est souvent distribué en
Wotan wagnérien. Gabriela Beňačková, à
l'automne d'une merveilleuse carrière, donne vie au personnage d'Adélaïde, loin
d'être anodin, et Jane Henschel prête à la tireuse de
cartes une envergure tout à fait remarquable. Daniela Fally décoche avec brio, à défaut d'esprit, les traits acrobatiques de la Fiakermili, la reine du bal.
Un concert festif de la Staatskapelle dirigée par Christian Thielemann

DR
Le premier des deux concerts
symphoniques était dirigé par Christian Thielemann. Avant d'aborder Strauss, il avait choisi de donner le concerto pour piano K 467
de Mozart, avec Maurizio Pollini, poursuivant ainsi
un partenariat fructueux entamé à Dresde et au disque avec les deux concertos
de Brahms. L'exécution se signale par un andante aux accents marqués dans le
rythme des basses entourant le chant immaculé du piano, et deux mouvements
extrêmes menés tambour battant, pour dire le moins, par le chef et joués hyper
virtuose par Pollini. A noter que les cadences de ces
derniers ont été écrites à l'attention du pianiste par son ami, le compositeur
Salvatore Sciarrino. A Richard Strauss était
dévolu la suite du programme. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, poème
symphonique op. 30, le compositeur se confronte à la pensée nietzschéenne et au
verbe amphigourique du poète. Il s'y livre avec une certaine complaisance et un
vrai brio. Comme dans Mort et transfiguration, il fait siennes les idées
abstraites de l'auteur avec la sincérité de n'avoir pas cherché à composer
« de la musique philosophique » mais de « transmettre par la
musique une idée de l'évolution de l'espèce humaine depuis ses origines, à
travers ses différentes phases, religieuses aussi bien que scientifiques,
jusqu'à l'idée de l'Übermensch (Surhomme) de Nietzsche ». La complexité
de l'œuvre est phénoménale : un prélude et huit séquences, requérant un
effectif orchestral important, au point de frôler la pure grandiloquence. Cela, Thielemann ne cherche pas à en amoindrir la portée,
et ne compte pas les décibels. Les bois sont superbes et les cordes opulentes.
On reste finalement moins ému qu'admiratif du travail accompli avec un
orchestre dont la sonorité mordorée ne saurait souffrir la discussion. Il en
ira autrement du bouquet de Lieder qui conclura la soirée, incontestablement le
sommet du concert. À l'automne d'une prestigieuse carrière, en 1948, les Quatre
derniers Lieder sont le plus émouvant testament du musicien, la somme de
son art, un palpitant mémorial en souvenir de toutes ces voix féminines qui ont
habité ses opéras. Une forme d'adieu plus radieux que triste. La présente
exécution ajoute aux quatre pièces bien connues une cinquième, Malven (fleurs mauves), écrite la même année 1948, pour la
soprano Maria Jeritza, qui ne la créera pas.
Découvert dans les papiers de la succession de l'illustre chanteuse, le Lied
sera finalement créé en 1985 à New York par Kiri Te Kanawa, avec accompagnement de piano. La présente
exécution, dans l'orchestration de Wolfgang Rihm, est
donc une première mondiale. On sait ces pièces écrites avec amour pour la voix
de soprano, qui est traitée dans sa courbe mélodique comme un instrument.
L'interprétation d'Anja Harteros est enthousiasmante.
Si cette magnifique artiste est aussi à l'aise dans Verdi que dans Wagner, il
faut compter sur elle désormais également pour porter haut les couleurs du
chant straussien et de ses héroïnes. Simon Rattle l'a
d'ores et déjà choisie pour incarner La Maréchale de son Rosenkavalier de Pâques 2015 à Baden-Baden. Dans ces pièces sublimes, requérant un
ambitus vocal exceptionnel, Anja Harteros offre en
partage plénitude dans les forte, transparence dans les pianissimos,
expressivité du texte ; en un mot une évidente empathie avec la prosodie
straussienne. Thielemann lui confectionne le plus
magique des écrins. Une interprétation de référence, à placer dans la sillage des grandes aînées.
Strauss selon Christoph Eschenbach

Gautier Capuçon et Christoph Eschenbach © Creutziger
L'autre concert symphonique
était confié à Christoph Eschenbach. Deux partitions
partageant le thème de Don Juan encadraient un programme straussien et une
œuvre de Wolfgang Rihm, compositeur en résidence du
festival. L'Ouverture de Don Giovanni est jouée avec grandeur, quoique
sans panache particulier. On notera que les pages conclusives sont dues à Ferruccio Busoni, qui font retentir de nouveau l'accord
tragique liminaire avant de reprendre la musique du finale giocoso de l'opéra ;
ce qui termine la pièce sur une note comme désabusée. Don Quichotte op
35, dont la composition suit celle de Also sprach Zarathustra, en
est bien éloigné en termes de qualités musicales intrinsèques. Car ces
« Variations sur un thème chevaleresque » sont plus dans le ton vif
de Till Eulenspiegel, et montrent un Strauss
s'identifiant mieux à la rêverie de Cervantès qu'à la prose de Nietzsche. Ses
talents de narrateur y sont exploités au maximum. Au point qu'on a pu voir dans
cette pièce une sorte d'opéra imaginaire. Eschenbach débute la pièce de manière très lente, et peu désinvolte, ce qui ne facilite
pas la mise en situation. Il fera ensuite beaucoup dans le détail des diverses
séquences. Le son est indéniablement straussien, tout en rondeur, sans la
manière heurtée que lui apporte parfois son confrère allemand, On sait que la
pièce est un cheval de bataille pour tout violoncelliste de renom. Gautier Capuçon en donne une lecture inspirée, au jeu très serré,
nourri d'une sonorité ample, mais sans affectation. L'altiste Michael Neuhaus lui donne une réplique émouvante, au son vraiment
immaculé. Malgré les aléas de la direction, voilà une exécution mémorable du
celliste français. Il se taille un franc succès auprès d'un public qui ne passe
pas pour le plus chaleureux. La seconde partie du concert s'ouvrait par la
pièce de Rihm Verwandlung 2. Musik für Orchester. Créées en 2005 par leurs commanditaires,
Riccardo Chailly et l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, ces Variations sont basées sur
l'idée de transformation permanente d'un motif. La pièce suit une construction
en arche depuis le pianissimo des cordes aiguës jusqu'aux grands climax d'un
vaste orchestre, couronnés par un brelan de cuivres et de percussions bien
ronflants. Moyennant quelques bois en moins, elle requièrent le même effectif que celui du Don Juan de Strauss. Ce morceau (1889),
qui termine le concert, Eschenbach en donnera une
lecture frôlant l'idéal : élan, pulsation rythmique et couleurs superbes. En
bis, « la Danse des sept voiles » de Salomé, s'avère lascive à
souhait et chemine dans un grand crescendo haletant.
Belles pages de musique de chambre au Mozarteum

Richard
Strauss / DR
En contrepoint des concerts
vespéraux, la matinée de musique de chambre du lundi de Pâques présentait
quelques solistes émérites de la Staatskapelle de
Dresde. D'abord, dans le Sextuor de Capriccio, ultime opéra du maître de Garmisch. Plus qu'une ouverture à proprement parler,
il s'agit d'une introduction à ce qui sera « une conversation en musique » :
une sonate miniature d'une langueur mélancolique. L'exécution est empreinte
d'une perfection toute en retenue. Epilog für Streichquintettde
Wolfgang Rihm est écrit pour un dispositif identique
à celui du Quintette à deux violoncelles de Schubert. Créée en 2013 par les
Arditi et Jean-Guihem Queyras, la pièce déploie de
fascinants contrastes : pianissimo introductif, traits pizzicatos à l'arraché
des deux cellos, atmosphère panique, et une
conclusion dans un souffle. Le prolifique Rihm,
en particulier dans le domaine chambriste, disait en 1974 « la musique
doit être pleine d'émotion, l'émotion pleine de complexité ». Cette pièce
en est la démonstration, où brillance et rêve s'unissent en un tout généreux.
Le Quatuor K 478 de Mozart, pour piano et cordes, se voit doté d'une exécution
de belle facture, quoique pas toujours des plus subtiles sous les doigts de
Christoph Eschenbach. Alors que la partie de piano
est virtuose, la tonalité de sol mineur offre une des inspirations les plus
sombres de Mozart, celle du destin selon Alfred Einstein. Il ne se trouve de
répit dans cette déploration tragique qu'à l'andante, empli de tendresse, et au rondo final, en forme de danse, où
perce la joie, quoique non des plus spontanées. Le Quintette pour piano et
vents K 452, autre combinaison instrumentale inédite, réserve plus de
félicités, grâce à la verve des vents de l'orchestre de Dresde,
particulièrement en évidence dans les deux mouvements extrêmes, Bernd Schober, hautbois, Wolfram Grosse, clarinette, Robert Langbein, cor et Joachim Hans, basson. Et à leur intériorité
dans le superbe 2 ème mouvement, larghetto. Il y a là
une des plus mémorables inspirations mozartiennes : le dialogue du hautbois et
de la clarinette sur l'accompagnent des deux autres vents et du piano. En bis,
ils joueront le mouvement lent du Quintette op. 16 de Beethoven, où l'on
remarque la délicatesse de la mélodie.
Jean-Pierre
Robert.
***
Kitège revisité
par Dimitri Tcherniakov au Liceu de Barcelona
Nicolas RIMSKI-KORSAKOV : La légende de la ville invisible de Kitège et de la vierge Févronia. Opéra en quatre
actes. Livret de Vladimir Bielski, d'après la
chronique de Kitège d'I. Medelin.
Eric Halfarson, Maxim Aksenov, Svetlana Ignatovich, Dmitry Golovnin, Dimitris Tiliakos, Maria Gortsevkaya, Josep Fadó, Alex Sanmarti, Gennadi Bezzubenkov, Albert Casals, Vladimir Ognovenko,
Xavier Mendoza, Alexander Tsymbalyuk, Larisa Yudina, Margarita Nekrasova. Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu, dir. Josep Pons.
Mise en scène : Dimitri Tcherniakov.

Acte I ©
Antoni Bofill
Kitège occupe une place à
part dans l'œuvre de Rimski-Korsakov, comme dans l'opéra russe. Cette immense
fresque, d'inspiration religieuse, est basée sur deux légendes distinctes,
celle de la vierge Fevronia, et le dit de la ville de Kitège. Bielski et
Rimski-Korsakov les unissent en un tout qui tient autant du mystère que de
l'opéra. Deux mondes opposés s'y côtoient, celui de Fevronia,
jeune femme vivant dans la forêt en communion avec la nature et les animaux,
plus panthéiste que réellement croyante, célébrant les bienfaits du Créateur à
travers la terre nourricière, et celui de Koutierma,
mi jouisseur, comme on en rencontre souvent dans la dramaturgie russe, mi
mercenaire cynique, partisan d'un nihilisme outrancier. Pour sauver la cité de Kitège, dont elle doit épouser le prince héritier Vsevolod, de l'invasion tatare, et préserver ses habitants
du massacre, Fevronia provoque par ses prières le
miracle de rendre la ville invisible. Mais le prince est tué dans les combats
contre les tartares. Malmenée par le démoniaque Koutierma,
qui a déchaîné les forces tatares adverses, Fevronia retrouve la paix dans la forêt tandis que le passé ressurgit et que la ville
réapparait. Elle pourra enfin être conduite à l'autel par le prince. La pièce
s'achève ainsi en une sorte de transfiguration conduisant Fevronia dans l'éternité. Cet opéra de vastes dimensions, a été comparé à Parsifal, eu égard à une apparente similitude de
sujet initiatique. En fait, les deux œuvres sont bien différentes et Kitège célèbre le pardon non par la pénitence et
l'idée de rachat, mais grâce à la volonté d'amour et à l'élévation spirituelle
qui aspire vers l'éternité.

Acte III ©
Antoni Bofill
Dans sa mise en scène présentée au Teatre del Liceu,
reprise de celle créée à Amsterdam, Dimitri Tcherniakov,
dont on connait la manière radicale de traiter ses sujets, adopte un parti à première
vue sobre et en adéquation avec les didascalies du texte. Le premier acte nous
transporte dans la clairière d'une forêt, agrémentée de la modeste chaumière et Fevronia, vision plus réelle que réaliste de louange
à la nature. Elle y rencontre un chasseur dont elle panse les plaies, et
succombe à la déclaration enflammée de celui-ci. Les choses prennent un tour
bien différent dès le 2 ème acte. On comprend vite
que ce peuple de la ville basse de Kitège est composé
de citoyens russes bien actuels, facilement agités par le paria Koutierma, être sans foi ni loi. Alors que Fevronia est accueillie avec joie et déférence par les
femmes, l'assemblée est soudain en proie à un saccage
en règle pratiqué par une horde de mercenaires. La vision est théâtralement forte.
L'acte suivant, dans une salle où ils sont rassemblés, les habitants, redoutant
un péril imminent, se séparent en deux camps, les partisans de la résignation,
à défaut d'espérance en leur salut, et ceux résolus à combattre l'envahisseur.
Tandis que les seconds - les hommes conduits par Vsevolod - s'en vont en découdre, les premiers se retranchent au fond dans une
immobilité qui peu à peu les rend invisibles. Après la page symphonique
décrivant la bataille, le théâtre donne à voir un spectacle de désolation,
invasion de brigands armés semant la terreur. Là encore, on est rassasié de
violence, et celle infligée à la malheureuse Fevronia n'est pas la moindre. La recherche de l'utopie d'une société meilleure, que Tcherniakov place au centre de son propos, voit son
aboutissement au dernier acte : la jeune femme, dont les forces déclinent,
retrouve ses amis d'antan tandis qu'arrive à sa table son prince charmant,
avant de s'éteindre béate dans le néant éternel. Le chœur reste relégué dans la
coulisse, tout comme est gommé l'aspect de féérie mystique. La mise en scène,
qui a porté au premier plan le destin de Fevronia, au
point d'éclipser l'autre légende, celle du sort de la ville de Kitège, banalise paradoxalement l'apothéose finale
rédemptrice, de l'admission de Fevronia au Paradis
des Martyrs. Ce faisant, elle réduit la portée initiatique de la légende en
l'enfonçant définitivement dans un vécu au premier degré. Si on résiste peu à
l'impact dramatique qui parcourt constamment la régie, à la manière magistrale
de traiter les masses chorales, et une direction d'acteurs ferme, voire
exacerbée, à la limite de comportements possédés, on s'interroge sur cette
réinterprétation pour le moins en décalage avec le texte.

Acte IV ©
Antoni Bofill
Le plateau vocal défend valeureusement une
pièce dont les rares représentations ne facilitent pas la mise en œuvre.
Unissant interprètes russes et solistes locaux, il est dominé par la Fevronia de Svetlana Ignatovich qui au long de quelques trois heures d'un spectacle haut en couleurs, maintient
une qualité vocale plus qu'irréprochable et déploie une force de conviction peu
commune. L'antipathique Koutierma est lui aussi
magistralement campé par Dmitry Golovnin,
qui de sa voix de ténor acidulée, propose une sorte d'anti héros et sort le
personnage de son côté veule et histrion. Le prince Vsevolod de Maxim Askenov est plus
banal, le rôle étant à vrai dire moins caractérisé musicalement. La
distribution gigantesque s'enorgueillit d'un contingent de basses
bien sonores, où aux côtés de voix éminentes du moment, tel Eric Halfarson, on trouve les stars d'hier comme Gennadi Bezzubenkov et Vladimir Ognovenko, naguère premiers couteaux du Mariinsky.
La partie chorale assume un rôle essentiel et d'une grande variété, empruntant
au chant populaire profane ou sacré : le chœur du Gran Teatre del Liceu la défend avec panache, tant vocalement que
scéniquement. Josep Pons, actuel directeur musical à Barcelone, dirige avec
fougue, à défaut de ferveur, et l'Orquestra Simfònica du Liceu ne mérite que
des éloges, que ce soit dans la poésie diaphane qui décrit la forêt ou les
torrents cataclysmiques exigés par les scènes de luttes. Les pages de sonnerie
de cloches, si essentielles, sont bien rendues, même si peu marquées. On
apprécie le jeu des motifs récurrents tissant la symphonie, et qui d'origine
vocale, sont attachés à des personnages, à la différence des leitmotive
wagnériens. Si pas aussi prééminente qu'est spectaculaire le volet théâtral, la
fresque musicale achève un bel équilibre voix orchestre.
Jean-Pierre Robert.
Le Désert de Félicien David

DR
Dans le cadre du cycle
« Déserts », la Cité de la musique présentait Le Désert de
Félicien David (1810-1876). Ce musicien, d'origine provençale, formé à l'école
de Fétis, devint le compositeur officiel du mouvement saint-simonien jusqu'au
coup d'arrêt porté en 1832 à ce courant de pensée. L'Orient l'attire et c'est
au retour d'un séjour en Égypte et en Algérie en 1833, qu'il compose Le
Désert. Celui-ci connaît, le soir du 8 décembre 1844, un succès
foudroyant et lui assure une reconnaissance tant convoitée, de ses pairs et du
public. Hector Berlioz déborde d'enthousiasme et salue un chef-d'œuvre d'un
grand compositeur. Il devait lui-même la diriger peu de temps après. Le genre
mixte de la pièce, une « ode-symphonie », avait de quoi surprendre,
puisqu'aux confins de l'univers symphonique et du monde lyrique, un peu comme
le Roméo et Juliette de Berlioz créé cinq ans auparavant. Mais, à la
différence de cette « symphonie dramatique », dans la pièce de David
le chœur est composé uniquement de voix masculines, et ne sont présents que
deux ténors solistes. Surtout, elle fait intervenir un récitant, ce qui lui
confère une tonalité tout à fait originale, proche de la contemplation : plus
qu'appelé à être le témoin d'une action, l'auditeur est pris par la main dans
l'observation d'un paysage poétique, au fil de ses trois parties : la marche de
la caravane, une halte nocturne, et le lever du jour. Le poème, dû à Auguste
Colin, possède quelques phrases superbes, comme « Ineffables accords de
l'éternel silence, Chaque grain de sable a sa voix.» Le Désert véhicule
un vrai souffle d'exotisme sans pour autant jamais sombrer dans le
grandiloquent ou la copie servile d'un modèle. La veine mélodique est riche et
puise sa source à des mélismes orientaux, telle une fantaisie arabe,
d'inspiration syrienne. La musique passe du frémissement des violons ppp au déchainement sonore. La présente exécution, sous la baguette racée de
Laurence Equilbey, en dévoile les sortilèges. On
admire les solistes de l'Orchestre de chambre de Paris, Lionel Speciale, en particulier, dont le cor solo baigne le
premier chœur, et parfume en fait toute la partition. Le chœur Accentus se distingue par sa rigueur et sa claire
énonciation du texte. Les deux ténors sont à l'unisson, Cyrille Dubois, timbre
solaire et engagé, Zachary Wilder, proche du haute-contre, dans l'invocation du
muezzin, aux arabesques ensorcelantes. En première partie, le Concerto N° 5 de
Saint-Saëns formait une entrée en matière judicieuse. Car cet op. 103, sous
titré « Égyptien », composé à Louqsor en 1895, est baigné de couleurs
méditerranéennes et ne renie pas un exotisme affirmé, même si un peu fabriqué.
Il célèbre aussi cet Orient mythique tant apprécié au XIX ème siècle. Fin musicien, Bertrand Chamayou en livre une
exécution magnifiquement équilibrée, qui entraîne en un tourbillon enivrant aux
deux mouvements extrêmes ou dans une douce évocation nocturne à l'andante.
Jean-Pierre Robert.
Les Israélites dans le désert

Jordi Savall / DR
Autre illustration de la même thématique,
mais dans le domaine sacré, la Cité de la musique présentait le « Poème
vocal sacré », Les Israélites dans le désert, de CPE Bach. Composé
à Hambourg en 1769, il est destiné, selon son auteur, à être joué «
n'importe quand, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église, simplement à la
gloire de Dieu et sans porter ombrage aux différentes confessions ». Autrement
dit destiné autant à salle de concert qu'à une cérémonie religieuse, eu égard à
son message universel. Sa forme est plus ramassée que celle du second oratorio
que composera le musicien en 1778, La Résurrection
et l'Ascension de Jésus. L'œuvre, en deux parties, narre l'exode des
israélites quittant l'Égypte pour se rendre vers la Terre promise. Moïse et
Aaron en sont les deux principaux personnages, tandis que deux femmes
israélites anonymes rapportent les sentiments du peuple. Celui-ci s'exprime par
le chœur, qui se voit confier le rôle essentiel, évoquant tour à tour la
révolte de la souffrance puis la jubilation de la félicité retrouvée. Les
récitatifs détaillés et les arias développées, de forme da capo, ne sont pas
sans rappeler la manière de Haendel. L'exécution de
Jordi Savall, à la tête de son Concert des Nations,
impose d'emblée une atmosphère recueillie, dépouillée, se refusant à tout
lyrisme, fervente dans l'accompagnement des arias que distinguent souvent de
superbes solos instrumentaux. Ainsi de la flûte lors du duetto réunissant les
deux femmes israélites désespérées, pleurant le sentiment d'abandon dans lequel
le peuple se croit enfermé, et surtout du basson et de ses arabesques tressées
durant l'air de Moïse implorant la miséricorde de Dieu. Le ton est résolument
chambriste, mettant en exergue la belle écriture homophonique de CPE Bach. La
contribution chorale de la Capella Reial de Catalunya est d'une souveraine splendeur quant à la
précision de la déclamation et à l'impact de la projection expressive. Celle
des solistes est plus nuancée : si María Cristina Kiehr favorise un chant épuré, sans vibrato, ce qui n'est pas toujours confortable,
en première partie du moins, Hanna Bayodi-Hirt
privilégie une élocution plus chargée en émotion et un art consommé de la
vocalise. Le jeune ténor Nicholas Mulroy est un peu
pâle, mais le Moïse de Stephan McLeod fait montre
d'une belle tenue alliant puissance
vocale et intensité de l'expression.
Jean-Pierre Robert.
Création française de Doctor Atomic à l'Opéra du Rhin
John ADAMS : Doctor Atomic. Opéra en
deux actes. Livret de Peter Sellars tiré de sources
originales. Dietrich Henschel,
Robert Bork, Marlin Miler, Anna Grevelius, Jovita Vaskeviciute, Peter Sidhom, Brian Bannatyne-Scott,
John Graham-Hall. Chœurs
de l'Opéra national du Rhin. Orchestre symphonique de Mulhouse dir. : Patrick Davin. Mise en scène : Lucinda Childs.

© ONR / A. Kaiser
Cinquième opéra de John Adams, Doctor Atomic (2005) est tiré
d'un fait historico-politique réel, tout comme l'était le sujet de Nixon in
China (1987) et de The death of Klinghoffer (1991). Sur un livret du fidèle Peter Sellars, le thème est cette fois celui de la mise au point
du premier essai nucléaire américain, le 16 juillet 1945, dans le désert du
Nouveau Mexique, appelé « opération Manhattan ». La figure centrale
de cette narration, qui épouse en temps réel les derniers préparatifs, est le
physicien Robert Oppenheimer auquel est confiée la mission d'essayer le «
gadget » qui est censé servir d'arme de guerre contre le Japon. D'aucuns, et en
particulier les commanditaires de la pièce, on voulu le comparer à un Faust
américain, ce dont Adams a tenu à se démarquer. A travers le combat d'un homme
en proie aux doutes que suscite l'explosion de la première bombe atomique, eu
égard à ses répercussions sociales et à sa dimension éthique, il s'agit, dira Adams,
d'une « course héroïque pour la survie de la civilisation ». Les auteurs ont
cherché à traiter ce propos de terreur en y injectant une facette poétique.
Homme extrêmement cultivé, Oppenheimer lit Baudelaire dans le texte et fait son
miel de la poésie de John Donne comme de la spiritualité hindoue. Ce qui lui
confère un visage humaniste plus qu'une dimension faustienne. Adams a conçu une
musique fort différente de celle de ses opéras précédents, montrant la
diversité stylistique qui le caractérise : à la fois raffinée, telle une
tapisserie sonore, et d'un formidable impact, avec de vrais déluges sonores. Le
procédé de la répétition à satiété de courts motifs, qu'on rattache au
mouvement minimaliste, sans doute à tort du fait que le musicien s'en est largement
émancipé depuis ses premières œuvres, confère au tissu orchestral une couleur
singulière. Adams dit se référer à Sibelius dans son travail. Il sait aussi se
montrer expansif, comme il en est du deuxième tableau du Ier acte, réunissant les époux Oppenheimer, Kitty l'épouse se livrant alors à une réflexion angoissée quant aux contradictions
entre la paix, la guerre et l'amour. Mais, à force de vouloir coller à un sujet
favorisant d'interminables discussions, l'opéra n'évite pas toujours la baisse
de tension, en particulier au II ème acte dont le
suspense n'est pas aussi palpable qu'on aurait pu le penser.

Dietrich Henschel © ONR / A. Kaiser
La production de cette première scénique
française à l'Opéra du Rhin, à Strasbourg, impressionne par son aboutissement
visuel, la vidéo et ses images mouvantes permettant d'installer un climat
oppressant et des arrières plans signifiants, telle l'apparition de la carte
géographique du Japon, ou des visions de tempête, à l'image de l'orage qui
aurait, un temps, contrarié la mise à feu de la bombe, le D Day. La mise en
scène de Lucinda Childs, qui signa la chorégraphie de le création à San Francisco, restitue la fébrilité des
préparatifs de l'essai, tout comme l'intensité de la réflexion des
protagonistes face à leurs propres interrogations. Elle se caractérise
cependant par un excès de placidité dans les confrontations, comme si le temps
pouvait être arrêté. Ainsi Oppenheimer apparait-il d'un étonnant sang froid,
pour ne pas dire d'un certain détachement face au questionnement angoissé des
membres de son entourage. Il réagit moins en démiurge qu'en homme
intérieurement torturé par la vision du monde que l'explosion va façonner. Ses
monologues sont la clef de voûte d'une trajectoire moins déterminée qu'il n'y paraît,
que ce soit à la fin du premier acte, et peu avant le déclenchement du compte à
rebours de la mise à feu. L'aspect thriller, on le trouve paradoxalement plus
dans les scènes où interviennent la femme du savant, Kitty,
qui ne peut réfréner une inquiétude viscérale, et sa suivante, Pasqualita, véritable pythie annonçant poétiquement les
malheurs à venir, souvent en simultanéité avec l'action principale. L'image
finale, qui montre l'anéantissement d'Hiroshima, anticipe le cataclysme
qu'entrainera le premier essai nucléaire américain : une armée d'ombres, femmes
et hommes vêtus de kimonos, envahit l'espace tandis qu'Oppenheimer et les
autres protagonistes s'avancent lentement parmi eux. Soumise à une vocalité
très tendue, la distribution est sans faille. Dietrich Henschel campe un Oppenheimer à peine taxé par l'endurance qu'exige le rôle. Peter Sidhom, le général Groves, lui
donne une réplique ferme. Anna Grevelius triomphe de
l'extrême ambitus de la partie de Kitty. L'étonnante
voix de contralto de Jovita Vaskeviciute prête à Pasqualita des accents d'une insondable
tristesse. A la tête l'Orchestre symphonique de Mulhouse, dont il est le
directeur musical, Patrick Davin accomplit des
prodiges : impact sonore, transitions poétiques, flux incandescent, tout est
savamment dosé. Et les Chœurs de l'ONR sont plus qu'irréprochables.
Jean-Pierre Robert.
Une autre vision de l'opéra selon John Adams
John ADAMS : A
Flowering Tree. Opéra en deux actes. Livret et adaptation de Peter Sellars et du compositeur. Paulina Pfeiffer, David Curry, Franco Pomponi. Ella Fiskum, Sudesh Adhana, danseurs. Dadi Pudumjee, Vivek Kumar, Simon T Rann,
marionnettistes. Chœur du Châtelet. Orchestre symphonique Région Centre-Tours, dir. Jean-Yves Ossonce. Mise en
scène : Vishal Bhardwaj.

© Marie Noëlle Robert
Alors que Doctor Atomic appartient au genre du « docu
opéra », A Flowering Tree,
créé à Vienne en 2006, à l'occasion des célébrations de l'année Mozart, se
situe, au sein de la production de John Adams, plutôt dans la veine de la pièce
sacrée El Niṅo (Paris, 2000). Autant oratorio qu'opéra, eu égard à une action réduite et à la
présence d'un conteur, le thème en est la métamorphose, celle d'une jeune
femme, Kumudha, qui possède le pouvoir de se
transformer en arbre en fleurs, ce qui ne l'empêche pas de pouvoir retrouver sa
forme humaine. Un prince, séduit par sa beauté, et plus encore par son pouvoir
magique, l'épouse et lui demande d'effectuer la métamorphose pour lui. Elle
s'exécutera, mais après avoir repris son apparence humaine, sombrera dans la
misère, devant l'indifférence du prince. Celui-ci, en proie au remords, se
condamnera à mener une vie errante de paria, avant qu'ils ne se rejoignent.
Pour le compositeur, c'est « une parabole à propos de la jeunesse, de l'espoir,
de la magie de la transformation, à la fois physique et spirituelle »;
comme dans La Flûte enchantée. En fait, si l'hymne à la jeunesse réunit
les deux sujets, celui traité par Peter Sellars a peu
à voir avec l'œuvre lyrique ultime de Mozart, car cette histoire inspirée des
contes folkloriques indiens, véhicule une philosophie bien différente. La pièce
est chantée à la fois en anglais (solistes) et en espagnol (chœurs).
Différente, quoique aussi contrastée que celle de Doctor Atomic, la musique fait encore la part belle aux
effets de tapisserie sonore qui caractérisait cet opéra, et affirme un souci de
polyphonie rythmique souvent virtuose. Le procédé de répétition de cellules motiviques reste bien présent, avec un recours intéressant
aux percussions et à un instrumentum particulier,
carillon, célesta, glockenspiel. On pense souvent à Britten, qui lui aussi
s'est inspiré de mélismes orientaux, balinais en l'occurrence. Adams fait
également usage d'onomatopées dans le traitement du chœur et soumet ses
chanteurs solistes à rude épreuve.

© Marie
Noëlle Robert
San soute pur mieux serrer de près la
thématique de l'opéra, la production du Châtelet a fait appel au cinéaste
indien Vishal Bhardwaj, qui
s'est entouré d'un chorégraphe et d'un marionnettiste. Mais la mise en scène
appréhende le sujet au premier degré de l'illustration. Ainsi est-on convié à
une succession d'images coloriées et froides, maniant à l'envi les effets de
symétrie au fil de fastidieux défilés de choristes s'affairant à placer et
déplacer une myriade d'amphores ou maniant avec gracilité ce qui ressemble à
des gerbes de blé. La gestuelle fonctionne comme au ralenti et inclut des
figurations de statuaire indienne, laquelle est affirmée dans les rares
éléments de décoration. La chorégraphie entourant la métamorphose de la jeune Kumudha ou figurant les mouvements du couple est agréable,
à défaut d'être imaginative. Le recours à des marionnettes pour représenter la
mère et la sœur de l'héroïne, cette dernière figurée aussi en poupée géante,
lorsque devenue, elle aussi, reine de quelque royaume lointain, apporte une
touche anecdotique plus que réellement signifiante. Quelques éclairages
judicieux, façon géométrique, à l'acte II, ne parviennent pas à renouveler un
intérêt qui s'émousse au fil des tableaux. Le cast est valeureux, n'était une fâcheuse amplification des voix, qui conduit le
spectacle à se vouloir proche d'une superproduction de type Broadway, ou Bollywood ! Le ténor-prince, David Curry, arbore à cette
aune une stature vocale digne d'Othello ! Et Franco Pomponi,
le Narrateur, déborde presque du cadre de l'histoire qu'il anime pourtant avec
une conviction à toute épreuve. A pleine puissance, les chœurs sonnent
tonitruants au point de devenir criards. Paulina Pfeiffer défend avec force les aspérités vocales du rôle de la pauvre Kumudha. Dans la fosse, Jean-Yves Ossonce dirige avec maestria un Orchestre Symphonique Région Centre - Tours loin de
démériter, tant la partition offre de difficultés.
Jean-Pierre Robert.
Anne-Sophie Mutter et Lambert Orkis, 25 ans chemin faisant

Anne-Sophie Mutter & Lambert Orkis © KFR
/ Wieler
Voilà vingt cinq ans qu'Anne-Sophie Mutter et Lambert Orkis font
chemin ensemble en des récitals de haute tenue. Celui donné à la salle Pleyel,
l'instant d'une tournée européenne pour fêter l'événement, ne fait pas
exception. L'admiration de chacun des deux musiciens pour l'autre explique sans
doute ce degré d'entente absolue qui marque leur partenariat. « Anne-Sophie
combine un authentique plaisir de la musique avec un esprit d'aventure et une
passion intense pour son sujet » dit le pianiste. Le programme du présent
concert en est la patente démonstration. Il s'ouvre, de manière audacieuse, par
une pièce pour violon seul de Krzysztof Penderecki (*1923), La Follia. Créée en décembre 2013 au Carnegie Hall de New
York, elle flatte le talent hors norme de sa dédicataire, dans des traits d'une
technicité redoutable. S'inspirant du modèle de la sonate baroque, Penderecki
propose un thème suivi d'une série de neuf variations mêlant toutes sortes de
difficultés dans un ingénieux mélange, succession de pizzicatos rageurs,
courbes mélodiques presque sinueuses, sauts d'intervalles inouïs, instaurant
une tension palpable. La puissance expressive qu'en restitue la violoniste est
confondante. La Sonate K 304 de Mozart, composée à Paris en 1778, ne saurait
apporter contraste plus affirmé : Mutter et Orkis la conçoivent avec le dernier raffinement, telle une
confidence, adoptant un tempo très retenu à l'allegro initial et maintenant un
solide degré de concentration au tempo di menuetto,
pris quasi adagio. Nouveau changement de climat avec la Sonate pour violon et
piano N° 2 d'André Prévin (*1929). On sait les liens
privés et artistiques qui unissent ce compositeur et Anne-Sophie Mutter. Comme d'autres œuvres conçues pour elle par Prévin, cette sonate (2012), est d'une écriture apte à
mettre en valeur l'art de la violoniste. Encore qu'elle soit tout aussi
démonstrative dans la partie de piano. Deux mouvements à la tonalité
entraînante, presque jazzy, « Joyous » et «
Brillant » encadrent une section plus introvertie, « Desolate »,
assurément la plus aventureuse en termes
de modernité. S'y déploie un fort potentiel émotionnel dans une étonnante
diversité rythmique. L'archet solaire de Mutter y
fait merveille. Le concert s'achevait par la sonate N° 9 op. 47 de Beethoven,
dite « A Kreutzer ». De ce morceau de choix, conçu comme un dialogue empli
de vigueur entre les deux partenaires, comme il peut se produire entre soliste
et orchestre dans un concerto, Mutter et Orkis offrent un feu d'artifice, marqué par de singuliers
écarts de dynamiques, une manière favorite chez la violoniste, qui ose des
ralentissements extrêmes souvent associés à des pppp évanescents (andante con variazioni) ou
des accélérations frénétiques (prestos du premier mouvement et du finale).
C'est supra virtuose, souvent proprement jubilatoire, et ne laisse pas de
marbre. On ne sait qu'admirer de la palette mirifique du violon, ou du toucher
vraiment immatériel du pianiste. Ils donneront en bis la Septième Humoresque de Dvořák,
fort chaloupée, et la Première Danse hongroise de Brahms, aux accents de
musique Klezmer.
Jean-Pierre Robert.
Daniel Harding et l’Orchestre de Paris : De vibrantes retrouvailles
!

© Lucas
Piva
Après une longue séparation de plus de
quinze années, le jeune chef britannique, élève de Simon Rattle et de Claudio Abbado, retrouvait le temps d’un concert l’Orchestre de Paris,
salle Pleyel, dans un programme très attractif associant Mozart, Mahler et
Strauss. La silhouette juvénile, le visage enfantin, la gestique élégante,
souple et féline, mais un bras de fer pour mener à bon port la phalange
parisienne réunie, ce soir, au grand complet. En ouverture la Musique funèbre maçonnique de Mozart.
Occasion entre toutes de ressortir les rutilants et trop rares cors de basset,
instruments fétiches de Mozart, fréquemment utilisés pour la musique de loges,
instruments symboliques du souffle de la vie et de la fraternité des colonnes
d’Harmonie. Un œuvre composée en 1785, interprétée lors d’une cérémonie
rituelle, dédiée à la mémoire de deux frères maçons disparus, Georg August von Mecklenburg-Strelitz et Franz Esterhazy von Galanta. D’une manière
générale, les musiciens francs-maçons ont créé et développé une musique
destinée à soutenir le rituel, mais leur
initiation les a souvent profondément marqués, au point que leurs œuvres
profanes soient fréquemment imprégnées de l’idéal maçonnique. L’Ode funèbre maçonnique K. 477 est à
cet égard une composition tout à fait emblématique de cette double appartenance
rituelle et symbolique. Il s’agit d’une réflexion sur la mort, mort profane de
deux Frères, mais également, mort et résurrection de l’initié à travers le
mythe d’Hiram. (cf. Musique et franc-maçonnerie,
in L'Éducation Musicale, n° 565, 2010). Daniel Harding en donna une
solennelle et majestueuse lecture, alliant désolation et espoir, Ténèbres et
Lumière, deuil et résurrection, où la petite harmonie, une fois de plus, fut à
l’honneur. Puis ce fut au tour de la mezzo soprano Chritianne Stojin de nous livrer une poignante
interprétation des Kindertotenlieder de Gustav Mahler. Une œuvre composée
entre 1901 et 1904, chargée d’une totale consternation, où certains ont voulu
voir l’annonce prémonitoire de la mort, quelques années plus tard, en 1907, de
Maria, la fille ainée de Gustav et d’Alma. L’Orchestre de Paris sut parfaitement valoriser la richesse de
l’orchestration mahlérienne et soutenir la superbe voix de Christianne Sotjin, alliant timbre rond, technique vocale sans
faille avec des passages d’une sublime douceur, legato envoûtant, tessiture
étendue, à laquelle manquait parfois quelques graves, projection efficace et
implication scénique rendant douleur et affliction palpables. Une prestation chargée
d’émotion qui fut suivie d’un long silence avant que ne retentissent de
vigoureux et mérités applaudissements. Après la pause, Daniel Harding nous
donna à entendre Une vie de Héros de Strauss comme rarement on eu l’occasion de
l’entendre auparavant, tant son interprétation nous parut captivante de bout en
bout, à la fois claire, fluide et particulièrement aboutie. Dernier des grands
poèmes symphoniques du compositeur, composé en 1898, Strauss s’y met en scène
de façon à la fois humoristique et légèrement mégalomaniaque... Occasion de
célébrer dignement les retrouvailles réussies entre le chef britannique et
l’Orchestre de Paris au mieux de sa forme.
Patrice Imbaud.
Un concert bien roboratif !

DR
Les rares spectateurs de la salle Pleyel
présents ce soir ne seront pas repartis les oreilles vides après ce concert du
« Philhar » dirigé par le chef américain
Kent Nagano. Il faut avouer que le plat de résistance, la Symphonie n° 3 d’Anton Bruckner, était particulièrement copieux et
indigeste… Une œuvre à la gestation
compliquée et douloureuse puisqu’elle fut revue et corrigée pas moins de trois
fois (1873, 1877, 1889) par le maitre de Saint Florian. Dédiée à Richard
Wagner, dont Bruckner était un fervent admirateur, elle comprenait
initialement, en son sein, nombre de citations wagnériennes qui finalement
disparurent au cours des différentes réécritures, notamment dans la version
ultime de 1889, la plus jouée et choisie ce soir par Kent Nagano. Œuvre
complexe, disparate, abrupte, considérée comme la première des symphonies
proprement brucknériennes, elle reste toutefois marquée par une impression
d’incomplétude et n’atteint pas au niveau de génie et de ferveur des symphonies suivantes…C’est dire si une telle
œuvre nécessite un engagement certain de la part du chef pour maintenir un
semblant de cohérence et surtout un minimum d’intérêt. Or d’engagement, il n’y
en eut pas de la part du chef américain qui se contenta de suivre l’orchestre,
au demeurant excellent, nous imposant une interprétation d’une redoutable
lourdeur, caricaturale, bien loin du Bruckner allégé et fervent que l’on aime.
On ne retiendra donc de ce concert que la première partie dévolue à Schoenberg
et Mozart. Après la courte et rare pièce de Schoenberg, Musique d’accompagnement pour une scène de film, seule la soprano
danoise, Suzanne Elmark apporta un peu de fraîcheur
dans cette soirée bien roborative, nous gratifiant d’une superbe interprétation
de trois airs de concert de Mozart « Ah, lo previdi »,
« Misera, dove son ! » et « Un moto
di gioia » où elle ne faillit pas à la
réputation d’excellence de ses consœurs pour lesquelles ces airs étaient
écrits.
Patrice Imbaud.
Tancredi au
Théâtre des Champs-Elysées
Gioachino ROSSINI : Tancredi.
Mélodrame héroïque en deux actes (Version de Ferrare, 1813). Livret de Gaetano
Rossi, d’après la tragédie éponyme de Voltaire. Marie-Nicole Lemieux, Patrizia Ciofi, Antonino Siragusa,
Christian Helmer, José Maria Lo Monaco, Sarah Tynan. Chœur du Théâtre des Champs-Elysées. Orchestre
Philharmonique de Radio France, dir. Enrique Mazzola. Mise en scène : Jacques Osinski.

© Vincent
Pontet -WikiSpectacle
Dernier opus en version scénique du
Festival Rossini au TCE, les deux opéras à venir, L’Italienne à Alger et La
Scala di Seta, étant présentés en version de
concert, Tancredi est un des rares opéra seria de Rossini. Composé en 1813, à l’âge de 21 ans, il marque indiscutablement un
tournant novateur dans l’histoire de l’opéra seria.
Fait important qui n’échappa pas au regard avisé de Stendhal, qui note avec
enthousiasme la réduction de récitatifs, ainsi que le nombre impressionnant et
la qualité des ensembles vocaux. Tancredi fut créé à la Fenice de
Venise le 6 février 1813. Il connut depuis lors un succès constant, valant à
son auteur une célébrité mondiale. Louanges méritées concernant la musique,
mais fort discutables concernant le livret de Gaetano Rossi. Tout commence par
une méprise épistolaire… Si la pièce de Voltaire, écrite en 1760, se veut une
critique acerbe de la peine de mort, de la justice expéditive, du mariage forcé
et du pouvoir tyrannique, le livret de Rossi dénature totalement ce message.
Car chez Voltaire les deux amants ne se rencontrent pas, du moins en tête à
tête, laissant ainsi la méprise amoureuse se poursuivre, entretenant du même
coup la dramaturgie ! En revanche, dans un souci de servir la musique de
Rossini et de valoriser les ensembles vocaux, le librettiste italien rend
absurde la trame de Voltaire : pas moins de deux duos d’amour entre Tancredi et Aménaïde, comme autant
d’occasions de lever le doute quant à la trahison hypothétique d’Aménaïde. Faute d’aveu le livret perd aussitôt toute
crédibilité et tout intérêt dramatique! Difficile dans ces conditions
pour le metteur en scène de servir une telle ineptie, et la transposition à
l’époque contemporaine ne fera rien à l’affaire. Une mise en scène fade, peu
dérangeante, il faut le reconnaitre, des costumes hideux et une scénographie
assez indigente qui vaudront à Jacques Osinski quelques huées, lors du salut final. Concentrons nous donc sur la seule chose
qui vaille, la musique, indiscutablement très attrayante et novatrice, où le
bel canto rossinien semble prendre, par instant, des accents belliniens. Une musique parfaitement servie par l’Orchestre
Philharmonique de Radio France (enfin un orchestre qui sonne !) conduit
par la baguette expérimentée d’Enrique Mazzola,
spécialiste du genre. Quant au casting vocal, il fut largement dominé par les
deux superbes prestations de Marie-Nicole Lemieux en Tancredi et de Patrizia Ciofi en Aménaïde.
Deux timbres vocaux complémentaires, parfaitement appariés, la tessiture
homogène et étendue de Tancredi répondant aux
aigus faciles et stratosphériques d’Aménaïde. Le reste de la distribution parut beaucoup plus
pale, Antonino Siragusa (Argirio)
ne paraissant vraiment à l’aise que dans le registre médium, Christian Helmer (Orbazzano) manquant
d’envergure vocale. A signaler les deux belles performances de José Maria Lo
Monaco (Isaura) et Sarah Tynan ( Roggiero), assez
convaincantes malgré leurs rôles secondaires. Une belle soirée !

© Vincent Pontet - WikiSpectacle
Patrice Imbaud.
***
L'EDITION MUSICALE
FORMATION
MUSICALE
Walter
PACELAT : Tessitures. 61 pièces
originales pour aborder la notion de « style » par la pratique
instrumentale collective. Van de Velde : ISMN 979-0-56005-301-1.
Ces soixante et une pièces
à géométrie variable sont utilisables en musique d’ensemble mais aussi et
peut-être surtout dans le cadre d’un cours de Formation Musicale. A travers
auteurs, modes, styles, l’auteur permet de découvrir ce qu’est un langage
musical. Ces pièces se prêtent à de multiples combinaisons d’instruments et de
timbres qui les rendent à la fois riches et facilement utilisables en toutes
circonstances. Elles pourront donner lieu, bien évidemment, à l’écoute et à la
découverte des « originaux » et seront précieuses pour en découvrir
l’architecture mélodique et harmonique.
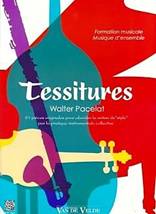
CHANT
CHORAL
Aurelio
PORFIRI : Cinq motets pour l’année
de la foi. Chœur mixte (SATB) a cappella. Symétrie : ISMN
979-0-2318-0739-4.
Ces cinq motets : 1. Spera in Domino, 2. Christo confixus sum cruci, 3. Fidelis Servus et prudens, 4. Multitudinis autem, 5. Ego sum via, veritas et vita, ne présentent
pas de grande difficulté et pourront être exécutés par un chœur moyennement
exercé. Ils n’en sont pas moins de grande qualité et survivront, espérons-le, à
l’occasion pour laquelle ils ont été écrits.

Patrick
BURGAN : Elle pour huit voix de
femmes. Symétrie : ISMN
979-0-2318-0750-9.
Cette œuvre difficile est
écrite sur un poème de Florence Delay : Revenante. L’auteur présente lui-même son œuvre qui demandera
beaucoup d’expressivité et de technicité dans la mise en place pour un résultat
d’une grande beauté.

Charles
BALAYER : Lullaby pour chœur mixte SATB et piano (ou
section rythmique). Delatour : DLT2374.
Cette délicieuse pièce
devrait faire le bonheur de nombreux chœurs désireux d’aborder un répertoire
jazz. Elle a été composée pour le "Chœur Artie Shaw", ensemble vocal
de jazz français.
Elle figure sur le premier album de cette formation, "Jasons Jazz",
paru en 1994. La vidéo est visible sur le site de l’éditeur. Si le chœur
dispose d’un flûtiste de jazz capable de faire ce que fait celui de la vidéo,
ce sera encore mieux !
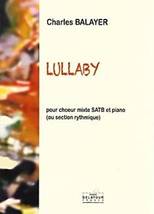
ORGUE
Valéry
AUBERTIN : Ma l’ombra sol pour
orgue. Chanteloup Musique : CMP007.
Il est indispensable,
avant de jouer cette œuvre, de se pénétrer de la « préface
autobiographique » qui la précède et en donne la clé. Il s’agit d’une
pièce longuement mûrie à interpréter telle que l’auteur l’a voulue. Il faudra
en particulier, respecter la lettre et l’esprit d’une registration qui demande
trois claviers pour exprimer pleinement la richesse de l’œuvre.

PIANO
Christine
MARTY-LEJON : Praia Vermehlapour piano. Lemoine : 29144 H.L..
On pourra méditer avant de
jouer cette pièce la citation de Paulo Coelho mise en exergue :
« C’est en marchant que se fait le chemin ». L’ambiance est
brésilienne à souhait et la pièce, de niveau moyen, demande une exécution
sensible à ce rythme syncopé, à ne pas jouer de façon scolaire ! A la fois
rythmée et un brin mélancolique, cette jolie pièce devrait beaucoup plaire.

Pierrette
MARI : Hommage à Henri Dutilleux pour
piano. Niveau supérieur. Sempre più : SP0102.
Certes cette pièce peut
être jouée par de grands élèves, mais elle ne déparera pas non plus dans un
récital. On connait les qualités de la grande compositrice et musicologue
qu’est Pierrette Mari pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en dire davantage. Le
titre parle de lui-même. C’est une courte pièce, certes, mais d’une grande
densité musicale et expressive.

ACCORDEON
Fabrice
TOUCHARD : Pour Elsa. Pièce pour
accordéon. Débutant. Lafitan : P.L.2712.
Ce tempo de marche est
tout à fait sympathique et entrainant. Après une introduction, un 4/4 martial
se fait entendre, suivi d’une valse sur le même thème. Une coda conclut le
tout, rappelant l’introduction.

Célino BRATTI : Courte sérénade pour accordéon. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2783.
Cette sérénade pleine
d’allant ne manquera certainement pas de séduire son interprète ainsi que son
public. Un thème en do majeur se développe d’abord, suivi d’un passage au ton
voisin et retour au thème jusqu’à une coda agréablement conclusive. La mélodie
est jolie et très chantante.

VIOLON
Laurent
MARTIN : Six Analexis pour deux violons. Delatour : DLT2373.
Ces six pièces sont plus
destinées aux professeurs qu’à leurs élèves, sinon à ceux qui s’apprêtent à
leur tour à devenir des « maîtres ». Elles forment un ensemble où le
style contrapunctique est dominant. N’est-ce pas ce qui est suggéré par le
titre, explicité d’ailleurs par le compositeur ? Ces pièces difficiles
mais profondément expressives sont vraiment à découvrir.
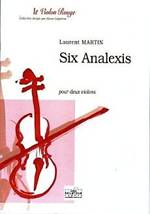
Otto-Albert
TICHY : Andante pour violon et
piano. Delatour : DLT2377.
L’auteur (1890-1973) est
un organiste chef de chœur et compositeur tchèque qui fut élève de Vincent
d’Indy à la Schola Cantorum. On découvrira avec
beaucoup d’intérêt et de plaisir cet Andante lyrique, expressif, d’une grande beauté d’un compositeur dont l’œuvre
importante et abondante est trop peu connue en France.

Armand
MERCK : Andante pour violon et
piano. Delatour : DLT2376.
Arnaud Merck (Liège 1883 – Meudon 1963) fut, comme Otto-Albert Tichy,
élève de Vincent d’Indy à la Schola Cantorum.
S’inscrivant dans la lignée post-franckiste, son œuvre, longtemps méprisée, a
cependant été soutenue par beaucoup, y compris Olivier Messiaen. Cet Andante ne manque certes pas de lyrisme
et de beauté harmonique, mais révèle aussi une véritable personnalité qu’on ne
saurait réduire à ses options esthétique. C’est donc une œuvre à découvrir et à
faire connaître.
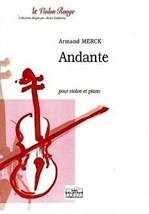
ALTO
Claude-Henry
JOUBERT : Quatre contes de Charles Perrault : 1 – Le petit chaperon
rouge, (première année) II – Les souhaits ridicules, (deuxième année) III – Le
Chat botté, (troisième année) IV – Cendrillon (quatrième année) librement
adaptés pour alto avec accompagnement de piano. Sempre più : SP0111, SP0112, SP0113 & SP0114.
Quel que soit le conte, il
est conseillé à chaque fois d’aller lire le texte original ne serait-ce que
pour voir quelle liberté l’auteur a pris avec tel ou tel récit, notamment pour
le Petit Chaperon Rouge où la liberté de l’auteur consiste à prendre la version
optimiste… qui n’est pas dans Perrault ! A part cela, ces pièces
pourraient constituer une très agréable suite pour une audition de classe,
puisqu’il y en a pour les quatre premiers niveaux. Le piano n’est pas un simple
accompagnateur mais a sa part dans le récit. Un récitant peut avantageusement
prendre sa place dans le concert… Bref, il y a plein d’idées… et de musique à
tirer de ces délicieuses pièces.

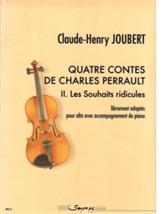
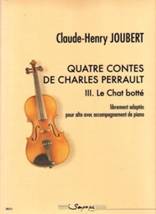

HAUTBOIS
Bruno
GINER : Trois silences déchirés (In
memoriam Pavel Haas). Hautbois seul. Dhalmann :
FD430.
Est-il utile de rappeler
que Pavel Haas est ce compositeur tchèque né à Brno en 1899 et mort gazé le 17
octobre 1944 à Auschwitz après avoir été déporté en 1941 au camp de Theresienstadt ? L’œuvre de Bruno Giner a pour point de départ la Suite pour
hautbois et piano op. 12. « Outre la similitude de construction, la
totalité du matériau de cette œuvre est issue de quelques formules mélodiques
ou harmoniques de la Suite. »
Que dire de plus de cette pièce en trois mouvements, expressive jusqu’au
paroxysme et profondément méditative.

G.
F. HAENDEL : Sarabande : suite
pour clavecin n° 11. Arrangement pour deux hautbois de Michel CHEBROU.
Premier cycle. Lafitan : P.L.2831.
C’est une excellente idée
que cette transcription faite avec un vrai souci de fidélité à l’original. On y
trouve bien entendu le thème et les deux variations. Bien sûr, on ne manquera
pas de faire entendre l’original aux deux interprètes : rien de mieux pour
leur culture musicale.

Francis
COITEUX : Promenade au bois pour
hautbois et piano. Deuxième cycle. Sempre più :
SP0096.
Il s’agit d’une promenade
variée commençant par un « allegretto rustico »
à 6/8, auquel succède un « scherzando spirito à
2/4 ; puis vient un retour au ternaire avec un « Grazioso
cantabile » pour terminer par un « allegretto giocoso » à 2/4
qui achève la promenade de façon tout à fait guillerette. Le piano est un vrai
partenaire pour cette mini-suite fort jolie et pleine de fraicheur. Il y a beaucoup
de plaisir en perspective pour les jeunes interprètes.

CLARINETTE
Francis
COITEUX : Escapade pour
clarinette en sib et piano. Facile. Delatour : DLT2324.
Cette première escapade
pour clarinettiste de premier cycle est pleine d’espièglerie : débutant
par un allegretto sautillant, elle se poursuit par un moderato cantabile où le
jeune clarinettiste pourra montrer ses qualités expressives. Un retour au tempo
primo qui se termine par un accelerando poco a poco lui permettra enfin de
faire montre de virtuosité. Cette pièce très agréable devrait beaucoup plaire.

SAXOPHONE
Jean-Michel
TROTOUX : La marche du chevalier pour
saxophone alto et piano. Débutant. Lafitan :
P.L.2740.
Joliment moyenâgeuse grâce à son utilisation du mode de ré transposé en fa, cette marche à la fois martiale et un peu mélancolique devrait faire le bonheur de ses jeunes interprètes d’autant plus que la partie de piano est abordable par un pianiste de petit niveau.

Claude-Henry JOUBERT : Pretty kettle. Blues pour quatuor de saxophones. 2ème cycle. Lafitan : P.L.2550.
Que dire sinon qu’on
retrouve dans cette jolie pièce tout le sens de l’humour, mais surtout de la
bonne musique et de l’harmonie délicate et riche de l’auteur. Il y aura
beaucoup de plaisir à monter cette pièce. Ajoutons cependant que le quatuor de
saxophone est composé d’un soprano, d’un alto, d’un ténor et d’un baryton.
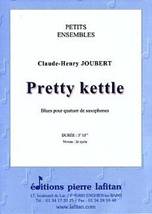
TROMPETTE
André
GUIGOU : Chevalier tempo pour
trompette ou cornet ou bugle et piano. Débutant. Lafitan :
P.L.2718.
Si ce chevalier ne manque
pas de tempo, il ne manque pas non plus de charme pour séduire sa belle… et les
interprètes et auditeurs de cette jolie pièce pleine d’entrain.

Claude-Henry
JOUBERT : Dans les bois… Thème
et variations pour trompette ou cornet ou bugle avec accompagnement de piano.
Préparatoire. Lafitan : P.L.2731.
Le thème commence comme le
« feu partout » de La vie
parisienne »… Nous ne savons si c’est volontaire ! Toujours
est-il que cette bien réjouissante invitation nous promène par des sous-bois
variés : fanfare, polka, slow, cha-cha-cha et marche se présentent tour à
tour de variation en variation. Ce sera certainement l’occasion pour le
professeur d’expliquer ces différents genres pas forcément connus de tous les
élèves ! Et grâce aux paroles proposées par l’auteur, on peut également
chanter le thème ! Que demander de plus ?

TROMBONE
Régis
BENOIST : Dans le parc pour
trombone et piano. Débutant. Lafitan : P.L.2737.
Le pianiste aura un rôle
important à jouer dans cette promenade où le trombone joue un rôle plutôt
placide. Des suites d’accords en harmonies parallèles accompagnent le tout, qui
n’est pas désagréable. Souhaitons bonne promenade aux deux interprètes !

Jean-Jacques
FLAMENT : Mouvance pour trombone
et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2699.
Mouvance dans les
mouvements, mouvance dans la succession des mesures, tout cela donne à cette
pièce un caractère de grande fluidité, sauf précisément dans le « Tempo di mercato » martial du centre de l’œuvre. Un
cantabile précède une cadence qui débouche sur une reprise du début et une
coda. Bref, il s’agit d’une œuvre pleine
d’intérêt et qui mettra en valeur toutes les facettes du talent des
interprètes.

COR
André
TELMAN : A fleur de peau pour
cor en mib et piano. Fin de 1er cycle. Lafitan : P.L. 2785.
Cette pièce pleine de
poésie nous emmène dans des paysages mélodiques et rythmiques variés qui ne
manquent pas de charme. La partie de piano n’est pas un simple accompagnement
mais prend une part importante dans le dialogue. Cette promenade « à fleur
de peau » devrait séduire ses futurs interprètes.
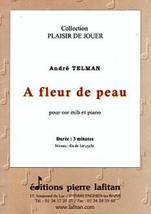
PERCUSSIONS
Jean-Luc
RIMEY-MEILLE : Le baiser. Théâtre
musical pour un percussionniste avec cymbales frappées. Version anglaise et
française. Difficile. Dhalmann : FD0370.
Cette courte saynète
mettra à contribution les qualités techniques et de dissociation de
l’interprète. Difficile à cause de cette pluralité d’éléments, cette œuvrette
est bien réjouissante et demandera également des qualités de mime et d’acteur
de la part de son seul exécutant. Nous ne défloreront pas ici l’intrigue qui se
noue entre les deux improbables personnages qui la composent.

Daniel
SAUVAGE : Samb’à Reims. Grand ensemble pour 13
percussions. Niveau moyen. Dhalmann : FD0426.
Cette samba pour treize
percussionnistes regroupe claviers de percussions, instruments traditionnels de
la samba et batterie. Pleine de fougue et de vie, elle s’inscrit bien dans le
cadre des flâneries musicales de Reims animées par Jean Fessard à qui cette pièce est dédicacée. Mais elle ne leur est pas réservée !

Daniel
SAUVAGE : Floria. Sextuor de percussions. Niveau moyen. Dhalmann : FD0365.
Sous-titrée « une
superbe piste de ski à Chamonix », et dédiée par l’auteur à sa monitrice
de ski (c’est ce que suggèrent à la fois la dédicace et le dessin qui figure
sur la couverture, cette pièce revigorante nous emmène à un tempo endiablé.
Tous les instruments – ou presque – de la percussion sont là, des vibraphones à
la batterie. Les six percussionnistes n’auront pas de quoi s’ennuyer.
Souhaitons-leur un parcours sans chute !

Régis FAMELART : Thapen I, II, III. Ensembles pour au moins deux claviers
de percussion et beaucoup plus. Niveau assez facile. Dhalmann :
FD0366.
Ces pièces écrites dans
l’esprit de la musique répétitive américaine ont été, nous dit l’auteur, créées en 2011 à Valbonne avec vingt-cinq claviers. Ajoutons
qu’en plus des nombreuses combinaisons possibles et souhaitables à l’intérieur
de chaque pièce, les trois versions peuvent être associées et jouées
simultanément. C’est dire le nombre de combinaisons offert par cette
œuvre ! Il y a là de quoi, mine de rien, faire faire un excellent travail
d’écoute comparative aux instrumentistes.

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Christine
MARTY-LEJON : Floréales pour quatuor à cordes (2 violons, alto
et violoncelle). Lemoine : 29145H.L.
Cette charmante pièce fera
certainement le bonheur d’un quatuor débutant (le quatuor, pas les
instrumentistes…). Trois parties s’enchainent avec le traditionnel majeur,
mineur, majeur. C’est de la très jolie musique écrite très classiquement mais
avec beaucoup d’esprit et de délicatesse. Que demander de mieux ?
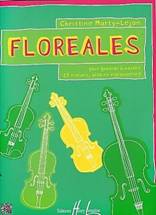
Jean-René
COMBES-DAMIENS : …Thébaïde pour
flûte en sol et récitant. Symétrie : ISMN 979-0-2318-0736-3.
Commande de la flûtiste Hélène Lazartigues à
qui l’œuvre est dédiée, cette pièce est présentée par le compositeur lui-même,
qui est également l’auteur du texte. Cette œuvre très méditative s’inscrit dans
la lignée d’Antoine Tisné et Henri Dutilleux, qui
furent pour l’auteur des « rencontres extraordinaires ». La pièce peut
être donnée sans récitant, mais ce serait vraiment dommage tant les 7 parties
qui la composent forment un tout difficilement dissociable.

David
LAMPEL : Sonate pour violon et
violoncelle. Delatour : DLT2375.
Ce dialogue entre deux
personnages, l’un féminin, le violon, l’autre masculin, le violoncelle n’est
pas sans évoquer, parait-il, les « scènes de la vie conjugale »
d’Ingmar Bergman. Il en a en tout cas la passion et la violence, avec
cependant, des moments plus paisibles. Un rappel (involontaire nous dit
l’auteur) du fameux thème de Tristan qui aboutît sur l’accord non moins fameux
constitue le thème de la deuxième partie de l’œuvre.

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
Francis
COITEUX : Mon ami piano. Concertino
pour piano et orchestre symphonique. Delatour :
DLT1921.
De difficulté moyenne,
cette partition met en œuvre un véritable orchestre symphonique au complet. La
durée de l’œuvre est d’environ quinze minutes. Trois mouvements s’enchainent,
comportant chacun une importante cadence pour le piano. Après un allegro
giocoso, un lento expressif comporte un développement « jazzy » avant
le retour du thème. Le tout débouche sur un ternaire joyeux. L’ensemble, fort
agréable, vise donc un orchestre de conservatoire d’un bon niveau. Le pianiste
devra peut-être être plus que moyen…

Dynam-Victor FUMET : Le Mystère de la Terre pour orchestre
symphonique. Delatour : DLT2198.
Rappelons simplement que
D.-V. Fumet (1867-1949) fut un remarquable organiste, en même temps qu’un
musicien et compositeur à la vie mouvementée. Les éditions Delatour continuent de nous proposer ces œuvres trop peu connues d’un musicien mystique.
Celle-ci commence par un largo et se continue par un allegro. Elle passe
successivement par des moments paroxystiques et des passages méditatifs. La filiation franckiste est certes présente,
mais le langage est profondément original et d’une grande beauté. Un
enregistrement a été fait en 2012 à Saint Pétersbourg en première mondiale disponible à http://www.hybridmusic.com/03_le_catalogue_03.php

Raphaël
FUMET : Symphonie de l’âme – SymphonialisAnimapour orchestre symphonique. Delatour : DLT2199.
Fils du précédent, Raphaël
Fumet (1898 – 1979) fut un compositeur tout à fait attachant loin des querelles
de chapelle. Son œuvre, originale, s’inscrit dans la continuité de celle de son
père. Celle-ci, écrite dans les années soixante, intègre, selon la philosophie
de l’auteur, tout un passé musical. Elle comporte deux parties : une partie
qu’on peut qualifier d’extatique, et une partie
fulgurante également d’une grande beauté. Un enregistrement se trouve sur le
même CD que Le mystère de la Terre : http://www.hybridmusic.com/03_le_catalogue_03.php L’œuvre peut être également écoutée sur You Tube.

ORCHESTRE
D’HARMONIE
Francis
COITEUX : Le castel animé pour
orchestre d’harmonie. Delatour : DLT1966.
De difficulté moyenne,
cette œuvre autobiographique relève de l’atmosphère du dessin animé. Encadrés
par une musique qui sert à la fois de générique de début et de fin, des
portraits ou des scènes vécues se succèdent, évoquant le château de la
Grand-Front d’Angoulême qui abrita la jeunesse de Francis Coiteux.
Cette musique bien réjouissante est abordable par des élèves de niveau moyen.

***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Philippe
CANGUILHEM (dir.) : Chanter sur le livre à la Renaissance. Les
traités de contrepoint de Vicente Lusitano. Turnhout, Brepols (www.brepols.com ), Collection Épitome musical, 2013, 410 p.
L’Agence Nationale
de la Recherche a soutenu le projet de recherche FABRICA, ayant permis à
l’Université de Toulouse-Le Mirail de réunir étudiants, musiciens et
musicologues français et italien autour de la traduction des Traités de Vicente Lusitano,
peu connus des historiens de la musique, ainsi que de leur réédition. Dans le
cadre de son Séminaire, Philippe Canguilhem s’est donc penché sur la pratique
du contrepoint et du chant à la Renaissance. Il en retrace d’abord la genèse,
faisant la distinction entre la musique composée et la musique improvisée.
Déjà, en 1412, Prosdocimo de Beldomando soulignait deux sortes de contrepoints : vocal (celui qui est prononcé) et
écrit (celui qui est noté). Cette magistrale étude traite donc les problèmes de
création musicale écrite ou improvisée. Dans son Lexique (1475), Johannes Tinctoris (v.
1435-1511) avait lancé les notions : cantare super librum, res facta ou cantus compositus(réalisation écrite).
Quant à G. Zarlino, dans ses Istitutioni harmoniche (1558), il s’était tout particulièrement
intéressé à l’art du contrepoint. Le problème est complexe, car les écrits de Lusitano se réclament d’une tradition d’enseignement
musical pratique : plain chant, musique figurée et contrepoint. Au XVIe
siècle, leur est adjoint la composition, discipline prévue à la fin des
ouvrages. Transcrits, traduits et édités respectivement par Philippe Canguilhem
et son équipe ainsi que par Véronique Lafargue, les écrits de Lusitano abordent le cantus firmus, y compris la
main musicale (cf. première de
couverture), la solmisation, les muances) ; le chant figuré (rythmé selon
les principes de la musique mesurée) ; le contrepoint simple (à deux
voix) ; le contrepoint concertant (à 3 voix), d’après un plain chant et
les règles pour réaliser des canons ; ensuite l’écriture des cadences de 3
à 6 voix, autrement dit la progression pédagogique et le solfège avec des
exercices en usage. Les Traités Dell’arte
de contrapuntoet Introdutione facilissima (Rome, 1553) de Vicente Lusitano bénéficient de judicieux commentaires, et sont
assortis de nombreux exemples musicaux (en notation moderne) permettant de comprendre la théorie, les règles du contrepoint, la méthode didactique de
la main musicale guidonienne (sur laquelle sont disposées les syllabes de
solmisation) et, d’une manière générale, l’enseignement musical à l’époque
humaniste et renaissante autour de la science du contrepoint chanté, du
contrepoint concertant, des fugues, du contrepoint sur un chant donné et,
finalement, des techniques de composition (compostura). Une très abondante Bibliographie sur plus de quatre siècles
force l’admiration. Grâce à Philippe Canguilhem et à son équipe, les historiens
de la philologie musicale et les mélomanes curieux pourront situer Vicente Lusitano dans son environnement théorique et
compositionnel ; enfin, les chanteurs seront mieux informés au sujet de
l’improvisation polyphonique à son époque. Cette publication fait honneur au
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Tours).

Édith
Weber.
Anne
PIÉJUS : Musique
et dévotion à Rome à la fin de la Renaissance. Les Laudes à l’Oratoire. Turnhout,
BREPOLS (www.brepols.com ), Collection Épitome musical, 2013, 549 p.
Lors d’un séjour en
Italie, Anne Piéjus a pu, avec le concours du
CNRS-INSHS, réaliser un projet de l’Académie de France à Rome, s’inscrivant
dans le cadre de l’histoire musicale et religieuse posttridentine,
à l’époque de la Contre-Réforme. Elle a
minutieusement exploité les fonds de bibliothèques (Rome, Bologne) et
d’Archives et, tout particulièrement, ceux de l’Archivio della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri qui, en 1575, a lancé la laude polyphonique destinée à susciter la dévotion, l’émotion, le plaisir musical, la
joie… lors des assemblées spirituelles dans une langue accessible à tous. Le
corpus des laudes oratoriennes
comprend dix livres publiés entre 1563 et 1600, dont deux volumes à
l’initiative de Giovanni Giovenale Ancina (1545-1604), avec des Laudes et des Canzonettes spirituelles. Comme les textes poétiques, la forme musicale bénéficiera de
l’essor de l’imprimerie qui leur assurera une large diffusion, tout en
contribuant à l’érudition et à la propagation de la doctrine chrétienne. Quant
aux laudes florentines, elles ont été
rassemblées par le dominicain Razzi. Vers 1610, la laude sera
supplantée par le madrigal dramatique.
Après avoir replacé
ces chants spirituels dans leur contexte historique, Anne Piéjus — tout en tenant compte du dernier état de la question — retrace l’évolution de
ce répertoire en langue vernaculaire, dans la mouvance de la Réforme
catholique, sans négliger l’héritage. Elle insiste sur la finalité pédagogique
par le chant, évoque les laudes florentines à Rome (à côté des laudes romaines)
et aborde le problème de la tradition orale, puis son affranchissement.
Giovanni Animuccia (v.1500-1571) est à la fois
« héritier » et « fondateur ». Les lecteurs trouveront de
précieux renseignements sur les éditions, les scriptoria, la tendance à la
parodie et les problèmes d’identité musicale. Pour sa problématique, la
deuxième partie tient en un seul objectif : « Reconquérir les âmes »
par les publications, les éditions et l’usage du « livre de
musique », par la stratégie pastorale voire sociale, afin d’atteindre le
stade de la dévotion et de l’élévation. L’esthétique doit donc reposer sur la
simplicité et l’humilité, également sur l’intelligibilité du style. La
troisième partie a pour comme dénominateur commun : « Méditer la
parole ». L’auteur envisage la « prédication entre lecture et
improvisation » ; la langue et la destination des homélies ; en
conclusion, laude et sermon représentent
« une complémentarité formelle » et la laude se situe « entre louange et
célébration ». Le dernier chapitre est titré : Musique et méditation dans le cadre des exercices spirituels ayant
pour finalité la dévotion, l’émotion, l’édification représentant, en fait, le
fil conducteur.
Cette monumentale
étude est menée à partir de sources solides, accompagnées d’une abondante Bibliographie circonstanciée et
d’exemples musicaux (en notation mesurée blanche ou en transcription moderne),
ainsi que de nombreuses citations d’époque, de pages de titres et de Figures significatives permettant de
visualiser le cadre, l’expression et les états d’âme des protagonistes.
Véritable somme : le livre ne laissera pas indifférents les musicologues,
historiens de la musique, des sensibilités et mentalités religieuses.

Édith
Weber.
Mondher AYARI, Antonio LAI (dir.) : Les corpus de
l’oralité. Sampzon, DELATOUR France (www.editions-delatour.com ), Collection Culture et cognition
musicales, 2014, DLT2388, 338 p. – 35 €.
D’entrée de jeu,
Michel Imberty, philosophe, psychologue et
musicologue, spécialiste des processus cognitifs, rappelle que « la
plupart des grandes cultures musicales ne sont pas de tradition écrite ».
Le texte écrit dans le Traité de Boèce ne permet pas aux musicologues de
reconstituer le texte de la musique ; par ailleurs, plus proches de nous, Simka Arom, spécialiste des
musiques d’Afrique Centrale, soulève la problématique de la « fixation par
l’écrit d’un répertoire complètement oral et transmis de génération en
génération ». L’objectif de cette publication collective vise à une
redéfinition de l’oralité — compte-tenu des données contemporaines de la
musicologie et de l’ethnomusicologie sous l’angle de la transmission orale des
répertoires non écrits — et des rapports entre improvisation et tradition
d’interprétation ; sans oublier le concept de narrativité ou
proto-narrativité (J.-J. Nattiez). Après la définition d’une « œuvre
musicale orale », difficile à cerner, celle-ci est replacée dans son
contexte historique et social. En Occident, elle apparaît comme un art
autonome. Les ethnomusicologues seront intéressés par les contributions portant
sur l’Asie, la Turquie ainsi que la Tunisie, la Croatie et la
Bosnie-Herzégovine. Les hymnologues apprécieront à
leur juste valeur les articles circonstanciés de Jacques Viret sur le chant
grégorien et son interprétation de nos jours, en réaction contre les tendances
et traditions marquées par les théories de Dom Moquereau et Dom Cardine en liaison avec le Motu
Proprio de Pie X (1903). Marcel Pérès, en connaissance de cause, aborde le
chant vieux-romain. Daniel Poisblaud — dans la
perspective de la restauration du chant grégorien — traite la question
primordiale : « Comment imaginer les sons à partir de
l’écrit ? » Les théoriciens seront sensibles aux critères d’approche
analytique des musiques d’Orient selon Jean-Claude Chabrier, à l’analyse de la
monodie modale… Les interprètes seront renseignés sur la créativité dans un
village sarde ou encore sur le violon arabe. Enfin, les spécialistes des
sciences cognitives trouveront leur compte dans l’extraordinaire diversité et
la complexité des corpus de l’oralité révélées dans toute leur ampleur
jusqu’ici insoupçonnée. À suivre.

Édith Weber.
Françoise ZAMOUR (dir.) : La musique au
risque des images. Sampzon, DELATOUR
FRANCE (www.editions-delatour.com ), Collection Filigrane, 2014, DLT2405,
223 p. – 23 €.
La notion
d’« image » regroupe aussi bien les enluminures, les caricatures que
la sculpture, les représentations de musiciens (guitariste, pianistes,
violoncelliste, homme-orchestre) que la dramaturgie, le cinéma, le jazz. Les
exemples examinés se situent aux XIIIe-XIVe siècles, au XIXe siècle et à
l’époque contemporaine. Autrement dit, sous un titre surprenant au premier
abord, 13 auteurs faisant appel à des documents significatifs, étudient
systématiquement — à partir d’un flirt entre image et musique — ce que
« l’image nous apprend de la musique ». Au départ, leur démarche
repose sur une gageure, « un risque » ; en fait, cette
problématique assez récente de la représentation relève de la
« transdisciplinarité » à la mode, après la pluridisciplinarité.
Au cours de deux
Colloques internationaux ayant pour dénominateur commun la relation entre image
et musique sous toutes ses facettes, de nombreux paramètres ont été agités
: formes de « captation », de présentation de la musique, du jazz par
le cinéma. Ce numéro 2 de la Collection Filigrane, avec son quadruple
objectif : « Musique-Esthétique-Science-Société » révèle
l’esprit d’ouverture des Éditions Delatour France et
de l’École Normale Supérieure. Il intéressera, à plus d’un titre, les
musicologues, ethnomusicologues, littéraires et dramaturges, ainsi que les
fervents de jazz et de cinéma. En fonction de ses centres d’intérêt, chaque
lecteur y trouvera de quoi réfléchir et satisfaire sa curiosité intellectuelle
et artistique. Pour l’œil et pour l’oreille, le « risque des images »
en vaut largement la peine.

Édith Weber.
Jean-Yves
HAMELINE : Leçons
de ténèbres. Ambronay, Ambronay Éditions. Distribution Symétrie (www.symetrie.com ), 2014, 269 p. – 35 €.
Le regretté
Jean-Yves Hameline — faisant encore bénéficier les hymnologues de sa très vaste culture historique,
théologique et musicale et exploitant son importante Bibliothèque personnelle —
s’adresse aux musiciens d’Église, chanteurs et instrumentistes soucieux
d’interpréter en connaissance de cause les Leçons
de Ténèbres (Lamentations de Jérémie)
exploitées par de nombreux compositeurs. Ces Leçons représentent un monument d’émotion toujours vivement
ressentie, et atteignent un sommet d’expressivité dans la mouvance dite
baroque. Leur interprétation pose de nombreux problèmes d’authenticité afin de
restituer l’esprit de ce grand moment de la liturgie catholique de la Semaine
Sainte. Comme il se doit, retournant aux sources (ad fontes), l’auteur se penche sur la prosodie latine en usage dans
la catholicité française sous l’Ancien Régime, la structure prosodique, la
rhétorique, c’est-à-dire l’actio dicendi ou pronuntiatio. La
valeur inestimable de cet ouvrage très circonstancié réside dans la
quantité et la qualité des documents
exploités concernant le Carême, le déroulement et les cérémonies de la Semaine
Sainte, les gestes et usages traditionnels : bref les offices… L’auteur
commente brièvement les textes pour les rendre sensibles aux lecteurs du XXIe
siècle soucieux de respecter le calendrier traditionnel des cérémonies dans les
diverses Églises et institutions parisiennes. Le chapitre 3 est plus
particulièrement dévolu à l’Office des
Ténèbres se déroulant selon le Messel (sic) & Bréviaire romain, avec toutes les
formules du chant alterné entre les clercs (clerici) et le chœur (chorus). Une présentation du livre
vétérotestamentaire des Lamentations de
Jérémie est suivie de définition des notions : Tonus Lamentationum, Tono lugubri et, finalement, Actio canendi, dans
l’environnement de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) et François
Couperin (1668-1733) ; de critères d’interprétation : récitatif — y
compris sa révision en 1684 par Guillaume Gabriel Nivers (v. 1632-1714) —, lecture, psalmodie, conduite mélodique spécifique. À la Contre-Réforme, dans la mouvance post-tridentine, d’un jour
à l’autre au cours de la Semaine Sainte, l’atmosphère et l’expressivité se
modifient progressivement. Les Parisiens d’antan, les visiteurs étrangers
(Chapelle Royale, Notre-Dame, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Victor, Saint-Germain-l’Auxerrois…) comme les fidèles du XXIe
siècle seront profondément impressionnés par le goût du chant liturgique à la
fin du XVIIe siècle et en tout cas remarquablement informés (Lexique sans rétropolation ni extrapolation). Quant aux interprètes, ils trouveront — dans ce maître-livre
abondamment illustré (pages de titre, notations musicales, Tableaux
synoptiques…) — des conseils indispensables pour garantir l’authenticité du
chant des Lamentations d’après le
texte latin de la Vulgate publiée à
Rome en 1592, sous le Pape Clément VIII. Grâce à Jean-Yves Hameline qui avait patiemment exploité son incomparable fonds de Recueils d’époque, les hymnologues, chantres, officiants et historiens des
mentalités et sensibilités religieuses en France, comblés, comprendront mieux
la portée des Leçons de Ténèbres.

Édith
Weber.
Daniel Barenboim : La musique est un
tout. Éditions Fayard, 2014, 1 vol, 173 p., 15 €.
Comme dans ses précédents ouvrages, Parallèles et paradoxes et La Musique éveille le temps, Daniel Barenboim s'attache dans le présent livre à défendre une
thèse, laquelle est accompagnée de digressions sur la musique et son interprétation.
Partant du constat que « la musique est infiniment plus grande et plus riche
que ce que notre société veut qu'elle soit » et qu'elle « est une partie
essentielle de la dimension physique de l'esprit humain », le pianiste-chef
d'orchestre précise sa pensée sur ses engagements esthétiques et éthiques. Loin
de la soif de spécialisation qui conditionne notre société, l'appréhension de
la musique ne peut se faire que dans un tout. L'éthique a sa place en musique
comme dans d'autres domaines, car l'interprète a l'obligation morale « de
recréer l'œuvre avec sincérité et dévouement, et non pas d'exprimer sa propre
personnalité ». De là procède la question de l'authenticité en matière
musicale, ou « savoir exclure soigneusement tout ce qui est superflu, inapproprié,
complaisant ou manipulateur ». Se référant à Einstein, pour qui le savoir
est le fondement de tout progrès humain, il estime que la connaissance n'est
nullement un frein à la spontanéité, mais au contraire permet la fantaisie et
l'imagination. Plusieurs interventions publiques lui permettent d'affirmer ses
convictions, que ce soit lors de l'attribution du prix Willy Brandt, du
discours d'ouverture du festival de Salzbourg, d'interviews avec un journaliste
lors de la présentation de spectacles de La Scala, ou encore à l'occasion d'un
vibrant hommage rendu à Dietrich Fischer-Dieskau, dont il fut un des
accompagnateurs choisis. Du fait de sa double
nationalité, son interprétation du conflit qui déchire le Proche Orient, et qui
est, selon lui, d'abord humain, apparaît essentielle. L'exigence première est
de se demander qui fera les pas décisifs pour le résoudre, car « il est temps
de cesser à jouer à qui est le plus gravement victime ». Voilà un livre qui
apporte une nouvelle pierre à l'édifice patiemment construit par ce musicien
protée, homme de son temps, apôtre de la paix.

Jean-Pierre Robert.
Hector
BERLIOZ. Critique musicale (7e Volume.
1849-1851). 1 Vol. Éditions Symétrie. Société Française de Musicologie,
2013, 713 p, 55 €.
Véritable leçon de critique musicale, ce
septième volume d’Hector Berlioz (sur les dix prévus par la SFM) relate la vie
musicale entre 1849 et 1851. Cinquante neuf articles publiés et toujours la
même sûreté de jugement, la même facilité d’écriture, le même humour qui ne peuvent
laisser le critique musical (obligé de rendre compte aussi vite que possible de
ce qu’il ne connait parfois qu’à peine…) que béat d’admiration devant tant de
talent ! Vingt cinq créations d’opéra, de nombreuses reprises d’ouvrages
lyriques dont Berlioz fera la recension minutieuse comprenant toujours un
résumé, une analyse de la partition, et un jugement des intervenants, sans
oublier une pincée d’états d’âme, un zeste d’anecdotes et une fluidité
d’écriture, guidée par l’imagination pour éviter toute monotonie ! Voilà
pour la recette ! Mais cet ouvrage se veut aussi un document historique
sur la situation musicale et économique désastreuse des années ayant suivi la
révolution de 1848. Enthousiasme et lassitude sous-tendent cet ouvrage. Enthousiasme
pour la création du Prophète de
Meyerbeer le 16 avril 1849 et la prestation vocale de Pauline Viardot, enthousiasme devant le respect, enfin retrouvé,
des partitions originales de Beethoven, enthousiasme pour la qualité musicale
de la Société des concerts qui défendra son œuvre, enthousiasme présidant à la
création de la Grande Société Philharmonique qu’il dirigera pendant deux
saisons, avant qu’elle ne disparaisse par manque d’organisation, enthousiasme
accompagnant le départ pour l’Exposition universelle de Londres en 1851 où, en
tant que juré, il manifestera son admiration pour les inventions des facteurs
d’instruments et notamment pour le saxophone qui l’émeut profondément. Mais
aussi, lassitude politique et conjugale, teintée de désillusion devant l’échec
de la Damnation de Faust, créée en
1846, lassitude et affliction devant la disparition de Chopin, Johann Strauss
et Spontini. Un livre remarquablement conçu avec un sommaire des articles très
pratique, en forme de résumés. Un ouvrage passionnant en même temps qu’une
leçon d’humilité pour tous les musicographes ! Une fois n’est pas
coutume !
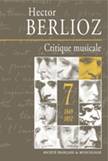
Patrice Imbaud.
Makis
SOLOMOS. De la
musique au son. L’émergence du son dans la musique des XXe et XXI e siècles. Collection
« AEsthetica » 1 Vol Presses Universitaires de Rennes, 2013, 547 p, 24 €. www.pur-editions.fr.
Le son est omniprésent dans la vie des
hommes. L’enregistrement en se substituant à la mémoire a permis l’émergence
d’une culture audio nouvelle, centrée sur le son et l’écoute, dans des domaines
différents, comme la pratique fonctionnelle (musique d’ambiance par exemple) ou
artistique. Quels rapports existent-ils entre son et musique ? Dans
certaines musiques le son reste une matière inerte qu’animent mélodie,
harmonie, rythme ou instrumentation. Dans d’autres, comme la musique
contemporaine, il existe un recentrement sur le son, expliquant notamment
l’important travail sur le timbre. Tel est le sujet de ce livre, monter que le
son s’est hissé en problématique centrale de la musique des XXe et XXIe siècle
et constater que nous sommes passés d’une culture musicale basée sur le ton à
une culture du son, pensé non comme réduction, mais bien comme émergence.
Émergence du son dont ce livre retrace l’histoire, non pas de façon linéaire,
mais plutôt de façon plurifactorielle intégrant les notions de timbre, de
couleur, de bruit, d’espace…d’où en définitive plusieurs histoires. La
première, celle du timbre, défini comme qualité du son, constate la tendance
actuelle à substituer le timbre à la hauteur et à prolonger l’harmonie dans le
timbre. La seconde remarque l’acceptation progressive du bruit par la musique.
La troisième, découlant de la précédente, traite de l’écoute nouvelle et du
silence. La quatrième s’intéresse à l’immersion sonore, ou vie intérieure du
son. La cinquième évoque le son comme entité composable. Enfin, la dernière
histoire développe l’hypothèse de l’espace-son, spatialisation du son,
architecture sonore et écologie du son. Un livre captivant qui reprend les
fondamentaux, montrent leur évolution et concrétise de nombreuses années de
réflexion sur ce qui fait, aujourd’hui, le cœur de la musique contemporaine.
L’importante documentation et l’argumentaire s’appuient, ici, sur l’étude
d’œuvres musicales nombreuses et variées, connues ou moins connues témoignant
d’une érudition certaine. Conçu comme un voyage véritablement initiatique à
travers la musique de notre temps, de la musique tonale à la musique « sonale », il s’agit là d’un ouvrage remarquable,
absolument indispensable à tous les amateurs de musique, contemporaine ou non.

Patrice Imbaud.
Simon STEEN-ANDERSEN. Musique transitive. 1 Vol bilingue
Français-Anglais. Ensemble 2e2m. Collection « A la ligne ». 2014, 171p, 10€.
Un livre qui permettra à l’amateur de
musique contemporaine de poursuivre plus avant une réflexion déjà entamée
depuis l’époque où se fit le passage de la musique tonale à la musique « sonale », y adjoignant aujourd’hui la composante
visuelle. Musique transitive, musique qui met en relation le sonore et le visuel. Dans une approche performative, Simon Steen-Andersen,
compositeur danois, maîtrise tous les possibles du sonore, compositions, performances et sound art.
Trois dimensions qui décrivent une musique en action dont l’énergie constitue
la force transitive. Il définit lui-même son projet : « Au lieu d’avoir une
musique et quelque chose en plus, je fais une musique qui peut aussi être
visuelle… Ainsi en amplifiant ce qui est silencieux, nous prenons conscience que ce qui est en train d’être joué n’est pas
que de la musique pure, mais plutôt une situation et des actions dont le
résultat est la musique ». Simon Steen-Andersen, né en 1976, est en résidence
de l’Ensemble 2e2m pour l’année 2014, son catalogue compte une cinquantaine
d’œuvres. Nombre de ses œuvres démonstratives sont ici commentées par
différents musicologues internationaux s’intéressant spécifiquement au rapport
interactif entre visuel et sonore A défaut d’être totalement convaincant, un
livre qui a le mérite d’informer et de faire réfléchir. Un jeune compositeur à
l’imagination débordante qu’il faut absolument découvrir…

Patrice Imbaud.
Pascal BOUTELDJA. Un patient nommé Wagner. 1 Vol Symétrie, 2014, 314 p,
40 €.
Un livre dont le titre accrocheur ne
manquera pas d’attirer le regard du wagnérien passionné à la recherche de la
dernière nouveauté publiée dans l’immense corpus déjà existant, consacré au
maître de Bayreuth. De nouveauté, avouons le, il n’y en a guère dans cet
ouvrage se présentant comme la première biographie médicale dédiée à Richard
Wagner, basée sur l’étude rétrospective, donc contestable, d’écrits
autobiographiques ou d’échanges épistolaires. Un livre qui se compose de trois
parties principales : le malade, l’homme et le patient. Dans la première
partie, l’auteur précise la symptomatologie présentée par l’illustre patient.
Un ensemble de manifestations, pour l’essentiel d’ordre nerveux ou digestif,
d’allure psychosomatique, majorées par la survenue épisodique de difficultés
matérielles et par le fréquent doute du musicien quant à son avenir de
créateur. L’aggravation de l’état de santé de Richard Wagner ne surviendra qu’à
partir de 1881, date de la majoration des troubles cardiaques à type d’angor
(insuffisance coronarienne) qui le conduiront à la mort le 13 février 1883.
Mort par infarctus compliqué de rupture myocardique, favorisée ou non par une
altercation violente, le matin même, avec Cosima, à propos d’une supposée liaison
avec la chanteuse Carrie Pringle ? La seconde
partie s’attache à la description physique et psychologique de Wagner. L’homme
est de petite taille, mince, souple, ayant une voix de ténor parfois difficile
à maîtriser, s’adonnant volontiers à la marche. Son physique est dysharmonieux avec une tête exagérément grosse, le visage
régulier entouré d’une barbe à la boer, le front large, les lèvres minces, les
cheveux bruns portés assez long, les yeux bleus légèrement asymétriques. Son
caractère est hyperactif, cabotin, en représentation permanente, imbu de sa
personne, colérique, d’humeur labile, séducteur et charmeur, parfois généreux
et joyeux, mais toujours d’un charisme imposant. Hétérosexuel, sa personnalité
est ambiguë certes, mais non psychiatrique avec une empreinte féminine (anima)
assez marquée expliquant son goût pour les étoffes raffinées et soyeuses ! La
troisième partie traite des rapports du compositeur et de la médecine. Wagner
s’y révèle un patient rebelle, peu compliant aux
différents traitements, se soignant de façon souvent excessive, souhaitant que
l’on s’intéressât plus à sa personne qu’à ses symptômes. Ses conceptions
médicales, comme celles de ses médecins d’ailleurs (ce qui est plus
grave !) prêtent à sourire…Tous les médecins consultés ignorèrent le
diagnostic d’insuffisance coronarienne, pourtant évident devant une
symptomatologie assez typique !! Mais nous sommes au XIX e siècle, la
physiologie, la microbiologie et la thérapeutique sont encore balbutiantes…La
première description complète de l’angor date pourtant de 1768 (William
Heberden) et le traitement par la Trinitrine commençait seulement à être connu…
Sans regret, retenons toutefois avec l’auteur que « le vieil
enchanteur », contrairement à Mozart, Schubert, ou Wolf, eut le temps
d’achever son Œuvre qui représente, sans nul doute, sa part
d’immortalité ! Dans la dernière partie, curieusement plus passionnante,
intitulée Annexes, le docteur Pascal Bouteldja évoque et discute de façon pertinente certains
aspects médicaux particuliers, comme l’hydrothérapie dont Wagner était un
fervent adepte, les lésions cutanées, les troubles cardiaques, les
manifestations oculaires et les céphalées dont le compositeur souffrit toute sa
vie… Un livre de lecture facile et agréable qui évite en permanence de sombrer
dans la spécialisation musicologique ou médicale, mais qui, de ce fait,
présente le défaut des ses qualités, peinant à satisfaire un public exigeant
déjà largement informé par les nombreuses publications antérieures consacrée au
maître de Wahnfried. La preuve qu’une thèse originale de doctorat en médecine ne fait pas
forcément un grand livre, et ce d’autant qu’aucun de ces petits maux, somme
toute bénins, n’entrava jamais, à l’inverse de la surdité de Beethoven par
exemple, l’activité créatrice de Richard Wagner… Souhaitons lui, malgré tout,
de trouver un large public car c’est finalement à celui-ci que cet ouvrage
s’adresse.

Patrice Imbaud.
***
CDs et DVDs
Johann Sebastian BACH : Kantaten zu Passion BWV 22, 23, 182. Thomanerchor Leipzig. Gewandhaus Orchester,
dir. Georg Christoph Biller. 1CD RONDEAU
PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP
4044. TT : 70’ 14.
Le Label leipzicois RONDEAU PRODUCTION poursuit sa Série très
appréciée : L’année liturgique avec
J. S. Bach, et consacre, au temps liturgique de la Passion, le n°4/10
(enregistré sur le vif en 2014). Toujours interprétées par le Thomanerchor de Leipzig et le Gewandhaus Orchester, sous la direction du Thomaskantor Georg Christoph Biller — dont la réputation n’est plus à faire —, les 3
Cantates sont précédées d’une hymne relative à la Passion du Christ et extraite
du Florilegium selectissimorumqu’interprète
l’Ensemble Florilegium. Les discophiles apprécieront
tout d’abord la Cantate BWV 22 : Jesus nahm zu sich die Zwölfe(Jésus
prit avec lui les Douze) pour le Dimanche Esto mihi, créée à Leipzig, le 7 février 1723
et reprise en 1724, interprétée et dirigée par J. S. Bach (avant la
prédication) : il s’agissait de son morceau probatoire (Probestück) pour
obtenir le cantorat après la mort de Johann Kuhnau (1722). Le récit repose sur l’Évangile de Luc. Tripartite, l’œuvre se termine par
le Choral Ertöt uns durch dein Güte(1524) d’Elisabeth Creutziger, d’après une mélodie profane, avec une note
d’espoir. La cantate BWV 23 : Du wahrer Gott und Davids Sohn(Toi, vrai Dieu et fils de David), pour
le même dimanche, a peut-être été interprétée (après la prédication), le même
dimanche que la précédente. Elle ne comporte pas de Sinfonia introductive ; Bach
fait appel à des figuralismes et à un canon à 3 voix pour le Choral bien
connu Christe, du Lamm Gottes correspondant à l’Agnus Dei (1528).La cantate BWV 182 : Himmelskönig, sei willkommen(Roi du ciel, sois le bienvenu), pour le
Dimanche des Rameaux, évoque l’entrée de Jésus à Jérusalem. D’abord entendue à
Weimar en 1714, puis à Leipzig en 1724, elle commence par une sonate
instrumentale qui introduit le chœur éponyme, suivi de plusieurs récitatifs et
airs, aboutissant au Choral Jesu, deine Passion sur la mélodie de Melchior Vulpius, aux accents douloureux, mettant en valeur la flûte
à bec et le violon ; parallèlement à la sonata, le chœur conclusif, avec
l’ensemble des instruments, insiste sur le mot Leiden (souffrance). Les voix des garçons, toujours en mouvement, s’imposent par leur
discipline et leur élan, les entrées successives bien marquées, les oppositions
de nuances. Excellente contribution leipzicoise aux
Cantates de l’année liturgique pour le temps de la Passion.

Édith Weber.
J. S. BACH : Trinitatis. Kantaten BWV 75, 194.Das Kirchenjahr mit J. S. Bach 8/10. e Thomanerchor, Leipzig. Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, dir. Georg Christoph Biller. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP
4036. TT : 78’ 47.
Dans le cadre de sa
Série de Cantates : « L’Année liturgique avec Jean Sébastien
Bach », le Cantor de St-Thomas, Georg Christoph Biller, consacre le Volume 8 au temps de la Trinité, avec
deux Cantates : Die Elenden sollen essen(BWV 75) et Höchsterwünschtes Freudenfest(BWV
194), précédées respectivement de l’Hymnus de Sancta Trinitate et O lux beata Trinitas extraites du Florilegium selectissimorum Hymnorum (interprétées par l’Ensemble Florilegium). Destinée
au 1er Dimanche après la Trinité, la Cantate 75 a été créée le 30 mai 1723 —
Bach venait d’arriver à Leipzig. Elle se compose de deux parties chantées
respectivement avant et après la prédication. L’Évangile du jour concernait la
parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare (Luc, 16, 19-31). L’incipit, emprunté au Psaume 22 : Les pauvres mangeront et seront rassasiés,
fait l’objet d’un grand chœur initial très développé, comme un prélude suivi
d’une fugue, après lequels alternent des Récitatifs
(Basse, Ténor). Rehaussé par la sonorité des hautbois, le Choral conclusif est
bien connu : Was Gott tut, das ist wohlgetan (Ce que Dieu fait [cela] est bien
fait), d’après la mélodie de Severus Gastorius et sur le texte (1676) de Samuel Rodigast. La seconde partie, introduite par une Sinfonia jubilatoire aux accents éclatants des trompettes, fait alterner Récitatifs et Airs, et se termine par la dernière strophe du même choral. La
Cantate 194, composée pour la dédicace de l’Orgue Hildebrandt à Störmthal et créée le 2 novembre 1723, réutilisée pour le
Dimanche de la Trinité, le 4 juin 1724, comporte également deux parties. Le
chœur d’introduction, de caractère festif, est très développé ; les Récitatifs et Airs laudatifs sont suivi du Choral
se présentant comme une invocation au Saint-Esprit. La seconde partie baigne
encore dans la joie, et le Choral conclusif est emprunté à Paul Gerhard : Wach auf, mein Herz und singe d’après une mélodie anonyme. Ces deux Cantates sont interprétées avec
les qualités qu’on leur connaît par le Thomanerchor,
des solistes et l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig.
Voici un intéressant apport au temps liturgique de la Trinité.

Édith Weber.
Johann Sebastian BACH : Kantaten zu OsternBWV 4, 31,
67. u Chœur de Saint Thomas, Leipzig. Gewandhausorchester Leipzig, dir. Georg
Christoph Biller. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP 4045. TT : 76’ 15.
Le 5e volume de la
Série L’année liturgique avec J. S. Bach,
à l’initiative du Cantor Georg Christoph Biller — à la tête du Chœur de Saint
Thomas et de l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig —
est consacré aux Cantates pour Pâques nos 4, 31 et 67. Ce volume met aussi en
valeur les talents compositionnels du Cantor actuel, avec son œuvre
intitulée : St-Thomas Ostermusik (Musique
de Pâques à St-Thomas). Une introduction à l’orgue s’élève des profondeurs,
puis un chœur puissant : Der schöne Ostertag (plage 10) évoque la joie de la Résurrection,
d’après l’adaptation (1983) de Jürgen Henkys, ponctué
par un jeu de cloches avec des broderies sur l’incipit du cantus firmus. Le
récitatif de ténor (pl. 11) reprend les versets 1 à 7 du chapitre 28 de
l’Évangile de Matthieu, suivi du Choral Christ ist erstanden entonné
par le Baryton avec réplique du chœur se terminant sur Kyrieleis (pl. 12). Le Récitatif
de Ténor (pl. 13) avec Chœur résume l’action : Sie gingen eilend zum Grabe hinaus (ils se précipitèrent au tombeau) ; le Christ, venu à leur rencontre, leur dit : « Ne craignez pas ;
allez dire à mes frères de se rendre en Galilée ; c’est là qu’ils me
verront. » Ensuite, le chœur entonne le Choral (2011) de Matthias Storck : Gott ist mir auferstanden(Dieu est ressuscité pour moi) (pl. 14).
Le Récitatif (pl. 15) poursuit le récit signalant que les onze disciples ont vu
Jésus qui leur dit : « Tout pouvoir m’a été donné… Faites de toutes
les nations des disciples… enseignez-leur à observer mes préceptes…. ». Le
chœur conclusif (pl. 16) repose sur une adaptation d’un texte du XIVe siècle : Christus hat keine Hände, nur unsere Hände… (Le
Christ compte sur nos mains, nos lèvres, notre aide…) et se termine sur une
note de louange : Halleluia, Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Kyrieleis. Cette œuvre, d’esthétique délibérément de
notre temps, avec dissonances à bon escient, revalorisation de l’unisson, de
l’aigu et une palette vocale très développée, a largement bénéficié de la vaste
expérience chorale de G. Chr. Biller. Tradition et modernité s’y côtoient.
Chaque Cantate de
J. S. Bach est associée à une Hymne (interprétée par l’Ensemble Florilegium), extraite du Florilegium selectissimorum hymnorum d’Erhard Bodenschatz, en liaison avec l’œuvre. La
Cantate 4 : Christ lag in Todesbanden(Christ gisait dans les liens de la mort)
est précédée de l’Hymne Vita sanctorumchantée au début du culte à Saint-Thomas et à
Saint-Nicolas lors de fêtes solennelles. L’œuvre, l’une des plus anciennes du
corpus, a été créée vraisemblablement à Mulhouse en 1707 ou 1708, et reprise à
Leipzig le 3 avril 1725. Cette Cantate chorale repose sur le texte de Martin
Luther en 7 strophes. Une brève Sinfonia introduit la mélodie provenant de la séquence
médiévale Victimae paschali laudes dont
Martin Luther s’est inspiré en 1524. La première strophe est chantée sur le texte Christ lag in Todesbandense terminant sur Alleluia, rappelant que le Christ
est ensuite ressuscité, que nous devons nous en réjouir et chanter « Alleluia ». Le cantus firmus, clairement énoncé, est
repris dans toutes les strophes jusqu’au choral harmonisé pour la 7e strophe.
Précédée par l’Hymne Vox angelorum nuncia. Tu Christe Pater
optime, la Cantate 31 : Der Himmel lacht ! Die Erde jubilieret(Le ciel rit ! La terre jubile !) a été créée à Weimar, à la Chapelle ducale, le 21
avril 1715, puis reprise à Leipzig. Le livret est de Salomon Franck, et le
choral final de Nikolaus Hermann : So fahr ich hin correspondant à la
dernière strophe du Choral Wenn mein Stündlein vorhanden ist, rehaussé par
l’éclat des trompettes. Introduite par l’Hymne Chorus novae Ierusalem, la Cantate
67 : Halt im Gedächtnis Jesum Christ (Gardez en mémoire Jésus Christ) a été
entendue à Leipzig, le 16 avril 1724, Dimanche quasimodo (1er dimanche après
Pâques). Le livret est d’un auteur inconnu ; les Chorals sont de Nikolaus Hermann : Erschienen ist der herrlich Tag (1560) et le dernier, de Jakob Ebert : Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (1601) est une invocation pour la
paix. Ce disque du Label RONDEAU
PRODUCTION est tout à l’honneur du chef, du cantor et aussi compositeur et des choristes
et instrumentistes leipzicois.

Édith
Weber.
Johann Sebastian BACH : Intégrale de l’œuvre d’orgue.
Vol. 8 Chorals de Leipzig (I). Bernard Neveu, à l'orgue baroque de Johann Patroclus Möller de l’Abbaye de Marienmünster.
1 CD SCAM/SYRIUS : SYR 141464. Distribution :
SOCADISC (www.socadisc.com). TT : 71’ 34.
Bien connue de nos
lecteurs, Helga Schauerte poursuit son Intégrale de
l’œuvre d’orgue du Cantor de Leipzig, avec un CD consacré aux Chorals de Leipzig (I) enregistré par
Bernard Neveu à l’Orgue baroque (1738) de Johann Patroclus Möller (1698-1772) à l’Abbaye bénédictine de Marienmünster en Westphalie (près de Detmold). L’instrument
possède de nombreux jeux contenant des tierces, également des tourelles et une
façade de buffet tracée en arc, caractéristique de ce célèbre facteur. Restauré
et augmenté de quelques registres en 2012, il comporte 3 claviers : Hauptwerk, Brustwerk, Rückpositiv et pédalier ; il est accordé en mésotonique.
Composés pendant la période de Weimar et remaniés à Leipzig, les Chorals ont été recopiés dans un Recueil
intitulé : Autographe de Leipzig.
Seuls, 15 sur 18 sont de J. S. Bach. L’excellente organiste titulaire de
l’Église Allemande de Paris fait judicieusement précéder les Préludes de choral par l’harmonisation
correspondante à 4 voix, extraite des 371 Chorals publiés entre 1784 et 1787
par Carl Philipp Emanuel Bach et Johann Philipp Kirnberger. Elle encadre
ce corpus de Chorals par la Fantasia pro organo in c (BWV 537), de caractère méditatif, et la Fantasia in c (BWV 562), très
intériorisée. Le cantus firmus est déjà gravé dans la mémoire des auditeurs
grâce à l’harmonisation à 4 voix : ils le repèreront donc facilement,
d’autant plus que l’interprète tient le plus grand compte de la structure. Le
choral pour la Communion : Schmücke dich, o liebe Seele,
à 2 claviers et pédale, comporte une mélodie ornée au soprano, suggérée par le
verbe à l’impératif : Pare-toi (schmücke dich). Dans
le Choral Von Gott will ich nicht lassen, le cantus
firmus est exposé à la pédale, alors que, dans la Fantasia super : Komm, Heiliger Geist pour le temps
de Pentecôte, le Veni Sancte Spiritus est énoncé en valeurs longues à la basse. Dans
le Prélude à 2 claviers et pédale, Allein Gott in der Höh sei Ehr,
très orné, il est confié à la trompette et plane au ténor. Le temps liturgique
de l’Avent est représenté par Nun komm, der Heiden Heilandd’après l’hymne Veni Redemptor gentium ;
la Passion, par le Choral très développé : O Lamm Gottes unschuldigcorrespondant à l’Agnus Dei avec sa triple invocation, la mélodie circulant à travers
les voix et se terminant sur : Accorde-nous
la paix. Des deux versions de Jesus Christus unser Heiland, la première
est plus tourmentée ; la seconde, de style fugué, avec, en conclusion, le
cantus firmus à la partie supérieure. Enfin, le Choral An Wasserflüssen Babylon (BWV 553b), en
fait, le Psaume 137, — à propos de l’exil des Juifs à Babylone —, est écrit à 5
voix, et l’interprète tire le meilleur parti des jeux de l’orgue : avec le
cornet pour le cantus firmus au soprano, le hautbois pour le deuxième soprano
et l’alto, alors que la double pédale réalise les parties de ténor et de basse.
Helga Schauerte précise que, « réduite sur
quatre voix », la version définitive (BWV 553) figure sur le CD à
paraître : Chorals de Leipzig
(II), attendu avec le même intérêt par les discophiles. A suivre.

Édith Weber.
Franciszek BRZEZINSKI : Sonata for violin and piano in D major op. 6. JOSEF SZULC : Sonata for violin
and piano in A minor op. 61. Irena Kalinowska-Grohs, violon, Barbara Pakura, piano. 1CD ACTE PRÉALABLE (www.acteprealable.com) : APO271. TT : 62’ 03 .
ACTE PRÉALABLE est
un label assurant la promotion de la musique et des musiciens polonais. Les
discophiles sont conviés à la découverte de deux Sonates pour violon et piano. Franciszek Brzezinski est né à Varsovie en 1867 et mort dans cette
ville, le 6 août 1944. Il a étudié le
droit, la musicologie avec Hugo Riemann et Arnold Schering, le piano avec Jan Kleczynski, la composition avec Max Reger et la direction
d’orchestre au Conservatoire de Leipzig avec Arthur Nikisch.
Sa carrière est bien remplie : Directeur musical, rédacteur de chroniques,
Consul à Breslau (1921), Berlin (vers 1928), admis à l’Association des écrivains
et critiques musicaux (polonais), il revient en Pologne en 1931. Sa Sonate pour violon et piano en Ré majeur, op. 6., publiée à Leipzig en 1910, en trois mouvements privilégiant la technique de la
variation, puis son développement, est marquée à la fois par la simplicité des
idées thématiques et des éléments populaires (mazurka), synthèse entre simplicité, traits polonais traditionnels
et esthétique parfois assez proche de J. Brahms. Plus près de nous, Josef Zygmunt Szulc (francisé Josef Szulc), né le 4 avril 1875 à Varsovie, est mort le 10 avril
1956 à Paris où il a notamment été formé par Jules Massenet. Il a été nommé
chef d’orchestre au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, et se spécialisera dans
la comédie musicale et la musique de film. Sa Sonate pour violon et piano en la mineur, op. 61 illustre les tendances de la
musique de chambre polonaise. De structure classique en 4 parties : Allegro ma non troppo-Andante
sostenuto-Presto ma non troppo-Allegro assai. La
responsabilité mélodique est assumée par chacun des instruments, la chantabilité des mélodies, avec des résonances
néoromantiques ; l’influence de la mazurka est indéniable. Dans son
commentaire, avec raison, Maria Renat met l’accent
sur « la pénétration mutuelle inter-genre » et l’esthétique polonaise
en ce début du XXe siècle. En parfaite connivence artistique, Irena Kalinowska-Grohs (violon) et
Barbara Pakura (piano) contribuent ainsi à redonner
vie à la musique de chambre de ces musiciens polonais. Curiosités polonaises à
découvrir.

Édith
Weber.
Félix FOURDRAIN : Songs. 1 CD ACTE
PRÉALABLE (www.acteprealable.com) : APO323. TT : 47’ 04.
En premier
enregistrement mondial, le Label ACTE PRÉALABLE propose une sélection de
mélodies de Félix Fourdrain,
né à Nice en 1880 et mort prématurément à Paris en 1923 — à l’âge de 43 ans. Il
a été formé à l’École Niedermeyer, puis au
Conservatoire de Paris, où il a bénéficié de l’enseignement en orgue d’Alexandre Guilmant et de
Charles-Marie Widor, ensuite en composition de Jules Massenet qui l’a beaucoup
soutenu. Pour ses Opéras, il a retenu des livrets d’Arthur Bernède et Paul de Choudens. Ses Mélodies ont des titres particulièrement descriptifs : Le papillon, Les abeilles, Le vieux moulin, Edelweiss, Les mouettes… ; évocateurs : Alger le soir…, Carnaval, Marins d’Islande, La dentelière de Bayeux, Chevauchée Cosaque… ou encore Les petites communiantes, La belle aux yeux d’amour, Sainte
Dorothée…. Jan A. Jarnicki, directeur artistique et producteur du Label, a eu raison de faire appel à la mezzo-soprano Liliana Gorska, qui a fait
ses études vocales à l’Académie Vocale de Gdansk et s’est produite notamment
aux États-Unis, excellente pédagogue, membre de l’Académie polonaise des
éducateurs vocaux ; et au pianiste spécialisé dans la musique de chambre et
compositeur, Piotr Ejsmont, formé à l’Académie de
Musique de Katovice en piano et composition, et
enseignant à l’Académie de Musique de Gdansk. Avec infiniment de subtilité et
d’équilibre, tous deux rendent les moindres nuances de ces 21 mélodies typiques
de l’esthétique de la mélodie française au début du XXe siècle.

Édith Weber.
Klaus CORNELL : From The Northwest. 1CD VDE-GALLO (www.vdegallo-music.com) : CD 1407. TT : 66’
15.
Les Disques
VDE-GALLO, tout en privilégiant les musiciens suisses, brillent par la
diversification de leur répertoire. C’est le cas de Klaus Cornell,
né le 18 août 1932 à Berne, où il a fait ses études musicales, ainsi qu’au Mozarteum de Salzbourg. Il est à la fois maître de
chapelle, compositeur, collaborateur de la Deutsche Grammophon Gesellschaft et du Südwestfunk à Baden-Baden, ainsi qu’à la Radio Suisse, notamment. Il a, entre autres,
dirigé plusieurs Orchestres symphoniques suisses. En 1989, il s’est installé
aux États-Unis, dans la région nord-ouest de la Côte pacifique, comme
compositeur et chef indépendant, puis, de retour en Europe, il vit à Constance,
en Allemagne. Trois œuvres sont gravées : Tcha-Ti-Man-Wi. The Legend of Mary’s Peak(1994), en 7 parties, avec le concours de la
contrebasse (Andreas Cincera) et de l’Orchestre du
Conservatoire de Zurich. Cette page, créée le 4 juillet 1998, est suivie de Cojote Tales (2000) – Histoires de coyote, pour violoncelle (Jelena Ocic)
et piano (Federico Lovato), en 4 miniatures, d’après
les mythes des Indiens d’Amérique du Sud, pièce dépouillée et inattendue,
faisant appel à la transparence et à la virtuosité ; A Quest for Snow White – Une quête pour
Blanche-Neige, d’après un scénario imaginaire évoquant « la vie
sauvage de la forêt dans les montagnes de la Côte nord-ouest ». Autre
curiosité musicale américano-suisse qui ne laissera pas indifférent.

Édith
Weber.
« Le
chant éternel des Abbayes cisterciennes ». Ensemble Venance Fortunat, dir. Anne-Marie
Deschamps. 2CDs MONTHABOR (www.monthabor.com ) : S 542873. TT.: 68’ 16 + 49’
56.
Anne-Marie
Deschamps, qui a fait ses études musicologiques notamment en Sorbonne, s’est
spécialisée dans l’étude approfondie des manuscrits et du « chant vivant des
traditions orales porteuses de textes essentiels ». Elle a ainsi pu
comprendre ce que les spécialistes du chant religieux ont voulu réaliser au fil
des siècles : « une articulation souffle-parole qui puisse transmettre
le message traditionnel tout en lui donnant la présence d’une vie
nouvelle ». Avec son Ensemble Venance Fortunat
et ses fidèles chanteurs — C. Heugel-Petit et D. Thibaudat (Sopranos), Fr. Levy (Mezzo-soprano), C. Ravenne (Alto), É. Trémoulières (Ténor), G. Lacascade (Baryton), A. Sicot et Ph. Desandre (Basses),
auxquels s’est joint A. Brand (Ténor) —, elle propose un remarquable choix de
35 pièces liturgiques : Motets, Organa, Répons, Graduels, Tropes (d’Agnus Dei), Offertoires, Sequella, Alleluia plus développés, Gloria, entre
autres... Ces pages sont extraites notamment des Manuscrits de Worcester, Laon, Madrid, Milan (rite ambrosien), Chartres, Apt, Florence, Las Huelgas… et d’Abbayes
cisterciennes. Certaines œuvres sont prévues pour les Fêtes de Saints :
Michel, Gabriel, Raphaël, Victor et Bernard ; des messes de Noël ou de
dédicace d’Église. Elles proviennent de transcriptions d’A.-M. Deschamps, A. Gastoué, de L. Dittmer ou des
Éditions de Solesmes… À noter : l’organum double (XIe siècle) Alleluia ! Angelus Domini (CD 1, pl. 12), l’un des tout premiers exemples
de polyphonie savante, extrait du Manuscrit
de Chartres ; l’Alleluia ! In conspectu angelorum(CD 1, pl. 17), avec sa teneur très
prenante sur laquelle plane la voix organale à l’ornementation souple et
expressive. Ces deux disques, tout à l’honneur de l’excellente musicologue,
paléographe et chef, toujours soucieuse de faire découvrir la musique médiévale
et, plus particulièrement, liturgique, ont été enregistrés respectivement en
France, à l’Abbaye de Sylvanès, et en Suisse, à
l’Abbaye de Bonmont. Bénéficiant d’une acoustique
appropriée, l’Ensemble Venance Fortunat s’impose,
comme d’habitude, par ses nombreuses qualités : souplesse des voix et de
l’ornementation vocale, transparence, relief, élan et surtout intériorité et
profondeur expressive de ce « chant éternel ».
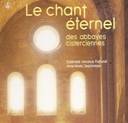
Édith
Weber.
Pierre ATTAINGNANT : Auprès de vous. Musique pour clavier
sous le règne de François Ier. Thomas Dunford, luth Renaissance, Pierre Gallon, Freddy Eichelberger, virginal et claviorganum.
1 CD L’ENCELADE
(www.encelade.net), distribué par Challenge International : ECL
1301. TT. : 65’ 40.
Le problème de
l’imprimerie de la musique avec des caractères mobiles a d’abord été résolu en
Italie par O. Petrucci en 1501, en trois étapes : il s’agissait d’imprimer
les portées, les notes, puis les paroles. En France, à partir de 1528, Pierre Attaingnant (v. 1494-1551/52) a édité des livres de musique
en une seule opération. Installé à Paris, rue de La Harpe, il est devenu
« Imprimeur et Libraire du Roi en musique » (1538). En 1531, il
publie 7 Livres pour clavier
« le tout réduict en la tablature d’Orgue, Espinette et Manicordion ». Pour ce CD, le récent
Label L’Encelade, spécialisé dans les programmes originaux baroques, a privilégié un intéressant répertoire en
usage au début du XVIe siècle. Il est interprété en connaissance de cause par
Thomas Dunford (luth Renaissance), Pierre Gallon et
Freddy Eichelberger (virginal et claviorganum — « hybride de l'orgue et du clavecin », comprenant un clavecin à un
clavier et un orgue coffre, construits respectivement par Émile Jobin et Quentin Blumenroeder,
d’après un modèle de 1528). Pour certaines œuvres, tout n’étant pas écrit,
l’improvisation est de mise. Les musiciens ont sélectionné un choix de danses
brèves en vogue à l’époque : pavanes, gaillardes, branles et des pièces à partir de chansons bien connues : À mes ennuis, Tant que vivray en âge florissant, Mon cueur en vous, Auprès de vous ou encore Languir me fait… On lira avec profit
l’introduction de Pierre Gallon situant le programme dans son contexte
historique et parisien. Quant aux instrumentistes, ils déploient tout leur
talent et leur musicalité pour restituer, tour à tour avec sensibilité,
finesse, expressivité, virtuosité et énergie, ce répertoire typique de la Cour
de François Ier. Grâce à une remarquable prise de son, les auditeurs du XXIe
siècle sont immédiatement plongés dans la réalité sonore d’antan. Une réussite
du genre.

Édith
Weber.
« Avé Fatimá » : Cantique du sanctuaire. Schola Cantorum Pastorinhos de Fatimá, dir.
Paulo Lameiro. 1CD
JADE (www.jade-music.net) : 699 804-2. TT : 72’ 11.
Les Éditions JADE
viennent de réaliser une première discographique autour du répertoire marial
qui résonne au Sanctuaire de Fatimá, lieu
de pèlerinage — équivalent portugais de « Lourdes » pour les
Catholiques français. Ces chants de louange et de prière en hommage à la Vierge
apparue aux petits bergers de Fatimá, en
juillet 1917, reposent sur des textes portugais, grec et latin. Ils sont
interprétés avec beaucoup de naturel par 42 jeunes choristes (entre 4 et 18
ans) ne connaissant pas la musique, accompagnés à l’orgue par Joao Santos. Ce
Chœur d’enfants est dirigé par Paulo Almeiro,
musicologue, ethnomusicologue et enseignant, absolument fasciné par ce
répertoire facile, monodique, sans ornementation et accessible à tous. Comme il
l’a précisé lors d’une interview, il a « favorisé des thèmes caractérisant l’identité
musicale de Fatima durant ces cinquante dernières années. » Il a aussi réservé
une place à Carlos Silva, « l’un des plus grands compositeurs liturgiques
portugais de tous les temps » et ajouté L’Hymne du Centenaire. Bel hommage de la Schola Cantorum Pastorhinos de Fatimá (existant depuis 10 ans) et remarquable illustration de l’atmosphère régnant
dans ce célèbre Sanctuaire portugais.

Édith
Weber.
Gioachino ROSSINI : Stabat Mater. Maria Stader,
Marianne Radev, Ernst Haefliger,
Kim Borg. Chorale de la Cathédrale Sainte-Edwige, Berlin. Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin, dir. Ferenc Fricsay. 1CD JADE (www.jade-music.net ) : 699
825-2. TT : 58’ 41.
À mi-chemin entre
la musique religieuse et le répertoire lyrique, dans le sillage de ses
opéras, le Stabat Mater de Gioachino Rossini
(1792-1868) pour quatre solistes, chœur et orchestre, figure à nouveau au
catalogue dans cette réalisation de 1954, remasterisée en 2014. Elle est interprétée par l’Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin
et de la Chorale de la Cathédrale Sainte-Edwige, sous la direction du chef
hongrois Ferenc Fricsay (1914-1963), célèbre, entre
autres, par ses nombreux enregistrements. Cette édition permet de retrouver les
voix inoubliables de Maria Stader (Soprano) et
d’Ernst Haefliger (Ténor). L’œuvre — commencée en
1831, terminée par Giuseppe Tadolini, son ancien
élève bolognais — a été donnée le Vendredi Saint de 1833, à la Chapelle de San
Filippo el Real de Madrid et, à Paris, en 1842. Le Stabat Mater est structuré en 10 parties. Une Introduction poignante décrit la douleur de Marie au pied de la
Croix ; les numéros confiés aux solistes sont particulièrement
dramatiques, par exemple l’Aria de Ténor, air de bravoure faisant appel à la
virtuosité et à un rythme martia ; le Duo de Sopranos, avec des vocalises souples.
L’Air de Basse, plus passionné, cède la place à un dialogue entre Chœur et
Basse a cappella. Dans le Quatuor Sancta Mater (Chœur de filles de Berlin), Rossini joue sur les timbres. La partition
évoquant les sentiments de tristesse, de tendresse et de douleur se termine par une invocation à
Marie : « À l’heure où mon corps va mourir, fais obtenir à mon âme la
gloire du paradis ». L’Amen conclusif
se présente comme une fugue énergique et très bien structurée avec une
remarquable précision par Ferenc Fricsay.

Édith Weber.
« La
France par chœur ». Bruno Fontaine (arrangements). Ophélie
Gaillard, violoncelle, Bruno Martinez, clarinette, Daniel Ciampolini,
percussion. Chœur Arsys Bourgogne / Pierre Cao, dir. Bruno Rastier. 1CD Vogue, distribution SONY MUSIC : 88843041262.
TT : 64’ 27.
Selon un adage bien
connu : « En France, tout finit par des chansons…». Elles ont, en
fait, le pouvoir de refléter le climat historique, sociologique et
sociétal à une époque donnée. Selon le
sous-titre : « Un chœur remonte l’histoire de France en
chansons », depuis la fin du Moyen-Âge, les
époques des Bourbons, de la Fronde, du Roi Soleil, du Directoire…, la
Révolution de 1848 jusqu’aux deux Guerres mondiales et à la réconciliation
franco-allemande. Elles évoquent des titres célèbres connus « par
cœur » par de nombreux Français : Réveillez-vous,
Picards, Vive Henri IV, le Chant du départ et La Marseillaise, Le temps des
cerises (Jean-Baptiste Clément), l’énergique Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine après la Guerre de 1870
et, plus proches de nous, Le chant des
partisans, Nuit et brouillard et À Göttingen… Le Chœur Arsys Bourgogne (Pierre Cao), sous la direction de Bruno Rastier, chante avec conviction ces pièces comprenant aussi
des arrangements de Bruno Fontaine pour piano, violoncelle, clarinette et
percussions. Ce répertoire, si souvent galvaudé, reprend ici ses lettres de
noblesse grâce à cette excellente évocation musicale de notre histoire
mouvementée.

Édith Weber.
Leonardo VINCI : Artaserse. Dramma per musica en trois actes. Livret de Pietro Metastasio.
Philippe Jaroussky, Franco Fagioli,
Max Emanuel Cencic, Valer Barna-Sabadus, Yuriy Mynenko, Juan Sancho. Concerto Köln, dir. Diego Fasolis. Mise en
scène : Silviu Purcărete.
Production de l'Opéra national de Lorraine, novembre 2012. 2DVD Erato :
46323234. TT. : 76'+125'.
Voici la captation vidéo de la production
fameuse d'Artaserse, donnée à l'opéra de Nancy
en novembre 2012 (cf. NL de 12/2012). Ce dramma per musica (1730) est un constant éblouissement musical, à
défaut de véhiculer une intrigue aussi passionnante : une sombre histoire de
crime et de trahison à la Cour d'Artaxerxès, roi de
Perse, déployant à l'envi le goût morbide de la catastrophe tant prisé par le
baroque italien. La musique de Vinci, qui fait souvent penser à son collègue
napolitain Pergolèse, est d'une prolifique inventivité et d'une pulsation
irrépressible qui soutient idéalement le chant. Car la pièce est prétexte à un
festival vocal comme il est peu d'exemples, même à cette époque. Créée par des
castrats, elle est défendue ici par cinq contre-ténors qui rivalisent de santé
vocale et de virtuosité proprement époustouflantes. La
mise en scène de Silviu Purcărete ne cherche pas à éluder le foisonnement baroque. Elle en épouse l'emphase et
fait son miel des postures recherchées. Les personnages sont vêtus de costumes
excentriques, fort chamarrés, et de couvre chefs extravagants, mêlant plumes et
autres atours festifs, de la généreuse perruque Louis XIV jusqu'à une parodie
de skinhead. Les péripéties, tracées sur un plateau relativement réduit, sont
saisies par une caméra très mobile et gourmande de détails. Ainsi les visages
au maquillage sophistiqué sont-ils caressés par un œil presque indiscret, mais
diablement pertinent ; comme est saisie l'hyperbole de la gestuelle et
l'exacerbation des sentiments à travers des attitudes un brin ampoulées.
L'impression est celle d'une agitation démultipliée, là où la représentation ne
donnait qu'une vision en deux dimensions. Les images sont extrêmement belles,
notamment des tribulations de ces petits marquis poudrés évoluant avec une
préciosité calculée, mais toujours élégante. La prise de vue mêle aussi la
coulisse à l'intrigue, à l'image de ces petites mains qui constamment guident
les protagonistes dans leur parcours, autre trait original d'une régie qui
prend ses distances avec la convention et la transcende. Les interprètes
épousent cette sophistication avec une conviction jamais prise en défaut et
sont tous d'une étonnante vérité. Max Emanuel Cencic et Valer Barna-Sabadus campent les héroïnes féminines, Mangane et Semira, dans un fabuleux naturel. Franco Fagioli, dans le rôle gratifiant d'Arbace,
est d'une suprême distinction dans sa prestation comme dans son chant, d'une
limpidité inouïe, et Philippe Jaroussky, dont
l'éclatante jeunesse et l'évidente sincérité confèrent au monarque Artaserse une aura enviable, déploie la vocalité accomplie
que l'on sait. La direction éminemment articulée de Diego Fasolis et la formidable plasticité sonore du Concerto Köln ajoutent à la perfection de ce spectacle décidément magique qui, s'il manie
l'excès en virtuose, ne verse jamais dans la facilité.

Jean-Pierre
Robert.
« Le Jardin de
Monsieur Rameau ». extraits d'œuvres
vocales d'André CAMPRA (L'Europe galante),
Michel PIGNOLET de MONTÉCLAIR (Jephté), Nicolas RACOT de GRANVAL (Cantate Rien du tout), Jean-Philippe RAMEAU (Hippolyte et Aricie, Dardanus, Les Fêtes d'Hébé, Les Indes galantes ; canons), Antoine DAUVERGNE (Hercule mourant, la Vénitienne), Christoph Willibald GLUCK (L'ivrogne corrigé). Daniela Skorda, Émilie Renard, Benedetta Mazzucato, Zachary
Wilder, Victor Sicard, Cyril Costanzo. Les
Arts Florissants, dir.: William Christie. 1CD Arts Florissants (distribution
Harmonia Mundi) : AF002. TT. : 81'03.
Ce programme fort intelligemment imaginé, a
été enregistré à le suite du concert du Jardin des
Voix, cru 2013, donné à la salle Pleyel (cf. NL de 5/2013). Rebaptisé «
Le Jardin de Monsieur Rameau » pour coller à l'actualité ramiste, il déroule une suite de morceaux essentiellement
vocaux donnant un large éventail de cet art français qui fleurit au XVIII ème siècle. Un art difficile, car basé aussi bien sur la
vocalité que sur la langue et le style dont la parfaite maîtrise peut seule
permettre de rendre à cette musique toute son éloquence. Le parcours musical,
articulé autour de Rameau, est illustré d'abord par des musiciens aux noms
moins connus. Ainsi de Michel de Pignolet de Montéclair
(1667-1737), dont la noblesse du style de la tragédie lyrique Jephté va
inspirer Rameau, d'Antoine Dauvergne (1713-1797), élève de celui-ci, qui dans Hercule
mourant, allie l'influence du maître à celle de l'opéra italien, et dans la
comédie-ballet La Vénitienne maniant l'art du travestissement dans une
écriture déjà plus moderne, ou encore de Nicolas Racot de Granval (1676-1753) dont la cantate comique Rien
du tout met en scène une chanteuse bavarde dissertant sur sa carrière.
André Campra est illustré par son premier opéra L'Europe galante, qui
appartient au genre alors en vogue de l'opéra-ballet. Il est constitué de
quatre « entrées », célébrant une nation européenne. Celle de la France
présente une nation volage et coquette. Un clin d'œil à Gluck, le sera à
travers des pages de son savoureux Ivrogne corrigé. Rameau est bien sûr
largement représenté avec des extraits de plusieurs de ses opéras majeurs,
comme Hippolyte et Aricie, Dardanus ou Les Indes galantes. Ou encore des Fêtes d'Hébé, un de ses
plus beaux succès. La succession des divers morceaux, sans solution de
continuité entre compositeurs, ouvre des enchaînements subtils, parfois
inattendus, le plus souvent évidents. Le piquant le cède à l'élégiaque,
l'hypnotique à la joie débordante. Outre les qualités vocales intrinsèques de
ces six lauréats de l'Académie de William Christie, on admire le sens de
l'ensemble que les chanteurs ont su déjà forger, cet esprit de collégialité
dont il peut être fier. Avec les Arts Florissants, il leur procure un
accompagnement d'une souveraine finesse et d'une belle alacrité.

Jean-Pierre Robert.
Felix MENDELSSOHN :
Quatuors à cordes N° 2, 0p. 13, en la mineur, N° 3, Op. 44 n° 1, en ré majeur,
& N° 6, Op. 80, en fa mineur. Artemis Quartet.
2CDs Erato : 0825646366903. TT.: 56'47+30'54.
Les trois quatuors présentement enregistrés
par les Artemis sont représentatifs de chacune des
périodes créatrices de Felix Mendelssohn. Ils ont été
composés entre 1827 et 1847, vingt ans au cours desquels le musicien va démonter
et affirmer combien il est un maître dans l'art du quatuor. L'op. 13, le
deuxième des six qu'il composera, est un vibrant hommage à Beethoven et à son
op. 132. Quelle maîtrise chez un musicien de 18 ans! Le premier mouvement bâti
sur le thème « est-ce vrai », en miroir au fameux « muss es sein » de Beethoven, progresse avec agitation.
L'intense adagio paie aussi sa dette au génie de Bonn avec des passages fugués
grandioses et tendus. L'intermezzo alterne danse gracieuse, à l'ancienne, et sérénade d'elfes,
préfigurant l'atmosphère nocturne du Songe d'une nuit d'été. Le finale,
qui nous ramène dans le drame beethovénien, laisse aux trois voix supérieures
le soin de disserter follement sur les sombres interjections du violoncelle.
L'op. 44 N° 1, de 1837, est selon le celliste Eckart Runge « d'une joie de
vivre toute de maturité ». Le molto allegro vivace s'élance fièrement et
développe des traits fébriles dans la tonalité, favorite chez Mendelssohn, de
mi mineur, que ne parviennent pas à arrêter quelques passages plus adoucis. Le menuetto est en fait un délicat intermède tout en demi
teintes, joliment balancé. L'andante espressivo retrouve l'autorité du premier
mouvement, mais dans un registre de sérénade avec des touches d'une grande
délicatesse. Le finale, presto con brio, déborde d'énergie, ponctué, là encore,
de passages plus ténus. L'op. 80, en fa mineur, est un déchirant requiem pour
Fanny, la sœur aînée disparue. Un climat sombre baigne ses quatre parties :
accents orageux traversant le premier mouvement, pour un climat agité, presque
haletant qui n'est interrompu que par quelques vaines touches plus amènes ;
révolte vigoureuse de l'allegro suivant, tandis qu'un deuxième thème insinuant
aux cordes graves semble s'épancher, mais sans lendemain car la véhémence
reprend ; prière, à l'adagio, dans laquelle les quatre voix semblent caresser
la cherté du souvenir de la disparue, jusqu'à un cri de désespoir ; défilé
d'horizons en apparence heureux, au finale, alors que des traits heurtés
rompent la charme. C'est le premier enregistrement de la formation renouvelée
du Quatuor Artemis depuis l'arrivée d'un nouveau
premier violon, Vineta Sareika : la sonorité de cette dernière est impérieuse, même si pas toujours des plus
confortables dans l'extrême aigu. Mais ils retrouvent leur cohésion et les
belles courbures qui distinguent cet
ensemble.

Jean-Pierre Robert.
Felix MENDELSSOHN :
Concerto pour violon et orchestre en mi mineur. John ADAMS : Concerto pour violon.
Chad Hoopes, violon. MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra, dir. Kristjan Järvi. 1CD Naive : V5368. TT.: 58'38.
Outre la superbe prestation du jeune
violoniste américain Chad Hoopes,
Premier prix, en 2008, du concours Menuhin, catégorie junior, le principal
intérêt de ce disque est le concerto pour violon de John Adams. Écrit en
1993, à l'intention de Jorja Fleezanis, premier violon solo de l'Orchestre du Minnesota,
il sera créé par elle en janvier 1994. De ce morceau Adams dira qu'il
« est presque implacablement mélodique ». Obéissant au schéma en trois
parties, il offre un exemple du style virtuose et abstrait favorisé alors par
le musicien, et qui place cette pièce dans le droit fil de la Chamber Symphony de
1992. le premier mouvement, tout comme celui du
concerto de Mendelssohn au demeurant, fait intervenir le soliste dès le début,
qui va entamer une course ininterrompue, sur une pédale grave de l'orchestre,
procurant une impression d'espace sonore, chère au compositeur. Le rythme
s'anime dans une progression de plus en plus frénétique dans les zones aiguës
de l'instrument. Le mouvement lent est une chaconne aux résonances lointaines à
l'orchestre. Le soliste inscrit au-dessus une mélopée large, flattant une
manière éthérée. C'est immédiat et prenant, et pour reprendre les mots d'un
connaisseur, le chef Simon Rattle, « empreint d'une tristesse et d'une profondeur
immenses ». Le scintillement du finale, « Toccare », fait contraste.
Là encore, le violon brode sans interruption, mais de manière énergique et
insistante. La pulsation rythmique devient obsédante, quelque peu motorique, à la manière d'un mouvement perpétuel, avec çà
et là des intonations presque jazzy. Le soliste est conduit à affronter des
traits d'une audace extrême. Devant ces passages grisants, comme vis à vis des
autres, Chad Hoopes, qui a
grandi avec cette musique, ne semble nullement impressionné. Il livre une
exécution d'une grande lucidité, solidement épaulé par Kristjan Järvi et son orchestre de la radio de Leipzig. Le
voisinage du concerto de Mendelsshon, a priori
curieux, pour ne pas dire osé, s'avère fructueux. De cette pièce archi jouée, Hoopes offre une lecture engagée, brillante, mais non
ostentatoire. On admire la pureté de la ligne du deuxième thème de l'andante,
sans affectation ni sollicitation, alors que les ultimes pages débordent
d'énergie. Le finale est joyeux, plein de verve dans un mouvement dansé, fuyant
toute prouesse extravertie. L'accompagnement magnétique prodigué par Järvi est au diapason d'un challenge parfaitement assumé.

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé MOZART : Concertos pour piano et orchestre N° 24, K 491 & N° 25, K 503.
Prague Chamber Orchestra, Paul Badura-Skoda,
piano et direction. 1CD Transart : TR176. TT.: 59'19.
Nouvel opus de la série des concertos de
piano de Mozart remis sur le métier par le légendaire Paul Badura-Skoda,
ce couplage des K 491 et 503 confirme les impressions ressenties à l'écoute des
volumes précédents. « Je me suis défié moi-même en enregistrant une
nouvelle fois ces deux chefs
d'œuvre », avoue-t-il. Le 24 ème concerto, K
491, de 1786, est de tonalité sombre, ce qui ne manque pas d'étonner car il est
contemporain de l'achèvement des Nozze di
Figaro. Ce tragique est perceptible dès l'allegro initial, où s'épanche le
désarroi, notamment dans une fin bouleversante, déjà proche du Requiem. Le larghetto et son thème
lumineux mémorable offrent plus de sérénité, notamment à travers le concertino
des bois, et une partie de piano riche, « où l'âme s'y reflète nue, à
découvert ». Le pianiste-chef joue la simplicité de la mélodie et ne
cherche pas le raffinement à tout prix. L'allegretto final marque un retour au
climat sombre du premier mouvement, devenant presque accablant sur un schéma de
thème de marche grave et de variations. Ces dernières s'enchaînent de manière
inexorable, seulement entrecoupées, par deux fois, par un épisode plus clair.
L'interprétation est chambriste, bien différente du geste grandiose souvent
adopté dans cette œuvre, et confère aux bois une importance particulière.
L'originalité réside dans la nouvelle cadence écrite par Badura-Skoda,
qu'il dit inspirée de la Fantaisie pour orgue mécanique K 608, et qui offre des
« modulations inhabituelles ». Le 25 ème concerto, K 503, le dernier des douze des années 1784-1786, est « le plus
grandiose et le plus ouvert sur l'avenir de tous les concertos de
Mozart », affirme le pianiste autrichien. Il le débute par une fanfare
éclatante, énergique et triomphale, dans laquelle on a pu voir, sous-jacent, le
motif de La Marseillaise. Paul Badura-Skoda presse le
tempo et cela est emporté de manière irrésistible, à l'orchestre comme au
clavier. La cadence retrouve ces caractéristiques de gaité et de triomphe. Pris
dans un tempo retenu, l'andante fait résonner une méditation d'une insondable
profondeur avec des accents troublants. Le finale dansant, fourmillant d'idées
et de modulations, est plein d'élan dans sa richesse thématique, que traversent
de brefs épanchements. Badura-Skoda presse le tempo
dans une coda riche de rebondissements, conférant un sentiment de victoire à
propos d'un concerto qu'il n'hésite pas à qualifier d'« impérial ».

Jean-Pierre Robert.
Johannes BRAHMS : « Les sonates pour
violon ». Sonates pour violon et piano N° 1 en sol majeur op. 78, N° 2 en
la majeur op 100, N° 3 en ré mineur op. 108. Sonate F-A-E. Berceuse op. 49, N°
4 (arrangement de John Lenehan). Leonidas Kavakos, violon, Yuja Wang,
piano. 1 CD Universal Decca : 478 6442. TT.: 76'46.
Cette nouvelle intégrale de Sonates pour
violon et piano de Brahms, assurément un des sommets du répertoire chambriste,
on a eu l'occasion de l'entendre sur le vif en concert à la salle Pleyel, le
mois dernier (cf. NL de 5/2014). Les impressions ressenties alors se confirment
et même s'amplifient à l'écoute du disque : le souci de bien différencier les
trois pièces et une approche retenue, dans les deux premières, marquée par des
ralentissements significatifs. La Sonate op. 78 est ici intensément lyrique,
idyllique et pastorale, et ce dès le premier mouvement, joué lent, ce qui
introduit quelque mélancolie. Le sentiment élégiaque se communique à l'adagio,
très pensé dans sa modération. Le finale moderato, très libre, ne se départit
pas de cette douce simplicité qui caractérise toute l'interprétation de la
sonate. L'op. 100 est placé sous le signe du merveilleux poétique, combien
illustré dans la thématique sinueuse de l'allegro amabile introductif et une
rythmique bien contrastée, alors que le développement retrouve la manière
élégiaque qui caractérisait l'œuvre précédente. L'andante, fusion chez Brahms
entre mouvement lent et scherzo, alterne réflexion et vivacité au fil de six
épisodes, entre balancement capricieux et extase, et le finale est pourvu de
passages plus sombres comme un jour déclinant. C'est, avec la troisième Sonate,
op. 108, le triomphe de la mélodie. Les deux interprètes s'y montrent dans un
mode plus vif, l'allegro initial mû par une force intérieure tout sauf
démonstrative, même dans les contrastes dynamiques du développement. Une
rêverie magistrale pare l'adagio qui s'élève vers les cimes, joliment déclamatoire
dans le dire du violon. Le court intermède, marqué « presto e con sentimento », est un paysage fantasque, d'une légèreté
immatérielle. Le finale n'est que jaillissement mélodique, sous l'archet enjoué
du violoniste et le robuste toucher de la pianiste, poursuivant une course
haletante. Outre une complicité certaine entre les deux protagonistes, on
admire la sonorité claire du violon de Kavakos, et le
doigté de Wang, tout en rondeur. En guise d'amuse-bouche, ils jouent le
mouvement de la Sonate dite FAE, un scherzo bien décidé ; et comme bis, la Berceuse op. 49 N° 4, un des lieder
les plus célèbres de Brahms, arrangé pour violon et piano par John Lenehan, où les deux voix s'échangent la mélodie.

Jean-Pierre Robert.
« Notturno ». Richard STRAUSS : Lieder
choisis. Thomas Hampson, baryton. Wolfram Rieger, piano.Daniel Hope, violon. 1 CD Universal DG : 479 2943. TT.: 70'19.
La composition de Lieder a rythmé la vie
créatrice de Richard Strauss. A travers eux, il restera égal à lui-même, si ne n'est
qu'après quelques poètes plus ou moins mineurs, tels Friedrich von Schack («Fleurs de
lotus », op 19), Felix Dahn («Simples mélodies », op. 21) ou John Henry Mackay (4 Lieder op. 27), il
se tournera vers des poètes importants tels Richard Dehmel, Friedrich Gottlieb
Klopstock, Clemens Brentano ou Friedrich Ruckert,
sans parler des emprunts au recueil anonyme du Knaben Wunderhorn. Les premières pièces entourent les
poèmes symphoniques, Don Juan, Till Eulenspiegel, Also sprach Zarathoustra, Don Quichotte ou Une vie de héros. Au temps des
grands opéras, Strauss ne négligera pas ses chers lieder, quand bien même
ceux-ci se feront plus espacés. Bien des recueils lui seront inspirés par son
épouse cantatrice, Pauline de Ahna. Grand défenseur
du Lied allemand, Thomas Hampson en offre dans ce
disque un bouquet fort séduisant. Là où bien de ses confrères et consœurs
achèvent leur programme, il débute le sien avec Zueignung (Dédicace), abordé dans un tempo retenu. Et
va enchaîner des mélodies empruntées à divers cycles représentatifs de l'art
straussien. Seul recueil d'importance à manquer : Der Krämerspiegel (le miroir du boutiquier) et ses poèmes satiriques. Ont été privilégiées des
mélodies à la profonde poétique. Une mention particulière au lied « Notturno », op. 44 N° 1, sur un poème de Dehmel,
inhabituellement développé (quelques 13') et pourvu d'un double accompagnement
de piano et de violon. Conçu pour orchestre (1900), il épouse la veine
cauchemardesque du poème qui a également
inspiré Schoenberg pour sa Nuit transfigurée : un rêve fantastique où la
mort est traitée comme l'ami qui erre dans la nuit avec son violon. La version
chambriste, si elle réduit le spectre sonore, n'en préserve pas moins le
caractère hallucinatoire recherché par la texte. Au
fil de ces tableaux d'atmosphère, de ces vrais petits drames, qu'on a pu
comparer à des opéras en miniature, le baryton américain cultive la juste
expression. Qu'il s'agisse de la poésie intérieure de « Ruhe meine Seele »
Repose mon âme) op. 27/1 ou du calme apparent de « Sehnsucht »
(Désir adent), qui passe du rêve à la franche agitation, et de toutes les
mélodies sollicitant une ligne vocale souvent terriblement exigeante, Hampson déploie une mâle intensité. Même lorsque l'écriture
fait appel à des modulations rapides, l'agilité comme la puissance sont
toujours au rendez vous, comme une magnifique panoplie d'expressions. Wolfram Rieger, le fidèle accompagnateur de ses récitals, se montre
lui aussi soucieux de créer le climat de chaque pièce et son pianisme traduit ce qui est souvent un scintillement
musical.

Jean-Pierre Robert.
Francis POULENC : Stabat
Mater pour soprano, chœur mixte et orchestre. Sept Répons de Ténèbres pour soprano, chœur et orchestre. Carolyn Sampson, soprano. Cappella Amsterdam, Estonian Philharmonic Chamber Choir. Estonian National Symphony Orchestra, dir. Daniel Reuss. 1 CD Harmonia Mundi : HMC 902149. TT.: 62'10.
Francis Poulenc a écrit son Stabat Mater en 1951, sur le schéma du grand motet à la française, pour chœur mixte à cinq
parties. C'est à celui-ci que l'on doit l'élan imprimé à la pièce, comme son
économie de moyens. Ses douze séquences font alterner climats apaisés et
vigoureux, autour du noyau central qu'est la sixième « Elle voit son fils
bien-aimé... », ou s'exhale une douce ferveur
dans l'intervention de la soliste. L'orchestre est traité dans une variété étonnante de modes, dont la danse n'est pas
absente, et plus d'une fois une veine de joie de vivre entoure paradoxalement
la gravité des mots. Poulenc ne parlait-il pas d'un « Requiem sans
désespoir » ? L'interprétation de Daniel Reuss montre une vraie empathie
avec la pièce et ses géniales modulations. Il est aidé par le magnifique
ensemble Cappella Amsterdam, renforcé du chœur estonien. On s'arrêtera plus
particulièrement sur la 10 ème séquence, poignante
dans sa déchirante déclamation, dont le langage anticipe celui des Dialogues
des carmélites, la soprano s'exprimant comme le fera Blanche de la Force
vis à vis de son père à l'acte I. La péroraison de l'œuvre délivre une joie
éclatante nimbée de mélancolie consolatrice, annonciatrice, là encore, de
l'opéra et de son ultime scène bouleversante. Les Sept Répons de Ténèbres,
fruit d'une commande de Leonard Bernstein, en 1959, pour le New York Philharmonic Orchestra, et qui sera créé à titre posthume
en cette ville en 1963, aborde le thème de la solitude de l'être angoissé,
aspirant à la paix. La pièce requiert un vaste orchestre, une soprano et un
chœur mixte, de voix d'hommes et d'enfants. La sérénité des accords qui ouvrent
le premier morceau, est comme une suite à la dernière scène des Dialogues.
Poulenc fait coexister la violence à peine contenue de l'angoisse
existentielle, soulignée par des dissonances, voire le recours à la série
dodécaphonique (4ème), et le calme serein des interventions de la soliste (3 ème et 5 ème), qui, dans ce
dernier cas, contraste avec la faconde chorale. L'atmosphère poignante,
implacable dans son aspect processionnel, du dernier répons, portant sa dette à
la scène de l'échafaud du grand œuvre scénique, débouche sur une note
d'espérance. On admire dans cette ultime œuvre chorale le dépouillement et le
raffinement, le partage, typiquement poulencquien,
entre résignation émue et affirmation de joie, à travers d'étranges rythmes
chaloupés et de grandes interjections chorales. L'extrême plasticité des chœurs
et la pureté de la voix de Carolyn Sampson confèrent
à l'exécution une aura de perfection.

Jean-Pierre Robert.
Karol SZYMANOWSKI : 12 Études op 33. Masques op. 34. 4 Études op. 4. Métopes op. 29. Cédric Tiberghien, piano. 1 CD Hyperion :
CDA67866. TT.: 74'34.
Dans sa musique pour piano, Karol
Szymanowski (1882-1937) cultive l'art de la métaphore. Son univers elliptique
est fait de motifs courts combinant une grande densité harmonique et une étonnante
légèreté de texture. Le programme de ce disque en offre une intéressante
moisson. Dans l'influence de Scriabine, et par delà de Chopin, les Quatre
Etudes op. 4 (1900/1902), s'affranchissent de toute contingence formelle et
révèlent déjà une personnalité affirmée. Elles requièrent de l'exécutant une
belle dose de virtuosité, dans la deuxième en particulier. La troisième, d'une
mélancolie passionnée, déroule une cantilène triste. Métopes,
« Trois poèmes » op. 29, de 1915, se rapprochent de l'école française,
de Debussy et de Ravel. Inspiré de l'architecture grecque, dorique plus
particulièrement, ce triptyque déploie un programme, le voyage d'Ulysse, plus
imaginaire qu'explicite, car là encore Szymanowski cultive savamment
l'abstraction. « L'Île des sirènes » est une pièce d'atmosphère, imaginant
une eau mouvante, rendue par un jeu arpégé dans une succession de motifs aussi
brefs que variés. « Calypso » est plus lyrique. Enfin
« Nausicaa » évolue telle une danse enjouée, d'une allégresse
insouciante. Les 12 Etudes op. 33 (1916), dont la durée totale n'atteint
pas les 15 minutes, poussent le souci de la miniature et la concision
épigrammatique à leur paroxysme : d'une facture évanescente, ce sont des
visions fugitives, de petits tableaux abstraits. Enfin, Masques op. 34,
construits de nouveau sous forme de triptyque, proposent successivement une
narration empruntée aux Contes des Mille et une nuits (Schéhérazade), et ses
mélismes vaporeux, une pièce emplie de fantaisie parodique (Tantris le bouffon), sur le Tristan d'Ernst Hardt où, à la cour du roi Marke, le héros se déguise en bouffon pour s'introduire
dans la chambre d'Isolde, et enfin un morceau en forme d'apparente
improvisation, capricieux et passionné (La Sérénade de don Juan). Derrière ces
trois « masques », se révèle un visage, mais lequel ? Dans toutes ces
pièces, où il n'est fait aucune concession à l'auditeur, Cédric Tiberghien est
impressionnant dans la maîtrise d'un discours complexe, souvent confié à un
tempo rapide et accumulant les difficultés techniques. Il est tout autant à l'aise pour clarifier ces
climats énigmatiques privilégiés par Szymanowski, requérant force subtilité
pour trouver le ton juste. Car le chatoiement, quasi impressionniste, de plus
d'une page se refuse à toute couleur locale. Un CD magnifique d'autant bienvenu
que cette musique est trop rarement jouée.

Jean-Pierre Robert.
Claudio
MONTEVERDI : Vespro della beata Vergine. Chœur de Chambre de Namur &
Capella Mediterranea, dir. Leonardo García Alarcón. 2 CDs Ambronay Editions : AMY041. TT.: 41’29+46’07.
Les Vespro (Vêpres) de
Monteverdi, une œuvre monumentale et mystérieuse, hybride, à la fois profane et
sacrée, contemplative et théâtrale, se situant aux confins de la Renaissance et
du monde baroque, composition qui n’a cessé d’interroger nombre de baroqueux et
de musicologues depuis des décennies. Sans doute pour plaire au pape Paul V, ce
recueil publié en 1610 s’inscrit-il de manière militante dans la nouvelle
mouvance esthétique de la Contre Réforme catholique réaffirmant le culte
marial. Le recueil des Vespro della beata Verginefut publié à
Venise, alors que le compositeur travaillait à la cour ducale de Mantoue. Il est probable qu’il s’agisse d’une pièce
d’audition visant à solliciter un poste à Venise (vœu exaucé en 1613 à la
basilique Saint-Marc) ou à Rome où aucun poste ne lui
fut offert. Une œuvre polymorphe laissant une grande liberté d’interprétation
et d’utilisation liturgique. Dans cet enregistrement, les éditions Ambronay nous proposent la vision personnelle du chef
argentin Leonardo García Alarcón, qui a comme particularité de composer un office dont
les tons d’antiennes correspondent aux tons des psaumes et du Magnificat.
Particularité anachronique qui permet, pour la première fois, d’entendre chacun
des psaumes précédé d’une antienne qui lui correspond. L’interprétation, comme
à l’accoutumée avec de tels interprètes est brillante, colorée, dynamique,
audacieuse, privilégiant la musique à la méditation.

Patrice Imbaud.
Johannes
BRAHMS. Symphonies
n° 1 & 2. Ouverture tragique. Variations sur un Thème de Haydn.London Symphony
Orchestra, dir.Valery Gergiev. 2CDs LSO Live : LSO00733. TT :
125’18.
Deux climats bien différents pour cet
enregistrement magnifique des deux premières symphonies de Johannes Brahms, interprétées
par le LSO sous la baguette de son chef titulaire Valery Gergiev,
captées en live au Barbican Center de Londres en
2012. La Symphonie n° 1, au climat
sombre et tendu, résultat d’une longue gestation de plus de vingt ans
(1854-1876) et la Symphonie n° 2,
composée plus rapidement (1877) peut-être plus charmante et d’abord plus aisé.
Deux expressions différentes de cette même altérité inspiratrice brahmsienne,
hantée par l’image ambiguë du double kreislérien faite de douleur et d’exaltation joyeuse, alternant drame et poésie, gravité
méditative et beauté mélodique, d’inspiration éminemment romantique mais
d’expression presque classique. Un enregistrement tout en demi-teinte, en
subtiles nuances, au phrasé limpide et savant, à la réalisation instrumentale
hors pair, passionnant de bout en bout, mené par la baguette exigeante d’un Gergiev qui semble, à l’instar de Brahms, s’assagir avec
les ans, se complaisant dans une lecture moins fougueuse mais plus profonde et
constamment habitée. Viennent s’adjoindre à ces deux symphonies, les Variations sur un thème de Haydn (1873)
dont la composition est légèrement antérieure à celle de la première symphonie,
une œuvre qui prouve l’expertise de Brahms en matière de variations. Soit dit
en passant, le thème utilisé, dit Choral
de Saint Antoine, est un thème populaire du XVIIIe siècle, attribué à Haydn
par erreur ! L’Ouverture tragique (1880) vient conclure en beauté ce superbe coffret qui bénéficie, de plus,
d’une très belle prise de son.

Patrice Imbaud.
Robert SCHUMANN : Kinderszenen. Abegg-Variationen. Fantasie. Lise
de la Salle, piano. 1CD Naïve : V 5364. TT.: 60’51.
Un disque que la pianiste Lise de la Salle
a voulu comme un voyage, comme une errance romantique autour de la Fantaisie en ut majeur (1836) de Robert
Schumann, une grande fresque où s’exprime toute la personnalité et les
sentiments complexes et passionnés de Robert qui se voit refuser la main de
Clara par son père…S’y associent les Variations Abegg (1830), œuvre de jeunesse, témoignage
amoureux imaginaire tout empreint de désir, et les Scènes d’enfants (1838), ensemble de treize miniatures adressées à
Clara. Un beau disque, d’un romantisme tout en contrastes, comme un miroir de
l’âme, où l’on regrettera parfois la
sonorité assez dure et l’usage un peu lourd de la pédale...

Patrice Imbaud.
« Amore Infinito ». Chants inspirés de poèmes de Jean-Paul II Karol Wojtyla.
Musiques de Placido Domingo Jr. Placido Domingo, ténor. Avec Andrea Bocelli, Josh Groban, Katherine Jentkins,
Vanessa Williams, Placido Domingo Jr. LSO, dir. Jorge Calandelli. 1CD Sony Classical : 88843053802. TT : 48’58.
Voici un enregistrement qui
interroge : Quel motif a pu pousser le grand Placido Domingo à commettre un tel disque ? Un subit doute spirituel, une urgente
quête métaphysique, un élan de foi irrépressible, ou une nécessité de marketing
à l’occasion de la récente canonisation du pape Jean-Paul II ? Rien de tout
cela semble-t-il, mais tout simplement une rencontre ancienne et une admiration
sans borne pour la personnalité et l’humanisme de Karol Wojtyla !
Si la motivation est défendable, le résultat musical l’est beaucoup moins.
S’appuyant sur des poèmes anciens de Jean-Paul II dont la qualité poétique est
digne d’Oronte, servi par une musique de Placido Domindo Jr., d’une platitude affligeante, interprétée par
le London Symphony Orchestra, en collaboration avec
les ténors Andrea Bocelli et Josh Groban,
la mezzo galloise Katherine Jenkins, Vanessa Williams et Placido Domingo Jr qui y va aussi de sa petite chanson… Voilà un disque qui ne fera pas
date. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, Monsieur Placido Domingo nous avait habitué à mieux !! Dommage.

Patrice Imbaud.
Martin
MATALON. Philippe HUREL. Bernard CAVANNA. Tramages. Ensemble Mesostics.
1 CD & 1DVD Editions Hortus : HORTUS104.
TT : 72’03+71’17.
Un coffret original comprenant 1 CD et 1
DVD, regroupant des œuvres de trois compositeurs contemporains. Trame I, IV, VII et VIII de Martin Matalon, Intersitices de Philippe Hurel et
le Concerto pour violon de Bernard
Cavanna. Un titre « Tramages » se référant au poème éponyme de Jorge
Luis Borges, car c’est à partir de la transformation du son que la trame se
tisse… Interprété par l’Ensemble Mesostics dont c’est
ici le premier enregistrement. Un nom curieux qui renvoie à la forme poétique
des mésostiches dans lesquels les lettres médianes
peuvent être lues verticalement faisant ainsi apparaitre un mot mystérieux se
rapportant au sujet du poème. Quel peut donc être ce mot caché se rapportant à
ces différentes œuvres, les regroupant
autour d’un même thème ? En écoutant ce disque, tout devient clair : il s’agit
à l’évidence d’images, de composantes visuelles, sorte de mobiles se dégageant
comme une évidence de cette musique en perpétuel mouvement… Ici, des images
dynamiques, fluides, scandées par une savante utilisation des percussions, dans
une inexorable progression musicale qui conduira à l’angoissant effondrement
final, point de départ d’un nouvel envol des possibles (Trame IV pour piano solo et onze instruments solistes). Là, une
progression mystérieuse comme une attente, tantôt lancinante, tantôt véhémente,
comme une aphasie musicale qui ne pourrait dire (Trame VII pour cor solo et quinze instruments). Ailleurs encore,
l’oxymore associant fluidité et tension (Interstices
pour piano solo et trois percussionnistes) ou l’espièglerie de l’instrument
soliste qui semble se jouer, tel un électron libre, des autres instruments (Trame I pour hautbois solo et cinq instrumentistes)
ou, enfin, l’étonnant jeu de cache-cache du marimba (Trame VIII pour marimba solo et huit instrumentistes). Au-delà de
ce sens caché, un disque qui traite des rapports, parfois conflictuels ou
symbiotiques, entre l’instrument soliste et les autres…Plusieurs façons de
concevoir le « jouer » et le «laisser jouer » mais toujours le même
plaisir de jouer ensemble. Une musique très colorée, un important travail sur
les timbres, sur l’articulation et les rythmes. Une très belle interprétation
de ce talentueux ensemble. Une découverte à ne pas manquer !

Patrice Imbaud.
Thierry ESCAICH. Magic Circus. Musique de chambre avec vents. 1 CD Indésens : INDE060. TT : 80’57.
Thierry Escaich (*1965), compositeur contemporain, organiste et improvisateur français, nous
donne à entendre dans cet enregistrement un corpus de huit de ses œuvres
composées entre 1989 et 2011, entièrement dédié à la musique de chambre avec
vents : Magic Circus (2005) Mecanic Song (2007) Le Bal (2003) Antiennes
oubliées (1989) Trois Instants
fugitifs (1996) Ground IV (2011) Le Chant des ténèbres (1992) Tanz Fantasie (2000). Des compositions
utilisant un instrumentarium original et varié qui
allie le potentiel polyphonique et l’ampleur sonore de l’orgue à la richesse des couleurs, le pouvoir
expressif et la sensualité des instruments à vent. Un résultat particulièrement
convaincant, une musique envoûtante nimbée de brouillard et de mystère,
desquels émergent les stridences fulgurantes ou les complaintes poétiques des
vents. Une musique d’une prodigieuse richesse thématique, fréquemment
sous-tendue par la danse, dynamique et obstinée, alternant lyrisme et vision grotesque, humour et mélancolie, rêve
et nostalgie, magie et enchantement. Une superbe réussite et un casting qui
réunit les plus grands et talentueux instrumentistes du moment (Ensemble Initium, Vendôme Clarinet Quartet, Axone Saxophone Quartet, l’Ensemble de saxophones de Paris, Nicolas
Prost et Eric Aubier, sans oublier l’Indésens Septet spécialement constitué pour cet
enregistrement). Magique tout
simplement!

Patrice Imbaud.
***
MUSIQUE ET CINEMA
ROCK AND THE MOVIE
Le rock 'n' roll
est un style musical inventé par des chanteurs blancs qui se sont inspirés du rythm and blues des musiciens noirs. Il a fait son apparition sur le grand écran
en 1955 avec le film “ Graine de Violence” (Blackboard Jungle) de Richard Brooks, où un des premiers orchestres de Rock' and Roll
“Bill Haley and his Comets” interpréte le fameux “Rock Around the Clock” qui devint un succès planétaire.
“L'Equipée Sauvage” (The Wild One) de Laszlo Benedek, réalisé en 1953, n'a pas
eu cette chance et les motards de Brando qui deviendront les grands fans de
cette musique l'ont découverte un peu plus tard. La BO ne fait aucune référence
à cette nouvelle musique. Leith Stevens, le
compositeur, propose une musique jazzy bien sage jouée par l’orchestre du trompetiste West Coast, Shorty Rogers, et le film perd en intensité.... Car qui dit
motards dit Harley Davidson, Hell's Angels et R&R. De nombreux films joueront sur ce trio
(“Hell Ride”, “The Wild Angels”,
“Hell's Belles”,“Hell's Angels 69” “Hell's Angels on Wheels”, The Glory Stompers”....) avec des musiques rock, hard rock (Davie Allan, Lex Baxter, ZZtop, Iron Butterfly,
Mike Curb, The Arrows...).
“Sur le réservoir de ma bécane j'écris ton nom liberté...”. C'est sa BO
rockeuse qui fit, entre autres, le succès de “Easy Rider”, (1969) réalisé par Dennis Hooper, film culte
pour toute une génération. Born To Be Wild... Cet album est toujours autant écouté...”Don't bogart that joint my friend, pass it over to me”. En 1957, avec Elvis Presley, deux
films seront offerts aux adolescents qui assiéront la suprématie du King du
Rock : “King Creole” mis en scène par le talentueux
Michael Curtis, réalisateur de “Casablanca” et “ Des Aventures de Robin des
Bois “, et “Jailhouse Rock” de Richard Thorpe à qui
on doit “Ivanhoé” et “Les Chevaliers de la Table Ronde”. Tous les symboles du
rock sont présents dans ces films : révolte adolescente, refus d'un système
d'éducation archaïque mis en place par les parents, violence gratuite pour effrayer
le bourgeois, jeunes qui veulent exister par eux-même,
qui revendiquent leurs codes vestimentaires et culturels, d'où cette musique insuportable pour bien des adultes dépassés. C'est cette
fureur de vivre post Seconde guerre mondiale qui va s'exprimer dans le R&R.
Le cinéma, qui n'est pas un art philantropique, va
s'engouffrer dans ce marché et proposer à toute une génération des films où le
rock sera soit à l'image, soit en bande son.
Suivront, de 1956 à 1958, des films qui
présenteront des groupes de Rock auxquels on ajoutera une bluette sentimentale
entre deux ados (“Rocking The Blues”, “Rock Around the Clock”, “Rock, Rock,Rock”, “Let's Rock”....). Ce qui sera intéressant pour ce qui est ces films c'est qu'on aura
des archives d'artistes que la télévision, alors naissante, n'aura pas encore
filmées. Des années plus tard suivront des films comme “Woodstock”, “The Last Waltz” ou le fameux documentaire “Monterey Pop Festival”,
filmé en 1967 par Pennebaker avec toute une
génération de nouveaux chanteurs influencés par le Rock des années cinquante.
Des concerts filmés sont aujourd'hui souvent proposés à la télévision. Elvis continuera à offrir des films à son
public mais le Rock hélas ne sera plus présent. Ce sont des BO sirupeuses et
des scénarii niais avec des metteurs en scène très médiocres qui transformeront
le King en roi du loukoum...”It's now or never”....De nombreux biopic seront réalisés sur des stars du rock avec plus ou
moins de réussite. (Aucun film ne sera fait sur les grands rockers noirs !).
John Carpenter réalisera un médiocre “Elvis” en 1979 avec un surprenant Kurt
Russel ; une pseudo bio de Janis Joplin, “The Rose”, sera mise en scène sans
conviction par Mark Ridell mais interprétée
superbement par Bette Midler. Denis Quaid, par contre, explose dans le “Great Balls of Fire “ (1989), la vie du
rock and roller barge Jerry Lee Lewis mise en scène à tombeau ouvert par Jim
McBride. “Les Runaways” (2010) de Floria Sigismond offre un biopic bien rythmé du groupe de
rock féminin de Joan Jett dans les années 1970. La
jeunesse de Lenon “Nowhere Boy” (2009) par Sam Taylor-Wood n'est pas inintéressant et la musique de Lenon y est très rock ; musique qu'il proposera lorsqu'il
aura quitté les Beatles. On peut aussi se souvenir de “The Buddy Holly Story”
(1978) de Steve Rash, une chronique de l'une des premières stars du Rock and
Roll, de “Sid and Nancy” d'Alex Cox (1986) sur la tragique histoire de Sid Vicious, des Sex Pistol, et une de ses groupies. Gary Oldman y est étonnant. On peut apprécier “Killing Bono”
(2011) de Nick Hamm ou “la naissance de U2”, un vrai bon film rock. Les BO de ces films sont les musiques de ces
groupes.
Peu de films vraiment Rock seront de fait
réalisés. En 1974, Brian de Palma réalise “Phantom of Paradise”, une tornade visuelle et baroque rock and
roll sur le mythe du fantôme de l'opéra. La musique et l’interprétation de Paul
Williams sont à la hauteur de la mise en scène. Richard Curtis prendra pour
thème la radio pirate anglaise en mer (histoire qui a vraiment existé), pour
offrir une BO compilation du tonnerre avec son film “ Good Morning England” (2009). C'est au son d'une compilation de
Rock des années cinquante que des aventures adolescentes se dérouleront dans “American Grafiti”
(1973) de Georges Lucas. Avec “Deux Cents Motels” (1971) Frank Zappa fera un
pur film Rock and Roll avec sa musique et ses visions délirantes. Dans le genre
délire on peut citer “Une Nuit en Enfer “ (From Dusk Till Dawn) (1996) de Robert Rodriguez et Sarah Kelly,
lui aussi un film dans l’esprit R&R avec une bande son où l’on trouve Zztop, Ray Vaughan, The Blasters,
Graeme Revell.…
Les deux groupes mythiques de l'histoire du
Rock n'ont pas laissé d'oeuvres majeures au cinéma.
Les Beatles, avec “A Hard Day's Night” (docu-fiction
sur le groupe, 1964) et “Help” (1965) mis en scène par Richard Lester, un
réalisateur de la new generation anglaise (Palme d’Or
à Cannes pour le “Knack” en 1965) montrent qu'ils
étaient prêts à toutes les incongruités pour plaire à leurs fans. Les BO de “Help” comme celle de “A Hard Day's Night” seront des énormes succès. Ils offriront le
premier dessin animé “psychédélique” avec le fameux “Yellow Submarine” (1968) réalisé par Georges Dunning et une bande son rock. Les Rolling Stones, eux, n’ont eu que de nombreux concerts filmés tout au long de leur
longue carrière. Le plus célébre, et un des plus
intéressants docu-concerts, est “Gimme Shelter” en 1970 réalisé
par David Maysles, Albert Maysles et Charlotte Zwerin. Il montre comment un groupe est
incapable de gérer sa notoriété avec un service d’ordre, les Hell’s Angels, sevrés d’alcool.
Un jeune homme noir est tué par l’un d’eux pendant que Jagger chante “Sympathy for the Devil”. La boucle est bouclée, on est dans un scénario
du style “Wild One” avec là une bonne vraie musique rock! Godard, en 1968, a
réalisé un documentaire très R&R sur le groupe et l'enregistrement de ce
morceau mythique. L’enregistrement de l’album des Beatles en 1969 “Let It Be”
sera réalisé bien plus sagement par Michael Lindsay-Hogg.
Souvent des “opéras rock” ou des comédies
musicales rock ont fait l'objet de film. C'est ainsi que “Tommy” des Who a été brillament mis en image
par Ken Russell, “Grease” de Jim Jacobs et Warren
Casey par Randal Kleiser, “The Wall” des Pink Floyd par Alan Parker. “Hair Spray” de Charles Walter, mis en musique par Mark Shaiman Thomas Meehan, est filmé par Adam Shankman,
“Hair” de James Rado et Gerome Ragnipar
Milos Forman. Un des plus gros succès de ce genre de film est “Rocky Horror Show “ de Richard O'Brien mis en image par Jim Sharman.
En France, le rock n'a pas eu l'honneur du
cinéma. Les Chats Sauvages ont fait une apparition dans une comédie assez
stupide, “Le Roi du Village“, en 1962, de Henri Gruel,
où la musique rock n'est pas appréciée par la population locale de ce petit
village bien français, sauf bien sûr par la jeunesse. La même année l'autre
groupe rock de l’époque, Les Chaussettes Noires et Eddy Mitchell, ont fait des
débuts peu convaincants dans “Comment
Réussir en Amour” de Michel Boisron et feront une
apparition dans “Les Parisiennes”. Pas très Rock and Roll ces films ! Plus
récemment en 2005, Laurent Tuel avec “Jean Philippe”
avait une bonne idée assez originale, à savoir que “Johnny n'avait jamais
existé!!!!” mais hélas il revient pour de bon...!
Pour terminer ce survol du Rock au cinéma,
on ne pas laisser de côté le film culte des années 80 qui résume assez bien
l'univers du Rock and Roll. C'est “The Blues Brothers”
de John Landis avec Dan Aykroyd et John Belushi, qui
sous prétexte d'une histoire farfelue, présente des stars du rock et du rythm and blues. La BO est une des plus vendues à ce jour.
Notre préférence va tout de même à deux films qui parlent de passion pour cette
musique. Ce sont “Presque Célèbre” (Almost Famous) de Cameron Crowe (2000);
un petit chef oeuvre, et le “High Fidelity”
de Stephen Frears (2000), un véritable acte d'amour
pour le Rock and Roll. Les BO de ces deux films sont exeptionnelles….”Just let me hear some of that rock and roll music”
comme chante la plus grande star du Rock, Chuck Berry. Seul un documentaire sur
un concert pour ses soixante ans, organisé par Keith Richards, existe sur cet
immense artiste : Hail! Hail! Rock 'n'
Roll, (1986). Il a été réalisé par Taylor Hackford.
Espérons qu’après son film Ray (2004) il réalisera Chuck….
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
https://www.youtube.com/watch?v=9FCv58ThH5E
Stéphane Loison.
ENTRETIEN
Rencontre avec Cyril Durand-Roger
MUSIC BOX RECORDS est un label phonographique
indépendant consacré à l'édition ou la réédition de bandes originales de films
et de séries inédites en CD. Le label, créé en 2011 par Laurent Lafarge et
Cyril Durand-Roger propose, sur CD et en édition limitée, des versions
complètes de ces musiques en y intégrant autant que possible des morceaux
inédits. Il existe très peu de sites de ce style pour les amateurs de musiques
de films. On peut citer le site espagnol « Quartet Records » qui
produit aussi des disques en phase avec les nouveaux films sortant sur les
écrans. On trouve également « Ecoutez le Cinéma », chez Universal dont s’occupe Stéphane Lerouge,
et qui sort des classiques de BO.
DR
Début juin vous allez sortir votre
cinquantième album. Les lecteurs le découvriront en allant sur votre site, on
leur laisse la surprise. Vous entamez votre troisième année ?
Le
site existe depuis le début 2011. Notre premier disque était consacré à la BO
de « L’Incorrigible », un film de Broca et une musique de Georges
Delerue. Pour nous, c’était important dès le départ d’avoir un site internet
parce que pour les fanas de musique de film qui cherchent leur Graal, c’est par
ce biais-là qu’ils peuvent le trouver. En province les boutiques de disques
disparaissent de plus en plus, les Fnac réduisent leurs rayons DVD et CD. Donc
les musiques de films en pâtissent. C’était primordial pour nous d’avoir un
site pour les amateurs de musiques de films.
Et comment fonctionne-t-il ?
On a
fait une première année laborieuse, parce qu’on se lançait dans ce milieu avec
une expérience assez réduite. Concevoir un album et le vendre c’était tout
nouveau pour nous. C’est tellement long et procédurier pour concevoir un album
qu’on a compris qu’il fallait travailler sur plusieurs albums simultanément. La
première année on a sorti, je crois, cinq à six CD ce qui n’est pas beaucoup.
On a enchaîné avec le double la deuxième année et aujourd’hui on va sortir
notre cinquantième album.
Comment vous vient l’idée de sortir un CD
de musique de film et quel est le processus pour qu’il existe ?
Avec
Laurent Lafarge, mon associé, on se met d’accord sur un projet. Souvent c’est
une frustration, car au départ on est cinéphile. On se dit : tient c’est jamais
sorti ou ça n’existe plus ; il faut qu’on se renseigne pour savoir s’il existe
du matériel, des bandes ou si cela a été numérisé; et puis surtout, la partie
la plus complexe, celle des droits. On avance et c’est très laborieux parce
qu’on peut avoir une bonne nouvelle au sujet du matériel, mais avoir des
éditeurs qui peuvent très bien ne pas être motivés, ou encore constater que les
droits sont perdus, et donc ne pas pouvoir exploiter la musique. Il y a plein
d’embûches avant que le CD arrive dans les bacs. Nous sommes assez pointus sur
le choix. Si le compositeur est bon, il n’y a pas de musique mineure, même si
le film n’est pas exceptionnel. Delerue a toujours fait des musiques
intéressantes même si ses scores ne sont pas parfaits ; enfin moi je n’en
connais pas. Il y a toujours des petites perles à découvrir, qui contrebalancent le côté réédition de musiques déjà
sorties qu’on commence à connaître par cœur. On est dans ce choix éditorial.
Avec
Laurent Lafarge vous vous connaissiez bien ?
Avec
Laurent on a été étudiant ensemble à Toulouse et il y avait une UV commune de
cinéma à l’époque. Avec une bande de copains il s’est trouvé que nous étions
des fans de musique de film. C’était avant que la cinémathèque de Toulouse ne
soit ce qu’elle est devenue aujourd’hui, une des plus importantes de France. On
est dans les années 90, on avait créé un fanzine de cinéma et de musique de
film, qui s’appelait déjà Music Box. On faisait des dossiers, des critiques. Je
me souviens d’avoir fait un papier sur la musique de Desplat sur le film d’Audiard « Regarde les Hommes Tomber », musique
passionnante, peut-être plus intéressante que ce qu’il fait aujourd’hui…On
avait fait un bon papier sur Patrick Doyle et « Carlito’s Way » de Brian de Palma. C’était une période
très riche qualitativement et c’était très existant de trouver des disques à
Toulouse à cette époque sans internet. On pouvait trouver des magasins de
disques d’occasion, c’était un vrai plaisir de faire les magasins de disques,
de chiner. Internet a tout révolutionné, on peut tout avoir pratiquement sur
internet si on y met le prix. Pendant dix ans j’ai travaillé à Paris dans une
agence de com sur des projets Web. J’étais toujours
collectionneur de BO. A un moment j’en ai eu assez de cette vie parisienne,
j’ai démissionné, je suis descendu dans le sud, au soleil, et innocemment j’ai
décidé de monter un label de musique de film, inconsciemment plutôt. J’en ai
parlé à Laurent qui lui aussi en avait mare de ce qu’il faisait et du coup on
s’est renseigné pour savoir comment monter une société sur internet. On voulait
commencer par un gros titre, un nom porteur et on a pensé à Georges Delerue qui
fait partie de nos compositeurs favoris et qui a une renommée internationale. « L’Incorrigible »
était un film qui me fascinait quand j’étais gamin, que je revois avec toujours
autant de plaisir. Je suis un fan de Belmondo, et cette musique n’était jamais
sortie en CD. On a eu beaucoup de chance. On a pu avoir les coordonnées de
Colette Delerue, la veuve du compositeur, qui a été enthousiaste sur le projet,
malgré notre inexpérience. Les droits étaient à l’ancienne CAM, elle nous a
fait confiance tout de suite. On avait une idée très précise du label, une
charte très forte, on voulait faire un bel objet. Mettre simplement une musique
sur une galette ce n’était pas notre intention. Le graphiste a fait un travail
superbe. On voulait aussi des textes à la hauteur, on a demandé à Frédéric Gimello-Mesplomb, qui avait fait
un livre sur Delerue, de faire le texte. Notre premier essai a été un succès
parce que le disque a été épuisé au bout d’un an. On avait fait mille exemplaires et c’est ainsi qu’on est entré dans ce
milieu.
On dit que le CD est mort et que l'avenir
c’est le téléchargement. Quelle est votre vision ?
Je
pense qu’il y a du lavage de cerveau : on dit tout le temps que le CD est mort,
comme on avait annoncé la mort du vinyle. S’il est mort c’est au niveau des
grands pressages, mais je pense qu’il y aura toujours une niche de gens qui
voudront toujours du CD, même si on leur dit qu’il est mort. On pourra toujours
l’écouter. Moi je suis la génération CD : au niveau confort d’écoute, je
préfère le CD au vinyle. Avec le téléchargement ce qui est terrible c’est que
la partie éditoriale disparaît. On balance de
la musique et je trouve que c’est excessivement cher comparé à un CD avec un
livret, un bel objet dans les mains comme était avant le vinyle. Pour de la pop
c’est peut-être moins important ; pour une musique de film, comme pour les
bibliophiles, c’est bon d'avoir un bel exemplaire. Ce qui m’agace le plus c’est
de mettre toujours en opposition deux mondes. Parce qu’il y a du digital il
faut que le CD meure ; je trouve cela débile. Je ne sais pas comment avec cette
histoire de téléchargement, et dans le domaine de la musique de film, les
éditeurs et les producteurs peuvent gagner leur vie. Les pourcentages étant
tellement faibles, je ne sais pas comment on pourra continuer à éditer de la
musique de film. Je ne parle pas du téléchargement illégal, qui est un vrai
fléau. Pour l’instant au niveau éditorial on ne s’est pas trop trompé. La
plupart de nos CD sont encore au catalogue, et on n'a dû faire des retirages
que sur deux titres qui ont cartonné : un de John Williams, qui s’appelle
« Fitzwilly » de Delbert Mann, un film de 1967, et un sur des courts métrages de De Roubaix. Le marché du film reste très restreint quoiqu’il en soit.
Vous
avez un peu la même culture que Quartet Records ?
Oui,
c’est un site espagnol qui sort des CD passionnants et qui produit aussi des
musiques de films contemporains. Il nous a soutenu dans notre démarche, on a un peu la même vision des choses. Il aime la musique
de film dans toute sa diversité. En cela on est très proche.
Y-a-t-il des musiques originales de films
récents que vous allez produire ?
Chaque
CD sorti est une volonté de combler un vide, c’est des frustrations qu’on veut
supprimer. Récemment on a réussi à sortir assez rapidement les musiques de
Michel Korb pour les films de Christian Philibert. On
a été synchrone avec la sortie des films. On a fait aussi « La Nouvelle
Guerre des Boutons », musique de Philippe Rombi,
mais le CD a été décalé par rapport à la sortie du film. Ce n’est pas facile de
sortir en synchrone, c’est souvent à l’arrache. Il y a constamment un blocage
avec les éditeurs et les compositeurs. Ils aiment que leurs musiques soient
présentes dans tous les bacs…Alors qu’on n'est plus comme dans les années 80 :
les gens qui achètent la BO sont des amateurs de musique de film et vont sur
internet. A Paris, par exemple, il y a Gibert, boulevard Saint Michel et la
Fnac des Champs-Elysées qui ont encore un rayon bien fourni de BO. Les
habitudes des fans ont changé, il n’y a plus de choix chez les disquaires. Pour
vendre 500 ou 1000 exemplaires on n’a plus besoin d’être partout. Les acheteurs
de musique de film il y a quelques années représentaient à peine 2 %, et encore
c’était l’année des « Choristes ». Les éditeurs pensent que si le
disque est partout, il va se vendre énormément.
Et
dans vos projets, avez-vous des BO récentes ?
On
aimerait bien faire quelques titres plus récents. D’ailleurs on va bientôt
produire un CD de la musique de « United Passions » réalisé par
Frédéric Auburtin sur la création de la Fifa avec
Depardieu et Tim Roth. Il est présenté à Cannes en section parallèle. La
musique est de Jean Pascal Beintus qui est un des
orchestrateurs de Desplat. C’est sa première musique
en tant que compositeur de musique de fiction. Il avait fait un documentaire de
Di Caprio « The 11th Hour ».
Il avait travaillé sur « La Guerre des Boutons » de Rombi. C’est une superbe
musique orchestrale. Il a beaucoup de talent. Le film sortira pour la rentrée.
Alors bon courage et on attend vos nouveaux
CD ainsi que le cinquantième avec impatience sur votre site :
http://www.musicbox-records.com/fr/
http://www.quartetrecords.com/catalogue.html


Propos recueillis
par Stéphane Loison.
BO EN CD
LE FANFARON et autres comédies italiennes. Réalisateurs: Dino
Risi. Mario Monicelli, Pietro Germi, Vittorio De Sica. Compositeurs : Riz Ortolani, Piro Umiliani, Carlo Rustichelli, Armando Travajoli.
1CD Milan n°399 55-2
Dans
ce CD, Milan nous offre quelques musiques de comédies italiennes les plus
célèbres des années 60. Une comédie italienne est par essence insolente et
subversive. Derrière le rire et le sourire, le film manie la dérision et la
satire. Les maîtres du genre se nommaient Risi, Monicelli, Germi,
de Sica. Avec le « FANFARON » de Risi qui a
fait de Vittorio Gassman une star, on retrouve le fameux klaxon arrogant de la
« Lancia Aurelia ». La petite histoire dit
d’ailleurs qu’il lança une telle mode en Italie qu’on finit par interdire les
klaxons musicaux. Le thème du film très jazzy est de Riz Ortolani,
un des plus célèbres compositeurs italiens qui vient de disparaître en ce début
d’année. Il est le compositeur de « Mondo Cane » (Oscar de la chanson en 1964). On lui doit pas moins de 300
partitions. Quentin Tarantino a emprunté, comme à son
habitude, un extrait de « I Giorni dell’Ira » pour « Django Unchained ».
Dans les bars, sur les plages les juke-box jouaient
les chansons à succès. Ainsi on entend dans ce disque « Guarda come Dondole », « Pinne Fucile ed Occhiale »
d’Edouardo Vianello, « Vecchio Frack » de Modugno,
« Saint Tropez Blues Twist », « Don’t Play That Song » par Peppino di Capri, et le tube de cette année 1962 à San Remo, « Quando Quando Quando »,
immortalisé par Tino Renis. C’est en 1958 qu’est
sorti le chef d’œuvre de Monicelli « I SOLITI IGNOTTI » avec un
casting impressionnant (Gassman, Salvatori, Mastroianni, Carotenuto et la Cardinale dans son premier rôle). La musique très jazz est de Piero Umiliani. Il a composé plus de 150 partitions pour le
cinéma. C’est un autre célèbre compositeur, Carlo Rustichelli,
qui a écrit la musique de cette énorme satire de la société italienne de Pietro Germi avec
Mastroianni et la Sandrelli, « DIVORCE A
L’ITALIENNE ». Armando Trovajoli est lui aussi
un très grand compositeur pour le cinéma. Il a travaillé avec Risi
(« Parfum de Femme »), Scola (« Une Journée
particulière »), Corbucci, et c’est pour de Sica qu’il a composé la musique de cette superbe comédie à
sketches « HIER, AUJOURD’HUI, et DEMAIN » interprétée par le couple
mythique Loren/Mastroianni. A travers ces quatre chefs-d’œuvre de la comédie
italienne on a un aperçu de la musique de ces grands compositeurs. Un disque
pour tout amateur de comédies et de bonne musique.

https://www.youtube.com/watch?v=yafIvKriSgo
M.PEABODY & SHERMAN. Réalisateur : Rob Minkoff. Compositeur : Danny
Elfman.1CD Sony Music n°88843048372
Danny Elfman signe sa
première BO pour une animation DreamWorks. Le
réalisateur Rob Minkoff avait collaboré avec Hans Zimmer pour "Le Roi Lion", et avec Alan Silvestri
pour "Stuart Little" (1999). Deux chansons
sont dans le CD, celle du générique de fin « Way Back When », par Grizfolk,
et « Beautiful Boy », par John Lennon. M. Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il
est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier...
et il se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les
domaines, M. Peabody est sur le point de relever son
plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se
préparer pour l’école, il décide de lui apprendre l’histoire et construit alors
une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand
Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa
camarade de classe. Ce film est une adaptation d'une série animée de la
télévision américaine des années 1950-1960. Grâce à sa machine à remonter le
temps, Rob Minkoff nous fait revivre à vive allure et
de manière amusante des époques historiques. Le principe de la musique pour les
films d’animations est d’appuyer le dessin, de lui donner du rythme, de
souligner les effets. Danny Elfman, dans ce genre
d’exercice, s’en sort bien et s’amuse musicalement. Il joue sur les ambiances
historiques en faisant des allusions musicales « clichées » (History Mash-up, Off To Egypt, The Wedding Exodus). A
partir d’un joli thème il offre des variations selon les moments du film
(piano, hautbois, clarinette, cor solo et orchestre) avec des ruptures
musicales correspondant au scénario (Reign of Terror). On reconnaît bien sûr la musique de Danny Elfman dans ses arrangements et sa façon de faire
intervenir les chœurs depuis « Batman ». Cette musique enjouée et
entraînante est un bel exercice de style et ceux qui ont vu ce film sympathique
auront le plaisir à l’écoute du CD de se remémorer les moments du film.

https://www.youtube.com/watch?v=tSHgP4JQhMc
UNDER THE SKIN. Réalisateur :
Jonathan Glazer. Compositeur : Mica Levi. 1CD de
Milan n°399 543-2;
Une
extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire
disparaître. Le film est adapté du livre de science fiction de Michel Faber et interprété par Scarlett Johansson.
Dans le roman de Faber, il s'agit de fournir de la
viande humaine aux habitants de la planète de la mystérieuse créature. Les
victimes, qui font de l'auto-stop, sont emmenées dans une ferme, engraissées
dans des cages, puis transformées... Mais Jonathan Glazer a préféré les faire disparaître de façon énigmatique, laissant place à l'interprétation.
Jonathan Glazer est un réalisateur qui avait fait des
clips, entre autres, du groupe Radiohead et qui n’a
réalisé que deux longs-métrages dont Sexy Beast (2000), qui avait reçu de nombreuses récompenses (Oscar pour Ben Kingsley). Il
considère son film comme une sorte de science fiction existentielle. Mica Levi
(Micachu), la compositrice de la musique du film, a
étudié le violon et l’alto, a composé des œuvres expérimentales pour
l’Orchestre Philharmonique de Londres. Elle joue de la musique électro-pop
minimaliste avec son trio Micachu & The Shapes. C’est sa première participation à un film.
Qu’importe si vous n’avez pas vu « Under the Skin » (il sort pour le
festival de cinéma à la fin du mois), l’album proposé par Milan est un pur
régal de musique contemporaine. C’est un cliché de mettre dans les films dits
de science fiction ce genre de musique, mais vu la construction du film et le
peu de dialogue, cette musique apporte l’atmosphère juste. (Elle rappelle celle
de « Planète Interdite », première musique électro-acoustique). Si la
composition est de Mica Levi, il faut y ajouter le talent de celui qui a
participé aux arrangements et qui l’a produite, Peter Raeburn. C’est un
compositeur talentueux de musique pour la publicité, la télévision, le cinéma
et qui écrit des chansons. Il a reçu avec sa compagnie de nombreuses
récompenses. Il a travaillé avec Jonathan Glazer sur
ses publicités ainsi que sur ses deux précédents films. Dans ce travail il faut
aussi reconnaître celui de Evan Jolly, l’orchestrateur,
qui avec cet orchestre de chambre de cordes d’une quinzaine de musiciens et
d’une flûte, nous emmène dans des atmosphères assez planantes. Ce disque est un
bel objet musical qui à l’écoute permet de s’inventer ses propres images….avant
d’aller voir celles de la superbe et inquiétante Scarlett Johansson.

https://www.youtube.com/watch?v=JyQ_PLDi0rU
X MEN, DAYS OF FUTURE PAST. Réalisateur : Bryan
Singer. Compositeur : John Ottman. 1CD
Sony Classical
Dans
un futur où les espèces humaines et mutantes ont été décimées par
d’impitoyables robots sentinelles, les ultimes survivants n’ont plus grand
chose à espérer de l’avenir. Dans un ultime effort pour changer le cours
tragique des événements, Professeur Charles Xavier et Magnéto envoient Wolverine dans le passé, à la rencontre des jeunes mutants
écorchés qu’ils ont été. Car le meilleur moyen d’arrêter la guerre reste encore
de ne pas la laisser éclater. John Ottman est
monteur, compositeur, réalisateur, producteur. Il n’a que 40 ans et déjà une
belle carrière derrière lui. Il est surtout le collaborateur régulier de
Bryan Singer (ils ont le même âge).
Depuis 1993, avec un film peu connu, « Ennemi Public », il a été
révélé ainsi que le réalisateur par « Usual Suspects » (2 oscars en
1995). Ce ne sera que le deuxième Xmen qu’ils feront
ensemble. C’était Michael Kamen qui était le
compositeur du premier. La mort prématurée de cet excellent musicien a fait qu’Ottman a composé les suivants. Inutile de dire que les
musiques et la mise en scène collent parfaitement, Ottman étant aussi le monteur des films de Singer. C’est un cas unique au cinéma. Dans
la série des Xmen, (il y en a sept et un en chantier
pour 2016) les deux premiers et ce dernier sont les meilleurs ; ce sont ceux de
Singer. John Powell, H.Gregson Williams, Henry Jackman, Marco Beltrami ont composé
les Xmen d’autres réalisateurs avec plus ou moins de
talent.

https://www.youtube.com/watch?v=cAgqFMe5U-M
GODZILLA. Réalisateur :
Gareth Edward. Compositeur : Alexandre Desplat.
1 CD Sony Classical 888 43073462
« GODZILLA » est un monstre issu
de la copulation d’un gorille et d’une baleine. Il est la figure emblématique
de la culture japonaise qui exploite les thèmes écologiques et la peur du
nucléaire dans le Japon d’après-guerre traumatisé par les bombardements
américains d’Hiroshima et de Nagasaki. Il y a eu une trentaine de films de la
saga Godzilla entre 1954 et 2014, avec autant de
comics, mangas, séries, jeux vidéo. Il était tantôt contre les hommes ou avec
eux pour lutter contre d’autres monstres. Ce sont les essais nucléaires dans le
Pacifique qui ont réveillé ce monstre antédiluvien. Irradié, il détruit Tokyo
avant de retourner à la mer. C’est le réalisateur Oshiro Honda qui réalisa le premier film dix ans après les bombardements. Le film a eu
un très gros succès au Japon mais a été censuré aux États-Unis pour minimiser
l’implication des essais nucléaires américains dans la création du monstre. Il
est à la fois une métaphore des États-Unis et une allégorie des armes
nucléaires. Un des derniers de la saga, assez nul, avec Jean Reno (sans
commentaire) mettait en cause les explosions françaises dans le pacifique.
Ce dernier Godzilla est très proche de l'esprit du film original de 1954. Le scénariste Max Borenstein décrit une histoire « aussi terrifiante que réaliste, comme si l'incident avait vraiment eu
lieu dans notre quotidien », mais qui reste également celle d'un
« spectaculaire film de monstres »
… Le réalisateur Gareth Edwards dit que « Le nucléaire est très présent au cœur du film, et notre thème principal
est l'homme contre la Nature. Et dans ce combat, la Nature gagne
toujours …Godzilla est comme le dernier
Samouraï : un ancien guerrier qui préfère rester à l'écart du monde, mais
dont les évènements vont l'obliger à réapparaître… Pour moi, il est comme une
force de la nature, comme la colère de Dieu ou sa vengeance pour la façon dont
nous nous sommes comportés ». La sortie du film coïncide avec le
soixantième anniversaire du premier film. Gareth Eward s’est fait connaître par ses talents dans les effets spéciaux. Il n’a réalisé
qu’un seul film, « Monsters » avec un très
petit budget, où il tenait un certains nombres de postes. Ce film eu un beau
succès. « GODZILLA » est son deuxième film.
« GODZILLA » est donc de retour avec les tonnes d’effets
spéciaux qu’on peut réaliser de plus en plus grâce aux ordinateurs. Après Reno
c’est Binoche, la frenchy. Le physicien nucléaire
Joseph Brody enquête sur de mystérieux phénomènes qui
ont lieu au japon quinze ans après un incident qui a irradié la région de Tokyo
et déchiré sa propre famille. Refusant de s’en tenir à la version officielle,
qui évoque un tremblement de terre, le scientifique revient sur les lieux du
drame accompagné par son fils Ford, soldat dans la Navy.
Ils découvrent que les incidents ne sont pas liés à une catastrophe naturelle
mais à une créature marine gigantesque dont l'existence a été dissimulée depuis
les années 1950 et les essais nucléaires dans le Pacifique. D'autres organismes
monstrueux font bientôt leur apparition et menacent la sécurité de l'archipel
d'Hawaï et la côte Ouest des États-Unis. Au même moment, la compagne de Ford,
infirmière et jeune maman, gère les blessés dans un hôpital de San Francisco…
Akira Ifukube est
le compositeur des bandes son et musiques des « Godzilla »
de la compagnie Toho et du réalisateur Oshiro Honda. Surtout reconnu comme compositeur de musique
classique Akira Ifukube a composé plus de 200 BO. Il
a créé le rugissement de Godzilla en frottant un gant
de cuir recouvert de résine sur les cordes détendues d'une contrebasse, et les
bruits de ses pas en frappant un boîtier d'amplificateur. Le premier « Godzilla » de 1954 ainsi que « King Kong contre Godzilla » sont les plus célèbres musiques de la
série.
On pourrait être surpris d’avoir Alexandre Desplat comme compositeur de musique pour un
« blockbuster ». Il est plus spécialisé dans le cinéma indépendant,
dans les films d’auteurs. A l’écoute de sa musique, on est très agréablement
surpris. Il a fait une musique plus classique, loin de ce qu’aurait proposée
l’écurie de Remote control d’Hans Zimmer,
et c’est tant mieux. Il s’est offert un orchestre impressionnant et cinq
orchestrateurs dont le compositeur Jean-Pascal Beintus avec qui il travaille souvent. Le thème « Godzilla »,
pourtant, pourrait passer pour une écriture de l’écurie Zimmer mais la suite des compositions et plus nuancée et plus dans la veine des bonnes
musiques des grands de Hollywood qu’on peut retrouver aussi chez Beltrami formé
par Goldsmith. Un final avec chœur ressemble étrangement à un passage du
Requiem de Ligeti dans son orchestration, œuvre qu’on a entendu dans
« 2001 Odyssée de l’espace ». Le thème « Back To the Ocean » est magnifique. Chez Desplat on a rarement des thèmes auxquels se rattacher, mais on n’est plus sensible aux
masses orchestrales. Après le désastre monumental, caricatural, musical, du
franchouillard Desplat au béret chez Colonel Clooney, l‘intimisme dont nous avait habitué ce compositeur
avec « Philomena », « Venus in
Fur » fait place à un gigantisme avec flûte à la japonaise chez le anti-héros sympathique Godzilla.
« Monument Men » et « Godzilla »,
deux films qui se répondent curieusement.

https://www.youtube.com/watch?v=HUcfO25Y4Po


https://www.youtube.com/watch?v=CpKXTGxzysU
Stéphane Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Passer une publicité. Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
maite.poma@leducation-musicale.com
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale
·
La librairie de L’éducation
musicale
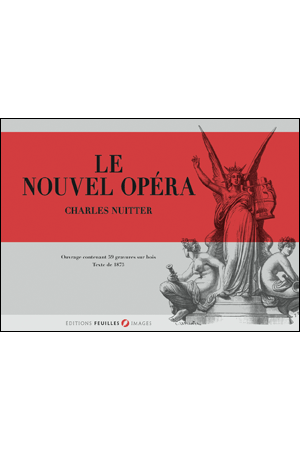 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
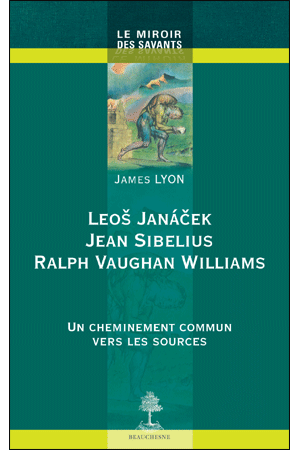 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque. Ils ont été confrontés aux tragédies de leur temps et y ont répondu en s'engageant personnellement dans la recherche de trésors dont ils pressentaient la proche disparition. (suite). |
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. Il prend la suite de La Recherche hymnologique (Guides Musicologiques N°5), approche méthodologique de l’hymnologie se rattachant à la musicologie historique et à la théologie pratique dans une perspective pluridisciplinaire. Nul n’était mieux qualifié que James Lyon : sa vaste expérience lui a permis de réaliser cet ambitieux projet. Selon l’auteur : « Ce livre est un USUEL. Il n’a pas été conçu pour être lu d’un bout à l’autre, de façon systématique, mais pour être utilisé au gré des écoutes, des exécutions, des travaux exégétiques ou des cours d’histoire de la musique et d’hymnologie. » (suite) |
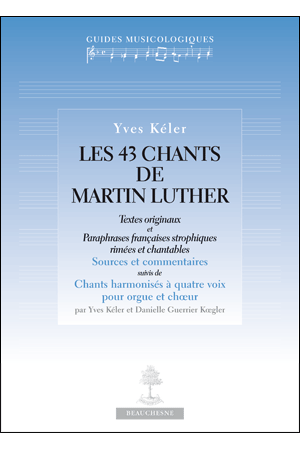 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. Aux hymnologues, musicologues, musiciens d'Eglise, chefs, chanteurs et organistes, ainsi qu'aux historiens de la musique, des mentalités, des sensibilités et des idées religieuses, il offrira, pour chaque choral ou cantique de Martin Luther, de solides commentaires et des renseignements précis sur les sources des textes et des mélodies : origine, poète, mélodiste, datation, ainsi que les emprunts, réemplois et créations au XVIè siècle... (suite) |
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ? Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui. Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ? Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique.
|
En préparation
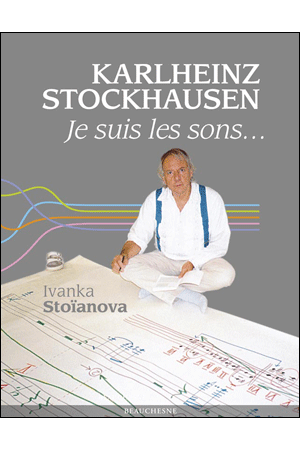 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite) |
 |
Analyses
musicales
XVIIIe siècle – Tome 1
L’imbroglio
baroque de Gérard Denizeau
BACH
Cantate BWV 104 Actus tragicus Gérard Denizeau Toccata ré mineur Jean Maillard Cantate BWV 4 Isabelle Rouard Passacaille et fugue Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu Janine Delahaye Phœbus et Pan Marianne Massin Concerto 4 clavecins Jean-Marie Thil La Grand Messe Philippe A. Autexier Les Magnificat Jean Sichler Variations Goldberg Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses Gérard Denizeau Apothéose Corelli Francine Maillard Apothéose de Lully Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus Sabine Bérard Israël
en Egypte Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile Jacques Michon L’alleluia du Messie René Kopff
Musique feu d’artifice Jean-Marie Thill |
***
 |
Parution du numéro spécial BAC 2015 dès Juillet 2014 CONFIEZ NOUS VOTRE PUBLICITE, VOS ANNONCES, VOTRE PROGRAMME
Plus de 4000 exemplaires. En vente durant 12 mois!
Contact : maite.poma@leducation-musicale.com Tel : 01 53 10 08 18
PS : N'hésitez pas à demander le sommaire
|
·
Où trouver le numéro du Bac ?
Les analyses musicales de L'Education Musicale

