L'ARTICLE DU MOIS : LE TRICENTENAIRE DE L'OPERA COMIQUE - PATRIMOINE ET ARCHIVES D'UNE INSTITUTION
FOCUS SUR LA MUSIQUE NOUVELLE : THOMAS HEWITT JONES
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
À RESERVER SUR L'AGENDA
9, 11 / 4
La Finta Giardiniera à l'Opéra de Dijon

Portrait de Mozart par Joseph
Lange (fragment)
Entre tromperie, ambiguïté des sentiments,
pardon et réconciliation, La Finta Giardiniera (La fausse jardinière), huitième
œuvre lyrique de Mozart, fait la belle aux ressors de l’opéra bouffe.
Musicalement, Mozart, alors âgé de 19 ans, prend pleinement possession de son
génie dramatique : richesse et complexité des ensembles qui font avancer
l’action et dessinent les caractères, maestria dans le contraste entre comique
et drame, dépassement de l’un et l’autre dans une équivoque qui soudain dit la
vérité ambivalente des sentiments humains. Si le livret fait la part belle aux
ressorts les plus courants de l’opéra bouffe, il offre pourtant au jeune
compositeur une sorte de galop d’essai pour Les Noces de Figaro. Déjà, les
ingrédients qui feront la subtilité de la folle journée y font modestement leur
apparition. Le spectacle sera dirigé Emmanuelle Haïm,
avec le Concert d’Astrée, et mis en scène par David Lescot qui est aussi auteur
dramatique et musicien passionné par le rapport texte/musique. Une belle
occasion de découvrir un opéra déjà unique, plein de feu et de fraîcheur
désinvolte.
Auditorium de Dijon, les 9 et 11 avril 2014 à 20
H.
Location : Billetterie centrale du Grand Théâtre,
Place du Théâtre, 21000 Dijon ; par tel : 03 80 48 82 82 ; en ligne :
www.opera-dijon.fr
12 / 4
René Jacobs dirige Pergolèse en Arles

© Philippe Matsas
Dans le cadre de la XXIX ème Semaine Sainte en Arles, René Jacobs dirigera, à la
tête de l'Akademie fur Alte Musik Berlin, un
programme consacré à Jean-Baptiste Pergolèse. Outre le célèbre Stabat Mater (dans la réorchestration de JS. Bach) seront donnés des extraits du rare Septem verba a Christo in cruce moriente prolata(Les sept paroles du Christ expirant sur la
croix). Cette pièce majeure du baroque napolitain, un « oratorio méditatif
et didactique » selon le chef belge, se compose de sept cantates à
l'orchestration riche et variée. Tout comme dans l'enregistrement
discographique qu'il en a livré récemment (cf. NL de 4/2013), René Jacobs est
l'interprète désigné pour faire revivre cette musique fascinante, à la tête
d'une formation qui connait son baroque sur le bout des doigts. Ils joueront également
le Concerto à quatre en ut mineur pour cordes et basse continue de Baldassare Galuppi. Un programme justement alléchant.
Chapelle
du Méjan, le 12 avril 2014, à 20H30.
Location: Association du Méjan, BP 90038, 13633 Arles cedex ; par tel : 04 90 49 56
78 ; en ligne : mejan@actes-sud.fr ou www.lemejan.com
23 / 4
Les Heures dolentes

DR
Le nom de Gabriel Dupont (1878-1914) reste
bien peu connu. Élève de Massent et de Widor, Prix de Rome en 1901, devant
Ravel, on lui doit trois opéras, dont Antar, créé à titre posthume, en
1921, à l'Opéra de Paris, un florilège de mélodies, de la musique de chambre et
des pièces pour piano. A ce dernier titre, le cycle Les Heures dolentes a été composé entre 1903 et 1905, alors que le musicien était déjà atteint de
la tuberculose qui allait l'emporter à 36 ans : une vaste suite de 14 pièces,
de plus d'une heure de musique, d'une grande charge émotionnelle. Il sera
interprété par Nicolas Stavy, dans le cadre de la
série Convergences de l'Opéra National de Paris. En préambule, on donnera aussi
ses Chansons normandes (1900), pour chœur de femmes et piano, et La
Damoiselle élue de Debussy, avec la soprano Andreea Soare. Une vraie opportunité d'apprécier la manière
d'un compositeur d'une belle sensibilité, héritier du franckisme et nourri à l'impressionnisme, sous les doigts d'un pianiste de grand talent.
Opéra
Bastille, Amphithéâtre, le 23 avril, à 20H.
Location : Billetterie, 130, rue de Lyon
75012 Paris ; par tel : 08 92 89 90 90 ; en ligne : www.operadeparis.fr
25, 26 / 4
Diabolus in musica : l'univers musical de la Sainte-Chapelle au temps
de Saint Louis

L'ensemble vocal Diabolus in musica, sous la direction d'Antoine Guerber, donnera un concert de chants liturgiques, sous le
patronage du Centre des Monuments Nationaux, à l'occasion du 800e anniversaire
de la Sainte Chapelle de Paris. Le programme
de ce concert est une émanation du programme de recherche “Musique et musiciens
dans les Saintes Chapelles, XIIIe-XVIIIe siècles”, soutenu par l'Agence
Nationale de la Recherche (ANR) et coordonné par le Centre d'Études Supérieures
de la Renaissance de Tours réunissant une équipe de musicologues, historiens,
historiens de l'art, archéologues… et dont le travail de recherche est de
proposer une relecture globale des chants lors de célébrations liturgiques qui
se déroulaient dans les Saintes Chapelles. Sera proposée
une sélection de chants puisés aux offices majeurs de deux célébrations
emblématiques de la Sainte-Chapelle de Paris : les premières Vêpres de la fête
des Saintes Reliques, célébrées au soir du 29 septembre, et les Matines de la
fête de la Sainte Couronne, pendant la nuit du 11 août.
Sainte-Chapelle, 8, Boulevard
du Palais, 75001 Paris, les 25 et 26 avril 2014 à 20H30.
Location : sur place le soir du
concert ; par tel : 01 53 40 60 80 (01 53 73 78 57, le week end) ; en ligne : www.diabolusinmusica.fr ou sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr
28 / 4
L'association ProQuartet présente le Trio
Jacob

DR
Dans le cadre de la série « Jeunes
lauréats », l'Association ProQuartet présente le
Trio Jacob. Formé en 2004, il est composé de trois lauréats du CNSMP, Raphaël
Jacob, violon, Sarah Jacob, violoncelle, et Jérémy Pasquier, alto. Il s'est
formé, entre autres, dans la classe du Quatuor Ysaye et auprès de maîtres tels
que Régis Pasquier et Roland Pidoux. Il jouera, à la
Maison des Polytechniciens, un programme réunissant le Trio à cordes N°1, D 471
de Schubert, le Trio à cordes N° 5, op. 9/3 de Beethoven et une pièce plus
rare, la Sérénade pour trio à cordes en ut majeur, op. 10, d'Ernö Dohnányi (1877-1960). Cette
pièce, écrite en 1902, se situe dans le sillage de la Sérénade op. 8 de
Beethoven, dont le compositeur hongrois renouvelle la manière avec bonheur, alternant,
au fil de ses cinq mouvements, tension soutenue et lyrisme subtil dans une
belle exubérance thématique, portée à son apogée dans la Tema con variazioni.
Hôtel Poulpry, Maison des Polytechniciens, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris, le 28 avril à 20H
Location
: par tel : 01 44 61 83 68 ; en ligne : www.proquartet.fr
2, 4, 6, 9 et 17 / 5
Création française de Doctor Atomic à l'Opéra du Rhin

Fruit d'une commande l'Opéra de San
Francisco, autour du mythe de Faust et ce qu'il peut encore inspirer à un
compositeur au XXI ème siècle, Doctor Atomic traite de l'aventure de l'élaboration de
la première bombe atomique : le projet Manathan d'essai nucléaire au Nouveau Mexique, de juillet 1945. Le livret de Peter Sellars, qui emprunte à diverses sources, tels que Beaudelaire ou un poème hindou, montre les hésitations du
concepteur de la bombe, le savant Robert Oppenheimer, et le pari des
scientifiques quand à son impact. Avec ce sujet, John
Adams revient à un thème historique,
comme dans Nixon in China ou The Death of Klinghoffer, pour un drame psychologique traité selon
un schéma narratif. Encore que l'auteur ait laissé entendre qu'il s'écartait de
l'aspect faustien du personnage. L'œuvre, donnée en création française à
l'Opéra du Rhin, sera mise en scène par Lucinda Childs,
qui signa la chorégraphie de la création, en octobre 2005, à San Francisco, et
dirigée par l'efficace et bouillant Patrick Davin.
Une expérience intéressante à n'en pas douter.
ONR, à l'Opéra de Strasbourg, les 2, 6, 9
mai 2014, à 20H, et le 4 mai à 15H ; et à Mulhouse, La Filature, le 17 mai à
20H.
Location : A Strasbourg/Opéra, 19 place Broglie
BP 80320 67008 Strasbourg cedex; par tel. : 825 84 14 84 ; en ligne : caisse@onr.fr
A Mulhouse/La Filature, 20 allée Nathan
Katz 68090 Mulhouse cedex ; par tel. : 03 89 36 28 28 ; en ligne : billetterie@lafilature.org
16, 17, 18, 19, 20 / 5
Le « Chantier Woyzeck » de la
Péniche Opéra

« Revenir aux fragments du Woyzeck de Georg Büchner afin d'en faire émerger la
musique et le livret d'un opéra de notre temps », tel est le projet conçu
par Mireille Larroche, directrice de la Péniche
Opéra. Cela donne un opéra de chambre reconstruisant une nouvelle dramaturgie,
contemporaine, à partir de la pièce inachevée de Büchner. Le compositeur
Aurélien Dumont signe la musique et le dramaturge Dorian Astor le livret. Un
opéra, en français, qui se créé et se vit dans une cité de banlieue, loin de la
caserne du Wozzeck d'Alban Berg, où la communauté est malmenée par le
projet de rénovation urbaine. 12 musiciens, 10 chanteurs, dont un chœur
d'adolescents, vont dérouler une histoire séquencée en courts tableaux, autant
d'instantanés romanesques, pour des moments de tension où affleurent énergie et
vitalité héritées du cabaret allemand. Woyzeck, tel
que vu aujourd'hui, n'est peut-être pas un soldat, mais un homme souffrant,
victime des violences sociales, empêtré dans un chaos d'espaces invisibles,
subissant cette précarité qui menace, dans un no man's land résonnant des
bruits fous de la ville. Mireille Larroche signera la
mise en scène et Pierre Roullier, à la tête de
l'Ensemble 2e2m, assurera la direction musicale. Le projet s'inscrit aussi dans
la cité puisqu'aussi bien les répétitions se dérouleront au cœur même de la
Cité Balzac de Vitry. En outre, une résidence au collège Paul Valéry de Thiais
permet tout au long de l'année la tenue d'ateliers avec le compositeur, le
librettiste et les artistes de la production.
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, les
16 et 17 (21H), 18 (16H), 19 (20H30) et 20 (14H30/scolaires) mai 2014.
Location : par courrier à Régie Théâtre
Jean Vilar, 1, Place Jean Vilar, 94400 Vitry-sur-Seine ; par tel : 01 55 53 10
60 ; en ligne : contact@theatrejeanvilar.com
Jean-Pierre Robert.
***
L'ARTICLE DU MOIS
LE
TRICENTENAIRE DE L’OPERA COMIQUE
Patrimoine et archives d’une
institution
Tout au long de la
saison 2014-2015, l’Opéra Comique célèbrera son
tricentenaire. Cet anniversaire important est inscrit au calendrier des
Commémorations Nationales pour l’année 2015. Il donnera lieu à plusieurs
événements majeurs dont certains concernent les archives de l’institution, un
axe que son directeur Jérôme Deschamps a souhaité valoriser au cours de son
mandat.
La programmation
artistique qu’il conduit depuis 2007 s’efforce en effet de renouer avec la
mémoire de l’institution, en particulier en remettant au goût du jour les
ouvrages anciens du répertoire historique de l’Opéra Comique,
parfois simplement oubliés après d’immenses succès populaires, parfois
déconsidérés par des décennies de mauvaises pratiques.
Cette démarche,
pour être conduite avec rigueur, s’est appuyée sur les travaux produits par le
monde de la recherche, raison qui a motivé la programmation de colloques
scientifiques réguliers et l’édition de programmes de salle exigeants.
Elle nécessitait
également de pouvoir utiliser régulièrement les archives de l’institution,
ambition plus difficile à mettre en œuvre, on va le voir. À l’occasion de son
tricentenaire, l’Opéra Comique a donc conçu
différentes manifestations qui favoriseront l’accès de tous, spectateurs,
chercheurs et artistes, à l’ensemble de ses archives, c’est-à-dire à sa mémoire
et à un pan important de notre histoire culturelle.

L'Opéra Comique en 2013 © Sabine Hartl & Olaf-Daniel Meyer
Rappel historique
Créé le 26 décembre
1714 par l’association de deux petites troupes parisiennes, l’Opéra Comique est l’une des plus anciennes institutions
théâtrales de France. Ses premières saisons se déroulent dans les foires de la
capitale, hauts lieux de commerces et de divertissements où le public est
particulièrement large en termes de générations et de classes sociales.
L'Opéra Comique doit s’imposer entre deux scènes royales,
l’Opéra (Académie royale de musique, et avant Académie d’Opéra, créée en 1669)
et la Comédie-Française (créée en 1680) qui détiennent chacune le monopole de
leur genre, chanté et dansé pour la première, déclamé pour la seconde. L'Opéra Comique crée donc un spectacle mi-chanté, mi-parlé, d’où le nom double de l’institution. Il
verse une lourde redevance à l’Opéra, recourt parfois à la pantomime et fait
aussi chanter le public lorsqu’il ne subit pas des périodes de fermeture,
principalement imposées par la Comédie-Française. Mais ses spectacles légers et
parodiques, qui visent particulièrement les deux répertoires officiels,
séduisent un public croissant ainsi que des artistes de premier plan, souvent
en début de carrière.
Au milieu du XVIIIe siècle, l’Opéra Comique compte une vingtaine de
musiciens, autant de chanteurs et de danseurs, et rallie des personnalités
comme le dramaturge Charles-Simon Favart, le chorégraphe Noverre, les
compositeurs Duni et Dauvergne, le décorateur
François Boucher. C’est sur cette scène que, conformément à l’esthétique du
naturel prônée par les philosophes, s’élabore l’art de l’interprétation qui
repose sur le réalisme du jeu et la vérité du costume. Marie-Justine Favart,
épouse du dramaturge, est l’une de ces artistes capables de tout interpréter,
d’incarner véritablement ses rôles, de chanter aussi bien que de jouer.
L’esprit parodique des débuts s’efface alors, laissant place à des intrigues
touchantes, à la représentation des conditions, à une nouvelle expressivité
musicale.
Installé à l’Hôtel
de Bourgogne en 1762, l’Opéra Comique reçoit le
statut de théâtre royal et devient ainsi la troisième scène officielle du
royaume, après l’Opéra et la Comédie-Française. La troupe présente souvent ses
premières à la Cour. Ses compositeurs – Philidor, Monsigny, Grétry, Dalayrac –
développent un genre léger d’effectifs et en phase avec les thèmes des
Lumières. Les ouvrages sont exportés, traduits ou adaptés sur de nombreuses
scènes d’Europe. Mozart les connaît bien et leur influence sera décisive sur le
développement de l’opéra allemand.
À partir de 1783,
l’Opéra Comique occupe son propre théâtre, la Salle
Favart. Il a alors absorbé sa rivale, la Comédie Italienne, et en fait autant
au lendemain de la Révolution avec un autre rival, le Théâtre Feydeau. Au XIXe siècle, très précisément de 1807 à 1864, en vertu d’un décret, l’Opéra Comique détient le monopole du genre opéra-comique qui se définit comme un
théâtre parlé entrecoupé de morceaux chantés ou dansés : airs, ensembles,
chœurs et ouvertures. Ses spécificités sont enseignées au Conservatoire
jusqu’en 1991.
Les compositeurs
Boieldieu, Auber, Hérold et Adam développent pour la troupe une vocalité
brillante. La période romantique voit l’Opéra Comique résister à la concurrence des salles parisiennes. Sa troupe, forte d’une
cinquantaine de musiciens et d’autant de chanteurs, entretient un esprit et un
style qui s’exportent dans toute l’Europe et qui attirent Donizetti, Meyerbeer,
Offenbach…
Sous la Troisième
République, l’institution domine la création musicale et produit les principaux
chefs-d’œuvre du répertoire français : Carmen,
Les Contes d’Hoffmann, Lakmé, Manon, Pelléas et Mélisande, L’Heure espagnole parmi d’autres.
Ce sont encore aujourd’hui les ouvrages français les plus joués au monde. Ils
témoignent à titres divers de l’évolution du genre opéra-comique, l’élément
parlé n’étant plus obligatoire depuis 1864 et l’Opéra
Comique accueillant au tournant du siècle tous les courants de la
modernité.
La première Salle
Favart avait brûlé en 1838, la deuxième brûle à son tour en 1887. Après un long
débat sur la pertinence de le maintenir sur son emplacement historique, la
troisième Salle Favart est reconstruite par Louis Bernier, sur la parcelle
délimitée sous l’Ancien Régime par le duc de Choiseul, alors propriétaire du
terrain. Elle hérite de l’orientation et des dimensions modestes du théâtre
inauguré en 1783 par Marie-Antoinette. Mais sa décoration éclectique se veut
représentative de la culture française en période d’exposition universelle. À
son inauguration en 1898, il s’agit du théâtre européen le plus moderne en
matière d’équipement électrique et de sécurité.
Malgré le succès de
ses saisons et les nombreuses créations qui émaillent le début du XXe siècle, l’Opéra Comique est fragilisé par une
subvention insuffisante. La grande dépression oblige l’État à en faire en 1939
une succursale de l’Opéra de Paris, au sein de la Réunion des théâtres lyriques
nationaux. Dès lors, il perd progressivement son identité. En 1971, sa troupe
est dissoute et la mission de la salle transformée : elle accueillera un
Opéra Studio puis des productions de l’Opéra dont, en 1987, la recréation d’Atys de Lully. Le renouveau baroque est
heureusement dès lors associé à la charmante Salle Favart, classée dix ans plus
tôt. L'Opéra Comique retrouve son autonomie en 1990
et devient une association, successivement dirigée par Thierry Fouquet, Pierre
Médecin et Jérôme Savary.
Avec le nouveau
millénaire, l’État décide de rendre à l’Opéra Comique sa juste place parmi les institutions culturelles françaises. Sous l’impulsion
de Maryvonne de Saint Pulgent, présidente du conseil
d’administration, l’Opéra Comique redevient en 2005
un théâtre national, avec statut d’établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC). Placé sous la direction de Jérôme Deschamps depuis 2007,
sa mission est triple : faire revivre le répertoire français des XVIIIe et XIXe siècles, promouvoir les œuvres baroques, favoriser la
création lyrique contemporaine.

© Sabine Harl & Olaf-Daniel Meyer
Le tricentenaire
Depuis 2007, la
programmation conduite par Jérôme Deschamps s’appuie sur le patrimoine musical
et architectural de l’institution, avec la volonté de convier le public à se
réapproprier l’Opéra Comique dans une perspective
historique : production et diffusion de spectacles remettant le riche
répertoire maison au goût du jour, restauration de l’ensemble des équipements
et des espaces publics, dont le magnifique Foyer rouvert en 2013 après six mois
de travaux. Jérôme Deschamps et ses équipes ont aussi mis à l’honneur l’accessibilité
tarifaire, le développement de la pédagogie et la mise en place de toutes
sortes de médiations autour des spectacles.
Cette démarche a
permis, saison après saison, de fidéliser spectateurs, mécènes et partenaires,
et d’assurer un rayonnement croissant de l’Opéra Comique dans les médias : tous soulignent l’originalité de son action dans le
paysage culturel français. Depuis 2007, les artistes et le public redécouvrent
son répertoire avec un intérêt croissant car l’Opéra Comique multiplie les éclairages historiques et esthétiques : reconstitution des
versions originales, interprétations historiquement informées, conférences
d’introduction, programmation faisant revivre le contexte des œuvres,
spectacles jeune public / public familial. L’excellent taux de remplissage des
représentations lyriques témoigne de la curiosité des spectateurs. L'Opéra Comique est devenu une référence pour l’authenticité
de sa démarche.
Pour la dernière
saison de son mandat, qui coïncide avec le tricentenaire de l’institution,
Jérôme Deschamps pilote des événements exceptionnels qui viendront enrichir la
saison lyrique, aussi bien dans le théâtre que hors les murs, car à ces
manifestations patrimoniales s’associent des partenaires prestigieux. Parmi
elles, plusieurs marqueront l’aboutissement de chantiers portant sur un aspect
crucial de la vie d’une institution : ses archives.
L’Opéra Comique et ses
archives
Contrairement à ses
deux aînés, l’Opéra et la Comédie-Française, l’Opéra Comique n’a jamais pu assurer la gestion de ses archives en interne. Aujourd’hui
encore, en tant qu’EPIC de moins de 300 salariés, l’Opéra
Comique ne peut engager d’archiviste. L’étroitesse du lieu lui interdit
de toute façon d’ouvrir ses portes en dehors des horaires de spectacle pour permettre
la consultation dans un centre de documentation.

La première
Carmen, Célestine Galli-Marié © Bnf
Les archives du
théâtre sont dispersées entre différentes parties de fonds des Archives
Nationales, de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque
Historique de la Ville de Paris ou encore du Centre national du costume de
scène et de la scénographie. Cette dispersion, résultant de versements ou de
prélèvements (y compris par des artistes du théâtre, dans une proportion
évidemment difficile à évaluer) est un état de fait qui a pu garantir la
conservation de pans d’archives mais elle rend leur consultation difficile. En
outre, l’inventaire est bien souvent incomplet dans chaque institution
concernée. D’ailleurs, bien peu de fonds portent encore explicitement le nom de
l’Opéra Comique et la plupart de ses collections sont
diluées dans d’autres fonds, en particulier ceux de l’Opéra. Par conséquent, la
numérisation des archives est peu ou pas réalisée. Certaines archives des
périodes les plus récentes sont restées dans les murs du théâtre. Autrement dit
et pour prendre un exemple concret, seul un chercheur chevronné peut
appréhender l’histoire de Carmen –
l’opéra le plus joué au monde – au sein de l’institution même qui l’a produit
en 1875…
De quelles archives
s’agit-il ? Nous parlons d’archives administratives (papiers officiels,
contrats, etc.), d’archives littéraires (livrets manuscrits, procès-verbaux de
censure et avis du comité de lecture jusqu’en 1906, livrets et partitions
imprimés, affiches et programmes de salle), d’archives
artistiques (cahiers de régie, matériels d’orchestre, maquettes de
costumes et de décors, livrets de mise en scène, costumes et accessoires) et
enfin d’archives audiovisuelles (enregistrements, captations, etc.).
En vertu de son
statut d’établissement public, toute archive produite par l’Opéra
Comique depuis 2005 a vocation à être versée aux Archives
Nationales. L'Opéra Comique a procédé aux versements
réglementaires à la mission des Archives – ministère de la Culture, qui réalise
l’inventaire puis verse le tout aux Archives Nationales. Le dernier versement
en date, portant sur la période dirigée par Jérôme Savary, est arrivé en 2012
aux Archives Nationales. Depuis
quelques saisons, l’Opéra Comique travaille avec la
mission des Archives au ministère de la Culture afin de sensibiliser ses
différents services à la question des archives courantes et intermédiaires.
Depuis sept
saisons, l’Opéra Comique est sollicité par des
spectateurs en quête de leur mémoire musicale ou familiale, par des musiciens
ou des institutions recherchant des sources de première main, par des
enseignants désireux de préparer leurs classes, par des étudiants souhaitant
orienter leurs recherches vers ce répertoire. Rien d’étonnant à cela : l’Opéra Comique est la principale scène de création lyrique
de France depuis le XVIIIe siècle, en termes de nouveautés créées
chaque année.
Des ressources en ligne, accessibles à tous
Dans le cadre de
son tricentenaire, l’Opéra Comique prépare donc la création
d’un site-ressources dédié, gratuit et accessible depuis la page d’accueil de
son site et celle consacrée à l’Opéra Comique sur le
site de la Réunion des Opéras de France. Baptisé archives.opera-comique.com, il est créé en partenariat avec
l’université de Rouen et la base de données Dezède,
un outil numérique développé depuis 2011 par les chercheurs au service de la
chronologie des spectacles en France. Il ouvrira en novembre 2014 et sera
enrichi tout au long des saisons suivantes par les apports conjoints de l’Opéra Comique et de ses partenaires. Le public y trouvera
une base de données interrogeable par titre, nom, date, lieu et type de
document, ainsi que des liens vers les documents numérisés. Par exemple pour Mignon d’Ambroise Thomas, on disposera
du livret d’origine, du dossier de censure, de l’affiche et des maquettes de la
création, des programmes de salle des productions successives jusqu’à tous les
éléments relatifs au spectacle de 2010.
La numérisation des
archives est conduite en partenariat avec les Archives Nationales, grâce au
financement du ministère de la Culture et de la Communication (DREST). Sont
concernées les archives littéraires et artistiques conservées aux Archives
Nationales ainsi que celles retrouvées dans les placards du théâtre,
additionnées à des legs récents : livrets, procès-verbaux de censure,
affiches, programmes de salle, brochures de saison, gravures, photographies,
billets, soit environ 2500 documents
pour près de 25 000 vues.
L’art du costume à l’Opéra Comique
Le Centre national
du costume de scène et de la scénographie (CNCS) a ouvert ses portes en 2006 à
Moulins, grâce au regroupement des collections de l’Opéra de Paris, de la
Bibliothèque nationale de France et de la Comédie-Française. Il a investi lors
d’une très belle réhabilitation le Quartier Villars,
un ancien quartier de cavalerie datant de la fin du XVIIIe siècle et
classé Monument historique. Le CNCS est la première institution au monde
consacrée à la conservation et à la valorisation des costumes et des décors de
scène. Deux expositions thématiques y sont organisées chaque année, chacune
agrémentée d’une série de manifestations pédagogiques. Leur rayonnement est
national.

La première
Mélisande, Marie Garden © Bnf
Il se trouve que
les costumes les plus anciens des vastes collections du CNCS sont ceux de l’Opéra Comique. Ils sont arrivés dans le fonds de l’Opéra,
qui les avait prélevés dans l’Atelier costumes de la Salle Favart au cours de
la période de fusion entre les deux institutions. Beaucoup de ces pièces
extraordinaires n’ont encore jamais été dévoilées au public. Le tricentenaire
de l’Opéra Comique offre donc l’opportunité de
concevoir au CNCS une exposition exceptionnelle. Intitulée « L'Opéra Comique et ses trésors », elle se déroulera de
février à mai 2015.
Cette manifestation
en région permettra aussi de rappeler que le répertoire de l’Opéra Comique fut longtemps le plus joué dans les
provinces, le plus perméable aux cultures régionales, le plus accueillant pour
des artistes formés dans toute la France.
Ce projet
d’exposition, la première consacrée à l’art du costume très original de l’Opéra Comique, permet également à l’institution de recenser
les costumes déclassés encore présents dans ses réserves. Celles-ci sont
situées au-dessus du Foyer public du théâtre, sur les trois étages qui
entourent l’Atelier toujours en activités aujourd’hui. Dans de vieux placards
en bois ou dans des armoires montées sur rails dorment des centaines de pièces,
dont les plus anciennes portent des tampons d’inventaire du XIXe siècle ou encore, inscrits à l’encre par les habilleuses dans les doublures,
les noms d’artistes prestigieux de la troupe comme Taskin,
créateurs des trois personnages diaboliques dans Les Contes d’Hoffmann en 1881, ou Félix Vieuille,
créateur du rôle d’Arkel dans Pelléas et Mélisande en 1902. Les productions dont il reste le plus grand
nombre de costumes livrent des enseignements intéressants. On découvre que les
choristes portaient des costumes distincts aux différences fortement accusées,
afin de faire vivre tout un peuple ou toute une cour sur scène. Ou encore que
les solistes bénéficiaient du droit de traiter avec un couturier de leur choix
et conservaient bien souvent leurs costumes, autant pour assurer des tournées
qu’en souvenir de leurs succès. Autrement dit, les archives recèlent beaucoup
d’Espagnols mais peu de Carmen, beaucoup d’Indiens mais peu de Lakmé, etc. Pour identifier ces costumes, il est
indispensable de consulter les inscriptions dans les doublures et les tampons
d’inventaires afin de les confronter aux listes et inventaires conservés dans
les placards ou récupérés dans les fonds d’archives. Ce vaste recensement en
interne doit permettre à l’Atelier de développer sa banque de données
techniques, et au théâtre de constituer un fonds destiné à la conservation au
CNCS.
L’exposition du
CNCS invitera le public à déambuler dans le répertoire, à la rencontre des
personnages et des artistes qui firent son histoire. Une partie interactive de
l’exposition sera dévolue aux métiers et aux techniques propres à l’Atelier
costumes de l’Opéra Comique : il est aujourd’hui
à la pointe de la recherche en ce qui concerne la teinture végétale, un procédé
qui permet aux créateurs de développer leur palette de couleurs et de matières,
et au théâtre de ne plus polluer l’environnement par les matériaux utilisés et
par le rejet des eaux usées.
Seront exposés
environ 100 costumes ; de nombreux chapeaux, perruques et
accessoires ; des éléments de décor conservés au CNCS ; des reproductions
d’affiches, de gravures, de maquettes mais aussi des peintures ornementales du
théâtre ; des extraits de spectacles ; des reportages et des
interviews filmés dans l’Atelier costumes ; des maquettes de la Salle
Favart…
Enfin l’exposition
donnera lieu à la publication d’un catalogue qui fera un état des lieux des
connaissances sur le sujet, sujet crucial si l’on considère que le costume est
l’élément visuel qui permet au chanteur de s’identifier avec le personnage et
au public d’adhérer aux codes de la représentation.
Les grandes heures de l’Opéra
Comique

Affiche de la
création de Lakmé © Bnf
En 2012-2013, les
recherches conduites sur la décoration de la Salle Favart, dont le Foyer a été
restauré cette année-là avec l’aide du World Monuments Fund,
ont mis en lumière l’importance et la variété des liens entre l’institution et
les arts durant la Belle Époque. Architecture, patrimoine décoratif, techniques
des métiers d’art mais aussi nouvelles pratiques théâtrales, écoles
littéraires, courants musicaux : l’Opéra Comique apparaît sous la Troisième République comme un véritable carrefour des arts,
des disciplines, des techniques et des esthétiques.
Ce constat a abouti
à l’idée d’une exposition parisienne axée sur les arts scéniques en lien avec
les arts plastiques, et concentrée sur la période la plus faste de
l’institution, la Belle Époque, qui débute avec la création de Carmen, atteint son apogée avec la
création de Pelléas et Mélisande et s’achève avec la
création de Mârouf, savetier du Caire.
Il est apparu que
cette période se trouve au cœur des collections du Petit Palais – qui monte en
ce printemps 2014 une grande rétrospective « Paris 1900. La
ville-spectacle ». C’est dans ce musée que se tiendra donc, de mars à juin
2015, une exposition intitulée « Carmen et Mélisande, drames à l’Opéra Comique », à laquelle la Bibliothèque nationale
de France apportera son concours. Les œuvres exposées proviendront
principalement des musées de la Ville de Paris et de la Bibliothèque nationale
de France. Elles seront de natures très diverses : peintures, sculptures,
costumes, éléments de décors, objets, accessoires, maquettes, plans,
manuscrits, affiches, photographies, documents audiovisuels.
Le propos se veut
pédagogique et grand public. Il s’appuiera sur ce qui est le plus connu du
public pour dresser le tableau d’une époque. Ainsi, l’échec de Carmen est révélateur des usages de la
bonne société parisienne. Les peintres impressionnistes sont indissociables de
leur ami collectionneur, le compositeur Emmanuel Chabrier. L’épouvantable
incendie de la Salle Favart en 1887, en pleine représentation, donne lieu à la
mise en place de normes de sécurité pour les lieux publics. Les provinces et
les colonies se donnent en spectacle sur la scène de l’Opéra
Comique alors que Paris accueille les expositions coloniales ou
universelles. C’est à la Salle Favart qu’Émile Zola introduit le vérisme sur la
scène lyrique. Le succès de Massenet fait écho à la condition féminine dans la
société française. Puccini fait de l’Opéra Comique le
point de départ de son rayonnement international. C’est dans la Salle Favart
que l’usage de l’électricité et du téléphone se généralise dans le spectacle.
C’est là que la direction d’orchestre moderne se met en place. C’est là que le
jeu d’acteur et la scénographie moderne se développent...
x
x x
Ces trois projets
figurent parmi la série d’événements qui rythmeront une saison entière de
commémoration du tricentenaire de l’Opéra Comique.
Ils illustrent plus spécifiquement l’importance que revêtent les archives dans
la vie d’une institution publique : ce sont des données qui lui permettent
d’ancrer son action, d’inspirer ses partenaires et de mobiliser le public –
toujours passionné de mise en contexte. Pour l’Opéra Comique dont la programmation artistique est indissociable de
l’idée de patrimoine, la question des archives était cruciale. Les rassembler
et les valoriser constituaient certains des enjeux du tricentenaire. Il
apparaît plus largement que le document d’archive, lorsqu’il est bien présenté
et contextualisé, est un excellent support pour aider le public à comprendre le
sens d’une œuvre et le fidéliser dans ses pratiques culturelles.
Agnès Terrier*.
* Agnès Terrier est dramaturge de l’Opéra Comique.
FOCUS SUR LA MUSIQUE NOUVELLE
Thomas Hewitt Jones
Ce jeune compositeur, organiste et
chef de chœur londonien né en 1984 est, aujourd’hui, l’une des figures
emblématiques de la musique sacrée de Grande-Bretagne(1).
Pour autant, son art est également dédié, avec autant de talent et d’inspiration,
à la musique instrumentale et de ballet. Ses partitions destinées au théâtre et
à la télévision attestent de sa capacité à la diversité quant à sa maîtrise du
métier de compositeur. Ce faisant, par son ouverture d’esprit, il témoigne
d’une disposition à considérer le langage musical comme une expression
homogène, non compartimentée de manière arbitraire. Ainsi, Thomas a-t-il
également travaillé pour Hollywood en tant qu’assistant du compositeur de
musique de film David Buckley. J’ai eu le privilège de le rencontrer récemment
au British Museum de Londres. Au cours de notre entretien, il a évoqué son
travail en toute simplicité et enthousiasme.

© Robin
Farquhar-Thomson
Son père, Tim, violoncelliste à l’Orchestra of the Royal Opera House (Covent Garden), sa mère, professeur de
violon à la Dulwich Preparatory School, et ses grands-parents paternels, Tony et
Anita, tous deux compositeurs, ont singulièrement contribué au développement de
son élan musical. Grâce aux répétitions du samedi matin au Covent Garden, Thomas a dès son plus jeune âge forgé son vocabulaire musical tout en
étant particulièrement touché par la profondeur de la musique orchestrale du
XIXe siècle. C’est dans ces conditions favorables qu’il deviendra un excellent instrumentiste, maîtrisant
aussi bien l’orgue, le piano que le violoncelle. Avec ce dernier instrument, au
sein du National Youth Orchestra, il a eu notamment
le privilège de participer à l’exécution de la Huitième Symphonie de Gustav
Mahler sous la direction de Sir Simon Rattle.
Âgé de neuf ans, il accompagnait les
hymnes s’initiant, de la sorte, à l’apprentissage de la mélodie et de
l’harmonie. La première revêtant de l’importance pour Thomas comme pour tout
musicien anglais soucieux de forger l’alliance entre le répertoire des folk-songs et
celui du chant d’assemblée, vivant et incarné.
Hewitt Jones a été organ scholar à Gonville and Caius College,
l’un des trente et un collèges de l’université de Cambridge(2),
où il a étudié la musique et développé son profond intérêt pour la musique
chorale. Au cours de cet apprentissage, il a apprécié de pouvoir étudier et
jouer l’œuvre de Bach.
En 2003, il a reçu le prix de la BBC
Young Composer Competition. Depuis lors, sa musique
est exécutée, enregistrée et publiée par des éditeurs tels que, entre autres, Faber Music, Novello, Oxford University Press ou encore Boosey & Hawkes.
Fantasy, pour orchestre
à cordes, est composée en 2004 pour l’excellent National Youth Orchestra Sinfonietta. Thomas Hewitt Jones l’a dirigé
lui-même à Cadogan Hall (Londres) à la tête du BBC Proms Chamber Concert. Cette œuvre en trois parties,
destinée à de jeunes instrumentistes, témoigne d’un langage libre autant
qu’original de par la qualité de son expression mélodique.
Hewitt Jones aime également composer
pour le ballet considérant, avec enthousiasme et intérêt, que les danseurs ont
une tout autre approche du langage musical. Lady
of the Lake, conçu au printemps 2010, est une commande du chorégraphe
Darius James, directeur artistique du Ballet Cymru,
au Pays de Galles. Il s’agit, en l’occurrence, du troisième ballet d’une
trilogie dont les deux précédents étaient Under
Milk Wood (2008), d’après le poète gallois Dylan
Thomas (1914-1953), et le fameux How
Green was my Valley (2009) de Richard Llewellyn (1906-1983). Lady of the Lake se fonde sur la mythologie
arthurienne telle, notamment, que Sir Walter Scott (1771-1832) l’a évoquée en
1810 dans son poème narratif. La source principale de Thomas se trouve dans le corpus du
folkloriste Sir John Rhys (1840-1915) publié en 1901.
Un jeune homme, Owain, tombe amoureux de la magique
« Dame du Lac ». Une promesse de mariage est conclue à une certaine
condition. La suite s’imagine facilement et la musique de Hewitt Jones traduit
admirablement une telle quête. Il lui importe, en effet, de bien raconter une
histoire.
Son carol, Child of the Stable’s Secret Birth, associé aux paroles de Timothy Dudley-Smith
(*1926), a été créé en décembre 2010 par son éminent maître, John Rutter (*1945)(3),
à la tête du Royal Philharmonic Orchestra, au Royal
Albert Hall. La même année, Thomas Hewitt Jones participait aux Jeux Olympiques
en composant et produisant une charmante musique pour quatre films animés (Mascot Films) à
partir d’histoires écrites par Michael Morpurgo,
connu pour ses ouvrages de littérature enfantine. Ces textes étaient dits par
le grand acteur et écrivain Stephen Fry. Dans le même temps, il assistait à la
création, par le compositeur et chef de chœur David Ogden, de The Same Flame, un cycle de songs fondé
sur les valeurs olympiques et humanistes, à partir des textes du poète et homme
de radio Matt Harvey.
En décembre 2012, le fameux et
emblématique Hallé Orchestra(4),
conduit par l’éclectique Roderick Dunk,
a donné la création de A Christmas
Cracker – musique imprégnée par la remarquable et
émouvante tradition victorienne du carol et un humour irrésistible – au
Bridgewater Hall de Manchester avant ses exécutions au Canada et aux USA. Le
même mois, la dynamique Sloane Square Choral Society,
fondée en 2011, donnait la première de Incarnation – A Suite
of Songs for Christmas sur
des poèmes de l’Australien Paul Williamson. À l’instar de tout Anglais, Noël
constitue un temps extrêmement important pour Hewitt Jones, au sein du
calendrier liturgique. Cette riche et profonde partition témoigne, sans
conteste, de l’extraordinaire synthèse entre la musique, la poésie, la
théologie et l’histoire grâce à l’étroite collaboration du compositeur et du
poète. L’itinéraire sonore conduit l’auditeur de l’inquiétude joyeuse à la paix
la plus sereine.
L’année suivante, Formation, sur des textes du romancier
et biographe Andrew Motion, sera une commande du chef de chœur et organiste
Ralph Woodward et ses Fairhaven Singers de Cambridge, afin de commémorer la naissance de Benjamin Britten, en 1913, et
la mort de John Fitzgerald Kennedy, en 1963.
Pour ce qui concerne son domaine de prédilection, la musique chorale, Thomas Hewitt Jones considère qu’elle constitue une merveilleuse source de communication pour un compositeur qui s’inscrit dans la longue tradition anglaise des musiques de cathédrales et de paroisses(5). Son sens inné de la mélodie lui procure également un remarquable équilibre destiné aussi bien aux chanteurs amateurs qu’aux professionnels les plus expérimentés. L’une de ses partitions les plus touchantes est certainement son motet In the bleak midwinter (2010/11) sur un poème de Christina Georgina Rossetti (1830-1894)(6). Ce très beau texte avait déjà été traité, en 1904/05(7), par Gustav Holst (1874-1934)(8) puis, en 1909, par le Dr Harold Edwin Darke (1888-1976)(9). Le motif qui préside au chant de Hewitt Jones est caractéristique de sa pensée musicale :
 (10)
(10)
Le commentaire qu’il en donne mérite
d’être cité : « Par contraste avec les célèbres mises en musique de
G. Holst et H. Darke (toutes deux ayant récemment
bénéficié d’un sondage les classant comme les carols les plus appréciés en
Grande-Bretagne), cette version de In the bleak mid-winter se
présente comme un souple ¾. Afin de respecter les délais, la nouvelle musique
destinée au temps de Noël est généralement composée durant l’été. Je me
rappelais alors une sombre soirée de décembre 2010. L’humeur hivernale se
retrouve dans les harmonies de la pièce qui transmet un sentiment de nostalgie
sombre. Doux et délicat dans le caractère, j’espère que cette version procure
une émouvante alternative à l’interprétation de ce beau texte de Christina
Rossetti. »
En 2011, la commémoration du quatre
centième anniversaire de la King James
Bible a inspiré Hewitt Jones pour son anthem(11), Lead me, O Lord (Ps
5,8), publié par la Royal School of Church Music(12) dont
il est un membre éminent avec de nombreux autres compositeurs de sa génération.
C’est à partir de son intuition que
Thomas choisit le texte qu’il mettra en musique. Fidèle à son contenu, il est
particulièrement soucieux d’aider ses auditeurs à sa compréhension. Sa culture
poétique et théologique le soutient sans aucun doute dans sa démarche. C’est
alors que son inspiration mélodique trouve à s’épanouir grâce à sa conception
particulière de l’harmonie. Horizontalité et verticalité se stimulent
réciproquement.
Le carol Baby in an Ox’s Stall, pour soprano
solo, chœur et piano, date de 2012. Il constitue un émouvant témoignage de
reconnaissance au compositeur, éditeur et écrivain anglo-gallois
Peter Warlock (1894-1930)(13), proche de Frederick Delius (1862-1934). Le texte est également de
Thomas Hewitt Jones.
Sans conteste, Thomas se situe dans
une riche continuité dont la source remonte incontestablement au concept de sweet music jadis
incarné par John Dunstable (ca 1385-1453).
Transcendant néanmoins les étapes chronologiques, ses modèles se trouvent à
chaque grande période de la musique anglaise : de John Bacchus Dykes (1823-1876)(14) à
Gerald Finzi (1901-1956) en passant par Sir Hubert
Charles Hastings Parry (1848-1918), Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924), Charles Wood (1866-1926) et John Ireland (1879-1962) – l’un des
professeurs de Benjamin Britten (1913-1976) – qu’il affectionne
particulièrement. L’oratorio de Sir Edward Elgar (1857-1934), The Dream of Gerontius (1900), d’après
le poème de John Henry Newman (1801-1890), constitue de même une référence
essentielle pour lui. Pour autant, Hewitt Jones est bel et bien un compositeur
de notre temps, avec son langage spécifique, nourri par une culture sonore qui
défie les dogmes.
James Lyon.
(2) Fondé une
première fois, en 1348, par Edmund Gonville († 1351),
puis en 1557 par John Caius (1510-1573).
(3)John Rutter, associé à la ville et au monde universitaire de
Cambridge, est connu dans le monde entier pour la qualité particulière de sa
musique chorale.
(4) Fondé en 1857,
à Manchester, par le chef d’orchestre et pianiste d’origine allemande Sir
Charles Hallé (1819-1895).
(5) Depuis de
nombreux siècles, un corpus de grande
importance s’est constitué au quotidien pour le répertoire destiné aux services
religieux, plus particulièrement de l’Evensong, fondé sur le Magnificat et le Nunc dimittis.
(6) Poétesse
anglaise, sœur du peintre et écrivain préraphaélite Dante Gabriel Rossetti
(1828-1882).
(7) Publié en 1906
dans l’English Hymnal.
(8) Plus
particulièrement connu, hors de l’Angleterre, pour sa suite orchestrale, en
sept mouvements, The Planets (1914/16).
(9) Compositeur et
organiste anglais. Il a étudié la composition et l’orgue au Royal College of Music sous la direction de Stanford et de Sir Walter Parratt (1841-1924). Darke est essentiellement connu pour sa mise en musique de In the Bleak Midwinter de Christina Georgina Rossetti, chanté le
plus souvent pour le service des Nine Lessons and Carols, à King’s College, Cambridge.
(10) (C) Copyright the Royal School of Church Music.
(11) Que l’on peut
aussi traduire par « motet ».
(12) www.rscm.com
(13) Pseudonyme de
Philip Heseltine.
(14) Connu pour la qualité de ses mélodies (tunes), Dykes a effectué une grande partie de sa carrière à Durham.
***
SPECTACLES ET CONCERTS
Reprise de Pelléas et Mélisande à l'Opéra Comique
Claude DEBUSSY : Pelléas et Mélisande.
Drame lyrique en cinq actes. Livret du compositeur d'après la pièce éponyme de
Maurice Maeterlinck. Phillip Addis, Karen Vourc'h, Laurent Alvaro, Jérôme Varnier,
Sylvie Brunet-Grupposo, Dima Biward,
Luc Bertin-Hugault. Accentus.
Orchestre des Champs-Elysées, dir. Louis Langrée. Mise en scène : Stéphane Braunschweig.

© Elisabeth Carrechio
Il est impossible de faire abstraction, en
assistant à une représentation de Pelléas et Mélisande à l'Opéra Comique, du fait que s'y
est tournée une page essentielle de l'histoire de l'Art lyrique. Production
scénique et interprétation musicale ne peuvent que s'en ressentir. Le texte de
Maeterlinck, que Debussy a fidèlement suivi, nonobstant quelques coupures
mineures, requiert l'intimité, ne serait-ce que parce qu'il en appelle souvent
à une dramaturgie du silence, ce « silence actif » dont le poète
belge souligne la prégnance, qui « détermine et fixe la saveur de
l'amour ». Lors de la scène cruciale du IV acte, un silence extraordinaire
sépare deux répliques (Pelléas : « Tu ne sais
pas que c'est parce que.. Je t'aime » ; Mélisande
: « Je t'aime aussi ». Il participe aussi de l'univers « des
choses dites à demi ». C'est sans doute ce qui a conduit Stéphane Braunschweig dans sa mise en scène à privilégier l'épure et
à s'écarter des conventions du théâtre lyrique, dont on sait combien Debussy
les avait en détestation. Elle s'inscrit dans un univers clos d'immenses
persiennes pour décrire ce qui « semble voué à la maladie, la vieillesse
et la mort », ou au contraire dans une perspective ouverte, celle de cette
fontaine « des aveugles » dont les deux jeunes gens affectionnent la
quiétude. Braunschweig joue le symbolisme de la pièce
de Maeterlinck et sa direction d'acteurs, d'une rare justesse dans sa sobriété,
portraiture des personnages archétypes : un adolescent étrange, une jeune femme
énigmatique, un mari rongé par les affres du soupçon, un vieillard qui semble
ne rien voir de ce qui se trame sous la chape de plomb d'un château perdu au
milieu de nulle part, et un enfant qui continue à jouer en solitaire. On est
bien près de ce « tragique du quotidien » dont parle Maeterlinck. La
régie saisit une réalité, qui n'est pas réalisme. Elle ne souligne jamais mais
suggère la consistance de sentiments bien humains : l'effroi de Pelléas devant les profondeurs du gouffre, assurément
celles de ses pensées, l'angoisse de Golaud à l'idée
de pouvoir être trahi par un demi-frère qu'il n'hésite pourtant pas à lancer
dans les bras de son épouse lorsqu'il faut aller rechercher la bague perdue
dans les souterrains de l'inconnu. Trait saisissant : il les poussera encore
l'un vers l'autre lors de leur ultime échange enamouré. La jeunesse des deux
héros, dont les scènes sont vécues « comme des rêves d'enfance et
d'innocence » crie l'évidence. N'évoluent-ils pas comme deux êtres sans arrière-pensée,
sans se soucier « des pièges de la destinée » ? La scène de la tour
en fournit un exemple topique, qui les voit évoluer dans une étonnante
proximité, traduisant, au-delà des didascalies du texte, la vérité de la
première étreinte amoureuse.
.

© Elisabeth Carrechio
La couleur a beaucoup d'importance dans
cette production scénique. Elle en a tout autant dans l'interprétation
musicale. On l'apprécie d'autant mieux grâce à l'immédiateté de l'acoustique de
la salle Favart, qui offre une présence à laquelle on est de moins en moins
habitué, formatés que nous sommes par des exécutions dans des salles de large
gabarit. La transparence de l'orchestration debussyste, ses traits merveilleux
des vents, en particulier du hautbois, trouvent un équilibre parfait dans
l'exécution de l'Orchestre des Champs-Elysées, sous la conduite de Louis Langrée. Comme ses véhémences, au point parfois de lutter
avec le chant. On croit volontiers que, contrairement à Wagner, Debussy laisse
à la prosodie du chant une parfaite intelligibilité. C'est loin d'être toujours
le cas. Il n'est que d'écouter la scène finale de l'acte III, durant laquelle Golaud exige de son fils Yniold d'épier les amants, pour se convaincre du contraire. Et pourtant, ici comme
ailleurs, Louis Langrée favorise-t-il une diction
très naturelle, faisant sien ce mot de José van Dam « Chanter c'est parler
plus haut ». Le Golaud de Laurent Alvaro
s'inscrit dans le sillage de ses illustres prédécesseurs, dont van Dam
précisément : après un début précautionneux, l'appréhension du rôle s'avère
assurée, se permettant même, avec la complicité du chef, des ralentissements
audacieux (échange avec Mélisande lors de l'évocation de la chute de cheval) ou
des pianissimos inouïs, à la dernière scène, sur la phrase « Mélisande,
as-tu pitié de moi...». Le Pelléas de Phillip Addis offre cette étrangeté légèrement détachée, puis une
fébrilité lors de la première scène de l'acte IV, qui rendent crédible la
transformation s'opérant chez le jeune homme, prenant conscience peu à peu
combien son attirance pour Mélisande est irrésistible. Le timbre clair de
baryton Martin est pur bonheur, et la quinte aiguë sûre, n'était une certaine
dureté çà et là, en seconde partie. Karen Vourc'h a
approfondi le personnage de Mélisande, le dotant d'une sensibilité à fleur de
peau, tout en gardant cette réserve, voire une distance, qui la conduisent dans
les contrées de l'énigmatique. Le timbre de soprano, irisé de teintes mezzo,
offre comme une fêlure dans cette voix réellement du bout du monde. Jérôme Varnier est un Arkel, dont le
registre de basse ne souffre pas la moindre difficulté dans les passages en
haut de registre, et sa vision de ce vieillard ambigu est des plus crédibles ; mais Sylvie Brunet-Grupposo,
Geneviève, offre un vibrato quelque peu gênant lors la lecture de la lettre. Ce
qui frappe le plus partout, c'est la fraîcheur dans le chant, en adéquation
avec la justesse qui se dégage de la conception scénique.
Jean-Pierre Robert.
Grandes pages de musique symphonique française

DR
Dans l'orbite des représentations de Pelléas et Mélisande, l'Orchestre des Champs-Elysées et
Louis Langrée offraient un concert au programme
spécifiquement français associant Debussy, Fauré et Chausson. Que de bonheur !
La musique française de la fin du XIX ème est marquée
par le phénomène d'attirance-répulsion vis à vis de Wagner. Nombreux sont ceux
qui ont fait le voyage à Bayreuth et ne peuvent s'empêcher de louer le génie
dramatique du musicien allemand. Même s'ils s'en défendent âprement,
l'empreinte est sérieuse, presque
inconsciente (dans certains des interludes de Pelléas et Mélisande, par exemple). Mais l'appel au renouveau, initié par César
Franck, contrebat ces velléités suivistes et chacun cherche à se dégager de
l'emprise du sorcier germanique. Écrit durant la genèse de Pelléas précisément, le Prélude à l'après midi d'un faune fut conçu pour accompagner
le poème de Mallarmé. Langrée en offre une exécution
pleine de sensualité et presque paresseuse dans son débit lent et sinueux. La
flûte de Marion Ralincout est vraiment enchantée.
Fauré, auquel on avait demandé une musique de scène pour les représentations en
anglais du drame de Maeterlinck, Pelléas et
Mélisande, devait en tirer une Suite en quatre parties. L'orchestration en est
extrêmement raffinée, d'une alchimie de couleurs inouïe. La perfection
fauréenne, son apparente simplicité, sa pudeur d'expression viennent
naturellement grâce à l'immédiateté de l'acoustique de la salle Favart, alors
que l'orchestre est disposé dans le décor même de persiennes closes du drame de
Debussy. On se laisse bercer par la féérie transparente du « Prélude »,
la tendresse ingénue de « La Fileuse », avec son solo de hautbois, où
Olivier Rousset s'avère magnifique, la nonchalance de la
« Sicilienne », où domine la flûte, alors que le chef ralentit encore
sur le second thème, pris très lent, enfin le drame discret mais puissant de
« La Mort de Mélisande » qui conclut la pièce sur une touche intense.
Le morceau sans doute le plus attendu était la Symphonie d'Ernest Chausson,
hélas si peu jouée. Cette unique incursion dans le domaine proprement
symphonique, Chausson la concevra en 1889/1890. L'admiration pour le maître de
Bayreuth est ici totalement assumée, comme d'ailleurs dans d'autres œuvres du
musicien, son opéra Le Roi Arthus en particulier. Mais l'héritage de
Franck ne l'est pas moins. L'orchestre est nettement plus fourni, avec cors et
trompettes par quatre, trois trombones et un tuba, outre deux harpes. Elle
s'ouvre par un « Lento » grandiose, sombre dans le vrombissement des
cordes graves, qui débouche sur un épisode lyrique paré d'une instrumentation
chatoyante. Le mouvement central « Très lent » ne cache pas sa dette
wagnérienne, puisque évoquant l'atmosphère douloureuse qui baigne le III ème acte de Tristan und Isolde. La partie développée de cor anglais est là pour le rappeler encore,
si besoin était. Il atteindra des sommets sonores bien cuivrés, un peu à
l'étroit dans la salle de l'Opéra Comique. Le finale
« Animé », puis « Très animé », est le terrain d'une lutte
du génie français contre l'ombre tutélaire de Wagner. Mais le développement est
riche de thèmes qui se métamorphosent à l'envi, au point de se perdre dans
leurs propres méandres, avec alternance de moments de répit et d'amples
fortissimos, dignes de Bruckner. La symphonie s'achève cependant sur une
séquence marquée « Grave », optimiste, comme si quelque chose venait
d'être vaincu. Louis Langrée, qui connait bien cette
pièce, pour l'avoir déjà livrée au disque, en donne une lecture d'une passion
contenue et d'un beau raffinement, à laquelle l'Orchestre des Champs-Elysées
apporte une vraie rutilance sonore, mais non clinquante.
Jean-Pierre Robert.
Laurent Pelly s'empare du Comte Ory à l'Opéra de Lyon
Gioacchino ROSSINI : Le Comte Ory. Opéra en deux
actes. Livret d'Eugène Scribe et Charles-Gaspard Delestre-Poirson. Dmitry Korchak, Désirée Rancatore, Antoinette Dennefeld,
Doris Lamprecht, Jean-Sébastien Bou, Patrick Bolleire,
Vanessa Le Charlès, Didier Roussel, Yannick Berne,
Dominique Beneforti. Orchestre et Chœur de l'Opéra de
Lyon. Mise en scène : Laurent Pelly.

© Bertrand Stofleth
Trop rarement représenté, Le comte Ory n'en révèle pas moins une facette attrayante de
Rossini. On sait que cet opéra, créé à Paris en 1828, reprend pour une large
part des morceaux conçus pour un précédent ouvrage, Le Voyage à Reims,
œuvre de circonstance écrite trois ans plus tôt pour le couronnement de Charles
X. Dans ce nouvel opéra français, Rossini se montre plus ironique que comique,
au fil d'une farce quelque peu grossière
et décousue sise en Touraine moyenâgeuse : un jeune libertin, le comte Ory s'est juré de conquérir une comtesse, Adèle, esseulée
par le départ de son époux à la croisade. Le garçon n'hésite pas à se travestir
en ermite, puis en nonne, pour parvenir à ses fins. La belle
s'avèrera pas si farouche qu'on l'aurait pensé. La minceur du sujet et le caractère
répétitif de la vis dramatica dans chacun des deux
actes ne sont pas pour décourager Laurent Pelly qui
tire de cette turlupinade médiévale matière à réflexion et parvient à en animer
la plus banale réplique. L'ironie se fait cynisme et c'est de satire sociale
qu'il va être question. Au lieu du paysage prosaïque proposé par le livret au Ier acte, il installe une sorte de salle de patronage où
affluent les villageois pour tester les vertus d'un ermite... devenu gourou, à
la mode hindoue et aux pouvoirs mystificateurs dignes du charlatan de l'Elisir d'amore de Donizetti.
Les dames se pressent pour en obtenir l'onction et tombent en pâmoison. La
situation devient « abracadabrantesque » à l'arrivée inopinée de la
comtesse qui s'empresse de se brûler, tel un papillon, à l'aura magique
pourtant grossière émanant du bonhomme. Le finale, transposé du fameux « Gran pezzo concertato a 14 voci » du Voyage à Reims, forme une conclusion endiablée où le libertin est démasqué.
On aura noté combien Pelly cherche à faire coller la
gestuelle de tout un chacun à la métrique musicale. Le second acte lui offre
encore plus d'aise avec, cette fois, un héros qui se fait passer pour une
religieuse, flanqué de quatorze autres de ses compères costumés sous pareille
apparence. La fantaisie prend alors un tour caustique, le scabreux devient
leste et le truculent vire au salace ; car ces messieurs harnachés en pèlerines
sont loin d'être des saintes-nitouches. La scène bachique est franchement
irrésistible, dans la meilleure veine hilare du metteur en scène. Auparavant on
aura apprécié une « temporale » (musique de tempête) - souvent de
rigueur chez Rossini - visualisée de manière fort originale avec casseroles et
cuvettes censées contenir les fuites causées par ce phénomène naturel dans la
demeure seigneuriale. Un habile décor, glissant de droite à gauche, découvre
successivement le salon du château, la chambre à coucher et sa salle de bains,
et à l'inverse l'office-cuisine où l'on vient se rafraichir en piochant dans le
réfrigérateur et y découvrir des intrus(es) affalé(e)s autour de la table,
dissimulant à peine des rires gras. Plus tard, le trio, une des meilleures
pages de la pièce et lieu d'un habile quiproquo, sera magistralement explicité
: Ory, croyant courtiser la belle Adèle, lutine en
réalité son page Isolier, lui-même en affaire avec la
maitresse des lieux, tous trois sur le lit d'icelle dans une position des plus
suggestives, et pendables. Dommage que le finale, qui voit le séducteur
invétéré de nouveau démasqué, n'offre pas l'occasion d'un vrai feu d'artifice,
la vacuité dramatique étant alors difficile à combattre. Mais il aura eu lieu
auparavant.

© Bertrand Stofleth
Musicalement, les facteurs sont plus
contrastés. La direction de Stefano Montanari est moins libérée qu'attendue de la part d'un
chef qui passe pour « un dynamitero de
l'orchestre », aux dires de ses supporters. Empêtrée dans ce qui est un
mélange insaisissable de comique et de retenue, elle ne dégage que peu de
fantaisie. Le clin d'œil, sur le fil, tant sollicité côté scénique, est, dans
la fosse, plus en retrait. L'emploi de « tenore di grazia » n'est pas aisé à défendre et peu
aujourd'hui s'y montrent convaincants. Dmitry Korchak est un Ory décontracté,
sympathique dans sa faconde sans complexe, visiblement plus en phase avec
l'habit de nonne que fagoté en gourou tout droit sorti d'un film de Bollywood. Mais la ligne de chant n'offre pas toujours
cette sûreté indispensable à la maestria rossinienne, en particulier dans la
quinte aiguë, passée plus en force qu'en grâce. La comtesse Adèle de Désirée Rancatore, interprétée façon soprano colorature, est
désopilante dans sa vraie-fausse naïveté et le jeu qu'elle se livre à
elle-même. Pelly imagine le personnage un peu mûr, ce
qu'accentue l'aspect vestimentaire, jupe ajustée à l'ancienne, cardigan rose.
Le chant réserve une vocalité accomplie. Mais la palme revient à la jeune
Antoinette Dennefeld, qui dans le rôle du page Isolier, illumine la soirée de son chant aisé, agrémenté
d'une prestance idéale de travesti. Jean-Sébastien Bou, Rimbaud, est lui aussi
fort amusant, en particulier lors de son air, recyclé de celui du personnage de
don Profondo du Voyage à Reims, où bagout et
vitesse d'élocution sont de rigueur. La basse Patrick Bolleire est moins à l'aise dans le rôle, à vrai dire difficile à animer, du Gouverneur.
Les chœurs de l'opéra de Lyon s'en tirent avec panache, notamment en leur
incarnation virile des nonnes, fidèles ouailles du comte Ory qui leur fait endosser le plus « hénaurme »
des canulars.
Jean-Pierre Robert.
Un rare opéra-ballet de Rameau
Jean-Philippe RAMEAU : Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour. Opéra-ballet en un
prologue et trois entrées. Livret de Louis de Cahusac.
Chantal Santon -Jeffery, Carolyn Sampson,
Blandine Staskiewicz, Jennifer Borghi,
Mathias Vidal, Reinoud van Mechelen, Tassis Christoyannis, Alain Buet. Chœur
et orchestre du Concert Spirituel, dir. Hervé Niquet.

Hervé Niquet © Éric Manas
Belle introduction à l'année Rameau que
cette exécution de concert de l'opéra-ballet Les Fêtes de l'Hymen et de
l'Amour. Créé en mars 1747 à Versailles, dans le manège de la Grande
Écurie, pour le second mariage du Dauphin, il marquait la deuxième
collaboration de Rameau avec Louis de Cahusac.
Accueilli avec enthousiasme au point d'atteindre les 150 représentations, il
sombrera ensuite dans l'oubli. Ce concert lui faisait vivre une sorte de
résurrection. Sous-titré « Les dieux d'Égypte », la thématique en est
centrée plus sur le merveilleux que sur la vérité historique, où il est question
des pouvoirs extraordinaires des dieux et des effets magiques de la nature. Eu
égard au prétexte festif, la pièce est nantie d'un prologue mettant en scène la
réconciliation de l'hymen et de l'amour. Trois actes, ou entrées, suivent, le
premier « Osiris », marquant cette incursion nouvelle de Rameau dans
le domaine de la mythologie égyptienne. Il en va de même dans la deuxième
entrée, « Canope », qui contient une des pages les plus
impressionnantes du musicien, quoique d'une étonnante concision : le
débordement du Nil, dont les didascalies précisent que le dieu Canope le
franchit sur un char amphibie tiré par des crocodiles, tandis que gémit la
foule dans un double chœur impressionnant. Cette partie, qui offre un tragique
certain, se referme cependant sur des réjouissances. La dernière entrée, «Aruéris ou les Isies », fait
intervenir le dieu des arts qui souhaite s'allier l'amour pour adoucir la vie
des humains. Tout au long de l'opéra on remarque l'importance des passages
dansés, ravigotants, voire cocasses, avec des ruptures de rythmes, ou à
l'inverse sur le mode pastoral, d'un charme extrême. Une quasi abolition de la
ligne de partage, pour ne pas dire une symbiose entre airs et récitatifs,
frappe également, les premiers s'enchainant sans solution de continuité avec
les passages narratifs ; ce qui introduit un élément de modernité dans
l'appréhension du discours musical. Autre particularité : la place dévolue aux
ensembles, duos, quatuor, quintette, et même un sextuor vocal dans le troisième partie, fait unique dans la production de
Rameau. La contribution du chœur est essentielle, sur lequel s'inscrivent
souvent des interventions de solistes. Hervé Niquet est l'homme de la
situation. Son orchestre du Concert Spirituel brille par une sonorité riche et
chaude, qui rend à la musique sa vraie palette de couleurs. On remarque la
contribution des bois (disposés par quatre, flûtes, hautbois et basson) et une
ligne de cordes immaculée, aux violons en particulier, d'une grande pureté
d'intonations. Deux trompettes et un tambour rehausseront un des moments phares
de la troisième entrée. La fluidité du débit musical est chez Niquet une
constante, notamment à travers les divertissements. Sa distribution est
valeureuse, portant haut l'art de la déclamation ramiste.
Comme souvent, un même chanteur se voit confier plusieurs parties. On
distinguera la soprano Chantal Santon-Jeffery (Orthésie et Orie), royale
présence et voix glorieuse, aux aigus éblouissants, en particulier dans
l'ariette « Heureux oiseaux », et les ténors Mathias Vidal, dont la
formidable projection vocale le désigne pour incarner Platée, un rôle autrement
plus développé, et Reinoud van Mechelen qui s'affirme, lui aussi, comme un des
grands interprètes de ce répertoire. Bonne nouvelle : Hervé Niquet et le
Concert Spirituel seront à la manœuvre pour une présentation scénique de Castor et Pollux, la saison prochaine en ce même
théâtre.
Jean-Pierre Robert.
Une vibrante exécution de la Troisième symphonie de Mahler

Michael Tilson Thomas & le San Francisco Symphony
© Bill Swerbiniski
« Ma symphonie sera quelque chose que le monde n'a pas encore entendu »
prédit Gustav Mahler à propos de sa Troisième. Pas seulement eu égard à sa
composante programmatique, un hymne à la nature et à son Créateur, mais par son
architecture défiant toutes les lois du genre : six mouvements, dont le premier
dure autant qu'une symphonie classique, et que suivent cinq autres enchaînés.
Un monde où le compositeur va laisser libre cours à une inspiration débordante
et convoquer les références à la fois existentielles et philosophiques. S'il
est un chef en empathie avec l'univers mahlérien, c'est bien Michael Tilson Thomas. A la tête du San Francisco Symphony depuis quelques 19 ans, il peaufine inlassablement
ce répertoire, tout comme naguère son aîné et mentor Leonard Bernstein. Mais à
la différence de Lenny, MTT cultive une manière plus introvertie. Et la
réussite, dans cette pièce particulière, empreinte de démesure, est au rendez-vous
: l'intensité expressive va unir en un tout ce qui dans le détail peut
ressortir du disparate. Le ton est donné d'emblée avec la longue phrase des
cors ouvrant le premier mouvement : l'approche sera très mesurée, où l'on prend
le temps de flâner, la démarche habitée d'une lenteur hiératique, les tempos
posés et tranquilles, voire très lents parfois, au point de rupture. Le son
restera toujours dégagé, par la clarté dans les plans et une volonté d'aérer
les multiples éléments d'une fresque aux contours variés, sans cesse mouvante,
aux harmonies ondoyantes, que traversent des silences marqués, évocateurs.
L'orchestre le suit par une sonorité tout sauf rutilante, à la différence de
bien des phalanges nord-américaines. Au contraire, le son offre un galbe d'une
belle profondeur, en particulier dans le soyeux des cordes. Et si la ligne des
cuivres est bien timbrée, mettant en valeur de magnifiques solos de trompette
et de trombone, l'équilibre général ne s'en ressent pas. La seconde partie
réserve de fascinants épisodes au fil de ses séquences si différenciées. Le
« Menuetto » se déroule telle une comptine
enchaînant des traits délicats, faisant la part belle à l'instrumentation
scintillante de Mahler. Le « Commodo scherzando », hymne à la forêt et à ses animaux, dégage des horizons
mirifiques. Sans doute le trio, bâti sur la mélopée du cor de poste, est-il
en-deçà du mystère qu'en renferment les pages. D'autant que MTT fait appel à
une trompette, à la sonorité trop brillante, malgré la formidable maestria de
son interprète, qui placé au balcon, ne réserve pas une perspective assez
distancée pour en traduire l'indicible nostalgie. Le Lied pour alto « O Mensch », tiré du Zarathoustra de Nietzsche,
magnifiquement chanté par la mezzo Sasha Cook, est pris avec grande lenteur, ce
qui en souligne la prégnante interrogation. Le chœur « Bimm Bamm », emprunté au Wunderhorn, sonne un
glas, car là encore très mesuré. MTT fait de l'adagio final une émouvante
méditation bâtie sur un étonnant crescendo à la fois ppp et très lent,
paisible dans sa progression, avant d'atteindre un climax qui dans son
objectivité, fuit le pathos et le clinquant ; comme il en sera des dernières
mesures.
Jean-Pierre Robert.
L'Orchestre de l'Opéra de Paris s'offre une saison russe

Lionel Bringuier / DR
Quel bien curieux et inélégant public qui
ne peut réfréner la moindre toux et applaudit entre les mouvements d'un
concerto pourtant célébrissime ou d'une symphonie, à vrai dire moins connue...!
Cela, à l'Opéra Bastille, ne ressemblait guère à l'auditoire extrêmement
attentif rencontré la veille à la salle Pleyel. Il en allait autrement côté
podium, où l'Orchestre maison, sous la direction de Lionel Bringuier,
affichait une concentration remarquable pour offrir à son chef invité le
meilleur. Il faut dire que la manière du jeune français, tout juste adoubé
directeur musical du Tonhalle Orchester de Zürich, a de quoi galvaniser : une battue terriblement efficace, une
gestuelle lisible et enthousiaste, une attention aiguë pour le détail aussi
bien qu'un vrai sens de l'ensemble. Le programme, entièrement russe, conviait à
la fête. Le court poème symphonique Une nuit sur le Mont Chauve communique un vent de fébrilité dès ses premières séquences, très dramatiques,
pour s'assouplir en une fin d'une poésie remarquable. Du Deuxième concerto pour
piano en ut mineur de Rachmaninov on semble ne vouloir connaître que la
virtuosité transcendante. Et pourtant, rien de tel ici sous les doigts véloces
du pianiste polonais Simon Trpčeski et dans
l'accompagnement racé qui lui procure Lionel Bringuier.
Les données autobiographiques ont une importance essentielle dans cette pièce
qui fut écrite en 1900/1901, alors que Rachmaninov venait de traverser et de
surmonter une grave crise de dépression. Le premier mouvement affiche une large
sinuosité mélodique. Le soliste semble plus accompagner l'orchestre que jouer
le rôle de primus inter pares ; ce que renforce
l'acoustique très ouverte de la salle, qui privilégie la masse instrumentale au
détriment du piano dans les tutti. L'adagio sostenuto, qui déploie une
cantilène mélancolique, de laquelle se détache un superbe solo de clarinette
(Jérôme Verhaeghe), est pure splendeur, le piano
caracolant sans forcer. Le feu d'artifice du finale, où le piano retrouve toute
sa verve conquérante, ne sera pas pompeux et ne sollicitera jamais une
quelconque manière racoleuse dans son thème hyper romantique. A la transparence
orchestrale fait écho l'absolue aisance du pianiste. Fêté, celui-ci donnera en
bis une valse de Chopin, choisie parmi les moins célèbres, jouée toute en
retenue. La Sixième symphonie op. 54 de Chostakovitch (1939) est étrange dans
sa conception d'ensemble n'offrant aucune unité thématique et développant un
schéma en trois mouvements d'inégale durée. Elle débute par un largo au ton
sombre et pathétique. Des solos, en particulier de la flûte (Frédéric Chatoux), y énoncent des idées étranges au sein d'une
texture peu contrastée des cordes. Lionel Bringuier se meut naturellement dans cette fresque austère et crépusculaire dont il
assemble habilement les divers épisodes. L'allegro, en forme de scherzo, pris à
une allure vibrionnante, montre combien le discours
de Chostakovitch est volubile, mais aussi volatile. Le presto final, qui
surenchérit de manière incroyable en termes de célérité, introduit une sorte d'allégresse incisive et
onirique dans ses répétitions obstinées, proches du grotesque. Du très beau
travail d'orchestre, où s'épanouit un son d'une vraie sveltesse.
Jean-Pierre Robert.
Un
concert tout en contraste au Théâtre des Champs-Elysées.

Yannick Nézet-Seguin / DR
Un concert au programme, en effet, très
contrasté, associant le Concerto pour
violon de Beethoven et Don Quichotte,
poème symphonique de Richard Strauss. Deux œuvres diamétralement opposées quant
à leur conception, réunies cependant par la somptuosité de leur orchestration.
La première pouvant être considérée, à juste droit, comme de la musique pure,
de forme classique. La seconde appartenant au domaine de la musique à
programme, s’appuyant sur un support narratif, en l’occurrence le Don Quichotte de Cervantès, prenant la
forme d’un poème symphonique se développant en un mouvement unique. Pour
exécuter ce programme intéressant et éclectique, l’Orchestre Philharmonique de
Rotterdam était placé sous la baguette de son directeur musical, le jeune chef
québécois Yannick Nézet-Seguin, associé pour
l’occasion à la talentueuse violoniste géorgienne Lisa Batiashvili qui donna du concerto de Beethoven une lecture très aboutie, très poétique,
très intériorisée et particulièrement surprenante car nous donnant à entendre
deux cadences originales, manuscrites, encore jamais éditées à ce jour,
composées par Alfred Schnittke (1934-1998). Des cadences
rappelant les affinités de la jeune violoniste pour la musique contemporaine,
étonnantes par leur modernité, où l’on pouvait sentir toutes les influences de
Prokofiev et de l’école sérielle. Ce concerto pour violon, pièce incontournable
du répertoire violonistique, contemporain de la Quatrième Symphonie, fut composé rapidement lors de l’année 1806,
directement inspiré par les fiançailles secrètes de Beethoven avec Thérèse de
Brunswick. Faisant figure de véritable poème amoureux, Lisa Batiaschvili sut en rendre, avec justesse et à propos, tout le bonheur serein et l’intimité,
la souplesse du toucher n’ayant d’égal que la beauté de la sonorité de son
Joseph Guarnieri « del Gesu » de 1739. La création de cette œuvre eut
lieu au Theater an der Wien par Stephan von Breuning, violoniste virtuose et ami du compositeur. C’est
pour l’épouse de son ami que Beethoven en effectua deux ans plus tard une
transcription pour piano dont la cadence avec timbales est parfois utilisée
dans l’exécution de ce concerto, notamment par la violoniste Patricia Kopatchinskaja. Un climat bien différent en deuxième partie
de concert avec le Don Quichotte de
Richard Strauss où la direction particulièrement inspirée de Nézet-Seguin fit des merveilles, malaxant véritablement la
pâte orchestrale pour rendre à cette partition tout son côté burlesque et
exubérant. Une œuvre composée en 1897, chargée de fantaisie, d’humour et de
sentimentalité qui touche, malgré tout, aux limites de la musique à programme
en dépit d’une orchestration virtuose…Dans ses poèmes symphoniques, Richard
Strauss va progressivement s’éloigner de l’orchestre wagnérien pour gagner en
transparence et en souplesse, poussant au maximum l’individualisation des voix
et l’exploitation de l’instrumentarium susceptibles
de caractériser personnages ou situations. Les sons seuls deviennent alors
capables de peindre des images éloquentes, sans le secours des mots, ni support
visuel. Poussant au maximum cette conception narrative, la musique devient
capable de se substituer aux mots ; problématique d’ailleurs évoquée dans Capriccio, dernier opéra de Strauss. Ce
poème symphonique en est le plus parfait exemple, qui nous narre les aventures
de Don Quichotte (violoncelle) et de Sancho Pançà (alto) sous forme de dix variations qui conduiront à la mort du héros dans la
sagesse retrouvée…Une magnifique interprétation pleine de couleurs qui ne
manquera pas d’alimenter les discussions sur les rapports du récit et de la
musique et sur le bien-fondé de la musique à programme… L’enjeu étant finalement
de savoir si la musique, à l’instar de la littérature, doit se libérer ou non
du récit. Mais ceci est un autre débat !

Lisa Batiaschvili/ DR
Patrice Imbaud.
D’une accablante lourdeur !

DR
Christian Thieleman est indiscutablement un des chefs d’orchestre actuels parmi les plus ancrés
dans la tradition musicale germanique. Un parcours sans faute qui l’a conduit
depuis ses débuts, successivement, à la Staatskapelle et au Deutsche Oper de Berlin, au Philharmonique de
Munich, au Philharmonique de Vienne, au Festival de Bayreuth et, depuis 2012, à
la tête de la Staatskapelle de Dresde. Orchestre
mythique parmi les plus anciens (fondé en 1548) et les plus réputés du monde
qui vit se succéder au pupitre Weber, Wagner et Strauss…. Un parcours, une
tradition et un programme exclusivement allemand pour ce concert au Théâtre des
Champs-Elysées réunissant Beethoven (Concerto
pour piano n° 4) Liszt (Orpheus) et Strauss (Une
Vie de héros). Il semble fort probable que nombre de compositeurs
romantiques et postromantiques aient ressenti comme une crainte ou un possible
péril la composition de symphonies… L’ombre
tutélaire, menaçante et pour certains insurpassable de Beethoven expliquant en
partie une certaine réticence à l’écriture de ce genre musical. Parallèlement
les avancées de la musique du XIXe siècle exigeaient des formes nouvelles, d’où
l’invention et le développement du poème symphonique dont Liszt et Strauss
furent les principaux artisans. Structure cyclique en un seul mouvement, le
poème symphonique s’appuie sur le pouvoir narratif de la musique. Liszt semble
plutôt y exprimer des sentiments, des climats émotionnels tandis que Strauss y
relate volontiers des récits. Orpheus et Une Vie de héros sont assez
représentatifs de ces deux conceptions. Orpheus (1854) que
Liszt composa comme un noble hymne de louanges à l’esprit de la musique, fut
inspiré par un vase étrusque conservé au Louvre. Orphée et sa lyre y chante
pour apaiser les Furies, les dernières notes s’élevant « comme des vapeurs
d’encens ». Un chant empreint d’une sérénité toute apollinienne, une douce
méditation à l’orchestration suave et aérée dont Thielemann fit une petite chose grinçante, pléthorique, gorgée d’orgueil, une faute contre
l’esprit qui ne parvient jamais à nous émouvoir. Une Vie de héros (1899) fut à peine mieux lotie, le caractère
héroïque de la partition atténuant, toutefois, les bévues de l’interprétation
caricaturale et emphatique. Après une entame qui s’apparentait à la fanfare des
quat’zarts, le chef allemand peina tout au long de l’œuvre à nous présenter
avec un quelconque intérêt, ou une quelconque émotion, les aventures de ce
héros mégalomane, aux allures de plantigrade ! Plus rien de la somptuosité
ni de la subtilité de l’orchestration noyée dans des tutti furieux, un ton
exagérément péremptoire et outrancier, monolithique et pompeux, sans aucune
ambigüité ni aucun recul susceptible d’atténuer la mégalomanie straussienne.
Une interprétation au premier degré, sans plus rien de la souplesse du phrasé,
de la beauté des timbres, l’orchestre ne parvenant jamais à faire montre de sa
qualité pourtant unanimement reconnue, en dehors de quelques individualités
(violon solo de Yuka Manuela Janke)
et de quelques moments plus réussis comme la
bataille marquée par l’appel des trompettes. Si la sonorité de la Staatskapelle de Dresde a pu être comparée par Wagner à
l’éclat du vieil or, force est de reconnaitre que ce soir Thielemann a sévèrement abusé de la patine… Pour couronner la soirée, Lars Vogt nous proposa
une lecture du Concerto pour piano n° 4 (1807) de Beethoven sous forme d’un galimatias musical fait de notes fuyantes
sans legato aucun, servi par un toucher d’une redoutable et gratuite
dureté, ponctué de variations rythmiques
exagérées dont la lenteur extrême dans l’Andante rendit le phrasé
impossible (n’est pas Wilhelm Kempff qui veut !). Bref, un Beethoven
exagérément héroïque, d’un romantisme de pacotille, brut de décoffrage où la
violence remplace la lumière et la fantaisie…Une soirée hypercalorique qu’on
tâchera de digérer rapidement !
Patrice Imbaud.
Andris Nelsons sur le chemin de la sagesse

DR
Il n’est pas besoin de remonter très loin
dans le temps pour se souvenir des interprétations furieuses et mouvementées du
colosse letton conduisant un orchestre chauffé à blanc et des musiciens sous
pression. Une fureur et une précipitation pénalisant souvent l’équilibre
d’interprétations par ailleurs remarquables. On se souvient en particulier, en
mars 2012, d’un Tristan et Isolde de
Wagner, incandescent où le violoncelle solo stressé s’était retrouvé seul, avec
une mesure d’avance…Mais les temps ont semble-t-il changé, la sagesse et la
maturité ont progressivement fait leur œuvre, apportant aux interprétations d’Andris Nelsons un recul, une
profondeur et un brio souvent exempt de toute critique. La prestation de ce soir
ne fit que confirmer cette heureuse évolution. Un concert, donc, très attendu où le bouillonnant chef se
trouvait à la tête de ses troupes du City of Birmingham Symphony Orchestra dont il est le directeur musical depuis 2008, dans un programme
Strauss, Brahms et Prokofiev, avec Anne-Sophie Mutter en soliste. En ouverture de soirée, Don
Juan (1889) poème symphonique de Richard Strauss que Nelsons traita comme une grande fresque quelque peu hollywoodienne, alternant pulsions
et assouvissements, prémonition de la mort et réalisation de celle-ci, menée de
façon très expressive et extravertie, où brilla tout spécialement la petite
harmonie. Vint ensuite le Concerto pour
violon (1879) de Brahms qu’Anne-Sophie Mutter interpréta de façon très académique, semblant jouer pour elle seule, sans
aucune projection émotionnelle. Carence heureusement compensée par les
somptueuses sonorités de l’orchestre et notamment par la complainte sublime du
hautbois dans l’Adagio central. Faute
d’originalité dans le choix ou l’interprétation des œuvres, force est
d’admettre que le rabâchage de ces éternels concertos tout au long de la saison à de quoi lasser les auditeurs les plus indulgents…
En « bis » la gigue et la sarabande de la Seconde Partita de Bach, dédiées à la mémoire d'Étienne Vatelot ou de Claudio Abbado ( ?). En deuxième partie,
des extraits du ballet Roméo et Juliette (1935) de Prokofiev où la direction très engagée du chef letton fit des
merveilles, dans une lecture équilibrée, claire, rendant parfaitement justice à
la très riche et saisissante orchestration de Prokofiev. Superbe soirée !
Patrice Imbaud.
Riccardo Muti fête le 80e anniversaire de
l’Orchestre National de France au Théâtre des Champs-Elysées

DR
Le concert inaugural de l’ONF eut lieu le
13 mars 1934, faisant suite de quelques jours à la signature du décret officiel
de sa création le 18 janvier 1934, nommant dans le même temps à sa tête le chef
d’orchestre franco-belge Désiré- Émile Inghelbrecht. A la libération, le
« National » s’installe en résidence au Théâtre des Champs-Elysées.
Un nouvel élan est redonné sous l’impulsion de Manuel Rosenthal qui a succédé à Inghelbrecht. Des chefs comme Charles Munch, Roger Désormière, Igor Markévitch,
Serge Koussevitzky, Josef Krips, Eugène Ormandy, Otto
Klemperer, Bruno Walter, Pierre Monteux, Hermann Scherchen, Georg Solti, Carlo Maria Giulini, Lorin
Maazel, Leonard Bernstein se succèdent au pupitre dans nombre de concerts
mémorables et de créations (le Double et Métaboles de Dutilleux, le Soleil des Eaux de Boulez, Déserts de Varèse, et bien d’autres
encore…). Les années Maazel voient arriver Seiji Osawa et Riccardo Muti, deux
chefs qui garderont toujours des liens privilégiés avec le
« National ». Puis, c’est au tour de Kurt Mazur,
figure emblématique de la musique romantique allemande de reprendre la
direction musicale avant que le chef milanais Daniele Gatti, actuellement en poste, ne reprenne les rennes, conduisant l’orchestre
dans une double activité symphonique et lyrique. Pour ce concert de gala, la baguette avait
été confiée au chef napolitain Riccardo Muti, figure
emblématique de la direction d’orchestre. Plus de cinquante années de carrière
dont plus de quarante consacrées à la direction d’orchestre, la première
rencontre du chef italien et du « National » remontant à 1980 !
Un programme taillé sur mesure, à la dimension des affinités du chef Muti et des capacités souvent surprenantes de l’orchestre. L’Ouverture
de Guillaume Tell (1829) de Rossini
donna d’emblée le ton, douceur et précision du violoncelle, complainte
plaintive du cor anglais, cohésion de l’orchestre, précision du phrasé et
élégance de la direction : quelle main gauche d’une expressivité hors du commun !
Vint ensuite le magnifique Poème de
l’amour et de la mer (1893) d’Ernest Chausson (1855-1899). Une œuvre très
impressionniste où la beauté du discours musical n’eut d’égal que la souplesse
de la ligne de chant de Bernarda Fink, malgré une
tessiture, il est vrai, souvent amputée de ses
extrêmes et une projection vocale limitée. Là encore Muti fit de cette œuvre rare, une véritable démonstration orchestrale s’appliquant à
servir le chant tout en magnifiant la sonorité du « National » dans
un phrasé suivant le rythme des vagues et les épanchements de l’âme, de la
« Fleur des eaux » à la « Mort
de l’amour », conclu par un « temps
des lilas et le temps d’une rose… » d’une indicible et poignante mélancolie. En deuxième partie de concert, la Symphonie n° 3 (1905) dite « Le Poème divin » de Scriabine
(1872-1915) fut un moment d’exception à la mesure de l’évènement. Une partition
complexe et monumentale, en trois mouvements donnés sans interruption, en forme
de poème symphonique enchaînant successivement un climat héroïque (Luttes), une ambiance voluptueuse (Voluptés) et un final plein de vitalité
radieuse (Jeu divin). Une composition
tout à fait symptomatique de l’esthétique scriabinienne,
toute empreinte de spiritualité aux accents nietzschéens, faite de tension et
de replis dont Riccardo Muti donna une vision, à la
fois juste dans la mesure et claire dans la réalisation, guidant le
« National » attentif et appliqué sur des sommets rarement égalés. Un
anniversaire triomphal ! Rendez-vous pour le centenaire…
Patrice Imbaud.
Un moment rare, les Gurrelieder d’Arnold Schoenberg, salle Pleyel.
Arnold SCHOENBERG : Gurrelieder. Katarina Dalayman, Robert Dean Smith, Michelle
de Young, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Gabor Bretz, Barbara Sukowa. Chœur de Radio France, Chœur de la Radio de Leipzig.
Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Esa-Pekka Salonen.

Esa-Pekka Salonen / DR
Il est de ces moments rares où le temps
suspend son cours, petits moments d’éternité qui viennent se graver dans nos
mémoires … Kathleen Ferrier versant quelques larmes sur les derniers « Ewig » concluant l’ « Abschied » du Chant de la Terre, la main longtemps suspendue de Claudio Abbado
prolongeant à l’infini, vers les horizons bleutés, les dernières notes de la 9e symphonie de Mahler… et
cette interprétation bouleversante des Gurrelieder de
Schoenberg par l’Orchestre Philharmonique de Radio France conduit par Esa-Pekka Salonen en font, sans aucun
doute, partie, gravés au fond de nous comme autant de moments magiques
inaltérables. Une œuvre monumentale et grandiose pour voix et orchestre
d’Arnold Schoenberg (1874-1951) composée entre 1900 et 1913 sur des textes de
Jens Peter Jacobsen, créée à Vienne en 1913 par Franz Schreker.
Inspirés de légendes nordiques, ces textes relatent les amours contrariées de
Waldemar et de Tove, au château de Gurre, développant les thèmes de la damnation, de l’amour
impossible, de la rédemption sur fond de nature consolatrice et de conte
fantastique. Une œuvre charnière entre tradition et modernité qui marque pour
Schoenberg le prochain abandon de la tonalité mais où s’expriment clairement
toutes ses influences wagnériennes, mahlériennes ou straussiennes. Une
partition que Schoenberg considérait comme la clé de tout son développement
ultérieur, contemporaine du Pierrot
lunaire, mais s’inscrivant encore dans la tonalité, comme La Nuit Transfigurée. Une position intermédiaire
entre deux mondes compositionnels dont témoigne la structure même de l’œuvre.
Une première partie qui correspond à la rencontre des deux amants,
d’inspiration directement wagnérienne (Tristan),
une seconde plus courte, au cours de laquelle le roi laisse s’exprimer tout son
ressentiment et son désir de vengeance envers Dieu après la mort de sa bien aimée, enfin, une troisième partie en forme de
mélodrame avec récitant en Sprechgesang,
s’éloignant du maître de Bayreuth, privilégiant timbres solistes et tutti
massifs. Une synthèse post romantique en apothéose, chargée de leitmotivs, qui
s’inscrit entre l'opéra wagnérien, le cycle de lieder avec orchestre et la
symphonie chorale, sur laquelle plane l’ombre de Zemlinsky, (La Symphonie Lyrique de celui-ci date de
1822), beau-frère de Schoenberg, qui assura une partie de la formation du jeune
compositeur. Une cantate rarement donnée nécessitant un effectif orchestral
colossal, cinq solistes, un récitant, un triple chœur d’hommes et un grand chœur
mixte !
Il fallait pour conduire à bien cette
entreprise périlleuse, un chef d’envergure exceptionnelle comme Esa-Pekka Salonen, également
compositeur, capable de rendre toute la clarté, le luxe, le drame, l’urgence et
la volupté de cette exceptionnelle partition aux 48 portées, conduite de bout
en bout avec le même élan, respectant l’équilibre entre les masses sonores,
sans couvrir les chanteurs, ni saturer l’espace sonore lors des plus furieux
tutti. Un chef à la gestuelle sobre et enflammée, éloquente dans la narration
de ce poème des deux amants au déroulement dramatique, égarés sur les sentiers
du désir et les chemins du délire, « pèlerins de l’impossible
assouvissement » dont on ne sait s’ils ne se rejoindront jamais dans les
ténèbres de la nuit ou le retour du soleil. Que dire encore devant tant de
beauté, qui ne paraisse comme une mesquine critique ? Certes, on pourrait
regretter le timbre un peu dur de Katarina Dalayman (Tove) alors qu’on l’aurait souhaité plus soyeux, regretter
également la puissance vocale parfois défaillante de Robert Dean Smith
(Waldemar) mais la beauté du timbre, la souplesse dans le médium ont vite fait
de faire oublier cette faiblesse passagère. Soulignons surtout l’excellence du
« Philhar », tous pupitres confondus, poussé pour l’occasion à son plus haut
niveau. Félicitations au Chœur de Radio France, renforcé par le Chœur de la
Radio de Leipzig, sans oublier la très distinguée basse de Gabor Bretz (Le paysan), l’ironique intervention de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (Le bouffon), la déchirante « Complainte du ramier » de Michelle
de Young et le très coloré sprechgesang de Barbara Sukova dans le mélodrame de la « Chasse
sauvage du vent d’été ». Assurément le plus beau concert de la saison
conclu par un triomphe pour Salonen et des ovations
prolongées de la salle. Un concert d’exception que l’on retrouvera avec le plus
grand bonheur en rediffusion libre sur le site de la Cité de la musique
« live ».
Patrice Imbaud.
Prima la musica !
Richard
STRAUSS : Der Rosenkavalier(Le Chevalier à la rose). Opéra en trois actes. Livret de
Hugo von Hofmannsthal. Soile Isokovski, Peter Rose, Sophie Koch, Martin Gantner, Christiane Karg. Chœur
de la Bayerische Staatsoper. Bayerisches Staatsorchester, dir. Kirill Petrenko. Version de
concert au Théâtre des Champs-Elysées.

Kirill Petrenko © Wilfried Hösl
« Prima la musica ! »
car c’est bien la musique qui fut à la fête pour cette version de concert du Chevalier à la rose de Richard Strauss.
Une véritable fête orchestrale menée par la baguette vive et inspirée de Kirill Petrenko à la tête de ses
troupes de la Bayerische Staatsoper dont il est le
nouveau directeur musical. Attention, un Petrenko peut en cacher un autre…Celui de ce soir est Kirill à
ne pas confondre avec son homonyme Vassily. Kirill est autrichien d’adoption, ancien directeur de la Komische Oper de Berlin, habitué
des plus grandes scènes lyriques internationales et des phalanges les plus
réputées. Une étoile montante (il est né en 1972) de la direction d’orchestre
qui ne se produit que très rarement en France, d’où l’affluence des grands
soirs avenue Montaigne, pour cette production donnée il y a quelques jours dans
la vieille version scénique d’Otto Schenk, à Munich,
avec une distribution vocale assez différente. Un opéra créé en 1911 à Dresde
où Strauss ne chante pas la fin du monde mais célèbre un merveilleux automne,
portant en lui les prémisses de l’hiver. On retrouve d’ailleurs, dans le
sublime trio de l’acte trois, des accents des Quatre derniers Lieder.
D’un point de vue musical cette soirée tint toutes ses promesses, Kirill Petrenko réussissant à
faire sonner merveilleusement son orchestre, parvenant à rendre de bout en bout
toute la rutilance, le brio et la richesse somptueuse de l’orchestration
straussienne, tout en suivant au plus près la dramaturgie. Un écrin musical de
rêve pour une distribution vocale qui souffrit, quant à elle, d’une hétérogénéité
certaine, à commencer par la Maréchale quelque peu vacillante de Soile Isokovski dont la ligne de
chant ne parvint jamais à nous convaincre, peinant à imprégner son chant de
cette nostalgie douloureuse qui caractérise la Maréchale devant la fuite du temps
et de l’amour. Une faiblesse vocale qui pénalisera les ensembles vocaux, au
demeurant si beaux et si nombreux de cet opéra, notamment dans le troisième
acte, malgré l’engagement de Sophie Koch (Octavian)
et l’assurance de Christiane Karg (Sophie), remplaçant
pourtant au débotté Mojca Erdmann souffrante. Peter Rose, habitué du rôle, se situant entre Pourceaugnac et Falstaff, campa un baron Ochs de haute volée, à la fois vocalement et
théâtralement, tout comme Martin Gantner dans le rôle
de Faninal. Bref, une belle soirée d’opéra, la
découverte pour beaucoup et la confirmation pour d’autres de l’avènement d’un
grand chef d’opéra… Applaudissements prolongés des musiciens pour Kirill Petrenko et standing
ovation du public…Un triomphe mérité qui fut toutefois gâché par un pugilat
surprenant au premier balcon ! Quand on dit que la musique adoucit les mœurs….
Patrice Imbaud.
***
L'EDITION MUSICALE
MUSIQUE
CHORALE
Franck
VILLARD : Neuf Répons des Ténèbres
du Jeudi Saint pour chœur mixte a cappella (SATB). Symétrie : ISMN
979-0-2318-0743-1.
Lorsqu’on voit ce titre,
des noms prestigieux résonnent, de Victoria à Poulenc… Ces répons ne déméritent
pas. Très fidèles autant à la lettre qu’à l’esprit de l’office du Jeudi Saint,
ils peuvent être donnés aussi bien en concert que chantés dans le cadre de la
liturgie. La plupart du temps homorythmiques, une discrète polyphonie s’y
introduit aux moments opportuns. L’exécution, sans être facile, est abordable
sans problème par un chœur un peu exercé. Il y faudra surtout une grande
retenue et une grande justesse à la fois musicale et expressive pour donner
leur juste valeur à ces textes d’une profonde beauté. L’auteur précise que
« la prononciation romaine du latin est souhaitée ». Cela semble
aller de soi, mais certains auteurs précisant maintenant qu’ils préfèrent la
prononciation dite « restituée », il n’était pas inutile de le
mentionner.

OPERA
Jean-Philippe
RAMEAU : Dardanus. Tragédie en un prologue et cinq actes.
Version 1739. Livret de Charles-Antoine Leclerc de La Bruyère. Société
Jean-Philippe Rameau – Réduction chant et piano. Bärenreiter :
BA8854-90.
C’est vraiment un
évènement que cette publication par la société Jean-Philippe Rameau de
l’intégralité de l’œuvre de ce compositeur majeur. Etant donné l’ampleur des
transformations opérées par les auteurs entre la version de 1739 et celle de
1744, cette œuvre fait l’objet de deux publications. On lira avec beaucoup
d’attention et d’intérêt la préface de cette édition réalisée par Céclie Davy-Rigaux et Denis Herlin avec la collaboration de Sylvie Bouissou, la
réduction clavier-chant étant de François Saint-Yves. On peut également se
procurer le conducteur ; les parties d’orchestre sont disponibles en
location.

ORGUE
Paul
STERNE : Berceuse pour une
enfant qui s’est endormie. Pour orgue. Delatour :
DLT2320.
Quelle jolie pièce, et qui
peut se contenter d’un instrument relativement modeste (deux claviers pédalier
romantique). Cette berceuse, bien que très explicite dans ses réminiscences,
pourra également trouver sa place dans le culte pour un offertoire, par
exemple. Le langage est original mais immédiatement compréhensible. Et c’est un
compliment ! On peut écouter l’œuvre sur le site de l’éditeur.

Gustave
MAHLER, Paul STERNE : Symphony n° 1 in D
« Titan » pour orgue. Delatour :
DLT2331.
Précisons tout de suite
que cette transcription a été conçue pour un instrument symphonique de 3
claviers. Paul Sterne précise bien qu’il s’agit d’une transcription et non
d’une réduction. La mode des transcriptions pour orgue connait en ce moment de
beaux jours, mais il ne faut pas s’en plaindre. L’œuvre peut être écoutée sur
le site de l’éditeur. La partition porte la référence imprimée
« 2321 » alors que le site la référencie sous le n° 2331.

Daniel
ROTH : Fantaisie-Dialogue pour
deux orgues (Grand Orgue et Orgue de Chœur). Organistes Alsaciens vol. 29. Delatour : DLT2299.
Il s’agit d’une commande
faite à Daniel Roth par le Directeur du Conservatoire de Mantes la Jolie à
l’occasion de la restauration des deux instruments de la Collégiale. Assez peu
de pièces ont été écrites au cours des âges spécifiquement pour ce dialogue
entre deux instruments au caractère forcément contrasté. Celle-ci continue fort
heureusement la tradition en tenant compte, bien évidemment, de la distance
entre les instruments et de l’acoustique particulière de nos grands vaisseaux.
On aimerait avoir en ligne ou sur CD cette œuvre jouée sur le Grand Orgue Merklin restauré et l’orgue de chœur tout neuf qui lui
donne la réplique pour l’inauguration le 25 mai 2013.

Francis
CHAPELET : L’œuvre pour orgue volume
2. Pièces et improvisations dans le style modal et contemporain. Delatour : DLT1876.
On lira avec intérêt la
préface de l’auteur. On aime découvrir les œuvres de ce remarquable organiste
qu’est Francis Chapelet. Le sous-titre indique bien le contenu du recueil. On
sera heureux d’en écouter une partie sur le site de l’éditeur, notamment l’impressionnant
Etna 71 de 1972.

HARPE
Antonin
SERVIÈRE : Deux moments pour
harpe. Delatour : DLT1221.
Moment
d’hiver… est
de caractère méditatif. Le deuxième, ...et
moment d’infini, bien que plus court, est plus volubile mais sans nuire à
son caractère poétique. Ce sont donc deux beaux moments offerts tant à
l’interprète qu’à ses auditeurs.
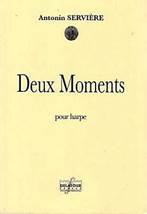
PIANO
Ludwig
van BEETHOVEN : Concerto n° 2 en si
bémol Majeur pour piano et orchestre op. 19. Bärenreiter :
Conducteur BA9022, partie de soliste et réduction pour deux pianos BA9022-90,
commentaire critique BA902240.
On ne peut que se réjouir
de voir les éditions Bärenreiter mettre ainsi ce
concerto à la portée de tous. C’est également une excellente initiative de
publier à part le commentaire critique de Jonathan Del Mar. On connait par
ailleurs les qualités de clarté de ces éditions. Ce qui caractérise cette
nouvelle publication, c’est qu’elle se base uniquement sur les sources
authentiques. Le commentaire critique apporte à ce sujet toutes les précisions
nécessaires.




Ludwig
van BEETHOVEN : Sonate en fa mineur
« Appassionata » op. 57 pour piano. Bärenreiter :
BA10852.
Outre un soin particulier
apporté à la clarté de l’édition et aux « tournes », on appréciera
tout particulièrement le commentaire critique et les conseils d’interprétation
donnés par Jonathan Del Mar et Misha Donat. Ce n’est pas une édition « de
plus », mais un élément important pour une meilleure connaissance et une
meilleure compréhension de cette œuvre par ailleurs si connue.

Guy
SACRE : Carnaval douze pièces
pour piano. Symétrie : ISMN 979-0-2318-0738-7.
Ces douze pièces
évocatrices de diverses figures du carnaval, avec aussi un clin d’œil au
Carnaval de Schumann, sont bien plaisantes. L’écriture en est tout à fait
contemporaine mais parfaitement limpide. Il faudra lire la présentation que
fait l’auteur de son œuvre pour en bien comprendre l’esprit. On en écoutera
avec plaisir des extraits sur le site de l’éditeur.

Pierre-Richard
DESHAYS : Gourmandise pour
piano. Débutant. Lafitan : P.L.2729.
Voici une délicieuse
gourmandise qui permet aux deux mains de dialoguer joliment. Le professeur ne
manquera pas de faire remarquer cette écriture qui donne la mélodie tantôt à la
main droite tantôt à la main gauche, les mains se répondant. Ce sera une
excellente préparation aux Inventions à
deux voix !

Arletta
ELSAYARY : Réponse d’Elise pour
piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2727.
La Poste a parfois de ces
lenteurs… Depuis le temps qu’on l’attendait… Elle ne décevra pas ! Pour en
goûter tout le sel, il faudra évidemment connaître la fameuse Lettre à laquelle celle-ci répond. Mais
cette jolie pièce est à la fois pleine de charme et d’humour.

VIOLON
Jeanne
DEMESSIEUX : Sonate pour violon
et piano. Delatour : DLT2079.
Remercions les éditions Delatour d’avoir édité cette sonate écrite en 1940 par
cette jeune compositrice (née en 1921) dont la carrière d’organiste a éclipsé
la compositrice. De plus, sa mort prématurée (1968) ne lui a pas permis de
donner sa pleine mesure. Cette sonate possède une originalité certaine et
mérite de figurer au programme des récitals des meilleurs violonistes. Elle
comporte trois mouvements : - Allegro moderato (6'30'') - Adagio cantabile
(2') - Thema et variations (7').

Claude-Henry
JOUBERT : Valse du Vöglein (« Petit Oiseau ») pour violon avec
accompagnement de piano. Premier cycle. Fertile Plaine : FP 1551.
L’introduction n’est pas
sans évoquer une certaine valse… Au professeur de faire peut-être entendre
l’original ! Une autre allusion, non moins explicite, à une œuvre connue
où il est question d’oiseleur et d’oiseaux méritera d’être également commentée…
Bien sûr, on ne peut pas ne pas penser également à Ouvrard même si cette
référence est moins recommandable ! De plus, l’auteur invite à se servir
de cette valse comme modèle pour en composer d’autres : espérons que
beaucoup d’élèves se laisseront tenter par l’aventure !

Alain
LOUVIER, Bruno GINER, François ROSSÉ, Eric FISHER, Carlos GRÄTZER : Neuf duos contemporains faciles. Dhalmann : FD0414.
La gageure était d’écrire
des duos intéressants et accessibles musicalement et techniquement à de jeunes
élèves. Le pari est tout à fait tenu et à la hauteur des compositeurs qui s’y
sont soumis. Il y a beaucoup de variété et d’intérêt, ce qui constituera en même
temps un excellent exercice d’oreille pour les jeunes interprètes.

Daniel
TOSI : Per a Balbino. Deux pièces pour deux violons. Assez
difficile. Dhalmann : FD0415.
Chacune des deux pièces commence par un
« cantus » d’un classicisme tonal absolu et se continue par une suite
tout à fait contemporaine. On voit tout l’intérêt de la confrontation de ces
deux écritures.

ALTO
Claude-Henry JOUBERT : Manzanillo. Cha-cha-cha pour alto avec accompagnement de piano.
Deuxième cycle. Fertile Plaine : FP 1558.
Voici un Cha-cha-cha qui
ne manque pas de tempérament ! Comme toutes les partitions de cette
collection, il s’agit à la fois d’une œuvre et d’une proposition. Invitation,
pour l’altiste, à écrire lui-même un autre Cha-cha-cha, invitation pour le pianiste
à aménager et enrichir sa propre partition, comme dit l’auteur, « livrée
en kit ». Il serait dommage de ne pas profiter de telles possibilités.

HAUTBOIS
Gilles
SILVESTRINI : Six Études
Pittoresques pour hautbois seul. Delatour :
DLT2319.
Ces études assez
difficiles se groupent par deux : Gengis
Khan et Alii Mundi sont
censées évoquer la Mongolie, La petite
Sirène et La Petite Poucette évoquent Andersen ; quant aux deux
dernières, elles sont un hommage un peu humoristique à Edward Elgar et Benjamin
Britten. Il y a là de quoi dérider même un hautboïste jouant une étude.

TROMPETTE
Julien
PONDÉ : Solaire pour trompette
en sib ou do, ou cornet ou bugle et
piano. Préparatoire. Lafitan : P.L. 2657.
Voici une pièce qui porte
bien son nom. Elle est chatoyante, tantôt éclatante, tantôt plus lyrique.
Pianiste et trompettiste devront faire preuve de bonne entente… mais n’est-ce
pas la condition sine qua non de la musique de chambre ?

André
TELMAN : La petite puce sauteuse pour
trompette ou cornet ou bugle et piano. Fin de 1er cycle. Lafitan : P.L.2602.
Si cette petite puce est
effectivement sauteuse à souhait, elle ne manque cependant ni d’humour ni de
charme et bénéficie d’une petite cadence qui lui permet d’exprimer toute sa
vélocité. Les deux interprètes devront respecter soigneusement les indications
de phrasé pour que notre puce retombe… sur ses pieds !

Pascal
PROUST : Swing Trompette. Etudes
rythmiques de moyenne difficulté (solos et duos) pour trompette, cornet ou
bugle. Sempre più : SP0085.
Ces dix-huit études
portent des noms évocateurs et sont comme autant de petits tableaux qui
devraient faire oublier aux interprètes la difficulté technique étudiée pour
qu’ils puissent ne plus voir que le charme musical et la variété des
sujets qui ont comme point commun le Far-West.

Pascal
PROUST : Sonate à trois pour 3
trompettes. Sempre più : SP0095.
Cette sonate en trois
mouvements est dédiée aux trois créateurs de l’œuvre aux Rencontres Musicales
des Monts d’Or en juillet 2012. Un premier mouvement aux rythmes joyeux de
forme ABA est suivi d’un court Adagio poétique. Le tout se termine par un
allegro ritmico endiablé. Il s’agit d’une pièce pleine de charme et de
dynamisme très fidèle à son titre !
 .
.
TROMBONE
Michel
NIERENBERGER : Douceurs estivales pour
trombone et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L. 2628.
Dédiée à Nathalie Rubbens, tromboniste de l’harmonie de Leffrinckoucke (Nord)
disparue prématurément, cette très jolie pièce est emprunte à la fois d’une
pointe de mélancolie et d’un charme indéniable où un certain optimisme
l’emporte malgré tout. Le tromboniste pourra déployer dans ces douceurs estivales tout son sens du
phrasé et de la mélodie.

SAXHORN
Rémi
MAUPETIT : A l’eau, les
métronomes ! pour saxhorn basse ou euphonium
ou tuba et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2609.
Vaste programme !,
pourrait-on dire en parodiant un célèbre général. Quoi qu’il en soit, cette
pièce bien rythmée vaut tous les métronomes… si nos interprètes on bien
intériorisé la pulsation, ce dont on ne saurait douter. Il y a en tout cas dans
cette pièce une jubilation communicative qui devrait lui valoir beaucoup de
succès.

Rémi
MAUPETIT : B.L.J.M. pour saxhorn
basse ou euphonium ou tuba et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2611.
A une première partie joliment
nonchalante succède une deuxième partie plus rythmée. Les interprètes pourront
donc, dans cette pièce, développer toutes les facettes de leur talent.

Jérôme
NAULAIS : Question-réponse pour
saxhorn basse ou euphonium ou tuba et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2589.
C’est une jolie pièce
calme, un peu comme une promenade, où piano et saxhorn dialoguent sagement. Le
tout ne manque pas de charme.

PERCUSSIONS
Antonin
SERVIÈRES : Le jour où (ou) la nuit… pour percussion et bande. Delatour : DLT2230
(sur le site : 2330).
Cette œuvre difficile mais
très intéressante par son ambiance est issue d’un court métrage. On lira avec
attention les indications de mise en œuvre de l’auteur. Bien sûr, la bande est
aujourd’hui un CD fourni avec la partition.

Bernard
ZIELINSKI, Arletta ELSAYARY : Ballada pour
caisse claire, cymbale et piano. Elémentaire. Lafitan :
P.L. 2570.
« La technique
facilite l’interprétation. Elle libère l’instrumentiste des contingences
matérielles. Tel est le but de la technique, tel est son rôle. » C’est
l’intérêt de cette pièce qui peut être jouée à trois niveaux de technique. Mais
pas seulement : la très jolie partie de piano incitera le batteur à
modeler sa sonorité sur celle de son partenaire et à mettre sa technique au
service de la musique.

Wieslaw JANECZEK : Of course pour batterie et piano. Elémentaire. Lafitan :
P.L.2579.
Il n’est pas sûr que ce
titre soit apprécié par celui qui ouvrira la partition. A lui de faire qu’elle
devienne évidente… pour son plus grand plaisir, car cette pièce très rythmée
est par ailleurs bien séduisante. L’effort du début sera vite récompensé par
l’accession au résultat final.

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Antonin
SERVIÈRE : Trio pour flûte, alto
et harpe. Delatour : DLT1260.
Cette formation rappelle
évidemment Debussy. Ceci dit, il n’y a rien de commun dans le langage utilisé.
Résolument contemporaine, cette pièce en un seul mouvement n’en est pas moins
très expressive et très lyrique.

Marius
MONNIKENDAM : Invocation pour
violoncelle, harpe et orgue. Delatour : DLT1732.
Editée dans la collection Musique et Patrimoine, cette
œuvre de ce compositeur néerlandais élève de Vincent d’Indy et Louis Aubert à
la Schola Cantorum est fort intéressante. Ecrite pour
une formation originale, cette pièce évolue dans un langage modal simple mais
d’une grande beauté. Une partie plus mouvante est encadrée par un début et une
fin très méditatifs. Espérons que malgré le caractère original de la formation,
cette œuvre connaitra un vrai succès.

Théodore
DUBOIS : Fantaisie pour
trompette chromatique et quintette à cordes. Transcription de Franck Villard.
Symétrie : ISMN 979-0-2318-0748-6
Cette œuvre, primitivement
pour trompette chromatique avec accompagnement de piano, a été transcrite pour
quintette à cordes (avec contrebasse) à la demande du directeur du festival Ars
Terra, dans la Somme. La trompette peut être également accompagnée par un
orchestre à cordes. Très fidèle à l’original, la transcription met en valeur
cette pièce de circonstance écrite en 1920 pour le Conservatoire de Paris.
C’est un joli moment de musique écrit par un compositeur qui sort fort
heureusement aujourd’hui d’un injuste oubli.

Alain
LOUVIER : Herbier V. Trois
courtes pièces pour cor et percussion. Assez difficile. Dhalmann :
FD0407.
Ces trois pièces qui
portent des noms de fleurs sont écrites dans un langage contemporain et des
techniques de jeu qui ne le sont pas moins. On appréciera les recherches de
timbres et les effets sonores qui en découlent.

Daniel Blackstone.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Katarina LIVLJANIC : Paléographie musicale,
Tome XXIII. Montecassino, Archivio dell’abbazia, MS.
542 -Antiphonaire (XIIe siècle). Solesmes, ÉDITIONS DE SOLESMES (www.solesmes.com ), 2014, 143 p. + 194 ill. – 89 €.
La Collection
« Paléographie musicale », lancée en 1889 par Dom A. Mocquereau à
l’Abbaye de Solesmes, s’achève avec ce volume XXIII, réalisé par K. Livljanic qui a consacré sa Thèse (ÉPHÉ) à l’Antiphonaire conservé aux Archives de
l’Abbaye du Mont Cassin (sous la cote ms.
542). Les lecteurs bénéficieront de sa vaste érudition du chercheur, de ses
compétences en écriture bénéventaine, mais aussi de
sa spécialisation dans l’interprétation vocale de la musique monodique
médiévale. Elle a profité du soutien scientifique, entre autres, des regrettés
Dom Jean-Claire et de Michel Huglo, notamment pour la
modalité. Contribuant au renom de la Collection, l’auteur met l’accent sur
l’aspect codicologique, tout en réservant à des
articles (parus ou à paraître) l’analyse du langage musical des antiennes.
Après avoir décrit
ce manuscrit (support, format, mise en page des cahiers, justification, mise en
texte), un chapitre est consacré à la graphie du manuscrit ms. 542 a l’appui d’exemples précis (lettres, ligatures, abréviations,
ponctuation) ; le chapitre suivant porte sur la notation musicale
(graphies neumatiques). Le manuscrit reproduit les ordinaires cassiniens après
lesquels sont placées les fêtes du sanctoral ; il pourrait s’agir de son
état primitif. Celui-ci comprend les chants ordinaires de l’office férial, des
antiennes in evangelio correspondant
aux principales fêtes (Saint Vincent, Sainte Scolastique et Saint Benoît, entre
autres), ainsi que de précieux renseignements sur l’organisation de la journée.
En conclusion, la question : « Manuscrit
séculier ou monastique ? » reste posée. Le langage musical est
tributaire des procédés compositionnels du chant bénéventain appartenant au « vieux fonds » et au fonds local, en fait, reposant
sur des timbres grégoriens déjà présents en Italie méridionale. Une abondante Bibliographie confirme l’intérêt du
sujet.
Katarina Livljanic établit encore l’Index du manuscrit,
signale ses règles éditoriales avec également une intéressante rubrique sur les
tons psalmodiques du Psaume invitatoire et le répertoire des pièces :
invitatoire, antiennes, répons, versets, versiculi, hymnes, lectures (p.
53-142) en usage selon les circonstances liturgiques et les divers dimanches.
De plus, les pièces communes aux manuscrits MC 542 (Monte Cassino) et BEN 21
(Bénévent) sont judicieusement signalées. Enfin, les Planches 1 à 194 sont
reproduites ; leur excellent état de conservation ainsi que la qualité de
reproduction rehaussent encore la valeur de ce dernier Volume de la célèbre
publication lancée par Dom A. Mocquereau. Katarina Livljanic fait ainsi honneur à cette Collection et à la réputation des Éditions de
Solesmes pendant plus d’un siècle.

Édith Weber.
Olivier TRACHIER (dir.) :
Gallus DRESSLER : Practica modorum explicatio. Explication pratique des modes. Sampzon, Éditions DELATOUR FRANCE (www.editions-delatour.com), 2014. DLT2190. 97 p.
Cette traduction
française — réalisée par des étudiants du CNR de Paris, supervisée et présentée
par Olivier Trachier, dans une finalité à la fois
historique, théorique et technique — permettra aux musicologues de mieux
s’orienter dans le labyrinthe des modes exploités au XVIe siècle.
C’est dans le
sillage du Dodécachorde (Bâle, 1547) de Heinrich Glaréan que Gallus Dressler a publié son Traité (Iéna, 1561)
qui se veut une « Explication
pratique des modes ». Né en 1533 en Thuringe — théologien, philosophe,
grand érudit et pédagogue, fin connaisseur des textes grecs et latins, mais
aussi fidèle à la pensée de Ph. Melanchthon et de Martin Luther —, il a occupé
le poste prestigieux de Cantor à l’école latine de Magdebourg, et publié
également des Psaumes latins et allemands et des Cantiones sacrae. Sa démarche s’inspire des
apports de Martin Agricola, Johannes Cochlaeus, Franchinus Gaffurius, Hermann
Finck… à propos des tons et des intervalles parfaits. Il s’intéresse aussi à la
« musique poétique », à la
formation des chanteurs et à l’ethos des modes. Son Explicatio, de caractère
didactique, fait le point des connaissances des tons à l’époque humaniste.
Olivier Trachier — après avoir défini ses principes
d’édition, et résumé quelques données codicologiques et justifié sa transcription diplomatique stricte pour les Motets — reproduit la page de titre (Tenor), suivie de la dédicace,
puis de l’Explicatio structurée en XVIII chapitres étayés d’exemples musicaux de démonstration.
Après avoir mis l’accent sur la nécessité des intervalles, ceux-ci sont passés
en revue et illustrés d’exemples musicaux empruntés à des œuvres religieuses de
Clemens non Papa, Ludwig Senfl, Jean Maillart,
Cristobal de Morales, entre autres. Faisant suite à l’Explicatio, le Motet à 4 voix de Gallus Dressler : Angelus Domini dixit ad pastores…annonçant
la naissance du Sauveur (Luc,
chapitre 2, versets 10-14) démontre ses qualités de compositeur.
Les musicologues
apprécieront aussi les notes critiques et l’indispensable Petit Lexique latin-français reflétant l’acception des termes à
l’époque en cause. Tant par ses exégèses si fouillées et ses commentaires très
minutieux, que par la gravure musicale exemplaire, cette Practica modorum explicatio,
avec son excellente traduction française, a d’ores et déjà sa place
incontournable dans toute bibliothèque musicologique de seiziémiste.
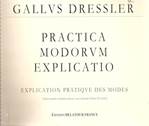
Édith Weber.
Bernard Fournier : Panorama
du quatuor à cordes. 1 vol Fayard, 2014, 327 p. 22 €.
Bernard Fournier est un spécialiste reconnu
de l'histoire du quatuor à cordes. Le présent ouvrage est une synthèse de
quatre précédents généreux volumes consacrés à l'Esthétique puis à l'Histoire
du quatuor à cordes (1999-2010). Une version allégée destinée à un large
public, mais qui contient l'essentiel : ce qu'il faut retenir de ce qu'est ce
genre musical et de son histoire. Quelle est la spécificité du quatuor à cordes
? L'endroit d'un dialogue instrumental à quatre, bien sûr, quintessence
fondatrice, symbole de perfection, d'achèvement, et qui n'est pas la seule
addition de quatre voix, mais le fait de combinaisons aussi nombreuses
qu'originales ; lieu d'intimité et d'intériorité aussi, qui féconde la
créativité des compositeurs, mais qui exige cette concentration de tous les
instants aussi bien pour les interprètes que pour ceux qui les écoutent. La
fabuleuse histoire du quatuor à cordes, l'auteur la divise en sept parties,
articulées autour de grandes périodes charnières que sont la naissance du genre
à l'âge classique, avec Haydn et Mozart, son apogée avec Beethoven, son
renouveau au début du XX ème siècle, marqué par la
seconde École de Vienne et surtout Bartók, et sa mutation
foisonnante à partir des années 1950, où il est utilisé par certains
compositeurs comme « le laboratoire de leurs expériences parfois les plus
extrêmes » (Boulez, Nono, Lachenmann). Chacune
de ces périodes phares est suivie ou « annoncée » par une phase pas
moins significative : le romantisme, les écoles nationales, le renouveau du
genre et son explosion dans les années 1900/1940. Au sein de chacune des
périodes, l'auteur analyse les œuvres essentielles avec minutie, sans pour
autant verser dans une sèche technicité, et viser une exhaustivité dont le
dessein est poursuivi dans les quatre autres livres cités. Pour Bernard
Fournier, quelles que soient les attaques subies par ce genre musical, et les
velléités de certains, ces trente dernières années en particulier, de chercher
ici « à faire table rase », le quatuor à cordes a survécu
vaillamment. Parce qu'il a toujours résisté aux effets de mode et aux coups de
boutoir que lui ont fait subir les compositeurs les plus iconoclastes. Le genre
demeure bien vivant, à en juger par l'indéniable attrait qu'il exerce toujours
et encore sur le public. Un chapitre annexe, fort pertinemment, repend les
définitions succinctes des termes de technique musicale.

Jean-Pierre Robert.
Riccardo Muti : Prima la musica. Mémoires. 1 vol Éditions
L'Archipel, 2014, 234 p. 19,95 €.
En bon napolitain, Riccardo Muti (*1941) n'a pas pour habitude de mâcher ses mots.
Celui qui vient tout juste de diriger l'Orchestre National de France, avec la
suprême élégance qu'on lui connait, pour le concert marquant le 80 ème anniversaire de la phalange parisienne, et seul
orchestre français qu'il accepte de conduire, revient dans ses Mémoires sur un demi-siècle
de carrière, partagée à égale partie entre directions symphonique et lyrique,
comme tous les grands. Un parcours fulgurant qui le mènera peu après le premier
prix au concours Cantelli en 1967, à la direction
musicale du Théâtre de Florence, puis vite à celle du Philharmonia de Londres (1973), où il succède à Otto Klemperer, puis à la tête du
Philadelphia Orchestra (1980), sur les traces d'Eugene Ormandy,
avant de prendre la direction artistique du Teatro alla Scla, en 1986, après Claudio Abbado. De solides
amitiés, comme avec le pianiste Sviatoslav Richter, le compositeur Nino Rota,
des rencontres artistiques passionnantes, dont Herbert von Karajan qui l'impose à Salzbourg, Luciano Pavarotti, ou encore Christa Ludwig,
ont scellé un destin hors du commun qui le distingue parmi ses pairs. L'homme
est très cultivé, qui manie le latin au point d'en introduire force citations
dans son propos. Le cœur de l'ouvrage est le crédo artistique du chef italien
et son viscéral attachement à la lettre du texte ; non pas par une quelconque
forfanterie, mais simplement par un sens aigu du respect de l'écrit. Cela lui
valut des démêlés homériques avec tel ou tel chanteur, avide de tirer la
couverture à soi et de mettre le public de son côté. Encore que la force de la
tradition soit souvent la plus forte : Muti avoue y
avoir cédé quelques fois. Cette forme d'intransigeance lui valut des
déconvenues, tel sa démission de la Scala ou son
renoncement à diriger une nouvelle production de La Clemenza di Tito à Salzbourg. Et pourtant, son aura dépasse ces vaines querelles et les plus grandes institutions le réclament, tel encore
le Chicago Symphony qui lui a offert récemment sa
direction musicale. Il passe pour distant, sans doute à tort. Car sa passion
pour la transmission est immense, auprès de la jeune génération en particulier.
De réflexions bien senties en anecdotes révélatrices, de remarques lucides,
mais non désabusées, sur les heurs et malheurs de la vie professionnelle, en
vraies déclarations d'amour, en particulier pour Verdi, avec lequel il dit être
lié par un « pacte d'amour », et pour qui il a tant donné, ces pages
fourmillent de passionnantes réflexions et de points de repère captivants sur
la vie musicale de ces cinquante dernières années. Elles sont écrites avec la
foi d'un vrai musicien et d'un homme qui place avant toute chose l'exigence
d'une conduite éthique dans la pratique professionnelle.

Jean-Pierre Robert.
***
CDs et DVDs
« Chansonnettes
frisquettes, joliettes & godinettes ». Doulce Mémoire, dir. Denis Raisin Dadre. 1CD ZIG ZAG TERRITOIRES
(www.outhere-music.com ): ZZT 339. TT : 60’
57.
Denis Raisin Dadre a misé sur un programme particulièrement typique et varié de Chansons de la Renaissance, dont — conformément au nom de son Ensemble — il lui tend à cœur de cultiver la « Doulce mémoire ». Il conduit les auditeurs sur les sentiers alors très courus, comme par exemple, avec la célèbre poésie de Ronsard : Mignonne, allons voir si la rose, dans les versions vocales de Jehan Chardavoine et Guillaume Costeley, ainsi que dans une version instrumentale (J. Chardavoine), assortie de la mention : « À vous de chanter ». Ces chansons savantes et populaires (galantes, osées, impertinentes) côtoient des danses : Pavanes (Nicolas Du Chemin, Tielman Susato, Étienne Dutertre), Bransle (Claude Gervaise), Gaillarde (Guillaume Morlaye)… Des thématiques de la malmariée, « Jean de Nivelle… est un galant »… sont développées. À noter une résonance plus moderne : La complainte de la butte (paroles de Jean Renoir, musique de Georges van Paris). Voici une chouette sélection de ce qui était « fredonné dans les rues, dans les échoppes d’artisans et dans les maisons en France » au XVIe siècle. Véronique Bourin (Soprano) et Hugues Primard (Ténor) font preuve d’une extraordinaire précision d’attaque, d’une volubilité et d’une virtuosité à toute épreuve ; il en est de même pour Pascale Boquet et Miguel Henry (luths et guiternes), Bruno Caillat (percussions) et le consort de flûtes à bec, hautbois, bassons, tournebouts… Le souhait de Denis Raisin Dadre : « En espérant que vous prendrez bien du soulas à dégoiser ces chansonnettes tant godinettes que frisquettes qui vous feront ramentevoir [se souvenir de, remettre en mémoire] ce temps ou l’on chantait ès-maisons, en bonne compagnie et à plaisir de gorge » est parfaitement réalisé. Les discophiles seront séduits, envoûtés et gagnés par leurs interprétations exceptionnelles avec lesquelles l’Ensemble Doulce Mémoire fête dignement ses 25 ans. Irrésistible.

Édith
Weber.
« Le chant
des poètes. Arcadelt ou l’Antiquité en musique ». Ensemble Enthéos, dir. B. Damant. 1CD PARATY (anne.gueudre@gmail.com) : PARATY 213 121. TT : 53’ 05.
Toujours à l’affût d’originalité et d’authenticité, Benoît Damant a, pour son disque, réalisé un programme à la fois littéraire et musical qui ravira les mélomanes les plus exigeants. Ces 20 pièces sont placées sous le signe « Arcadelt ou l’Antiquité en musique », autrement dit situées au XVIe siècle marqué par le retour à l’Antiquité gréco-latine, le changement d’esthétique musicale et l’influence de la Renaissance italienne. L’Ensemble Enthéos y rend hommage à la Maison de Lorraine. La mise en situation est assurée par le Récitant (B. Damant) qui, avec une diction impeccable, fait revivre un texte de Pierre Ronsard relatant une soirée passée chez Charles de Guise, Cardinal de Lorraine, « l’un des plus grands protecteurs des arts ». Tout naturellement, des compositeurs ayant repris des poèmes de Ronsard sont présents : Pierre Cléreau — maître des enfants de chœur à la Cathédrale de Toul —, Ferrabosco — musicien italien — et Jacques Arcadelt (1507-1568) — compositeur francoflamand, « musicien du Roy et maistre de chapelle du Cardinal de Lorraine ». Après cet hommage au Cardinal, cinq chants sont placés sous le signe de Didon et Énée. J. Arcadelt a mis en musique l’Ode d’Horace : Poscimur, si quid vacui sub umbra (Livre I, 32) et le poème Ad trepida et coeptis immanibus effera Didode Virgile (Énéide, Livre 4, 554sq.) assurant la présence de l’Antiquité. Six autres évoquent la France qui « sous Henri fleurît comme sous Auguste fleurissoit Romme » avec également des textes de Pietro Bembo, Pierre de Ronsard mis en musique par P. Cléreau. Pour conclure, trois pièces sont regroupées sous le titre : Vénus et Adonis (texte d’Ovide) avec la Fantaisie instrumentale à 4 de Ferrabosco, la chanson Laissés la verde couleur (Mellin de Saint-Gelais-J. Arcadelt). L’Ensemble Enthéos (« enthousiasme »), créé en 2005, comprend 4 voix solistes, 4 violes de gambe, 1 harpe et 1 luth ; son chef est aussi un remarquable Récitant, insufflant aux discophiles tout son enthousiasme pour la musique du XVIe siècle : une réussite du genre associant littérature, musique et histoire.

Édith Weber.
Johann Sebastian BACH : Markus Passion (reconstruction : Simon Heighes). Knabenchor Hannover, dir. Jörg Breidling. 2CDs RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP
7015/16. TT : 103’.
Le Cantor de Leipzig — après avoir traité magistralement les Passions selon Saint Matthieu et Saint Jean — a mis en musique la Passion selon Saint Marc qu’il a dirigée, à Saint-Thomas, le Vendredi saint 1731. Toutefois, si le livret existe, la musique a disparu. Plusieurs exégètes en ont tenté une restitution. En 2005, Volker Braütigam, disciple du Cantor Rudolf Mauersberger, l’a intitulée : Evangelienmusik zu BachsMarkuspassion (dans l’optique du renouvellement de la musique sacrée en Allemagne). Récemment, le musicologue Simon Heighes en a réalisé une reconstitution. Il est « évidemment hasardeux de proposer une version d’une musique qui n’a peut-être jamais été en l’état, mais qui toutefois a pu exister ». Ce musicologue l’a reconstituée, d’un côté à partir de Choeurs et d’Airs existant à l’origine, et de l’autre côté en faisant appel au procédé de la parodie. D’après Christoph Wolff, le spécialiste de J. S. Bach : « La Passion selon Saint Marc d’après Simon Heighes est une tentative digne de louange, permettant de compenser cette perte ». Celle-ci est donc « réparée » par le remarquable chef Jörg Breiding à la tête du Chœur de garçons et de la Chapelle de la Cour de Hanovre, et grâce au Label leipzicois RONDEAU PRODUCTION. L’enregistrement, gravé sur deux disques, comprend 46 numéros. Cette Passion était chantée avant et après la Prédication. Le texte conservé est extrait des Poèmes sérieux et satiriques de Christian Friedrich Henrici (1700-1764), alias Picander ; il a été publié à Leipzig en 1723. Quant aux sources de la musique : les spécialistes estiment qu’il s’agit d’un processus de parodie que Bach, très occupé (il devait composer une nouvelle cantate pour chaque dimanche ou jour de fête) avait, selon l’usage habituel à son époque, puisé dans ses propres compositions. Cette hypothèse d’emprunt concerne le chœur d’introduction et le chœur conclusif, ainsi que 3 Airs que Bach a vraisemblablement empruntés à l’Ode funèbre (BWV 198) pour la Reine Christiane Eberhardine (1671-1727), Reine de Pologne, Princesse de Saxe et épouse d’Auguste le Fort. Les chorals sont empruntés, pour la plupart, à la collection réalisée par son fils, Carl Philipp Emanuel Bach. C’est le mérite de Jörg Breiding, avec le Hannover Knabenchor — dont la réputation n’est plus à faire — d’avoir redonné vie à cette Passion , d’après les chapitres 14 et 15 de l’Évangile de Marc relatant l’arrestation de Jésus, sa comparution devant les autorités, sa condamnation à mort, les moqueries des soldats et sa mise au tombeau. Un événement qui fera date : à ne pas manquer.

Édith Weber.
Jean Sébastien BACH : The Well Tempered Clavier. Frédéric Désenclos, orgue. 4 CDs ALPHA (www.outhere-music.com) : ALPHA 819. TT :
56’33+48’03+66’18+74’ 21.
L’enregistrement partiel du Clavier bien tempéré a fait l’objet d’une récente version au clavecin par Sébastien Guillot (Préludes et Fugues, BWV 870b-893) qui, pour la première fois — l’original étant perdu —, a exploité le manuscrit original de Londres, Version A (Londoner Originalhandschrift (ou Fassung A), mettant en valeur les sonorités exceptionnelles du Clavecin reconstitué par O. Fadini (Milan, 1993), d’après l’instrument F. Blanchet (Paris, 1733) (cf. NL n°78, février 2014). Pour sa part, Frédéric Désenclos propose, en 4 CDs, la version intégrale pour orgue avec : CD 1 : les Préludes et Fugues 1 à 12 (BWV 846-857) ; CD 2 : 13 à 24 (BWV 858-869) ; CD 3 : 1 à 12 (BWV 870-881) ; CD 4 : 13 à 24 (BWV 882-893). Ils ont été enregistrés respectivement aux Orgues de la Oud Katholieke Kerk à La Haye (1726, instrument restitué en 1994) ; de l’Église Saint-Vincent à Lyon (construit en 1994) ; de l’Église Saint-Étienne à Baïgorry (construit en 1999) et de la Sint-Maartens Kerke à Zaltbommel (Pays-Bas), (1723, restitué 1986). En remarquable pédagogue et interprète, pour réaliser cette Intégrale, l’éminent organiste Frédéric Désenclos a donc judicieusement sélectionné deux Orgues français et deux néerlandais. Rappelons que le Premier Cahier est « dédié à l’usage et profit de la jeunesse musicienne avide d’apprendre, ainsi qu’au loisir de ceux qui sont déjà exercés en cette étude. » J. S. Bach propose ainsi une progression pédagogique et une remarquable méthode exploitant le tout récent tempérament égal, dans toutes les tonalités, favorisant l’émotion, c’est-à-dire — selon les théories du Professeur Marc-Mathieu Münch — l’« effet de vie », conformément au constat de Henri de Rohan-Csermak : « Le fil d’Ariane tissé par Bach nous conduit donc bien plus loin que d’une tonalité à l’autre…». Dans ce cadre, il est impossible de détailler chaque pièce ; il est indéniable que Frédéric Désenclos a signé non seulement un « manifeste de l’art du clavier », mais encore une grande réussite grâce à l’interprétation mettant en valeur les jeux et les sonorités spécifiques à chacun des 4 instruments. Tentative très convaincante qui s’adresse à la fois aux mélomanes, aux discophiles et aux organistes les plus exigeants.

Édith
Weber.
Franz LISZT : « En
rêve ». Ludmilla Guilmault, piano. 1CD VDE-GALLO (www.vdegallo-music.com) : CD 1402. TT : 62’ 59.
La pianiste concertiste de renom international, Ludmilla Guilmault, spécialiste incontestée de Franz Liszt (passionnée par lui depuis l’âge de 6 ans), a commencé sa carrière en 1984. Elle a retenu 10 pièces fort célèbres et un piano Bösendorfer Imperial dont elle tire le meilleur parti pour « faire partager ce voyage spirituel et musical dans l’univers de l’Abbé Liszt » à travers une sélection parmi les pièces des Années de Pèlerinage (Les Jeux d’eau à la Villa d’Este et le Sonnet 123 de Pétrarque et ses Deux Légendes dont Saint François de Paule marchant sur les flots et Saint François d’Assise : La Prédication aux oiseaux). Sa technique pianistique est remarquable : jeu perlé et transparent, ornementations et trilles, trémolos, arpèges, triolets ; elle se joue de tous les traquenards techniques ; fait autant preuve de délicatesse que de passion, tout en traduisant le rêve ; recrée aussi bien la douceur que la fougue. Elle réussit à merveille dans le descriptif : bruissement de la forêt, flots déchaînés de la mer, nature (cyprès, jets d’eau, sources, cascades), gazouillis des oiseaux… Elle a le mérite de faire découvrir Trübe Wolken (S. 199) et, en quelque sorte, de faire re-découvrir des œuvres parfois galvaudées : Le Rossignol ; Liebesträume et Consolations (vrai morceau de salon)… Elle s’impose par le charme de la mélodie, les sonorités généreuses, les effusions lyriques contrôlées, l’expressivité et, d’une manière générale, sa musicalité et sa sensibilité. Disque à écouter et réécouter, aussi bien par les jeunes pianistes que par les mélomanes avertis.

Édith Weber.
Antonin DVOŘÁK : Dumky-Trio, op. 90. Alfred FELDER : The Second Attention. Trio Artemis. 1CD VDE-GALLO (www.vdegallo-music.com) : CD 1409. TT : 53’ 42.
Privilégiant les
interprètes suisses, le Label VDE-GALLO a fait appel au célèbre Trio Artemis composé de trois musiciennes
helvétiques : Katja Hesse (violon), Bettina Macher (violoncelle), Felicitas Strack (piano). Elles interprètent le « Dumky-Trio »,
op. 90 (B. 166), 4e Trio écrit par Antonin Dvořák (1841-1904) à Prague entre novembre 1890 et février 1891, créé — avec le
compositeur au piano — le 11 avril 1891. Selon le texte bilingue
d’accompagnement (qui gagnerait à être traduit en français), le titre de ce Trio se réfère à la chanson ukrainienne
intitulée Dumka,
très répandue dans les Pays slaves et signifiant « une petite
pensée », ce mot dumati dont dérive Dumka signifie « être profondément plongé dans ses pensées, contempler ou
méditer ». Dans son Trio structuré
en 6 mouvements, Dvořák privilégie les mouvements lents contrastant immédiatement avec un mouvement
rapide, exploite la sonorité si prenante du violoncelle, le dépouillement des
lignes mélodiques, les interventions pianistiques plus énergiques. Les 3
premiers mouvements, Attaca,
sont enlevés d’un seul tenant ; les mouvements 4 et 5 sont séparés par un
silence. Dans cette œuvre, proche de la poésie populaire, oscillant entre la
mélancolie et la joie exubérante, le Trio Artémis, très équilibré, force aussi
bien sur les envolées mélodiques que sur le rythme percutant.
Né en 1950 à Lucerne, Alfred Felder, violoncelliste et compositeur, a eu de nombreuses commandes, entre autres des Institutions musicales de Zürich et de Lucerne, diffusées aussi bien au Japon, en Russie qu’en Afrique du Sud et aux États-Unis. Son œuvre est intitulée : The Second Attention (d’après le deuxième mouvement). L’idée générale repose sur la notion de rêve qui, selon un dicton australien, est, en fait, la seule chose que nous possédions réellement. Le compositeur précise que « notre vie ne se joue pas seulement dans la réalité du quotidien » (Premier mouvement : Voyage - The Journey), car « nous connaissons tous également la réalité non-quotidienne, avant tout par des prémonitions, visions, rêves et symptômes passagers ». Depuis longtemps, il s’est intéressé au chamanisme impliquant, pour lui, la possibilité d’ouvrir sa conscience à la perception d’autres réalités (deuxième mouvement : The Second Attention). Sa musique vise à « extraire d’un monde familier les auditeurs et à les amener à un voyage dans un monde totalement différent et mystérieux » : objectif rempli pour les auditeurs par le Trio Artémis qui vibre en sympathie avec le compositeur, restituant les moindres insinuations de sa pensée.

Édith
Weber.
« Jewish Songs ». Pierre-Luc
Bensoussan, batterie, Pierre Diaz, saxophones, Patrice Soletti,
guitare électrique, objets sonores. 1 CD Éditions
de l’Institut Européen des Musiques Juives (www.iemj.org ) : IEMJ CDD 001. TT : 49’ 26.
L’Institut Européen des Musiques Juives (IEMJ), créé en 2006 par la Fondation du Judaïsme Français, en partenariat avec l’Association Yuval, a pour mission de recenser, préserver et diffuser le patrimoine musical juif en France par des enregistrements audio et vidéo, des partitions, monographies…La Collection « Découvertes » convie les discophiles à un « Voyage instrumental et poétique sur les traces des musiques juives ». Hervé Roten, Docteur en Musicologie de l’Université Paris-Sorbonne, Directeur de l’IEMJ, a regroupé 7 pièces de Chants juifs typiques, évoquant l’histoire et les vicissitudes du Peuple d’Israël, par le biais de la musique et du chant qui, grâce à la mélodie, suscitent « l’émotion de l’exil, mais aussi celle des jours heureux ». Cette réalisation est accompagnée d’un bref commentaire français et anglais (traduction : Noam Cochin). La première pièce : Bith Aneth plonge immédiatement l’auditeur dans l’atmosphère nostalgique et langoureuse si caractéristique de l’âme juive. La célèbre chanson : Dona Dona, selon le texte d’accompagnement, écrite en yiddish par Aaron Zeitlin sur la musique de Sholom Secunda, décrit la condition d’un petit veau ligoté mené à l’abattoir, parallèle avec la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La Fête de Hannouka commémore la réinauguration de l'autel des offrandes dans le second Temple de Jérusalem, lors de son retour au culte judaïque, après son interdiction ; elle est associée à l’allumage des chandeliers à neuf branches, et le chant Ochos kandelikas fait allusion aux huit bougies ; malgré son atmosphère judéo-espagnole, cette composition moderne (1983) est due à Flory Jagoda. La poésie religieuse Tsur Michelo est chantée avant la bénédiction de la fin du repas ; d’origine vraisemblablement française, remontant à la seconde moitié du XIVe siècle, elle s’est répandue dans la diaspora. Cet enregistrement reprend aussi une chanson d’amour du folklore judéo-espagnol. Il en sera de même du traditionnel : Dos Amantes. Le folklore ashkénaze russe est représenté par Tumbalalaïka (habituellement chanté en yiddish). Le chant traditionnel judéo-espagnol : Cuando el rey Nimrod évoque l’histoire de la naissance d’Abraham. Ce CD — entièrement instrumental, interprété par Pierre-Luc Bensoussan (batterie), Pierre Diaz (saxophones) et Patrice Soletti (guitare électrique, objets sonores) — réussit à rendre sensible et à recréer l’atmosphère mélancolique typique des chants juifs. Il contribue à la diffusion et à la mémoire du patrimoine musical juif.

Édith
Weber.
« AVE MARIA ». Pascal Jean, hautbois & cor anglais,
Jean Brenders, orgue. 1CD JADE (www.jade-music.net) : CD 699 818-2.
TT : 55’ 37.
Sous le titre « Méditations mariales », Pascal Jean (hautbois, cor anglais) et Jean Brenders (orgue) proposent une sélection de pièces d’esthétiques diverses : baroque, classique, romantique, moderne et contemporaine, comprenant neuf versions de l’Ave Maria par Giulio Caccini, Jacques Arcadelt, Luigi Cherubini, Franz Schubert, Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, César Franck, ainsi que celle, plus récente et inattendue, quelque peu langoureuse et sentimentale, d’Astor Piazzola (1921-1992). L’alliance des sonorités de l’orgue, du hautbois ou du cor anglais renforce encore l’émotion de ces pages si expressives. Les arrangements ont évidemment tenu compte des possibilités de ces trois instruments. L’intériorité est encore accrue par l’Ave verum de W. A. Mozzart, la Sinfonia (BWV 156) de J. S. Bach, l’Aria de sa Suite en Ré (BWV 1068) et, bien entendu, le Largo de G. Fr. Haendel. Ce parcours à travers les siècles comprend également l’incontournable Negro Spiritual Amazing Grace. Cette mini Anthologie retiendra l’attention des discophiles, jeunes et des moins jeunes, car elle est interprétée en connaissance de cause par deux interprètes professionnels qui, selon les Éditions JADE, « rejoignent la dimension cosmique de l’orgue en des harmonies toujours plus riches et renouvelées ».

Édith
Weber.
Hervé ROULLET : Œuvres liturgiques. 1 CD Hervé ROULLET 2012 (25,
rue Descartes, 75005 PARIS). TT : 52’ 02.
Hervé ROULLET : Chants liturgiques pour quatre voix mixtes. 1 CD Hervé ROULLET 2013. TT : 64’ 01.
Hervé Roullet (né en 1947) est compositeur, écrivain français,
ingénieur de formation, ayant effectué sa carrière dans des groupes bancaires
parisiens. Musicien, il a bénéficié de l’enseignement de Henry Mesmin, disciple
de Vincent D’Indy et de Déodat de Séverac. Depuis une
quinzaine d’années, il compose des œuvres pour piano et petit chœur mixte. Son
esthétique est personnelle, à la fois romantique et contemporaine. Très marqué
par la foi catholique, il a réalisé deux disques à finalité liturgique, et ses
œuvres sont interprétées par l’Ensemble vocal Via Lucis que dirige Marie Saadi et placé sous le patronage de Sainte Thérèse de Lisieux.
Il comprend des grands amateurs et quelques professionnels. Certaines pièces
sont soutenues à l’orgue de chœur de l’Église Saint-Louis-en-l’Île,
par l’organiste Jean Galard (aussi titulaire des Orgues de St-Médard et de la
Cathédrale de Beauvais). D’autres pièces sont chantées a cappella. À
l’imitation du Traité de l’amour de Dieu par François de Sales, pour le compositeur, l’important est de susciter un élan
spirituel, de gravir la « haute région de l’Esprit ».
Le premier CD
(2012), intitulé : Œuvres liturgiques,
est vraiment pensé pour la célébration de la messe en français, commençant aux
accents du Psaume 51 : Seigneur,
ouvre mes lèvres. L’atmosphère est, tour à tour, solennelle, joyeuse,
parfois populaire. Il se poursuit avec les traditionnels Introït, Kyrie, Gloria, Lectures, Credo jusqu’au Notre Père,
à l’Agnus Dei, à l’Eucharistie et à
l’Envoi conclusif avec le
chant extrait d’une poésie de Ste Thérèse : Mon chant d’aujourd’hui qui est aussi l’emblème de l’Ensemble Via lucis et résume bien les objectifs fonctionnels du
compositeur. La deuxième Partie comprend 5 « autres chants
liturgiques » : Psaume, Béatitudes, entre autres. Les paroles
restent toujours très intelligibles.
Le deuxième CD
(2013), intitulé : Chants
liturgiques pour 4 voix mixtes (avec
les mêmes interprètes), révèle également le langage personnel de Hervé Roullet et sa musique intime et volontairement mélodieuse.
Son cycle marial comprend 11 pièces dans le sillage de la dévotion mariale
évoluant en Occident à partir du premier millénaire, peut-être sous l’influence
du Christianisme oriental, par exemple : Je vous salue, Marie (avec une certaine envolée mélodique et
des oppositions de nuances) ; le Magnificat (avec
alternance entre les tessitures : soprano et basse et interventions du choeur) ; Ave maris stella (plus développée, avec une mélodie
spéculant sur l’aigu et commentaires du choeur); Ave Regina coelorum (bref,
avec participation de l’orgue); Salve,
Regina ou encore Réjouis-toi,
Marie, pleine de grâce (planant dans l’aigu, de caractère plus discret),
entre autres. La seconde partie est une sélection de chants d’invocation, de
bénédiction. Cette séquence se termine par le chant : Vers la Cité sainte énergiquement soutenu à l’orgue et très
développé. Enfin, l’épilogue est signé par l’emblème de l’Ensemble Via lucis, se : Mon
chant d’aujourd’hui d’après une poésie de sa patronne.
L'écrivain et
critique musical Jean Cabourg définit Hervé Roullet comme un « aquarelliste musical hanté par la grâce » et ajoute :
« une musique qui sent bon, comme disait Claude Debussy ». Ces deux
disques montrent que, selon les perspectives ouvertes par le Concile de Vatican
II (1962-1965), les chants liturgiques en français sont en plein essor.


Édith
Weber.
Antonio VIVALDI. Concertos
per archi vol II ( concertos RV 150, 134, 151,
119, 110, 160, 128, 164, 127, 166, 157). Concerto Italiano, dir.
Rinaldo Alessandrini. 1CD Naïve : OP 30554. TT.:
51'14.
Ce 57 ème volume
de l'Édition Vivaldi de Naïve offre une intéressante sélection de concertos à
quatre pour les seuls archets. Toujours pareils pense-t-on, et pourtant si
différents ! Car l'inventivité du Prêtre roux est sans limite, à l'aune des
attentes de son public avide de nouveauté. Leur brièveté les rapproche des
Ouvertures d'opéra, leur immédiateté les apparente à la musique de chambre. La
succession des mouvements relève parfois de l'audace, car les enchainements
réservent des surprises en terme de contrastes. Ainsi
des trois parties du concerto RV 151, « Alla rustica »,
dont la durée totale au demeurant ne dépasse pas 3 minutes, et la section lente
quelques 40''. La manière est souvent aventureuse dans l'agencement des
diverses séquences, et offre renouvellement jusqu'à à l'intérieur d'un même mouvement. Les largos ou
adagios peuvent être hypnotique (RV 119) ou déclamatoire (RV 128), mystérieux
(RV 164) ou élégiaque (RV 166). Les mouvements rapides offrent un panel encore
plus varié, mesurés, bien sentis, ou rageurs telle une tempête (RV 110), ou au
contraire, semblent comme l'émanation de quelque aria d'opéra (RV 128). En un
mot règne ici la plus grande liberté, à travers « une idée, rythmique ou
mélodique soumise à des progressions harmoniques en général prévisibles »,
note Rinaldo Alessandrini, qui voit une variété des
rythmes souvent empruntés à la danse. Ses interprétations qui font appel à un
seul instrument par partie de cordes, outre un théorbe, offrent un raffinement
extrême et sont des modèles d'équilibre : une belle motricité, pas agressive ni
cassante, comme chez certains de ses confrères, une ligne généreuse, justement
animée, pour un résultat sonore éminemment vrai.

Jean-Pierre Robert.
Ludwig van BEETHOVEN : Trios pour piano,
violon et violoncelle N° 6 op. 70 n° 2 & N° 7, op. 97 « À l'Archiduc ». Alexander Melnikov,
pianoforte, Isabelle Faust, violon, Jean-Guihen Queyras, violoncelle. 1CD Harmonia Mundi : HMC
902125. TT.: 67'34.
Un avertissement s'impose : ces
interprétations font appel à un pianoforte et non au piano de concert moderne.
La différence est de taille : le pianoforte de Graff joué par Alexander Melnikov apporte une saveur ascétique, aux harmonies plus
dépouillées que celles produites par le
Steinway grand que nous connaissons aujourd'hui. Mais passé la surprise,
l'oreille s'habituant vite, la plaisir s'avère intense. L'équilibre, si délicat
entre clavier et cordes, se trouve bien assuré, en particulier dans las tutti, le grave du pianoforte offrant moins de
résonance et le martèlement étant plus sec. Le CD rapproche les deux dernières compositions conçues par Beethoven
pour le trio à cordes avec clavier. L'op. 70, N°2, dédié à la comtesse Anna
Marie Erdödy, autre bien aimée, développe des
harmonies inattendues au fil de son premier allegro qui fait la part belle aux
deux cordes. À l'allegretto suivant,
deux thèmes s'enroulent l'un dans l'autre, l'un urbain, l'autre espiègle, pour
des enchaînements souvent curieux, aux sonorités presque bourrues. Le suivant
offre une fluidité déjà presque schubertienne, et le finale, qui assure la
primauté au clavier, se développe sur un mode bien senti, énergique et allant. Le trio Op. 97, « A
l'Archiduc », car dédié à Rodolphe d'Autriche, est d'une autre
ampleur. On admire ici la sérénité de
l'allegro moderato initial dont les vastes développements font se succéder des
climats enchanteurs et de subtiles transitions. Pris à vive allure, le scherzo
est un modèle de fluidité, dans une simplicité de traits qui en allège encore
la texture. Le thème insinuant, initié par les cordes, s'enfle crescendo et
débouche sur un forte des plus nets. L'andante cantabile se déploie sans
affectation selon le schéma du thème et variations. Le discours ne le cède pas
à la facilité du beau son et joue sur une dynamique volontairement non
excessive. Le rondo final s'emplit d'un ton populaire non exagéré et lié à une
douce gaité. Les passages de lyrisme en acquièrent encore plus de douceur. Le
presto ultime est ailé et jubilatoire. Melnikov,
Faust et Queyras, dont la réunion des talents n'a rien à envier à une formation
non ad hoc, livrent là la quintessence de la musique de chambre.

Jean-Pierre Robert.
Franz SCHUBERT : Symphonie N° 7, D. 759
« Inachevée ». Ludwig van BEETHOVEN : symphonie N° 2, op.
36. Richard WAGNER : Siegfried
Idyll. Wiener Philharmoniker (Schubert), Chamber Orchstra of Europe, dir. Claudio Abbado.1 CD Audite/Lucerne
Festival Historic performances : 95.627. TT. : 77'44.
Il n'était sûrement pas prévu que ces
documents tirés des archives du Festival de Lucerne sortent aussi vite dans la
série historique récemment initiée par l'institution et confiée au label
Audite. La disparition du maestro en aura décidé autrement. L'Inachevée,
donnée lors d'un concert de septembre 1978, où Ababdo conduisait les Wiener Philharmoniker, est émouvante
en ce qu'on y trouve déjà les traits saillants de ce qui jalonnera son
infatigable quête schubertienne. Même si le discours se place dès les premières
dans une lenteur soulignée - et pas encore aussi habitée que dans l'ultime vision livrée lors du concert à
Lucerne du 26 août dernier - notamment dans les longues tenues des basses, qui
forgent une opulence rare, on est frappé par la beauté du phrasé, l'équilibre
des masses. La rondeur des cordes des Viennois fait le reste. Empruntés au
concert du 25 août 1988, qui reprenait le programme exact du concert inaugural
de 1938 dirigé à Tribschen par Arturo Toscanini, les
deux autres pièces sont enthousiasmantes. Abbado dirigeait alors le Chamber Orchestra of Europe, une formation chère à son cœur
- avec laquelle il venait d'ailleurs d'enregistrer l'intégrale des symphonies
de Schubert pour DG, en 1986/87 - savoir un orchestre favorisant un son aéré,
extrêmement clair. Tournant le dos à la tradition académique, l'exécution de la
Deuxième symphonie de Beethoven se signale par sa souple articulation, son
climat allégé : clarté de l'adagio molto introductif ; con brio souplement
articulé progressant de manière allègre ; larghetto, pris très retenu, mais
n'en conservant pas moins un allant remarquable ; scherzo d'une suprême finesse
avec ses effets de surprise ; finale possédant une énergie viscérale, doté d'un
sens de l'urgence basé sur une savante combinaison de la dynamique et du rythme.
Le nombre restreint des cordes permet aux vents de se frayer un naturel chemin.
Plus tard, avec l'Orchestra Mozart, le chef favorisera une texture de cordes
plus fournie, sans pour autant que la sonorité ne s'en ressente. Une des rares
incursions du maestro dans l'univers wagnérien (avec Lohengrin à Vienne
et Tristan à Salzbourg, cependant) sa vision de Siegfried Idylloffre, là encore, une urgence expressive
admirable et un ton chambriste frôlant l'idéal. L'extrême ductilité des cordes,
le ton éloquent des vents apportent à la pièce une délicatesse émue et lui
confère une vraie aura de noblesse, au-delà du statut de morceau de
circonstance. Après le passage fébrile fleurant le joyeux appel du cor du héros, la section conclusive
est habitée d'un lyrisme apaisé. Un bien beau témoignage de l'art souverain du
maestro Abbado.

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé MOZART : Concertos pour piano et orchestre N° 25, en ut majeur, K 503 & N°
20, en ré mineur, K 466. Martha Argerich, piano. Orchestra M ozart,
dir. Claudio Abbado. 1 CD Universal DG : 479 1033. TT.: 61'44.
Ces interprétations ont été captées live au
KKL de Lucerne lors de deux concerts du Festival de Pâques 2013. On se
souvient, non sans émotion, de ces moments intenses de musique vécus grâce à
ces deux « vieux amis » que sont Claudio Abbado et Martha Argerich (cf. NL de 4/2013). On est triste à la pensée de
savoir que ce sont sans doute parmi les dernières gravures du maestro, et
l'ultime de cette paire légendaire qui inaugurait son partnership il y a plus quarante ans avec un couplage devenu iconique du Concerto en sol de
Ravel et du Troisième de Prokofiev. Le présent CD est intéressant en ce qu'il
rapproche deux pièces dissemblables. Le Concerto K 503, le dernier de la série
des douze des années 1784/1786, est tout sauf flatteur. Abbado lui confère même
un sentiment de gravité dans la conversation serrée entre soliste et orchestre.
Passée une entrée en matière presque martiale, un vent fébrile va souffler
entre les deux protagonistes, l'orchestre et le piano : changements fréquents
de rythme, alternance majeur mineur. Dans l'andante, le piano distille des
climats sublimes de tendresse caressée par les cordes et soulignée par les
vents, la flûte en particulier, non sans qu'affleure une pointe de tragique. Le
rondo final, ouvert par une ritournelle en forme de gigue, offre une variété de
motifs exposés avec une grande liberté de ton et une joyeuse effusion. L'élan
créé par Argerich et Abbado est difficilement
résistible. Le Concerto K 466, le 20 ème, révèle
d'autres perspectives. Une expressivité tragique s'y révèle dès l'allegro
introductif, avec son entrée en matière agitée, qu'Abbado ne cherche pas à
amoindrir, grondement de la basse, rythmique haletante, sens de l'urgence. Par
contraste, l'entrée du soliste est sereine, tel un récitatif libre, mais
celui-ci s'imprègne vite du climat ambiant. Argerich joue la cadence de Beethoven, elle aussi extrêmement dramatique dans ses
premières mesures et offrant un développement presque virtuose. La
« Romance » qui suit est parfaitement pacifiée, quoique l'intermède
médian introduise, là encore, quelque perturbation avec traits syncopés et bois
criant quelque inquiétude. Le finale, qu'Abbado enchaîne, renoue avec
l'agitation du premier mouvement. Il est pris avec entrain dans un geste preste
: clavier bien marqué, accompagnement instrumental vif. La cadence, de
Beethoven, apporte une grandeur qui tranche quelque peu. Mais le retour de
l'orchestre sait se faire allègre et enthousiaste. Comme l'accueil du public ! Dans l'un et l'autre cas, le pianisme fluide, non affecté, de Martha Argerich est en empathie avec les subtiles couleurs orchestrales créées par le chef.
L'effectif relativement fourni de l'Orchestra Mozart n'affecte en rien la
transparence du discours et l'équilibre miraculeux entre vents et cordes. Dans
une discographie déjà riche, ces interprétations sont à placer aux côtés des
meilleures.

Jean-Pierre Robert.
« Bratsche ! »Paul
HINDEMITH : Sonate pour alto et piano op. 11 n° 4. Sonate pour alto seul op. 25
n°1. Der Schwanendreher : concerto pour alto et petit orchestre d'après de chants populaires. Trauermusik (musique
funèbre). Antoine Tamestit alto. Markus Hadulla, piano. Frankfurt Radio Symphony Orchestra, dir. Paavo Järvi. 1CD Naïve : V 5329. TT. : 67'.
Longtemps honni, voire cloué au piloris par le régime nazi, Paul Hindemith (1895-1963)
reste un musicien largement incompris. Sa manière peut, certes, sembler
déconcertante, cultivant des sonorités particulières dans ce qu'on peut appeler
une tonalité élargie, cultivant l'abstraction du contenu musical, voie
personnelle qui n'aborde ni l'atonalité, ni le dodécaphonisme. Mais cela cache
un musicien profondément amoureux des instruments, et d'abord de l'alto qu'il
jouait à la perfection. Aussi ce CD, concocté par l'altiste Antoine Tamestit, est-il le bienvenu, d'autant qu'il se révèle une
mine de la diversité avec laquelle, tout au long de sa riche production,
Hindemith a écrit pour l'instrument, qu'il a décliné en formation chambriste
(trois sonates pour alto et piano), en solo (pas moins de quatre pièces), ou en
la forme concertante. La Sonate op. 11 N°4, de 1919, d'un seul tenant, offre
trois parties contrastées, qu'unit un vrai élan mélodique. La
« Fantaisie » a quelque chose d'impressionniste et fait penser à
Debussy. Le « Thème et variations », qui doit « être joué avec
la simplicité d'un air populaire », contraste dire expansif et passages
saccadés qui rattachent le discours à l'héritage brahmsien. Et le finale est
enjoué, voire mordant, non sans une pointe d'humour. Cette pièce déploie sous
les doigts d'Antoine Tamestit des sortilèges rares.
Tout comme la sonate pour alto seul op. 25, N° 1 (1922). L'interprète se joue
des ébouriffantes difficultés qui jalonnent ses cinq mouvements : rythmique
d'une énergie rageuse du premier, profonde réflexion du deuxième, marqué
« très frais et tendu », ce que prolonge le suivant, « très lentement », exploitant l'entier registre de
l'instrument. Une séquence « sauvage » fait suite, bardée de traits à
l'arraché, tandis que le finale mène le morceau à une conclusion apaisée,
évoluant dans le registre grave de l'alto. Écrit en 1935, juste après l'opéra Mathis
der Maler, le Concerto pour alto, titré
« Der Schwanendreher » (La valse des
cygnes), montre combien Hindemith est un brillant orchestrateur. Il est tout
aussi généreusement écrit pour l'alto qui introduit seul le premier mouvement.
La pièce alternera ensuite, au fil de ses trois parties, improvisation et
grande retenue, tel le début de la deuxième en forme de choral. Le finale, une
série de variations sur le thème de « N'es-tu pas le joueur de vielle ? » est
extraordinairement diversifié dans les climats et la composition, et tout finit
par une pirouette. Là encore Tamestit est royal et
inspiré. Il sera profond et racé dans la Trauermusik,
de 1936, habitée au long de ses quatre sections d'un chant pudique, la première
et la dernière sur le mode lent, l'alto soulignant une triste résignation. Un
magnifique disque pour les amoureux d'un instrument envoûtant, et pour tous les
autres.

Jean-Pierre Robert.
Pablo de SARASATE : Danses espagnoles op. 21, 22, 23 & 26. Jota aragonesa, op. 27. Serenata andaluza,
op. 28. El canto del ruisenor, op. 29. Caprice
basque,
op. 20. Zigeunerweisen op. 20. Julia Fischer, violon, Malina Chernyavska. 1CD Universal Decca
: 478 5950. TT.: 68'20.
Délaissant le grand répertoire
« sérieux », Julia Fischer, qui explique ne pas vouloir opposer
musique savante et de divertissement, nous emmène à la découverte de Pablo de
Sarasate. Violoniste virtuose (1844-1908), dédicataire de nombreuses
compositions de ses contemporains, dont Lalo, qui lui offrira sa Symphonie
espagnole, Sarasate était aussi compositeur. Il écrira quasi exclusivement
pour son instrument des pièces éminemment brillantes dont la technicité
ébouriffante n'a rien à envier à un certain Nicolò Paganini. Julia
Fischer a composé pour ce disque un hommage à l'Espagne et à ses danses
traditionnelles, aux rythmes si différents et tant contrastés. Les huit Danses
espagnoles, réparties par groupes de deux en quatre cahiers, proposent des
morceaux aussi divers que la Jota aragonaise, une danse tendue d'origine
mauresque, la romance andalouse, plus expansive et quelque peu hyperbolique, la
Habanera ou autre Malaguena, ou encore la Playera, au style flamenco accentué. On trouve encore les
rythmes entraînants du Zapateado, presque endiablé. Dans le Caprice basque op. 24, la dramaturgie s'établit sur un schéma de thème et variations. La
longue ligne du délicieux Canto del ruisenor (Chant du rossignol) est ornée à foison de
trémolos d'une infinie douceur et d'aigus filés extatiques. Seule exception à
ce parcours ibérique, les Zigeunerweisen (Airs
tziganes) op. 20 reflètent une autre facette du musicien et traduisent
l'attrait, partagé par ses contemporains, pour le folklore d'Europe centrale,
avec ce que cela comporte de concessions au grand romantisme. Ces courtes
pièces sont plus que des bis de fin de concert pour flatter un public avide de
sensations. Ce sont, nous dit Julia Fischer, de « merveilleuses
miniatures », qui n'ont rien de trivial. C'est d'ailleurs l'impression que
laisse l'écoute de ce disque : les interprétations ne cèdent jamais à la
facilité et offrent un vrai raffinement. Au-delà de la plus extrême virtuosité,
on y admire une sonorité solaire, d'une finesse magique sur toute l'étendue du
registre, une aisance et une intuition pour distinguer le caractère de chaque
pièce et, à l'intérieur de chacune, ses divers éclairages.

Jean-Pierre Robert.
« Les Vents
français ». Jacques IBERT : Trois pièces
brèves. Maurice RAVEL : Le tombeau de Couperin. Darius MILHAUD : La Cheminée du roi René, suite op. 205. Paul TAFFANEL
: Quintette à vents. André JOLIVET : Sonatine pour hautbois et basson. Paul
HINDEMITH : Kleine Kammermusikop. 24 N° 2. Sándor VERESS : Sonatine pou hautbois, clarinette et basson.
Alexander von ZEMLINSKY : Humoresque (Rondo). Samel BARBER : Summer Music op.
31. György LIGETI : Six
Bagatelles pour quintette à vents. Les Vents Français : Emmanuel Pahud, flûte, Paul Meyer, clarinette, François Leleux, hautbois, Gilbert Audin,
basson, Radovan Vlatkovic, cor. 2 CDs Warner classics : 2564 63484-5. TT.: 67'01+51'.
Cette anthologie présente un double volet.
Le premier est consacré à quelques gemmes de la musique française pour vents.
La fin du XIX ème et la première moitié du XX ème ont signé l'âge d'or de cette musique de
divertissement, où l'on ne se prend pas la tête, mais si agréable à déguster.
Surtout lorsqu'interprétée avec le talent qu'y mettent les solistes des Vents
Français ! Paul Taffanel (1844-1908), flûtiste et
chef d'orchestre, eut une grande influence dans ce domaine puisqu'à l'origine
de la fondation, en 1879, de la Société de musique de chambre pour instruments
à vent. Son Quintette à vent, de 1876, est de belle facture dans sa coupe en
trois mouvements : délicates modulations de l'allegro, aux harmonies inventives
; andante pacifié s'ouvrant sur la houlette enveloppante du cor avant que se
dégage une ravissante cantilène du hautbois, pour conduire à un développement
pluraliste offrant à chacun des cinq protagonistes matière à briller ; finale,
sur un rythme de saltarello, offrant grâce et
zest au fil de moult rebondissements. Les Trois Pièces brèves de Jacques
Ibert (1890-1962) déploient une musique gracile, mélodieuse, qui ravit
l'oreille sans trop demander d'effort à l'intellect. Mais quel brio, de gaieté
et d'élan ! La Suite La Cheminée du roi René de Darius Milhaud (1941)
est tirée de la musique conçue (avec Honegger et Désormière)
pour le film de Raymond Bernard « Cavalcade d'amour » (1939).
C'est un florilège de sonorités rappelant l'époque du roi René d'Anjou, comte
de Provence, au XV ème siècle, mises au goût moderne
dans l'admirable manière de Milhaud. Les sept pièces, très courtes, font passer
du cérémonieux à l'élégiaque, de l'énergique au lyrisme diaphane. Ravel n'est
pas loin. Celui-ci, précisément, a tenté bien des transcripteurs. Ainsi le
corniste américain Mason Jones a-t-il arrangé pour
quintette à vent le Tombeau de Couperin. Le passage du piano, ou de
l'orchestre, à un dispositif réduit au seuls vents fonctionne plutôt bien et la saveur de ces miniatures reste intacte. On se
prend même à mieux distinguer les lignes mélodiques diffuses de la deuxième
pièce, « Fugue », pas toujours discernables dans la version pour
clavier. L'exécution, bien allante, est une merveille de goût. Enfin, la
Sonatine pour hautbois et basson d'André Jolivet (1963) signale une modernité
qui se joue de la tonalité franche et tisse une alliance originale des deux timbres
et de l'extrême de leur tessiture. A ce jeu, le hautbois de François Leleux est magistral.
Le second CD focalise sur quelques pièces
marquantes pour vents des « modernes ». C'est d'abord Paul Hindemith
et sa Kleine Kammermusik op 24, de 1922, merveille dans l'art de marier les timbres. Mais aussi une
courte pièce d'Alexander von Zemlinsky, Humoreske, un rondo plus tourné vers Brahms
qu'orienté vers Schoenberg. La Sonatine pour hautbois, clarinette et basson de Sándor Veress (1907-1992) prône la veine populaire d'Europe
centrale tant cultivée par ses maitres Bartók et Kodály.
Cela se ressent en particulier dans la partie centrale où les instruments sont
traités dans leur registre inhabituel (le grave de la clarinette ou l'aigu du
basson). La pièce Summer Music de Samuel
Barber (1953) offre un curieuse alternance de tunes
nostalgiques, plaintifs, et de passages riants, ou encore de rythmes
sautillants avec notes répétées, en un étonnant foisonnement sonore. Enfin,
dans les 6 Bagatelles de György Ligeti,
arrangement partiel pour quintette à vent des douze mouvements de sa Suite pour
piano (1951-1953), demeurée dans l'ombre sous le titre de « musica reservata », la
science des vents est poussée à explorer des limites extrêmes, aux effets
appuyés, souvent avec force ostinatos. La cinquième pièce est un hommage à Bartók.
Au-delà de la perfection instrumentale, ce qui ne surprendra pas de la part de
ces éminents solistes, on est conquis par l'élégance du jeu, l'esprit dont ils
parent ces morceaux si divers, qui tous développent cette idée de plaisir en
musique, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Un petit air des programmes
qui égaient les nuits étoilées estivales du Festival de l'Empéri !

Jean-Pierre Robert.
« American journey ». Leonard BERNSTEIN : Serenade
for Solo Violin, Strings, Harp and Percussion. Samuel BARBER
: Adagio for strings. Bernard HERRMANN : Psycho Suite for Strings.
George GERSHWIN : Trois Préludes pour piano. Charles IVES : The Unanswered Question. Tai Murray, violon.
Orchestre Poitou-Charentes, piano et dir.
Jean-François Heisser. 1 CD Mirare : MIR 244. TT. : 67'.
Ce disque célèbre la musique américaine à
travers cinq de ses représentants et au fil d'un programme peu conventionnel.
La Sérénade pour violon, cordes, harpe et percussion de Leonard
Bernstein, de 1954, créée deux ans plus tard par Isaac Stern à la Fenice de Venise, emprunte sa thématique au Banquet de
Platon, qui au long de cinq séquences, sur le schéma lent-rapide, en met en
scène les divers épisodes. C'est un
challenge pour le soliste, mais la violoniste américaine Tai Murray se déjoue
des pires difficultés haut la main. Le très célèbre Adagio pour cordes de Samuel Barber, tiré du deuxième mouvement de son Quatuor op. 11, est pris
par Jean-François Heisser et les cordes expressives
de l'Orchestre Poitou-Charentes justement pas trop lent, laissant à la musique
sa respiration à travers cet habile mélange de consonant et d'à peine
dissonant. Psycho Suite for strings est tirée de la musique conçue par
Bernard Herrmann pour le film de Hitchcock
« Psychose » : Elle en offre la quintessence. La gageure est ici une
composition confiée aux seules cordes. L'effet est d'une prodigieuse
efficacité, au fil de ses sept séquences, pour distiller l'effroi, voire
l'épouvante qui suinte dès le« Prélude » avec ses rythmes hachés, ses
thèmes en en scie, pour atteindre son paroxysme dans l'épisode du
« Meurtre ». La désolation de « Marécage » fait penser à la
même atmosphère parcourant la scène du meurtre de Marie dans le Wozzeck de Berg. Les trois Préludes pour piano de Gershwin sont joués avec tact par
Jean-François Heisser qui revient à son cher piano.
Le programme se referme sur The Unanswered Question de Charles Ives, donnée dans sa version originale pour ensemble de
chambre : pièce énigmatique, qui fait appel à un substrat philosophique,
« un paysage cosmique » dira l'auteur, interrogation sur l'existence,
au fil d'un jeu de questions-réponses non solutionnées. L'interprétation de Heisser et de son orchestre est magistrale.

Jean-Pierre Robert.
Johann Sebastian BACH. Œuvres pour
clavecin-luth (Lautenwerck). Olivier Baumont, clavecin-luth. 1 CD Loreley : LYO54. TT.: 54’.
Si vous n’avez pu vous rendre à la Cité de
la Musique pour entendre Olivier Baumont dans la
toute récente Intégrale de l’œuvre pour clavecin de Bach, voilà une excellente
occasion de vous rattraper avec ce disque entièrement consacré aux œuvres de
Bach (originales ou transcriptions) pour Lautenwerck.
Instrument baroque, clavier de l’illusion, encore appelé Lautenclavier ou Clavicymbel, correspondant à un clavecin cordé en
boyau, et non en métal, apte à imiter le son du luth ou celui du théorbe. Au
fil de cette rencontre originale vous découvrirez un Bach comme vous ne l’avez
jamais entendu, à la sonorité plus ronde et plus vibrante, tout en demi-teinte,
entre ombre et lumière, où la virtuosité le dispute à l’émotion. Certains partitions, comme la Suite « aufs Lautenwerck » BWV 996, furent spécifiquement
écrites pour cet instrument particulièrement prisé en Allemagne au XVIIIe
siècle, d’autres correspondent à des œuvres s’adressant originellement au luth
ou au clavecin (Prélude BWV 999, Suite
BWV 997, Prélude, Fugue & Allegro BWV 998, Fantaisie et Fugue BWV 903),
certaines, enfin, sont des transcriptions, comme la Polonaise d’après BWV 1067, initialement pour flûte, transcrite par
Johann Christian Bach. Un disque magnifiquement interprété, original, qui tombe
à point nommé pour nous rappeler l’importance du clavecin dans l’œuvre de Bach,
un instrument chéri qui le suivra toute sa vie durant (Weimar, Köthen, Leipzig). Bach, à l’instar de Haendel ou de
Couperin, était, dans la tradition de son temps, à la fois organiste et
claveciniste, sans omettre qu’il possédait, en outre, une grande expertise en
termes de facture instrumentale expliquant sans doute son intérêt pour la
clavecin-luth. Superbe !

Patrice Imbaud.
« BACH : Père et
fils ». Pièces de Johann Sebastian BACH, Wilhem Friedmann BACH, Carl Philipp Emmanuel BACH et Johann Christian BACH. David Bismuth, piano. 1CD AmeSON : ASCP 1325. TT.: 54’44.
Un disque que le pianiste David Bismuth a
voulu comme un voyage entre deux époques, baroque et classique, deux mondes
tendus entre Bach père et Bach fils. Des fils compositeurs, Wilhem Friedmann, Carl Philipp Emmanuel et Johann Christian,
comme autant de passerelles qui nous feront passer de la polyphonie baroque à
la sonate classique et au développement de la ligne mélodique principale.
Superbe itinéraire, magnifique projet, probant au plan didactique et
particulièrement convaincant au plan musical. David Bismuth dont l’élégance du
toucher n’a d’égal que la souplesse de la ligne y déploie toute sa maîtrise,
son pianisme abouti, tout son sens musical pour
dégager comme une évidence lumineuse dans l’interprétation. Le choix de faire
entendre dans cet enregistrement deux compositions assez libres et modernes du
père (Toccata BWV 914 et Fantaisie BWV 906) insérées au milieu de
celle de ses fils n’est peut-être pas totalement anodin, diminuant par là, le poids de la tradition qui ne doit pas être trop
écrasant, mais valorisant parallèlement un espace de liberté compositionnelle
dans lequel les enfants pourront se réaliser. Bach ne disait-il pas que les
musiciens dépourvus d’imagination se devaient de renoncer à la
composition ! La magnifique Sonate en la mineur de Wilhem Friedeman, composée probablement vers 1774, par le
fils ainé et bien aimé est, ici, enregistrée pour la première fois au piano.
Les Sonate en si mineur (1772) et fa dièse mineur (1744) de Carl-Philipp Emmanuel sont empreintes d’un lyrisme annonciateur du romantisme. La Sonate en ut mineur (1766) de Johann
Christian porte, quant à elle, les influences extra familiales du Padre Martini, témoignant ainsi de la reconnaissance d’un
héritage mais aussi d’un progressif éloignement…Un disque intelligent à la
thématique originale, parfaitement interprété, clair et cohérent.
Indispensable !
A noter qu'il sera possible de retrouver
David Bismuth salle Pleyel, aux côtés de l’Orchestre de Paris, les 9 et 10
avril prochains, dans un programme Mozart. Un rendez vous à ne pas manquer !

Patrice Imbaud.
Jean-Philippe
RAMEAU : Intégrale de l’œuvre pour clavecin. Olivier Baumont,
clavecin. 3 CDs Loreley : LYO56. TT :
73’37+70’45+61’08.
Décidément Olivier Baumont se trouve sous tous les feux de l’actualité ! Après un disque consacré au
clavecin-luth chez les Bach, deux concerts à la Cité de la Musique dans le
cadre de l’Intégrale de l’œuvre pour clavecin du Cantor de Leipzig, le voilà de
nouveau sur le devant de la scène avec ce coffret de trois CDs consacré à
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) dont on fête cette année le 250 ème anniversaire de la mort. Une réédition qui tombe à pic
et nous permet de réentendre l’œuvre pour clavecin du musicien français qui
fut, avec François Couperin, un des maîtres du XVIII e siècle. Un corpus de 85
pièces au ton inimitable, hautain, urgent, impératif, véhément et tendre. Un Premier Livre de Pièces de Clavecin (1706)
encore marqué par le XVII e siècle et ne comportant quasiment que des pièces de
danse. Les Petits Marteaux, le Menuet en Rondeau et les Pièces de Clavessin datent de 1724. Les Nouvelles Suites (1729-1730) alternent danses et pièces de caractère. Les Cinq Pièces en Concert (1741) ont été ici arrangées par Olivier Baumont pour
clavecin seul. Enfin, Les Indes Galantes (1736) nous rappelle la profonde attirance de Rameau pour le théâtre. Il
n’écrira pas moins de trente œuvres lyriques, dont la première est Hippolyte et Aricie (1733) composée à
l’âge de 50 ans. Dès lors, il composera en moyenne un opéra par an, abordant
tous les genres connus à l’époque, tragédie en musique, ballet héroïque,
pastorale, comédie lyrique et comédie ballet avec toujours cette innovation
audacieuse dans l’expression du « je » avant de devenir compositeur de
la Chambre du Roi à 62 ans ! Il meurt en 1764, à 81 ans, après avoir vécu
trois querelles esthétiques célèbres qui l’opposeront d’abord à Lully, puis à
Rousseau, Diderot lors de la querelle des Bouffons et enfin à Gluck. Une
interprétation superlative, élégante et virtuose, par un des maîtres
incontestés actuel du clavecin, qui fait de ce coffret un incontournable.

Patrice Imbaud.
Ludwig van BEETHOVEN: Sonates pour piano Tempête, Waldstein, Appassionata. Soo Park, pianoforte.1CD LABEL-HERISSON : LH10. TT : 72’45.
Des sonates de Beethoven comme vous ne les avez que rarement entendues, car jouées sur un pianoforte
Jakob Weimes (1807) contemporain de leur composition,
ce qui confère à cet enregistrement authenticité et originalité. Authenticité
d’abord, car Soo Park a choisi de replacer ces œuvres
dans le contexte instrumental de leur création, entre 1801 et 1806, période
contemporaine du testament d’Heiligenstadt où le
compositeur fait part à ses frères, dans une longue lettre qui ne sera jamais
envoyée, de sa surdité croissante, de son isolement et de son désespoir. Les
trois sonates présentées ici « Tempête» op. 31 (1801-1802),
« Waldstein» op. 53 (1803-1804) et «Appassionata» op. 57 (1804-1805)
appartiennent à cette deuxième période
de Beethoven (succédant à la période de la virtuosité viennoise et précédant la
période héroïque) coïncidant avec la naissance du pianoforte de Jakob Weimes. Originalité ensuite, par la sonorité
caractéristique du pianoforte, bien différente de la sonorité des pianos modernes.
Le pianoforte est l’ancêtre du piano actuel dont le premier modèle fut
construit par un facteur de clavecin, Christofori. A
la différence du clavecin dont les cordes sont pincées, les cordes du
pianoforte sont frappées par des marteaux, d’où un jeu qui peut être plus
nuancé, piano ou forte. Beethoven composa 32 sonates dont la
composition s’échelonne sur une vingtaine d’années, témoignant de l’évolution
stylistique de maître de Bonn. La Sonate pour piano n° 17 dite « La Tempête », en référence
à l’œuvre éponyme de Shakespeare, est toute entière empreinte d’une sombre
inquiétude, teintée d’accents plus lumineux, plus classiques notamment dans le
second mouvement, rappelant Mozart. La Sonate n° 21 dite « Waldstein » marque des avancées compositionnelles dans
les registres extrêmes, autorisées par l’amélioration de la facture
instrumentale. La Sonate n° 23 dite « Appassionata » est
également sombre et tourmentée, à l’image de cette époque difficile pour le
compositeur, bien différente toutefois de la période plus tardive de la Sonate
« Hammerklavier »
(1819) où la surdité de Beethoven quasi complète, l’autorisera à se débarrasser
de la forme en poussant le pianiste et l’instrument à leurs extrêmes limites.
Un disque, on l’aura compris, particulièrement intéressant redonnant à
Beethoven toute sa persuasion expressive, bien loin de toute boursouflure
romantique, pointant par instant le regard vers Mozart comme vers « un
passé dont Beethoven sut accomplir les prémisses… ». Une interprétation magnifique dans la note
comme dans l’esprit servi par le jeu superlatif de la pianiste coréenne.
Éblouissant !

Patrice Imbaud.
***
MUSIQUE ET CINEMA
ENTRETIEN
De nombreux catalogues de « musique de librairie »
(ex musique au mètre) proposent des musiques pour illustrer toutes sortes
d’œuvres filmées. C’est un marché très important. Des groupes comme Césame Music Agency, Audio Network, Koka chez Universal, KPM chez EMI proposent des catalogues
conséquents de musiques pour l’image. Ces musiques sont classées par genre et
par durée. On y trouve des compositeurs très connus ainsi que des orchestres
réputés. Aujourd’hui, grâce au progrès des machines, un compositeur peut créer
seul un environnement musical de haute qualité. Souvent des réalisateurs de
long-métrage emploient ces musiques soit pour leur montage, soit pour compléter
leur musique originale, ou encore, par manque de budget, pour s’offrir une musique
originale. Ces musiques sont souvent de bon marché.
Manuel Bleton,
compositeur de musique de librairie

DR
Qu'est-ce que la musique d'illustration
pour l'image ?
C'est
de la musique pré-écrite qui est employée principalement pour l'illustration sonore
de documentaires, de reportages, d'émissions de télévision, de jingles ou pour
des films d'entreprises. On l'appelle encore musique au mètre car elle s'achète
à la minute ou à la seconde employée.
Comment cela se passe-t-il à votre
niveau de compositeur ?
On
nous soumet des thèmes. En général, il y a plusieurs compositeurs qui
travaillent sur un album. On propose des maquettes qui sont validées ou pas.
Chez Universal ce sont des décisions qui sont prises
d'une manière collégiale. Il y a un directeur artistique qui donne la ligne
directrice et ensuite les propositions sont écoutées par l'équipe.
Comment êtes-vous entré dans ce milieu de la
musique pour l’image ?
Quand
j'étais aux Arts Appliqués, où j'ai fait cinq ans d'études, j'ai fait un stage
dans un studio de son qui réalisait de la publicité pour les radios. Je
rencontrais de nombreux comédiens comme Roger Carel, Valérie Lemercier, qui
venaient faire des voix. Je m'étais fait une bande démo et je l'avais envoyée à
Frédéric Lebovitz qui avait créé Koka Média, la première boîte
d'illustration musicale en France. Le directeur artistique m'a contacté pour un
projet d'album pour enfant. J'étais en dernière année et tous les quinze jours
je lui envoyais un ou deux titres. Au bout d'un an il y avait un album. Comme
j'avais un petit budget, je l'ai composé avec un piano et des jouets. Cet album
a passé la barrière du temps parce que je n'avais pas trop utilisé de synthés
ou des sons qui connotent l'époque.
On
vous paie pour faire cette musique ou on attend qu'elle soit employée ?
On a
des cessions de droits par titre une fois que les morceaux sont validés,
enregistrés, produits. Ensuite on touche des droits d'auteur à l'utilisation.
On n'est pas payé quand on compose la musique. On n'est payé que lorsqu'elle
est validée par l’équipe.
On vous paie les studios ?
Il y
a différentes méthodes. Il y a des productions qui sont faites “à la maison” et
qui sont masterisées ensuite par la production. Il y
a des productions où je ne fais que la maquette qui sera rejouée, et là c'est
le producteur qui prend en charge le studio, l'orchestre, etc....
Quelles sortes de formations avez-vous
dans votre catalogue ?
Tout
ce qui est home production, musique à la maison évidemment. J'ai des
enregistrements où les solistes sont enregistrés à la maison, donc en quatuor,
en quintette. Pour des productions plus importantes, c'est fait en extérieur.
J'ai enregistré avec un orchestre de trente musiciens, et bien sûr cet
orchestre était payé par la production.
Quel est votre instrument d'origine ?
Je
suis autodidacte : j'ai commencé de manière très empirique avec les machines et
ensuite, pour collaborer avec des musiciens, j'ai pris des cours de piano, des
cours de solfège. J'ai commencé avec les basiques Atari 520, 1040, avec les petits mac bien classiques et midi. J'ai vu l'évolution
qui est assez phénoménale. Aujourd'hui avec peu d'argent et des logiciels bien
choisis on peut composer de la musique presque définitive. Ce qui est important
après, c'est d'avoir un bon studio et un bon mixeur.
On
s'aperçoit que dans les catalogues de musiques pour l'image, on peut trouver des orchestres tels que le
LSO ou le Philharmonia Orchestra et des compositions
de très bonnes qualités pour des sommes dérisoires. C'est une concurrence avec laquelle
les compositeurs de musique originale ne peuvent rivaliser. Qu'en pensez-vous ?
Pour
un jeune compositeur il faut avoir un positionnement un peu différent, avoir sa
propre identité. Badalamenti joue beaucoup avec des
synthés, il n'a pas besoin d'orchestre et ça marche très bien seulement avec
des machines. Ensuite ce n'est qu'une question de son : faire que les machines
sonnent, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est vrai qu'on peut avoir des
maquettes de compositeurs tels que Morricone, Trovajoli, Nyman à moindre coût dans les catalogues de musiques pour l'image.
Y
a-t-il une évolution dans les compositions de ce qu'on appelait la musique au
mètre ?
Aujourd'hui
on l'appelle musique de librairie, et la qualité est bien plus exigée. Avant
c'étaient des musiques assez répétitives. Aujourd'hui avec les briefs qu'on reçoit ce sont des musiques au millimètre. La
composition, le son, les éditeurs sont de plus en plus exigeants. Les
programmateurs de télévision sont très pointilleux sur le style et la qualité.
Avoir un jingle choisi pour la
télévision c'est bingo, non ?
S'il
passe à trois heures du matin sur une chaîne du câble ce n'est pas très intéressant. Si c'est le
générique de Champs Elysées, là oui c'est le jackpot.
Vous
connaissez des compositeurs qui ont commencé dans ce genre de musique et qui
aujourd'hui font des BO pour des longs-métrages ?
Alexandre Desplat je crois. Il était tâcheron chez Canal, il
faisait de la musique à la demande. Quand on lui demandait de la musique
mariachi, il faisait de la musique mariachi. Jean-Michel Bernard était pianiste
pour “l'Oreille en Coin” de Claude Villers. Annie Delfot,
qui est une très bonne pianiste, l'a remplacé. Il ne faut pas s'enfermer
dedans, c'est une solution de facilité. Travailler avec un réalisateur c'est
aussi une belle expérience.
Aujourd'hui
vous êtes
au jury d'Emergence, comment y êtes-vous arrivé ?
J'ai
été lauréat et j'ai eu Jean-Michel Bernard comme parrain. Ensuite il cherchait
quelqu'un pour faire le lien entre les compositeurs et Emergence. J'ai tout de
suite accepté, ce qui m'a permis de rencontrer Jean-Claude Petit, Bernard
Wagner, Bertrand Burgalat, les parrains de cette
association. Bientôt Bruno Coulais
qui est le parrain de l'édition 2014. Je ne suis qu’un jeune compositeur, j'ai
le savoir-faire ; maintenant il faut que je le fasse savoir, il faut y passer
plus de temps que pour la composition.
Arrive-t-on
à vivre correctement en faisant seulement de la musique de librairie ?
Cela
dépend du nombre de titres qu'on a édités. Moi, quand j'ai débuté on m'avait
dit qu'avec trois albums on commence à s'en sortir un petit peu ; ça représente
soixante, soixante-dix titres qui tournent. Koka avait été racheté par Universal, c'est une bonne
vitrine, mais ici il y a plus de monde, c'est question d'image, la même musique sur un label inconnu
n'aurait pas le même impact.
Sur
internet on trouve des musiques qui coûtent pratiquement rien, est-ce un handicap pour vous ?
Je
ne sais pas si cela est une vraie concurrence. Il y a un tel niveau d'exigence
aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir pour un prix dérisoire une musique de
qualité. Je viens de travailler avec l'Orchestre Repetita,
des musiciens très pro, on a enregistré dans un bon studio, puis mixé une
première fois. Le mixage ne convenant pas, il a été remixé à Los Angeles, masterisé sur place. Je ne connais pas beaucoup de jeunes
compositeurs sur internet qui vendent leur musique pour rien et qui ont cette
qualité de musique ! Il y a un niveau d'exigence aujourd'hui qui ne permet pas
l'amateurisme. On a des productions de l'ordre de cinquante à cent mille euros
! Pour rentabiliser cette somme il faut bien connaître le marché. Ce produit est fait pour
les Etats-Unis : ils aiment une certaine
manière de composer. Par exemple, ils n'aiment pas le pizz de cordes, il faut mieux les éviter. Alors qu'en Europe c'est un marronnier. Si
vous mettez des pizz de cordes dans un documentaire
ça marche toujours. Tout dépend du marché, c'est l'avantage des grands labels.
Vous pouvez télécharger sur internet, avoir des CD de toutes mes musiques, de
toutes les musiques, même recevoir un
petit disque dur et ensuite faire les déclarations pour les musiques employées.
Ces musiques vieillissent très vite selon le mode de composition.
Quelle musique vous a rapporté le plus
?
L'ouverture
du générique début et quelques scènes du film “Mariage” de Valérie Guignabodet avec Jean Dujardin, Miou Miou, Mathilde Seigner. Il
y avait un compositeur pour la BO, Fabrice Aboulker.
C'est un film qui a fait beaucoup d'entrées et donc j'ai eu pas mal de droits
d'auteur. Mes musiques sont souvent utilisées pour la radio, France Musique par
exemple, mais je ne connais pas forcément dans quel cadre elles sont utilisées.
Je sais que Culture Pub utilisait mes musiques. Il y a des réalisateurs, comme
Audiard ou Despléchin qui complètent leur BO avec de
la musique de librairie.
Quelles musiques aimez-vous écouter ?
De
la musique de film, car c'est une musique très large. Il y a de la variété, du
symphonique, du jazz. De Delerue à Miles Davis c'est très large.
Comment êtes-vous venu à cette musique ?
Mon
père travaillait dans la Maison de la culture d'Amiens, c'était une grande
structure créée par Malraux. J'y allais très souvent, puis vers l'âge de dix ans, j'ai travaillé avec le Revox de mon père à bidouiller les sons, et ensuite avec
l'ordinateur je me suis mis à synchroniser les sons.
Votre musique préférée ?
“Il
Etait Une Fois l'Amérique”, de Morricone. C'est une musique lyrique, mélodique,
simple et belle : c'est tout ce que j'aime, la simplicité et la beauté !
Et un compositeur français dans un film
récent ?
Rob
dans “Grand Central”. J'avais fait un disque avec lui. J'avais un pseudo à
l'époque, et lui jouait avec le groupe Phoenix. Il a
une réalisatrice, Rebecca Zlotowski, qui le soutient
et le pousse à trouver des compositions originales.

Universal / Koka KOK 2363
Propos recueillis
par Stéphane Loison.
BO EN CDS
NEBRASKA. Réalisateur ALEXANDER PAYNE.
Compositeur MARK » ORTON. 1CD Milan MC36663
Voilà un film d’une originalité
amusante et tendre, d’une mise en scène précise et fluide, d’un jeu d’acteurs
stupéfiants qui fait qu’on est ravi de l’avoir vu et que de réécouter la
musique sur CD donne envie de le revoir.
L’argument est
très simple : Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un
improbable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska
pour y recevoir son gain. Sa famille, inquiète de ce qu’elle perçoit comme le
début d’une démence sénile, envisage de le placer en maison de retraite, mais
un de ses deux fils se décide finalement à l'emmener en voiture chercher ce
chèque auquel personne ne croit. Pendant le voyage, le vieillard se blesse et
l’équipée fait une étape forcée dans une petite ville en déclin du Nebraska.
C’est là que le père est né. Épaulé par son fils, le vieil homme retrace les
souvenirs de son enfance.
Le film a été
nommé aux Oscars dans les catégories Meilleur Film, Meilleur Réalisateur,
Meilleur scénario original, Meilleur Acteur (Bruce Dern),
Meilleure Actrice (June Squibb), Meilleure
photographie.
La musique aurait pu être elle aussi
nommée tant elle est en parfaite adéquation avec le film. Mark Orton a commencé à apprendre la composition dès le lycée et
a eu comme professeur Danny Deutsh qui faisait écrire très tôt ses élèves. Marco
Beltrami avait aussi étudié avec lui. Ils étudiaient Carter, Ligeti aussi bien
qu’Hendrix ou Mingus. Il continua ses études à la Hart School of Music et au Conservatoire de Peabody. Il composa
toutes sortes de musiques pour le théâtre, la radio, la danse. Son groupe Tin Hat composa de la musique de librairie qui a été utilisée
souvent et même dans quelques films dont « The Good Girl » de Miguel Arteta. Pour « Nebraska », Alexander Payne
n’avait aucune idée de composition musicale, explique-t-il sur le CD. Avec
« Sideways » il voulait du jazz, pour
« The Descendants » de la musique Hawaïenne. Pour ce film, pas la
moindre idée. Richard Ford, le monteur, utilisa de la musique de Tin Hat et le provisoire devint définitif. Mark Orton écrivit en plus de la musique originale et cela donne
cette bande son qui ajoute à la poésie et à l’humour du film. C’est une musique
country/western avec un petit côté italien. On pourrait s’imaginer Ennio
Morricone et le Ry Cooder de « Paris Texas » ensemble. La formation orchestrale est originale. Orton mélange des instruments plus bluegrass comme la
guitare et l’harmonica, avec des instruments comme le piano et la trompette et
des percussions, qui donnent une impression de deux mondes qui se
côtoient. Il y a un thème qui revient
souvent comme l'obsession du héros pour aller chercher son million. Inutile de
dire qu’à la sortie de la projection ce thème reste dans la tête.

Musiques
de film chez Marco Polo/ Naxos
Bernard Herrmann,
Alfred Newman, Eric Korngold, Hans Salter, Max
Steiner, Victor Young, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin, Hugo Friedhofer, Georges
Auric, Arthur Honneger, Jacques Ibert, tous ces
grands compositeurs de l’âge d’or du cinéma français ou hollywoodien, ont été
enregistrés par William T. Stromberg avec l’Orchestre
Symphonique de Moscou. L’éditeur Marco Polo (Naxos) propose ainsi plus d’une
trentaine de CD de partitions de célèbres long-métrages. Chacune mériterait
qu‘on s’y arrête tant la qualité musicale est exceptionnelle. Ce travail de
recherche de ces compositions et d’enregistrement a été fait par John Morgan
ainsi que par William Stromberg.
William T. Stromberg est né à Oceanside en 1963. Il était un enfant
précoce et à 11 ans il composait déjà. Il composa surtout des musiques pour des
films de séries B, jusque dans les années 80. Dans les années 90 il s’intéressa
à l’enregistrement de BO pour Marco Polo. Parmi ses premiers albums on peut
citer une compilation de musiques d’Hugo Friedfofer et deux musiques de Korngold « Another Dawn » (1937) réalisé par William Dieterle, et « Escape Me Never » (1947) de Peter Godfrey. Ces deux films ont Errol Flynn comme acteur. Plus
récemment, en 2007, Stromberg a enregistré du même Korngold « The Sea Hawk » (1940), un des films les plus célèbres de
Michael Curtis avec Errol Flynn la star du moment, et « Deception » d’Irving Rapper (1946) avec la stupéfiante
Bette Davis.
John Morgan est aussi compositeur de
musiques de film. Sa passion pour les grandes BO classiques l’a entrainé dans
les orchestrations et la direction de nombreuses compositions telles que des
musiques de Max Steiner, d’Erick Korngold, de
Frederik Hollander… Marco Polo a édité, entre autres,
la musique de « La Charge de la Brigade Légère », « Virginia
City », « Capitaine Blood » réalisés par Michael Curtis et
interprétés par Errol Flynn, « The House of Frankenstein » d’Erle Kenton, et des compilations
de films fantastiques. Tous ces CD sont aussi disponibles sur le site de
Naxos/Marco Polo.


POMPEII. Réalisateur
PAUL W.S. ANDERSON. Compositeur CLINTON SHORTER. 1 CD Milan / Universal 399 437-2.
En
l’an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont
Vésuve. Milo, esclave d’un puissant marchand, rêve du jour où il pourra
racheter sa liberté et épouser la fille de son maître. Or celui-ci, criblé de
dettes a déjà promis sa fille à un sénateur romain en guise de remboursement…
Manipulé puis trahi, Milo se retrouve à risquer sa vie comme gladiateur et va
tout tenter pour retrouver sa bien-aimée. Au même moment, d’étranges fumées
noires s’élèvent du Vésuve dans l’indifférence générale… Dans quelques heures
la ville va être le théâtre d’une des plus grandes catastrophes naturelles de
tous les temps.
« Pompéii » est le film typique du samedi soir, sans
prétention, bourré d’effets spéciaux. Du grand péplum en trois D. La musique
doit cracher autant que le Vésuve et Clinton Shorter ne se prive pas lui aussi d’effets musicaux. Il est peu connu comme compositeur
de film bien qu’il ait à son actif quelques centaines de compositions, surtout
en télévision. Avec « Pompeii » on est dans
la grandiloquence hollywoodienne sans grande imagination. Shorter connait par cœur son Zimmer et nous offre des morceaux avec voix seule ou
chœurs, même chantés en latin ( Carmina Buranan’est pas loin) qui ressemblent étrangement à
ceux de « Gladiator ». On a l’impression
d’avoir entendu cette musique des centaines de fois dans les productions
américaines actuelles. C’est de la musique standardisée. Elle est à l’image du
film, sans saveur. Si « Gladiator » a eu un
énorme succès en CD, celle-ci ne risque pas d’intéresser beaucoup d’amateurs.
Pour
les amateurs de bonnes BO et pour ceux qui aiment les vrais péplums, on trouve
encore sur internet le CD et le DVD du film « Les Derniers Jours de Pompeii » réalisé par Sergio Leone avec une courte
participation du réalisateur Mario Bonnard. La musique est celle du prolixe
Angelo Lavagnino. Le rôle principal était tenu par
Hercule, à savoir Steeve Reeves.


MONUMENTS
MEN.
Réalisateur : GEORGE CLOONEY. Compositeur : ALEXANDRE DESPLAT. 1 CD
Sony Classical
La
plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie.
« Monuments Men » est inspiré de ce qui s’est réellement passé.
En
pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats –
des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes et
des historiens d’art – se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des
œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires
légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi, et les
chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille
ans d’art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable
course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les
plus précieux trésors artistiques de l’humanité…
Troisième
collaboration de Desplat avec Clooney (Pour Argo ce dernier était producteur), cette
musique n’a aucun intérêt et participe à l’ennui que procure « Monuments
Men ». Si le film est lénifiant, académique et patriotard, la musique qui
en rajoute à la louche, est à l’image du jeu de Desplat qui interprète un brave paysan français bien de chez nous, ridicule. Certes,
les américains ont sauvé la culture européenne, l’humanité diront certains,
mais ce n’est pas avec ce film et cette musique qu’ils vont apporter une pierre
à leur fragile édifice culturel cinématographique actuel. Mais à y réfléchir,
peut-être que Clooney a tenté de faire un film à la Tarantino ? Oublions vite ce raté musical et ce CD, et
précipitons-nous sur le documentaire qui a été réalisé sur ce passionnant
sujet.

ROBOCOP. Réalisateur : JOSE PADHILA. Compositeur : PEDRO
BROMFMAN. 1 CD Sony Classical n°88843005782
Les services de
police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop,
mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et
d'acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce
cyborg a aussi une âme...
Ce film est le remake du célèbre Robocop de Paul Verhoeven. C’est
un bon film d’action et avec les progrès de l’informatique, Jose Padhila fait une mise en scène rondement menée. Grâce au
talent de Samuel Jackson, le réalisateur nous offre une dimension satirique.
Jose Padhhila pour la musique a réussi à imposer son
compositeur Pedro Bromfman. Ce jeune compositeur
d’origine brésilienne a fait ses études à Berkley et
a touché tous les genres musicaux. Il a écrit de la musique pour librairie, a
été arrangeur, avant de composer pour le cinéma. On lui doit la musique de
« Troupe d’Elite 1 et 2, » de Jose Padhila (Ours d’Or à Berlin en 2008), « They killed Sister Dorothy » de
Daniel Junge, et la musique du célèbre jeu vidéo
« Max Payne n°3 ». Sony a investi 130 millions de dollars sur ce
compositeur pratiquement inconnu pour la musique de « Robocop ».
La musique de Bromfman n’a rien à voir avec la
célèbre BO de Basil Poledouris.
Le thème de Robocop de 1987 a été repris dans un
court morceau de 50 secondes, mais les deux concepts musicaux sont totalement
opposés. La musique de Bromfman est synthético-orchestrale, assez répétitive : une musique pour
appuyer les scènes d’action sans y apporter une autre lecture que de
l’efficacité pure. L’écoute du disque n’est pas désagréable mais le sentiment
de répétition se fait encore plus sentir. On ne peut s’empêcher de penser à la
magnifique BO de Poledouris qui a réussi à écrire une
musique traduisant tous les aspects de l'histoire. On sent dans cette musique
la puissance de la justice, la violence et les états d’âmes du héros. « Robocop » est un des grands classiques de Basil Poledouris comme l’était « Conan le Barbare ». Le CD est toujours au catalogue
de Varèse.


Stéphane Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Passer une publicité. Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
maite.poma@leducation-musicale.com
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale
·
La librairie de L’éducation
musicale
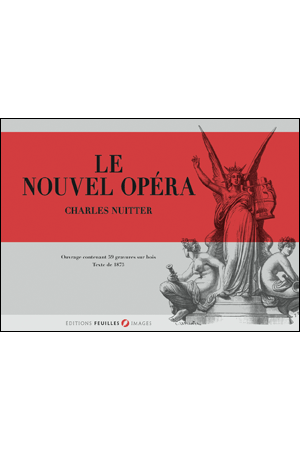 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
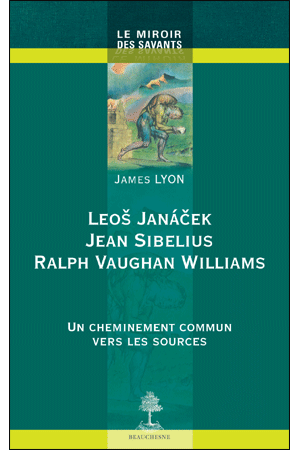 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque. Ils ont été confrontés aux tragédies de leur temps et y ont répondu en s'engageant personnellement dans la recherche de trésors dont ils pressentaient la proche disparition. (suite). |
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. Il prend la suite de La Recherche hymnologique (Guides Musicologiques N°5), approche méthodologique de l’hymnologie se rattachant à la musicologie historique et à la théologie pratique dans une perspective pluridisciplinaire. Nul n’était mieux qualifié que James Lyon : sa vaste expérience lui a permis de réaliser cet ambitieux projet. Selon l’auteur : « Ce livre est un USUEL. Il n’a pas été conçu pour être lu d’un bout à l’autre, de façon systématique, mais pour être utilisé au gré des écoutes, des exécutions, des travaux exégétiques ou des cours d’histoire de la musique et d’hymnologie. » (suite) |
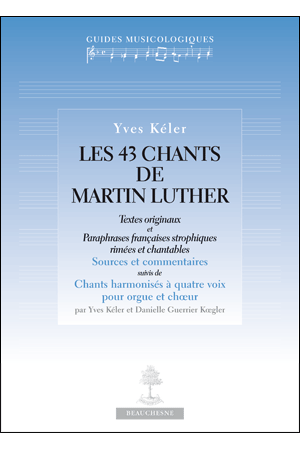 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. Aux hymnologues, musicologues, musiciens d'Eglise, chefs, chanteurs et organistes, ainsi qu'aux historiens de la musique, des mentalités, des sensibilités et des idées religieuses, il offrira, pour chaque choral ou cantique de Martin Luther, de solides commentaires et des renseignements précis sur les sources des textes et des mélodies : origine, poète, mélodiste, datation, ainsi que les emprunts, réemplois et créations au XVIè siècle... (suite) |
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ? Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui. Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ? Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique.
|
En préparation
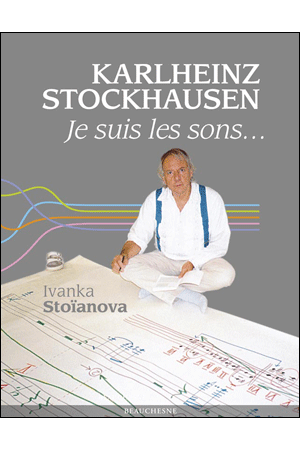 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite) |
 |
Analyses
musicales
XVIIIe siècle – Tome 1
L’imbroglio
baroque de Gérard Denizeau
BACH
Cantate BWV 104 Actus tragicus Gérard Denizeau Toccata ré mineur Jean Maillard Cantate BWV 4 Isabelle Rouard Passacaille et fugue Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu Janine Delahaye Phœbus et Pan Marianne Massin Concerto 4 clavecins Jean-Marie Thil La Grand Messe Philippe A. Autexier Les Magnificat Jean Sichler Variations Goldberg Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses Gérard Denizeau Apothéose Corelli Francine Maillard Apothéose de Lully Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus Sabine Bérard Israël
en Egypte Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile Jacques Michon L’alleluia du Messie René Kopff
Musique feu d’artifice Jean-Marie Thill |
***
Paru en juillet
·
Où trouver le numéro du Bac ?
Les analyses musicales de L'Education Musicale


