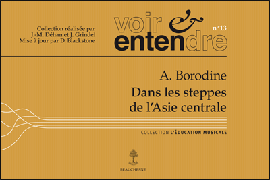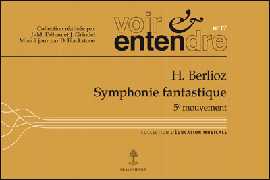PAROLES D'AUTEUR : PROPOSITION D'ANALYSE DU PROCESSUS DE TRADUCTION EN ART – FANTIN-LATOUR ET WAGNER
PROPOS PARTAGÉS : HELGA RABL-STADLER, PRESIDENTE DU FESTIVAL DE SALZBOURG
FESTIVALS! LA SEMAINE MOZART DE SALZBOURG
L'AGENDA
8 / 3
Le Roi David à Toulouse
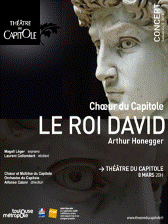
Le Roi David d'Arthur Honegger
a débord été conçu comme une musique de scène pour le drame de René Morax.
Celle-ci a été créée en 1921. Honegger reprendra ensuite sa partition pour en
faire un oratorio, élargissant le matériau orchestral de manière substantielle.
Cette version a été donnée pour la première fois en 1923, en Suisse et en
allemand, puis en français à Paris, à la salle Gaveau en 1924. Sous cette
forme, elle appartient au genre de l'oratorio dramatique avec chœur mixte,
solistes et récitant, car ceux-ci jouent un rôle aussi important que
l'orchestre. La force de la composition, la ferveur qu'elle dégage, lui ont
vite assuré un succès qui ne s'est jamais démenti. Honegger y fait montre d'un
langage personnel dont Cocteau disait qu'il brûlait d'un vrai « feu
intérieur ». Elle sera jouée à Toulouse, au Capitole, avec l'Orchestre et
les chœurs maison sous le direction d'Alfonso Caiani. Une occasion d'écouter une œuvre rare.
Théâtre
du Capitole, Toulouse, le 8 mars 2016 à 20H
Réservations : place du Capitole, BP 41408
- 34014 Toulouse Cedex 6 ; par tel. : 05 61 63 13 13
; en ligne : service.location@capitole.toulouse.fr ou www.theatreducapitole.fr
9, 10, 15 / 3
Concerts à Notre Dame de Paris

Olivier
Messiaen / DR
Dans le cadre du cycle de
concerts de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, est programmée La Passion selon Saint-Jean de J.S.
Bach, les 9 et 10 mars. Elle sera interprétée par la Maîtrise Notre-Dame de
Paris "chœurs d'adultes", avec Henri Chalet pour Chef de chœur. Et
par un ensemble instrumental et vocal
formé d'élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris, du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, et des
Conservatoires à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt et de Paris, sous
la direction de Philippe Pierlot. Par ailleurs, un concert d'orgue et d'ondes
Martenot avec les étudiants du Conservatoire de Paris et du CRR de
Boulogne-Billancourt, sous la direction de Michèle Foison, aura lieu le 15
mars. Avec au programme : Adoro Te (orgue)
et La Fête des belles eaux (sextuor
d'ondes Martenot) d'Olivier Messiaen, et Gemme
d'étoiles (sextuor d'ondes Martenot, orgue à quatre mains et tam-tam) de
Michèle Foison (*1942).
Notre Dame de Paris, les 9, 10
(Bach) et 15 mars 2016 à 20H30.
Réservations : sur place avant
le concert ; par tel : 01 44 41 49 99.
13, 15, 17, 19, 21 / 3
Une création de Wolfgang Mitterer à l'Opéra de Lille

Wolfgang
Mitterer / DR
Événement pour la création lyrique 2016 que l'opéra Marta, le
nouvel opus du compositeur autrichien Wolfgang Mitterer
(*1958), aussi iconoclaste que génialement inventif, issu de la
scène viennoise. Dans
un flux dramatique puissant et foisonnant, ce virtuose du collage musical et
des dispositifs électroniques fait converger texte et musique au service d'une
fable à la féérie sombre, commandée à la jeune auteure autrichienne Gerhild Steinbuch,
héritière de Thomas Bernhard, Werner Schwab ou Elfriede
Jelinek. Ludovic Lagarde met en scène ce
monde « d'après la fin du monde », d'où les enfants ont totalement
disparu. Tous, sauf une, Marta, devenue une icône idolâtrée. "Les enfants sont
partis" : la ville s'est vidée, et le roi et la reine
cherchent encore à comprendre : où est passée Marta ? Les enfants sont-ils
morts ou se sont-ils enfuis ? L'ensemble Ictus et
l'ensemble vocal Les Cris de Paris, sous la
direction musicale de Clement Power, font vivre une
partition faite de vertiges, ruptures, syncopes, et brusques montées
d'adrénaline au service d'un texte aussi sidérant qu'inquiétant. « C'est
important pour moi de donner aux chanteurs des mots avec lesquels ils peuvent
engager leur âme » écrit Mitterer :
Elsa Benoit, Georg Nigl,
Ursula Hesse von den Steinen, Martin Mairinger et Tom Randle, tous
chanteurs rompus aux exigences scéniques des opéras d'aujourd'hui.
Opéra
de Lille, le 13 mars 2016 à 16H et les
15, 17, 19, 21/3 à 20H
Réservations :
Billetterie, rue Léon Trulin, Lille ; par tel : 03 62
21 21 21 ; en ligne :
billetterie@opera-lille.fr
9, 11,
14, 18, 21, 23, 30 / 3
Moult pianos à Gaveau et trois clavecins
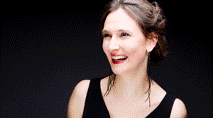
Béatrice
Martin

Benjamin
Alard

Jean
Rondeau / DR
Mars verra à la Salle Gaveau se produire plusieurs maîtres du
piano ainsi qu'une triade de clavecinistes. François Weigel, pianiste,
compositeur et chef d'orchestre (*1964) donnera une trilogie audacieuse puisque
constituée de la Sonate KV 457 de Mozart, de la sonate N° 23
« Appassionata » de Beethoven et la Sonate en si mineur de Liszt (9/3).
Puis ce sera le tour, le 11/3, de Muza Rubackyte, dans Schumann, Cuirlionis
et Prokofiev (cf. NL de 2/2016). Luis Fernando Pérez se consacrera à une œuvre
qui lui est chère, Goyescas de
Enrique Granados. Cet héritier de la grande Alicia de Larrocha n'a que tendresse pour ces pièces baignées du
chaud soleil de son Espagne natale (14/3). La pianiste japonaise Junko Okazaki, élève de Vlado Perlemuter dont elle est la dédicataire des manuscrits, a
choisi un programme français : trois Nocturnes (Nos 1, 12 et 13) de Fauré, deux
extraits des Images 2 ème série et
« Masques » de Debussy, avant de conclure avec la Sonate de Liszt,
décidément fort prisée par les interprètes ces temps (18/3). Puis Ivo Pogorelich, qui ne se produit à Paris que dans le cadre
intimiste de cette salle légendaire, concoctera une soirée comme il en a le
secret : la Sonate op 54 de Beethoven, la Toccata de Schumann,
« Pour le piano » de Debussy, Trois danses espagnoles de Granados et
Les 6 Moments Musicaux de Rachmaninov (21/3). Enfin François-Frédéric
Guy jouera les trois sonates de Brahms. Ces pièces souvent délaissées par ses
confrères, sont en tout cas très peu souvent jouées à la suite. Mais Guy aime
les défis (30/3). Entre ces déluges pianistiques, un concert de musique baroque
réunira trois clavecinistes de renom Béatrice Martin, Benjamin Alard, et Jean Rondeau, accompagnés par Les Folies
Françoise dirigées par Parick Cohen-Akenine. Au programme : les concertos pour deux et pour
trois clavecins de Bach, chefs d'œuvre du genre (23/3).
Salle Gaveau, les 9, 11, 14, 18, 21, 23, 30 mars 2016 à 20H30.
Réservations : Billetterie, 41-47, rue La Boétie, 75008 Paris ; par tel : 01 49 53 05 07 ; en ligne :
www.sallegaveau.com
16, 18, 20, 22, 23 / 3 & 8, 10, 17 / 4
Ideomeneo à l'ONR

DR
Poursuivant son exploration des
operas serias de Mozart,
l'Opéra de Rhin présente Idomeneo. Ce
premier grand titre, créé à Munich en 1781, est d'une audace exceptionnelle
quant à la vraie révolution qu'opère le jeune compositeur dans le genre seria : importance déterminante accordée aux chœurs, fine
peinture des caractères, d'une force tragique, d'une extrême efficacité pour
narrer le drame de ce fils s'émancipant
d'un père qui a voulu le sacrifier à Neptune. Cette nouvelle production sera
dirigée par Sergio Alapont et mise en scène par
Christophe Gayral. Au sein de la distribution qui,
s'agissant de certains des personnages, doit affronter de périlleuses
difficultés vocales, on retiendra plus particulièrement l'Idomeneo
de Maximilian Schmitt, l'Idamante de Juan Francisco Gatell, l'Elettra d'Agneta Eichenholz et l'Ilia de
Judith Van Wanroij.
Opéra de Rhin à Strasbourg, les
16, 18, 22, 24 mars à 20H et le 20/3 à 15H, puis à Mulhouse, La Sinne, les 8 avril à 20H et 10/4 à 15H, enfin à Colmar,
Théâtre municipal, le 17 avril à 15H.
Réservations : Opéra de
Strasbourg : 19, Place Broglie, BP 80320, 67008 Strasbourg cedex ; par tel. :
03 68 98 51 80.
Théâtre
de Colmar : 3, rue Unterlinden, 68000 Colmar ; par
tel. : 03 89 20 29 01.
La Sinne/Mulhouse, 39, rue de la Sinne,
68948 Mulhouse ; par tel.: 03 89 33 78 00.
En ligne : caisse@onr.fr
18, 20, 22 / 3
Semaine Sainte en Arles
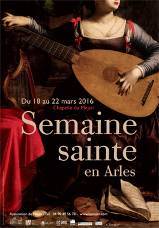
La XXXIe
édition de la Semaine Sainte en Arles se déroulera du 18 au 22 mars dans la
chapelle du Méjan. En ouverture de ce festival de musique
baroque et sacrée, se produira l'Ensemble Musicatreize,
dirigé par Roland Hayrabedian, qui interprétera les
Litanies pour Ronchamp de Gilbert Amy. Conçu comme une sorte d'hommage au
sanctuaire de Ronchamp et à son génial architecte en 1955, Le Corbusier, cette
œuvre est chantée à la fois en latin (sur les « Litanies de la
Vierge » de Jacques Hostius) et en français (extraits du Livre de
l'Ecclésiaste). « C'est une manière d'itinéraire liturgique et sonore où les
langues de la tradition occidentale chrétienne (grec et latin) alternent avec
le français, pour les besoins de la cause, rappelant le rôle prépondérant et international des pèlerinages
médiévaux », selon l'auteur (18/3). Puis c'est le tout jeune Concert de la
Loge Olympique, fondé en 2015 par Julien Chauvin, qui fera (re)découvrir
le somptueux Stabat Mater de Boccherini, écrit en 1781 sur un texte du
XIII ème siècle, attribué à Jacopone
da Todi. On jouera aussi du même compositeur sa Symphonie
en si bémol, et de Francesco Corselli les Lamentations
du Jeudi Saint (20/3). Enfin, l'ensemble La Rêveuse transportera le public
dans le monde des "Abendmusiken", cantates et sonates
traditionnellement jouées avant Noël dans le Nord de l'Allemagne. Buxtehude
donna ses lettres de noblesse à cette musique et sera à l'honneur avec
plusieurs cantates. Seront données également des pièces de Johann-Adam Reinken. On appréciera les talents de ces musiciens
généreux, en particulier de Florence Bolton, viole de gambe, Benjamin Perrot,
théorbe et Bertrand Cuiller, clavecin & orgue (22/3).
Chapelle du Méjan,
les 18, 20 et 22 mars 2016 à 20H.
Réservations : Association du Méjan, BP 90038, 13633 Arles cedex ; par tel : 04 90 49 56
78 ; en ligne : mejan@actes-sud.fr ou www.lemejan.com
23, 24, 25 / 3
Pour ses dix ans Aedes chante Bach

DR
L'Ensemble
vocal Aedes fête en 2016 ses 10 années
d'existence avec la Passion selon
Saint-Jean BWV 245 de JS Bach. Sous la direction de Mathieu
Romano, Aedes s'associe à l'ensemble Les Surprises
avec ses 18 instrumentistes et cinq solistes vocaux pour donner cette
œuvre majeure en une tournée de sept dates dont les trois premières auront
lieu en mars, respectivement à l'Opéra de Massy, au Théâtre impérial de
Compiègne et au Théâtre Jean Vilar de Suresnes. D'autres représentations
suivront en mai (Festival de l'Epau, 27/5), et en
août : Rencontres musicales de Vézelay (20/8), Opéra de Vichy (23/8) et Sinfonia en Périgord (24/8).
Les 23 mars 2016 (Massy),
24/3 ( Compiègne) et 25/3 (Suresnes).
Réservations : Opéra de
Massy, 1 Place de France, 91300 Massy ; par tel : 01 60 13 13
13 ; en ligne : www.opera-massy.com
Théâtre impérial de
Compiègne, 3, rue Othenin 60200 Compiègne ; par tel :
03 44 40 17 10; en ligne : www.theatre-compiegne.com.
Théatre
Jean Vliar, 16 Boulevard Stalingrad, 92150 Suresnes ;
par tel : 01 46 97 98 10 ; en ligne : www.theatre-suresnes. fr
16, 17 /
4
Athalia de Haendel à Herblay

Une
nouvelle production d'Athalia
de Haendel sera donnée au théâtre d'Herblay dans une interprétation
à la fois originale et purement baroque sur instruments d'époque. L'oratorio en
trois actes Athalia a été créé en 1733 à
Oxford, sur un livret de Samuel Humphreys d'après la
tragédie Athalie de Racine. Il traite l'affrontement des religions et
des jeux politiques. Iñaki Encina Oyón
dirigera le Chamber choir of Europe, formation
d'excellence et l'Ensemble Diderot, fondé en 2009, qui compte parmi les formations baroques actuelles les plus
brillantes. La régie sera assurée par Mohamed Djaafeur
Djebbar et Thomas Sanlaville.
Théâtre
Roger Barat, place de la halle, 95220 Herblay, le 16
avril 2016 à 20H et le 17 à 16H.
Réservations
: au théâtre ; par tel : 01 39 97 79 73 ou 01 34 50 34 80 ; en ligne :
billeterieculture@herblay.fr
Le Festival d'Aix et le Festival de Pékin sur la même orbite

Le
Songe d'une nuit d'été dans la mise en scène de Robert Carsen
Festival
d'Aix-en-Provence 2015 / DR
Lors d'une conférence de presse
à l'Hôtel de La Monnaie à Paris, Bernard Foccroule et
Long Yu, directeurs artistiques, respectivement, du
Festival d'Aix-en-Provence et du Beijing Festival ont présenté l'accord de
collaboration entre les deux institutions. Ce partenariat, d'une durée de cinq
ans (2016-2020), permettra, chaque saison, de présenter à Pékin une production
aixoise. Ainsi Le Songe d'une nuit d'été de Ben Britten, dans la
célébrissime mise en scène de Robert Carsen, le sera
en 2016, puis Written on Skin de George
Benjamin, créé à Aix en 2012, à l'automne 2017, et Pelléas
et Mélisande, dans le production très attendue du
Festival de l'été prochain, sera donné en 2018. Ces œuvres seront interprétées
par le China Philharmonic Orchestra, sous la
direction de Stuart Bedford (Britten) et Franck Ollu
(Benjamin). Elles seront suivies, en 2019 et 2020, de deux opéras, objets de
commandes conjointes des deux festivals, dont une passée à un compositeur
chinois dont le nom est encore à déterminer.
Selon Bernard Foccroulle, les deux festivals partagent des valeurs
communes en termes de créativité et d'ouverture. Il faut savoir que celui de
Pékin, créé en 1998, a déjà une riche expérience derrière lui, comme le fait
d'avoir accueilli, entre autres, la
première représentation chinoise du Ring de Wagner, la première
pékinoise de Lady Macbeth de Mzensk de
Chostakovitch, mais aussi des créations d'opéras notamment d'Howard Shore, ou
encore d'un concerto pour piano et orchestre pour commémorer le bicentenaire de
la naissance de Chopin, et joué par Lang Lang. De
nombreux musiciens et chefs occidentaux s'y sont produits comme des orchestres
de renom (Philharmoniques de Berlin et de New York, Orchestre de Paris, ou de
la BBC, notamment). La singularité du Beijing Festival tient à sa volonté
d'encourager la musique contemporaine à la fois occidentale et chinoise.

Written on Skin Aix 2012 ©Pascal Victor/ArtcomArt
Cet accord arrive à un moment
important pour le Festival d'Aix, notamment eu égard au développement de
l'action pédagogique qui y est menée depuis plusieurs années. Deux convictions
sont au cœur de la démarche. D'une part, l'importance du facteur création, qui
est une sorte de fil rouge pour le festival aixois, et répond à une ambition de
son homologue chinois. D'autre part, l'idée selon laquelle le dialogue
Orient-Occident est essentiel, au-delà même de de la
dimension artistique et a fortiori purement économique : l'ouverture grâce à la
créativité des artistes.
Pour Long Yu,
directeur artistique du Beijing Festival, Les deux institutions partagent les
mêmes affinités artistiques. Cet accord se place dans le cadre du développement
de la culture internationale en Chine. L'intérêt pour celle-ci manifesté par le
public chinois est indéniable, qui aspire à une certaine liberté artistique.
L'échange avec la France et son Festival d'Aix en particulier, devrait grandement
y contribuer. On ne saurait douter de la curiosité du public chinois, pour
l'opéra en particulier. La jeune génération chinoise est surtout intéressée par
l'inspiration.
Les deux institutions
bénéficieront de ce dialogue interculturel et pourront ensemble conquérir de
nouveaux publics comme soutenir le travail des jeunes artistes, créateurs et
acteurs d'enrichissement humain. Car comme le souligne Bernard Foccroulle, « l'opéra est un miroir du
monde ».
Pour
plus de renseignements : bmf.org.cn
& www.festival-aix.com
Jean-Pierre Robert.
***
PAROLES D'AUTEUR
L'exemple
de la Scène première du Rheingold de Fantin-Latour d'après l'opéra de Wagner
Première partie
Traduire le sujet,
l'expression et l'idée d'un art dans un autre art
La traduction interartistique (ou intersémiotique), bien qu'admise et
incluse dans la science de la traduction depuis plus d'un demi-siècle(1), demeure encore suspecte aux yeux de certains
chercheurs(2). Ainsi, les études relatives au
passage(3) d'une œuvre d'art dans un autre art
empruntent-elles généralement à des disciplines autres que la traduction –
notamment la sémiologie(4) ou l'histoire de
l'art(5) – leurs méthodes d'analyse. Bien des
artistes pourtant, et parmi les meilleurs, ont utilisé le mot de
"traduction" pour caractériser l'interprétation d'une œuvre
d'art par un autre art – opération que Jakobsòn nomme
« transmutation » (6). Convaincue pour
notre part qu'il existe d'étroites parentés entre les processus de traduction
littéraire (ou interlinguistique) et artistique,
notre objectif est de montrer, à l'aide d'un exemple concret, que le terme
"traduction" se justifie pleinement pour le domaine artistique. Pour
ce faire, deux conditions sont toutefois nécessaires : que l'analyse
prenne appui sur une définition générale de la traduction, valable pour tous
les types de traduction ; que l'œuvre choisie soit qualifiée par son
auteur de « traduction ».
Pour ce second
point, le peintre Henri Fantin-Latour (1836-1904) s'est imposé à nous. Fervent
mélomane, cet artiste témoigne d'un jugement particulièrement éclairé sur la
musique de son temps et revendique lui-même le terme de
« traduction » pour les nombreuses gravures ou peintures qu'il a
réalisées à partir d'œuvres de Wagner, Berlioz, Schumann, Brahms, Rossini, Weber.
Dès 1862 il grave sa première lithographie d'après le début de Tannhäuser, et en 1864 il réalise sa
première peinture sur le même sujet. C'est à cette peinture intitulée Tannhäuser au Venusberg(7) qu'il fait allusion en 1892 lorsqu'il déclare avoir
« cherché à traduire picturalement
Wagner depuis 1864 », bien avant que « naissent en foule » les
wagnériens(8). Quelques années plus tard, à
propos de ses « lithos et petits tableaux » sur Berlioz et Wagner, il
affirme tout de go à Camille Mauclair :
« […] c'est de la traduction d'un art par l'autre » (9).
Pour Fantin-Latour,
la traduction n'est donc pas réservée au seul domaine littéraire. En art comme
en littérature, elle est un moyen, pour le traducteur, d'exprimer son
admiration envers l'œuvre d'un artiste d'une autre langue ou d'une autre
discipline, de la partager avec ceux qui n'ont pas accès à cet autre langage,
et elle peut contribuer ainsi au succès de l'artiste dont le langage est
différent ou étranger. C'est ce que signifie la remarque de Fantin-Latour à son
interlocuteur. Rappelons d'ailleurs qu'il participa de manière active à la
défense de la cause wagnérienne à l'époque de la Revue Wagnérienne (1885-1888) en livrant plusieurs lithographies,
fort appréciées, d'après les opéras de Wagner.
L'exemple
qui va servir de support à notre analyse est la gravure Scène première du Rheingold réalisée en
1876 [Fig. 1], l'année même où fut créée à Bayreuth la Tétralogie.
Fantin-Latour assiste à la troisième série de représentations, les 27, 28, 29
et 30 août 1876. Cinq lettres adressées de Bayreuth entre le 28 et le 31 août
1876(10) rendent compte de son voyage artistique et
de ses réactions après chacune des représentations. Il est
« transporté » d'admiration. Le 30 août il écrit à son ami Scholderer :
C'était magnifique
tout cela, malgré mon absence de savoir musical, malgré le peu de connaissance
que j'avais de cette œuvre, j'ai été transporté. Il y a plusieurs choses qui
font oublier tout ce que l'on connaît de musique dramatique, un ensemble qu'il
a raison d'appeler l'Art de l'Avenir. Musique, situation dramatique, décors,
mise en scène, costumes, effets féeriques, parfois et même souvent c'est
complet(11).
Dès son retour
d'Allemagne il effectue ses premières esquisses, et c'est
vingt-deux ans plus tard, en 1898, qu'il achève un ensemble de plus de quarante
œuvres entièrement dédié au Ring(12). Inaugurant sa série sur la Tétralogie, la Scène première du Rheingold
reflète l'un des moments du cycle wagnérien qui l'avait le plus impressionné à
Bayreuth. Outre l'illumination progressive des eaux du fleuve, Fantin-Latour
avait admiré le mouvement « parfait » des Filles du Rhin qui « nagent en
chantant ». À son ami Edmond Maître, il commente depuis Bayreuth :
Oh, c'est très
beau, unique. Rien n'est comme cela. C'est une sensation pas éprouvée encore.
[…] Ces mouvements des Filles qui nagent en chantant, est (sic) parfait,
l'Alberich qui grimpe, qui ravit l'or, l'éclairage,
la lueur que jette l'or dans l'eau, est ravissante. Là comme dans tout le
reste, c'est de la sensation, pas la musique, pas le décor, pas le sujet, mais
un empoignement du spectateur, c'est pas le mot qu'il
faut, que spectateur, ni auditeur non plus, c'est tout cela mêlé(13).
Quels rapports
cette gravure entretient-elle avec l'opéra de Wagner et sa représentation à
Bayreuth ? En quoi peut-elle être considérée comme une « traduction »
de l'œuvre dramatique en ses différentes composantes visuelles, littéraires et
musicales ?
Présentation de la
méthode d'analyse
Pour
répondre à cette question, faut-il d'abord s'entendre sur la signification du
mot « traduction ». Eugène Delacroix, qui a puisé largement son
inspiration dans la littérature et le théâtre (y compris musical), a proposé
dans son Dictionnaire des Beaux-Arts
une définition générale de la traduction qui orientera en grande partie notre
démarche. Cette définition se trouve, assez curieusement, à l'entrée
« Gravure » de son Dictionnaire.
Pour Delacroix, en effet, les gravures anciennes qui « reproduisent »
des œuvres de peintres sont de « véritables traductions ». Il en
donne les raisons dans sa définition :
Gravure. Les plus anciennes gravures sont peut-être les
plus expressives. Les Lucas de Leyde, les Albert Dürer, les Marc-Antoine sont
de vrais graveurs, dans ce sens qu'ils cherchent
avant tout à rendre l'esprit du
peintre qu'ils veulent reproduire
[...] La gravure est une véritable
traduction, c'est-à-dire l'art de transporter une idée d'un art dans un autre,
comme le traducteur le fait à l'égard d'un livre écrit dans une langue et qu'il
transporte dans la sienne. La langue étrangère(14) du graveur, et
c'est ici que se montre son génie, ne consiste pas seulement à imiter par le moyen de son art les effets
de la peinture, qui est comme une autre langue. Il a, si l'on peut parler
ainsi, sa langue à lui qui marque d'un cachet particulier ses ouvrages, et qui,
dans une traduction fidèle de
l'ouvrage qu'il imite, laisse éclater son sentiment particulier(15).
Trois critères,
auxquels répondent les gravures « anciennes » d'après les œuvres de
peintres célèbres, permettent donc à Delacroix d'affirmer que celles-ci sont
bien des « traductions » : le premier concerne l'idée – la traduction est
« l'art de transporter une idée d'un art dans un autre » ; le
deuxième se rapporte à l'expression – la traduction consiste à
« imiter par le moyen de son art les effets » de l'autre art ;
le troisième vise l'interprétation – et c'est là que « se montre son
génie » : « dans une traduction fidèle de l'ouvrage qu'il imite, il
[le traducteur] laisse éclater son sentiment particulier ». Delacroix met
ainsi en lumière deux points capitaux de toute traduction, à savoir qu'elle
exige, d'un côté, la fidélité à l'esprit
de l'œuvre source – notion incluant l'idée
et les effets –, de l'autre, la
liberté d'une expression personnelle.
Cette définition
générale, à la fois concise et claire, une fois adaptée au cas de la traduction
plastique d'une œuvre musicale, servira de support à notre analyse qui
s'effectuera alors en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous
vérifierons la fidélité du peintre à
son modèle en analysant ses moyens pour transférer la scène d'opéra en gravure
sur trois plans : le sujet (ou contenu narratif), l'expression, l'idée.
Dans un second temps, nous mettrons en lumière comment s'est manifestée la liberté du peintre par rapport à l'opéra
en nous appuyant sur ses propres confidences et l'ensemble des œuvres qu'il a
réalisées d'après la première scène de L'Or
du Rhin.
Deux des points de
l'analyse sont encore à préciser : l'un à propos du transfert de la narration
(absent de la définition de Delacroix), l'autre à propos de l'idée. En ce qui concerne le premier
point – le passage du livret de
l'opéra au sujet de la gravure –, il
est à souligner que le peintre doit condenser dans l'espace de sa gravure les divers
faits qui se succèdent dans le livret, ce qui engendre inévitablement des
écarts par rapport à la narration, mais des écarts nécessaires à
l'intelligibilité du sujet(16), et révélateurs,
en outre, des intentions secrètes du peintre. Il est donc capital de repérer
ces écarts.
En ce qui concerne
le second point – le transfert de l'idée
–, il est important de bien distinguer l'idée
du sujet, celui-ci n'étant que l'enveloppe
extérieure de l'idée. Or, pour
le peintre traducteur, c'est l'idée
de l'opéra qu'il s'agit avant tout de transporter dans son art, même si cela
passe par la représentation d'un sujet.
Cette idée est en quelque sorte le
« germe » ou le « noyau essentiel » (17) de l'œuvre originale que le traducteur a pour tâche
principale de « libérer ». Dans le cas de la gravure Scène première du Rheingold,
c'est la musique – qui est comme
« l'inconscient de la parole » (18) –, et non le texte, qui va inspirer au peintre la structure
géométrique capable de symboliser l'idée
de l'œuvre dramatique. Mais c'est aussi la structure plastique, mise en
relation avec la vie psychique du peintre, qui permettra d'accéder à
l'interprétation personnelle de ce dernier. D'une importance capitale, la
découverte de la structure interne de l'image est aussi l'un des aspects les
plus délicats de l'analyse du processus de traduction en art.
Faut-il ajouter, enfin, que la
compréhension du processus de traduction gravée ou peinte d'une scène d'opéra
exige une double compétence, en musique et en
peinture, mais pas seulement. Comme l'artiste traducteur, le chercheur doit en outre
être « doué de sensibilité et
d'imagination » (19). Paul
Ricœur l'affirme : « Tant que l'œuvre ne s'est pas frayé un chemin
jusqu'à l'émotion analogue, elle demeure incomprise » (20). Pierre Lemarquis ne dit pas
autre chose lorsqu'il déclare que « seule l'empathie, le ressenti de
l'intérieur, permet de vibrer à l'unisson et de remonter à l'essence des
choses » (21).
Deux numéros de la
Lettre d'Information de L'Éducation
musicale accueilleront les deux parties de notre analyse. Dans la première
partie (n° 101, mars 2016) qui s'attachera à démontrer la fidélité du peintre à Wagner,
nous partirons, de manière logique, de l'analyse du texte de l'opéra
– dont l'écriture par Wagner a précédé la composition – pour aboutir à la
signification du drame révélé par la gravure : après l'étude du transfert
du livret de la première scène de L'Or du Rhin au sujet de la lithographie (le « sujet extérieur »), nous
vérifierons comment les formes plastiques (figures et décor) imitent les effets de la musique, puis mettrons en lumière la structure
plastique issue de la musique, avant d'expliciter son rapport à l'Idée du drame qu'elle symbolise sous une
forme géométrique.
Pour
la seconde partie (Lettre d'Information de L'Éducation
musicale, n° 102, avril 2016) visant à démontrer la part de liberté nécessaire au véritable
traducteur, nous procèderons de
manière inverse par rapport à la première c'est-à-dire en partant non pas du
texte, mais de la musique. De type poïétique – c'est-à-dire cherchant à
reconstituer le processus créateur du peintre –, cette analyse est rendue
possible par les confidences de Fantin-Latour dans sa lettre écrite de Bayreuth
après le spectacle et par les diverses variantes qui ont précédé et suivi la gravure
de 1876 (plusieurs croquis, un pastel et une peinture). La comparaison de la
lithographie [Fig. 1] avec la peinture réalisée douze années plus tard [Fig.
2], permettra de comprendre comment la création personnelle du peintre, dans la
peinture, l'a emporté, en quelque sorte, sur le désir de traduire fidèlement
l'œuvre wagnérienne qui s'était imposé tout d'abord dans la gravure(22).


Fantin-Latour, Scène première du Rheingold
Fig. 1. Lithographie, 1876(23) Fig. 2. Peinture à l'huile,
1888(24)
Cette double
lecture de l'œuvre à laquelle nous nous sommes livrée peut rappeler la théorie
sémiologique de Molino et Nattiez qui préconisent
pour toute œuvre d'art trois niveaux d'analyse (poïétique, neutre et esthésique), les différents niveaux ne se correspondant pas
nécessairement(25). En réalité, si
nous avons tenté de reconstituer le processus créateur (le niveau poïétique) et
accordé une grande importance au processus perceptif (le niveau esthésique), nous n'avons pas cherché à appliquer cette
méthode, restée d'ailleurs en grande partie à l'état d'aspiration théorique
face aux difficultés de sa réalisation. Il n'en reste pas moins que le fait de
mettre en regard ici deux méthodes d'analyse différentes – l'une aboutissant à
la signification de l'œuvre source, l'autre à l'idéal même du traducteur –
permet d'envisager le processus de traduction d'une manière aussi complète que
possible et d'élargir en outre notre compréhension de l'art en général.
Traduire le texte
et l'expression
Si l'on a pu voir en L'Anneau du
Nibelung « une gigantesque allégorie philosophique sur la société, la
politique, l'économie, la psychologie et le pouvoir » (26), on retient plus généralement qu'un conflit majeur et universel s'y
joue : le conflit entre l'amour et le pouvoir. Celui-ci apparaît dès la
première scène de L'Or du Rhin lorsque
le nain Alberich renonce à l'amour pour s'emparer de
l'or du Rhin et forger un anneau censé lui donner la toute puissance sur les
êtres et le monde. Véritable moteur de l'action, l'anneau, maudit par le nain
lorsque Wotan (le roi des dieux) le lui arrache pour payer aux géants le
Walhalla, engendrera la mort pour tous ceux qui le détiendront. Après que Wotan
ait tenté vainement de le récupérer au cours des deux opéras centraux (La Walkyrie et Siegfried) pour échapper à son tragique destin, le conflit trouve
sa résolution à la fin du Crépuscule des
dieux, lorsque Brünnhilde (fille de Wotan), ayant
récupéré l'anneau au doigt de Siegfried mort, se sacrifie par amour pour ce
dernier en se jetant dans le bûcher édifié pour consumer la dépouille du héros. Alors, les
Filles du Rhin viennent reprendre l'anneau du doigt de Brünnhilde.
L'or retourne finalement au Rhin, tandis que les dieux périssent dans les
flammes.
En replaçant la
première scène de L'Or du Rhin dans
le contexte de la Tétralogie, il apparaît clairement que le Ring en son entier repose sur cette
scène initiale. Pour en faire comprendre la portée véritable, le peintre ne
peut donc la dissocier du reste de l'opéra. C'est ce que nous aurons à découvrir.
Mais, dans un premier temps, nous nous bornerons à vérifier en quoi le sujet de
la gravure Scène première du Rheingold est fidèle au livret de la même scène chez
Wagner. Après avoir rappelé les principaux épisodes de cette scène initiale,
nous relèverons dans l'image ce que le peintre a retenu, éliminé ou modifié par
rapport au texte de Wagner (poème et didascalies).
Du livret d'opéra
au sujet de la lithographie : la concentration dramatique
La
scène se passe dans les profondeurs du Rhin [Fig. 3] (27). Au tout début du
livret, une didascalie plante le décor : « une pénombre verdâtre,
lumineuse vers le haut, obscure vers le fond [...] des rochers escarpés se
dressent un peu partout, émergeant des profondeurs et délimitant l'espace
scénique » (28).

Fig.
3. Josef Hoffmann, dessin pour le décor de L'Or
du Rhin

Fig.
4. Scène première du Rhin 1876
Cliché Bibliothèque nationale de France
Puis vient l'action
proprement dite que l'on peut décomposer en cinq épisodes. Résumons-les très
succinctement(29) :
- Premier
épisode : Trois ondines s'ébattent et bavardent au cœur des eaux. Par une
faille de la terre survient Alberich, un Nibelung
immédiatement séduit.
- Deuxième
épisode : Par jeu, les trois filles du Rhin feignent successivement de
s'accorder au nain avant de le repousser.
- Troisième
épisode : Une clarté grandit dans les eaux ; apparaît l'or au sommet
des rochers dont s'exaltent les ondines.
- Quatrième
épisode : À l'étonnement du nain, et inconscientes du danger qu'il
représente parce qu'elles ne différencient pas l'Amour et le Désir violent qui
anime Alberich, les ondines répondent avec ironie que
seul peut s'en emparer et bénéficier de l'absolue puissance que l'or donne,
celui qui pour toujours renonce à l'Amour.
- Cinquième épisode : Ce que
fait immédiatement Alberich, qui s'empare ainsi de
l'or et disparait. Une obscurité tragique ferme la scène.
De cette scène
plutôt longue (d'une durée de vingt minutes environ), quels éléments
Fantin-Latour a-t-il retenu pour la composition de sa gravure de 1876 [Fig. 4]
? Notons d'abord que l'un des épisodes clés de la première scène, le rapt de
l'or par le nain, est absent de la gravure, et que sur deux points le peintre
s'éloigne du spectacle : le format en hauteur – contraire à l'espace scénique –,
et la nudité de deux ondines – inconcevable dans le théâtre de l'époque.
En ce qui concerne
le décor, Fantin-Latour a conservé quelques aspects de la mise en scène
figurant dans les didascalies. « De tous les côtés et depuis les
profondeurs se dressent des récifs de rochers raides et escarpés qui délimitent
l'espace », comme à Bayreuth. Vers le fond en haut à gauche, des pointes
rocheuses, « semblables à une masse mouvante de nuages », « se
dissolvent en un brouillard humide ». À droite, « un récif […] se
dresse de sa pointe élancée » jusque vers les rayons lumineux que
darde le soleil au sommet de l'image, alors qu'à son pied « des flots
d'eau plus denses » sont agités de vagues et de remous. Dans l'angle
gauche en bas, un bloc énorme de rocher à l'aspect menaçant, creusé d'une
profonde cavité, « laisse supposer, dans la plus épaisse obscurité, des
gorges profondes ». Quant aux effets de lumière qui avaient subjugué le
peintre à Bayreuth, ils ont été eux aussi respectés : lumière plus vive en
haut, plus sombre en bas autour du gnome.
Pour la
représentation des figures, Fantin-Latour respecte certains détails du livret.
« Gracieuses et séduisantes, sveltes et fluides », selon les termes
du gnome, les Filles du Rhin, dans la gravure, s'opposent à « l'affreux
nain noir » situé tout en bas dans l'obscurité, agrippé à un rocher.
Décrit par les ondines comme « velu et bossu, les cheveux piquants aux
boucles raides, le corps de crapaud »,
Alberich semble revêtir dans la lithographie
certains de ces traits, notamment le corps velu et anguleux, les cheveux épais,
la cuisse repliée l'apparentant au crapaud.
Par rapport à
l'action dramatique, Fantin-Latour reste également proche du livret en montrant
les Filles du Rhin « nageant en tout sens, tantôt vers le fond, tantôt
vers le haut » – ce qu'elles font à diverses reprises dans la scène
première de l'opéra. Mais là où Fantin-Latour ajoute au livret, c'est dans
l'individualisation des ondines, attribuant à chacune un rôle bien défini dans
l'action dramatique :
– L'ondine qui
plonge nue et dialogue avec le nain apparaît d'abord comme une figure de la
tentation – rôle que les nixes tiennent tout à tour dans le deuxième épisode.
Cette même ondine, de son bras levé avec l'index pointé vers le haut, attire en
outre l'attention du nain sur l'or qui brille au sommet (quatrième épisode).
Elle tient donc aussi le rôle de « bavarde ».
– L'ondine vêtue
d'une longue robe sombre qui, au centre, remonte vivement le Rhin tout en
déployant une guirlande d'algues, s'associe à Flosshilde,
la plus responsable des Filles du Rhin. C'est elle, en effet, qui s'interpose
entre ses sœurs et leur reproche, soit de mal veiller l'or (premier épisode),
soit d'être trop « bavardes » (quatrième épisode). Elle incarne
l'autorité et la sagesse. Mais par sa grande fluidité et sa vivacité elle peut
être reliée à plusieurs moments de la scène où les ondines « nagent en
tout sens, tantôt vers le fond, tantôt vers le haut pour inciter Alberich à leur faire la chasse » (deuxième épisode),
ou encore lorsqu'elles « montent et descendent, nageant et riant dans la
lumière éclatante » (quatrième épisode). Cette ondine peut donc aussi
exprimer le jeu et la joie.
– Tout en haut, la
troisième ondine, qui s'enivre des rayons d'or, manifeste le sentiment d'extase
éprouvé par les trois Filles au moment où la lumière inonde les flots
(troisième épisode). Elle représente la béatitude.
–
Enfin, situé en bas dans l'obscurité, le nain personnifie la menace. Présenté
de dos, ramassé sur lui-même, la tête tournée en direction des Filles et de
l'or qui rayonne, il s'agrippe au rocher qu'il cherche à gravir pour saisir
l'une des ondines (deuxième épisode). Mais son attitude convient également aux
divers moments où il les interpelle – soit pour folâtrer avec elles (deuxième
épisode), soit pour connaître ce qui brille là-haut (quatrième épisode) –, ou
encore à la fin du quatrième épisode lorsqu'il se contente de les écouter et
s'apprête à s'emparer de l'or.
Ainsi, lorsqu'on
met en relation la lithographie avec le livret de la première scène de L'Or du Rhin, on peut y reconnaître une
grande partie des quatre premiers épisodes : le jeu des Filles dans le
Rhin et l'attention de Flosshilde à bien veiller sur
l'or (premier épisode), l'épisode amoureux d'Alberich
et des Filles du Rhin (deuxième épisode), l'éveil de l'or et son adoration par
les ondines (troisième épisode), les questions du nain à propos de l'or, la
révélation de ses prodiges par les nixes, voire la reprise de leur jeu
(quatrième épisode).
Bien sûr, le
peintre propose au spectateur une lecture différente de celle du livret. Au
temps linéaire, chronologique de la narration, se substitue, dans la gravure,
un temps que l'on pourrait qualifier de « vertical », nouant en
chacune des figures des « simultanéités nombreuses » (30). D'où certains écarts par rapport au récit, par
exemple l'évocation simultanée de la séduction et de la révélation de l'or par
l'ondine qui plonge.
Une lecture
temporelle n'est cependant pas exclue. Elle semble même devoir s'imposer ici.
En effet, la superposition des figures alternativement dirigées dans un sens
puis dans l'autre et leur orientation vers la lumière invitent à lire l'image
du bas vers le haut. Un ordre différent de celui du récit dramatique gouverne
alors l'enchainement des figures : de la séduction à la fois charnelle et
matérielle au début du parcours visuel, à l'Adoration de l'or à son terme, en
passant par une étape transitoire dont la signification véritable se dérobe à
ce stade de la description. Qu'a donc voulu dire le peintre à travers ce
parcours visuel peu conforme au livret de la scène initiale qui, rappelons-le,
se clôt dans l'obscurité totale ? La question est essentielle, mais nous
ne découvrirons la réponse que progressivement. Un premier élément de réponse
est apporté par l'analyse des liens entre les figures et certains motifs
musicaux que nous allons aborder maintenant.
Les figures de la
lithographie et les thèmes musicaux de L'Or
du Rhin : l'imitation des effets
de l'autre art
Dans la définition
de la traduction donnée par Delacroix, l'un des critères permettant de
reconnaître une véritable traduction
est l'imitation des effets de l'autre
art. Comment Fantin a-t-il cherché, à travers les
figures et le décor de sa gravure, à imiter
les effets de la musique et par quels moyens ? Soulignons, de prime
abord, qu'il ne s'agit pas d'imiter les formes extérieures, mais leurs
« effets », des « effets » agissant sur la sensibilité et
l'imagination du récepteur. Kandinsky a lui-même insisté dans ses écrits sur le
double aspect, à la fois extérieur et intérieur, des éléments de l'art. Et
pour lui, comme pour tous les artistes, « ce ne sont pas les formes
extérieures qui définissent le contenu d'une œuvre picturale, mais les
forces–tensions qui vivent dans ces formes(31) » et
affectent la sensibilité du spectateur ou de l'auditeur.
Le
type d'analyse que nous allons aborder ici est donc fondé essentiellement sur
une expérience sensible et subjective. Dans la gravure Scène première du Rheingold, il s'agit
alors de repérer si certains éléments figurés de la gravure résonnent avec certains motifs musicaux
de la première scène de L'Or du Rhin,
alors même qu'aucun motif musical n'est attribué à l'une ou l'autre des ondines
dans l'opéra. Mais, dans la lithographie, chacune d'elles, nous l'avons vu,
incarne un ou plusieurs moments de la scène, moments auxquels sont reliés
divers motifs musicaux. On a donc tout lieu de penser que des motifs musicaux
de la première scène, en lien avec les actions des ondines suggérées dans la
gravure, ont pu influencer l'expression des gestes et attitudes de ces
dernières. C'est ce dont nous avons fait l'expérience, presque à notre insu, et
que nous allons vérifier en comparant les effets
des formes gestuelles des trois figures féminines avec ceux des motifs musicaux
exprimant les actions de ces mêmes ondines. Pour notre étude, nous suivrons
l'ordre d'apparition de ces motifs dans la partition.
Particulièrement
musicale, d'une grande fluidité, l'ondine vêtue qui remonte le Rhin, toute
tendue vers l'avant, entre immédiatement en résonance avec un fragment musical
du premier épisode : l'interlude orchestral, d'un puissant élan rythmique,
qui soutient le jeu des Filles juste après que Flosshilde
ait menacé ses sœurs de « payer cher ce jeu » si elle
ne veillaient pas mieux au repos de l'or comme le leur a ordonné leur
père, le Rhin [Ex. 1].

Ex. 1. L'Or du Rhin : Les Jeux
des Filles du Rhin
Construit sur le
motif héroïque et ascendant du Rhin dans sa deuxième version au rythme plus
resserré que la première, cet interlude est accompagné du motif très animé des
Flots ondoyants qui a pu suggérer l'ondoiement rythmique des vagues au bas de
la lithographie(32). Une didascalie
souligne le caractère vif et joyeux du fragment musical : « […] riant
et folâtrant, elles s'élancent ainsi de récif en récif, vives comme des
poissons ». En réalité, la reprise incessante du motif du Rhin pendant les
jeux des trois ondines sonne aussi comme un rappel insistant de la mission qui
leur a été confiée.
Que
Flosshilde ait été associée par Fantin-Latour au Rhin
lui-même, cela n'est pas sans raison. Dans le nom de cette ondine sont réunis,
en effet, les mots der Fluss = le fleuve, et die Heldin = l'héroïne. La plus
responsable des Filles du Rhin, c'est elle qui rappelle à ses sœurs les ordres
du Rhin, leur Père, dont elle est la plus proche, et son importance dans la
lithographie – elle seule est représentée en entier – témoigne de son rang
privilégié.
Pas
moins musicale que cette dernière, la Fille du Rhin qui plane au sommet de
l'image et s'enivre des rayons de l'or renvoie tout naturellement à l'extrait
musical débutant le troisième épisode, l'un des fragments les plus
"impressionnistes" de l'opéra [Ex. 2]. Wagner y dépeint le moment où
« une lumière féerique et dorée irradie progressivement les flots ».


Ex. 2. L'Or du Rhin : le motif
de L'Or (début)
Au début de cet
épisode, le motif arpégé et
ascendant de l'Or, « aussi pur
que celui du Rhin » (33), émerge tout doucement au cor, sur une
harmonie de sol majeur immobilisée
pendant vingt mesures au-dessus d'une « oscillation tranquille et
régulière de triolets de croches aux violons divisés » (34) en trois pupitres. Sur sa note finale tenue, et à
chacune de ses redites, s'enchaîne le chant que se partagent les Filles du Rhin
saluant « l'aurore éveillant l'abîme » – d'abord Woglinde,
puis Wellgunde, puis Flosshilde.
Lorsque « la claire lumière » paraît, trois cors doublent la mélodie
de Wellgunde pendant que les violons divisés en huit
pupitres oscillent sur un rythme dédoublé de sextolets de doubles croches. Sur
la tenue des cors s'enchaîne ensuite la phrase arpégée dans l'aiguë de Woglinde chantant « l'astre qui irradie dans les reflets des flots »,
phrase qui se termine sur la note la plus élevée – un sol aigu blanche pointée. Aussitôt un crescendo s'amorce. Deux
harpes déroulent leurs rapides arpèges ascendants pendant que le rythme des
violons s'atomise encore, se transformant en sextolets de triples croches
maintenus cette fois dans un registre très aigu. Alors, le motif de l'Or éclate
à la trompette, « plus lumineuse que le cor » (35), dans une nuance forte
et sur un accord d'ut majeur.
Cette
progression sonore, Fantin-Latour a cherché à la reproduire dans la partie supérieure de la lithographie : l'eau
s'est immobilisée – l'horizontalité en est soulignée par les éraflures de
l'estampe – et la figure oblique de l'ondine en émerge progressivement.
Orientée vers la lumière irradiant du coin droit supérieur, la tête renversée
en arrière, elle s'associe au motif de l'Or dont l'arpège ascendant reste comme
en suspens sur sa note finale longuement tenue. Une gradation lumineuse conduit
le regard, de la partie inférieure du corps de l'ondine à sa gorge. Tout en
haut, la lumière éclatante de l'astre invisible darde la pluie fine de ses
rayons d'or qui éblouissent l'ondine et pénètrent l'espace aquatique, imitant
l'effet de ruissellement sonore produit par les oscillations des violons dans
l'aigu qui accompagnent la fanfare éclatante de l'Or à la trompette.
Quant
à l'ondine nue qui surgit du milieu du bord gauche de la gravure et plonge dans
les profondeurs du Rhin, elle ne cherche pas seulement à séduire Alberich. De son bras droit dessinant une ample courbe
ascendante au centre de l'image, l'index pointé, elle attire l'attention du
nain sur l'or qui « brille et luit là-bas », comme c'est le cas,
précisément, dans le quatrième épisode de la première scène de L'Or du Rhin. Il suffit alors d'écouter
la musique de ce passage pour percevoir immédiatement le motif décisif dont
Fantin-Latour a traduit ici l'effet :
le Renoncement à l'amour [Ex. 3].

Ex. 3. L'Or du Rhin : le motif
du Renoncement à l'amour (début)
Chanté par Woglinde sur les paroles « Seul celui qui renie
le pouvoir de l'amour, seul celui qui bannit le plaisir d'aimer, lui seul
pourra par magie imposer à l'or la forme d'anneau », ce thème ressort
d'autant mieux qu'il contraste fortement avec ce qui précède : le
mouvement ralentit, la couleur s'assombrit et la nuance s'amenuise. Débutant
par un intervalle de sixte mineure ascendante en anacrouse repris deux mesures
plus loin, il « est accompagné par de larges, doux et lents accords
parfaits (ut et fa mineurs, sol et lab majeurs)
joués avec gravité par des cuivres aux sonorités profondes : quatre Wagner-Tuben
(deux ténors, deux basses), un tuba et un trombone contrebasse » (36). Très inspiré, d'une rare intensité dramatique, il
représente l'un des moments cruciaux de la première scène, la révélation de Woglinde étant à l'origine même du drame. Ce thème aurait
donc dicté à Fantin-Latour la courbe imposante du bras levé de l'ondine au
centre de l'image, bras qui lui emprunte à la fois son profil et son caractère
de gravité.
Quant
au bras gauche de la même ondine, il oppose à la courbe ascendante du bras
droit une courbe descendante symétrique, et s'achève, lui aussi, par l'index
pointé qui interpelle le nain. La forme courbe dessinée par ce bras pourrait
faire écho à autre motif qui s'immisce à l'orchestre sous la dernière
proposition de la phrase chantée par Woglinde que
nous venons de citer (« Lui seul pourra par magie imposer à l'or la forme
d'anneau ») : le motif de l'Anneau – bien que tronqué à cet endroit et assez
peu repérable à l'audition –, dont le profil est inversé par rapport au
Renoncement à l'amour [Ex. 4].

Ex. 4 : Le Renoncement à l'amour (fin) superposé au motif tronqué de
l'Anneau
Caractérisé par une
succession de tierces en descente et remontée qui, en se répétant, produit l'effet d'un anneau, le motif de l'Anneau
est présent également, sous des formes différentes et tout à fait repérables à
l'audition, à deux autres endroits de la scène. Au début du
quatrième épisode il apparaît sous un premier aspect, que l'on peut dire
"mythique" – « car le trésor semble bien gardé, par un sort qui
lui a été dévolu » (37) [Ex. 5].

Ex.
5 : L'Anneau (version « mythique »)
Sous cette forme,
le motif de l'Anneau accompagne la voix de Wellgunde
dévoilant au nain le pouvoir suprême de l'or une fois transformé en
anneau : « La richesse du monde appartient à celui qui transforme
l'or en anneau ».
Une
autre fois il est enfin présent, mais c'est dans le cinquième épisode (exclu de
la représentation de Fantin-Latour), à l'extrême fin de la scène première, et
sous un nouvel aspect, lorsque le nain, en déclarant renoncer à l'amour,
conquiert véritablement le pouvoir de transformer l'or en un anneau(38) : « J'arrache l'or au récif, / Je forgerai
l'anneau vengeur ; / Et que les flots l'entendent : / Je maudis
l'amour ! » [Ex. 6(39)].

Ex. 6 : L'Anneau (version définitive)
Très
prégnant dans les deux derniers épisodes de la scène première, l'Anneau est
l'un des motifs les plus importants de L'Anneau
du Nibelung. Il ne serait donc pas surprenant que Fantin-Latour ait cherché
à suggérer son effet dans sa gravure.
Un anneau virtuel, en effet, d'une géométrie parfaite, s'impose au cœur de
l'image grâce aux deux bras courbes de cette même ondine et du bras droit tendu
vers l'arrière de celle qui remonte le Rhin [Fig. 5]. Ces trois bras
s'inscrivent exactement à l'intérieur de deux cercles concentriques(40). Ils constituent donc un anneau dont les proportions
énormes sont à la mesure de la Toute Puissance qu'il symbolise.

Fig. 5 : Une construction en anneau
Le
rôle de l'ondine qui plonge se précise alors : tout en révélant au nain,
de son bras dressé, la condition pour forger l'or – le renoncement à
l'amour–, elle « livre », pour ainsi dire, l'anneau au Nibelung. En
effet, comme Fantin-Latour l'a bien saisi, c'est au moment même où retentit le
motif du Renoncement à l'amour, d'une infinie désespérance, que commence
véritablement le drame, même si ce n'est qu'à l'extrême fin de la scène
première qu'Alberich, tout en maudissant l'amour,
conquiert le pouvoir de transformer l'or en anneau. Mais dans l'image,
Fantin-Latour anticipe le drame par la présence virtuelle de l'anneau que
suggèrent les bras de deux ondines. Le drame est donc bien amorcé, et la
responsabilité en revient au bavardage inconscient de l'ondine qui dialogue
avec le nain.
À chacune des
figures féminines correspond donc un, voire deux thèmes fondamentaux de la
première scène : à celle qui s'exalte de la beauté de l'or rayonnant, la
fanfare de l'Or ; à celle qui remonte le Rhin à vive allure, le motif du
Rhin dans sa deuxième version ; à celle qui plonge en direction d'Alberich, le Renoncement à l'amour lié à son bras droit et
le motif de l'Anneau suggéré par ses deux bras en forme d'arc de cercle. Nous
reviendrons plus loin sur la signification du bras de Flosshilde
contenu lui aussi dans l'anneau virtuel.
En traduisant quelques uns des motifs les
plus importants de la première scène, ou mieux, leurs effets, par l'expression des gestes et directions des ondines et le
traitement de quelques éléments naturels du décor – les jeux de la lumière sur
les flots –, Fantin-Latour parvient, en quelque sorte, à musicaliser l'image.
Aussi, n'est-il pas impossible, en contemplant l'image, d'entendre
intérieurement ces mêmes motifs du début de l'opéra (comme ce fut notre propre
expérience). Le poète Mallarmé à qui Fantin-Latour offrit la gravure de 1876 en
avait lui-même perçu la musicalité. En témoigne sa lettre de remerciements dans
laquelle il considère « avec émerveillement […] la façon dont tout était
vu à travers la musique – la composition est imprégnée d'une mobilité diffuse
et vibrante » (41).
Mais Fantin-Latour
ne musicalise pas seulement sa gravure en imitant
les effets de certains motifs musicaux de la première scène de l'opéra à
travers les gestes et mouvements des ondines. En donnant corps aux motifs de
l'Or, du Rhin, et de l'Anneau (indissociable du Renoncement à l'amour), il
réunit dans sa gravure les éléments fondateurs du drame wagnérien, les pièces
maîtresses, que l'on retrouve sous forme de mots dans le titre et le sous-titre
du drame : L'Or du Rhin et L'Anneau du Nibelung. Reste à comprendre
comment ces pièces fonctionnent les unes avec les autres. C'est l'objet du
chapitre suivant.
Traduire la
structure et l'idée
Pour Fantin-Latour,
l'art est une « affaire de sentiment qui doit être pourtant une loi,
une chose mathématique » (42), par exemple,
« deux tons mis à côté qui produisent un tout vrai, beau, complet, il ne
peut y avoir rien de changé [...] c'est mathématique, c'est deux et deux qui
font quatre(43) ». Et de préciser que les
« lois harmonieuses » régissant la composition sont « nullement
de convention », dictées uniquement par le « besoin de
l'artiste » – que Kandinsky nommera plus tard « la nécessité
intérieure » –, et qu'elles sont l'expression des « forces de la
nature ».
Mais comment
découvrir la « loi d'organisation interne » (44) conférant à la Scène
première du Rheingold sa « mystérieuse
harmonie » ? Si « des chemins sont ménagés à l'œil du
spectateur » à l'intérieur de l'œuvre, comme l'écrit Paul Klee, si
« l'artiste recherche une certaine simplicité de construction, une
certaine facilité de lecture » (45), le récepteur n'en
devra pas moins faire preuve d'intuition et d'imagination pour saisir la
structure dynamique servant de soubassement à la gravure et assurant l'unité de
la représentation, cette structure qui ne correspond à aucun schéma préétabli,
mais uniquement à « l'esprit du contenu » (46).
Le motif des
Filles du rhin et la structure plastique : un
schème commun en S
Dans
la Scène première du Rheingold,
c'est grâce à l'enchainement des corps des trois Filles du Rhin, du bas vers le
haut, orientés dans des directions opposées, et grâce aussi à l'anneau déjà
identifié au sein de la composition, que nous pouvons découvrir le schéma
géométrique servant de support au parcours vif et ondoyant des ondines [Fig.
6].
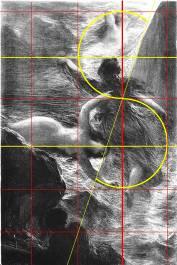
Fig. 6. Une structure en S
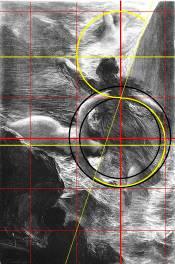
Fig. 7. Une double structure en S et en anneau
En effet, en
suivant leur trajet à partir de la courbe du bras inférieur de celle qui
plonge, on en vient à dessiner tout naturellement une ligne serpentine en forme
de S, c'est-à-dire deux portions inversées de deux cercles superposés tangents
l'un à l'autre, le changement de sens s'effectuant au niveau du dos et du bras
tendu en avant de Flosshilde, et la courbe supérieure
du S enveloppant le corps de l'ondine en extase au sommet de la gravure.
L'axe vertical sur
lequel se trouvent les centres des deux cercles est le même que celui de
l'anneau [Fig. 7] : il passe entre le talon du pied droit de Flosshilde et les doigts de la main inférieure de la nixe
qui plonge. Quant au point de tangence des deux cercles, il se trouve à
l'intersection de cet axe vertical avec l'axe d'or horizontal(47) – sur lequel repose la main supérieure de l'ondine qui
pointe son doigt vers l'or –, axe lui-même tangent au cercle intérieur de
l'anneau.
La
construction d'ensemble est donc d'une géométrie et d'une simplicité parfaites. Un quadrillage régulier de la gravure en carrés
(se prolongeant hors du cadre de l'image) détermine les centres des deux
portions de cercles(48) ainsi que
l'emplacement de détails importants des figures(49) et l'occupation
spatiale de ces dernières. On observe par ailleurs que Fantin-Latour a prolongé
la partie sombre du récif situé en haut à droite jusqu'au bras inférieur de
l'ondine qui plonge, si bien que les deux portions de cercle constituant le S,
ainsi délimité par cet axe oblique virtuel – il passe par le point de tangence
des deux demi-cercles constituant le S –, font alterner l'ombre et la lumière,
ou le sombre et le clair en une sorte de balancement accordé aux mouvements
inversés des ondines.
Mais
d'où vient l'idée du schéma en S reliant entre elles les Filles du Rhin ?
Probablement, du motif ondoyant des Filles du Rhin qui ouvre la première scène
de l'opéra [Ex. 7].

Ex. 7. Motif des Filles du Rhin
Joyeuse, gracieuse,
vive et légère, cette entrée des Filles du Rhin sur un balancement rythmique
ternaire plein d'allant et un accompagnement aérien d'arpèges de violons (le
motif des Flots ondoyants) suggère à merveille les mouvements en tous sens des
Filles du Rhin jouant dans les flots. « Ce ne sont qu'enlacements, jeux,
taquineries » (50), écrit Christian Goubault.
En
observant plus attentivement ce motif, on constate, après une première mesure
où la mélodie est descendante – une mélodie qui « plonge » –, que
trois mesures s'enchainent dont les cellules mélodiques – très proches les unes
des autres par leur profil(51) et surmontées
chacune d'une liaison – dessinent dans l'espace trois S basculés à
l'horizontale s'élevant progressivement et imitant le mouvement des vagues que
les mots ou onomatopées du chant de Woglinde évoquent
parallèlement [Fig. 8]. Un même mouvement ondoyant caractérise donc le profil
mélodique de chacune des trois cellules ascendantes du motif des Filles du Rhin
et l'arabesque ascendante en forme de S régissant la composition des figures
dans la gravure. Aussi peut-on penser que la structure en S de la gravure
provient du mouvement ondoyant du motif des Filles du Rhin, ou mieux, de l'effet que ce motif a exercé sur la
sensibilité et l'imagination du peintre. Et sans doute n'est-il pas un hasard
si l'ondine située en début du parcours visuel plonge vers les profondeurs du Rhin, ses deux bras constituant un
arc de cercle, à l'image de Woglinde, au début de
l'opéra, qui débute son chant par un motif descendant tout en « nageant en
cercles gracieux ».

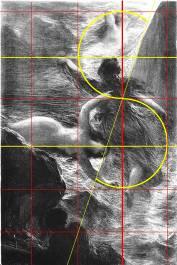
Ex. 8 et Fig. 8. Le motif des Filles du Rhin et la structure en S
Rappelons que
Fantin-Latour avait admiré à Bayreuth les « mouvements [parfaits] des
Filles qui nagent en chantant ». Dans sa gravure, une synchronicité
du même ordre se jouerait donc entre le visuel et le
sonore, c'est-à-dire entre l'arabesque verticale des ondines et le chant
des Filles du Rhin qui la sous-tend. La composition en S de l'image serait donc
issue des sensations éprouvées par le peintre lors du spectacle de Bayreuth,
mais sans doute aussi du texte du livret qui évoque en termes parfaitement
clairs « les Filles ondoyantes du Rhin » (52), ou encore
« les Filles du Rhin [qui] nagent en cercles gracieux » (53).
Ajoutons que le
motif des Filles du Rhin est l'un des plus récurrents de la première scène.
Après son exposition au tout début de l'opéra, il réapparait à quatre reprises
dans le second épisode où il accompagne les jeux, moqueries ou provocations des
ondines vis à vis du nain(54), puis au début du
quatrième épisode lorsqu'elles invitent Alberich à
venir « nager et jubiler » avec elles(55), et à la fin du
même épisode lorsqu'elles se moquent une dernière fois du nain tout en jouant
et riant(56), juste avant l'épisode dramatique
du rapt de l'or(57).
La forte présence
du motif des Filles du Rhin dans la première scène de l'opéra plaide aussi pour
l'idée que Fantin-Latour ait pu y trouver l'inspiration de la structure en S de
sa Scène première du Rheingold,
mais pas seulement. Sans doute a-t-il perçu simultanément dans cette forme
serpentine une signification symbolique en lien avec l'opéra, comme nous allons
tenter de le montrer maintenant.
De la structure plastique à la signification du
drame
« Transporter
une idée d'un art dans un autre »,
telle est l'une des principales tâches du traducteur selon Delacroix. Or, pour
l'artiste, le contenu et la forme – ou l'idée et la structure – sont
indissociables. Comme l'écrit Jacques Parrat :
« Le contenu ne préexiste pas à la forme. Le sens naît avec la forme » (58). Jean Molino, de son côté,
observe que « le schématisme sert à établir un pont entre l'intuition et
le concept et constitue ainsi une fonction intermédiaire entre la sensibilité
et l'entendement » (59). Il ne fait aucun
doute, en effet, que le schématisme propre à la structure plastique –
directement issu des effets de la
musique sur la sensibilité – possède conjointement une signification symbolique(60). Michel Imberty confirme
lui-même ce lien entre schème et symbole lorsqu'il déclare que « le
symbole musical, qu'il soit un de ces brefs éléments isolés par les travaux
musicologiques (motifs rythmiques, mélodiques, intervalles, accords…) ou qu'il
soit une forme plus complexe, tire sa signification d'une assimilation à un
schème » (61).
Mais tout d'abord,
de quelle forme, structure ou schème s'agit-il dans la gravure Scène première du Rheingold ?
Le schème en S doit-il être considéré indépendamment ou non de la structure
annulaire ? En réalité, les deux schémas s'emboitent l'un dans l'autre [Fig.
5] : le demi-cercle inférieur du S – dont le centre est situé plus
bas que celui de l'anneau mais sur la même verticale – est compris entre les
deux cercles concentriques de l'anneau : il est tangent, en bas, au cercle
le plus grand de l'anneau, et tangent, en haut, au cercle le plus petit de
l'anneau. Les deux structures (annulaire et serpentine) sont donc inséparables.
Comment la double
structure de l'image reliant le S à l'anneau [Fig. 7], issue de sensations
musicales, établit-elle alors un pont avec l'Idée poétique du drame wagnérien ?
En deux temps nous répondrons à cette question importante. Dans un premier
temps, nous chercherons à comprendre le lien entre la double structure de
l'image et les figures auxquelles elle sert de soubassement : quelle
signification cette double structure donne-t-elle au parcours des ondines dans
le contexte de l'Anneau du Nibelung ?
Dans un second temps, nous montrerons comment le symbolisme de la double
structure de l'image peut éclairer l'idée même du drame wagnérien.
1. De la double structure à la signification des
figures féminines de la lithographie
Sur le lien entre
la double structure et les figures féminines, nous avons déjà répondu
partiellement. En effet, le schéma en anneau enfermant les bras de l'ondine qui
plonge a permis de comprendre, précédemment, la signification des gestes de
cette même ondine : portant en quelque sorte l'anneau entre ses deux bras, elle
livre au nain l'objet de la Toute Puissance.
Mais à la structure
annulaire est reliée, en outre, par l'un de ses bras, Flosshilde,
l'ondine centrale de la gravure, dont il reste à comprendre la signification
dans ce nouveau contexte. Pour cela, un élément important de la structure doit
également être pris en compte : le sens de rotation des portions de
cercles auxquelles sont liés les mouvements des ondines. Comment le double sens
de rotation du S donne-t-il sens au parcours des ondines dans leur rapport au Ring ? C'est ce que nous allons tenter
de montrer dans un premier temps.
Située en bas de la
gravure, l'ondine qui plonge impulse à l'Anneau un mouvement s'effectuant dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'image même du motif musical qui
symbolise l'Anneau [Ex. 6]. Dans ce même sens évolue le demi-cercle inférieur
du S sur lequel repose le bras inférieur de cette ondine. Ce sens de rotation,
qui inverse le mouvement naturel, signifierait donc le détournement de l'or de
son milieu naturel. Rappelons que Platon, dans le mythe du Politique, avait
trouvé « la cause de la régression et des catastrophes cosmiques dans un
double mouvement de l'univers : tantôt la divinité guide sa révolution circulaire, tantôt elle l'abandonne à
lui-même et il recommence à tourner dans le sens opposé » (62).
Au centre de la
gravure, Flosshilde, dont un bras est inséré dans
l'anneau, se trouve à la jonction des deux courbes du S où le changement de
sens s'effectue. Dans un élan ascensionnel d'une puissante énergie, elle
entraine avec elle l'anneau dont elle interrompt le mouvement de rotation en
s'orientant dans le sens opposé avec une guirlande tenue entre ses deux mains. Flosshilde rétablirait donc le sens naturel de l'évolution,
qui est celui des aiguilles d'une montre, à l'image même du motif ascendant du
Rhin dont elle est l'expression [Ex. 1].
Dans le célèbre duo
de Wotan et Erda au début de l'acte III de Siegfried – une scène clé de la
Tétralogie(63) –, Wotan demande à Erda : « Comment arrêter une roue qui
tourne ? ». Dans la gravure, Flosshilde, en
changeant le sens de « la roue qui tourne » (l'anneau au centre de
l'image), accomplit, en quelque sorte, « l'acte rédempteur du monde »
qui, à la fin du Crépuscule des dieux,
revient à Brünnhilde qui se jette dans le brasier par
amour Siegfried avec l'anneau au doigt. Alors, les trois Filles du Rhin s'approchent
du rivage pour récupérer l'anneau, et « Flosshilde,
qui précède les autres [Woglinde et Wellgunde] […] brandit en l'air, avec allégresse, l'anneau
reconquis ». Dans la gravure Scène
première du Rheingold, Flosshilde
ne brandit pas l'anneau mais transporte entre ses mains une guirlande d'algues,
symbole d'une « vie sans limite » (64), qui pourrait
signifier que l'anneau a bien été dissous, comme l'a recommandé Brünnhilde(65), et que la vie
peut continuer, encore et toujours, éternellement.
Grâce à la
structure cachée de la gravure (le S jaillissant de l'anneau), on comprend donc
que Flosshilde n'est pas seulement reliée au début de
la Tétralogie (à la fois joueuse mais aussi chargée de veiller à l'or et responsable de ses deux sœurs), mais qu'elle est
avant tout en lien avec le contenu final du Ring,
lien grâce auquel l'image prend tout son sens.
Que Fantin-Latour
ait attribué à Flosshilde le rôle qu'elle joue dans
l'épilogue du Crépuscule des dieux,
cela n'étonne guère quand l'on sait que le motif des Filles du Rhin qui
construit la gravure, très présent dans la première scène du Rheingold(66), mais totalement absent des deux opéras
suivants – La Walkyrie et Siegfried –, réapparait en revanche par
trois fois à la fin du Crépuscule des
dieux. On l'entend d'abord seul, au tout début de l'épilogue instrumental,
lorsque la didascalie précise sur la partition que « Flosshilde, qui précède les autres [Woglinde
et Wellgunde] en nagant
vers le fond de la scène brandit en l'air, avec allégresse, l'anneau reconquis. »
Il est repris ensuite lorsqu'« on voit les Filles du Rhin nager en cercle
et jouer gaiement avec l'anneau sur les vagues apaisées du fleuve qui est peu à
peu rentré dans son lit. » Enfin on l'entend, une dernière fois, alors que
« le palais s'est écroulé ; par delà les décombres, les hommes et les
femmes, saisis d'une violente émotion, regardent l'incendie qui se propage dans
le ciel. »
Il n'aurait donc
pas échappé à Fantin-Latour que le motif des Filles du Rhin ouvre et clôt la
Tétralogie, et qu'une sorte de symétrie apparaît entre les scènes initiale et
finale : l'anneau livré en toute
inconscience au nain par les Filles du Rhin – acte à l'origine de tous les
malheurs qui vont se succéder au cours des quatre opéras –, est finalement
repris par les mêmes Filles du Rhin. Joyeuses au début, elles le seront de
nouveau à la fin lorsque l'or sera restitué au Rhin. Entre temps, le monde des
dieux s'est effondré, et la volonté de puissance a été remplacé
par l'amour.
C'est par la
glorification de l'Amour, en effet, que s'achève L'Anneau du Nibelung, grâce à un autre motif connu sous le nom de Rédemption par l'amour [Ex. 9], mais
intitulé par Wagner la Glorification de Brunnhilde(67). Pour Lavignac, « le chant radieux de la Rédemption par l'amour, devenant de plus
en plus éthéré […] vient planer au-dessus de tout, comme l'enivrant
et suave parfum qui s'exhale de l'âme pure de Brünnhilde,
comme l'épanouissement de son immense tendresse » et « plonge l'âme
attendrie […] dans un état de
contemplation surnaturelle » (68).

Ex. 9 : La Rédemption par
l'amour (La Walkyrie, acte III, scène
1)
Dans l'épilogue du Crépuscule des dieux, le motif de la Rédemption(69) se superpose au thème des Filles du Rhin lors des deux
dernières apparitions de celui-ci [Ex. 10], avant de clore, seul, le Crépuscule des dieux.


Ex. 10 : Les Filles du Rhin +
la Rédemption par l'amour (épilogue du Crépuscule
des dieux)
Au sommet de la
gravure, l'ondine qui plane, toute tendue vers la lumière de l'or, située dans
la boucle supérieure du S est orientée – de même que Flosshilde
et sa guirlande d'algues dont elle prolonge la courbe – dans le sens des
aiguilles d'une montre c'est-à-dire du mouvement naturel, tout comme le motif
de l'or [Ex. 2] auquel elle a été associée. Dans le contexte de la fin du Ring auquel est relié Flosshilde, l'ondine en extase, pourrait-elle incarner
alors la Glorification de l'amour
dont le motif est superposé à celui des Filles du Rhin ? Il suffit
d'écouter ce motif tout en contemplant l'ondine s'enivrant des rayons d'or pour
se rendre à l'évidence qu'il n'en est rien. L'image n'en conserve pas moins
toute sa cohérence puisque que le Ring
s'achève au moment où l'Or est enfin restitué au Rhin et que les ondines
peuvent de nouveau l'adorer. Si Wagner n'introduit pas dans sa partition, à la
fin du Ring, le motif de l'Or,
Fantin-Latour n'en achève pas moins le parcours de ses ondines dans l'éclatante
lumière de l'Or.
La mise en évidence
de la double structure supportant les figures de la gravure permet donc de découvrir
le lien secret établi par Fantin-Latour entre la scène première et la scène
finale de L'Anneau du Nibelung, et
comment il parvient, avec une simplicité déconcertante et une rare capacité
visionnaire et synthétique, à traduire l'essentiel du contenu de L'Anneau du Nibelung en un parcours
pleinement cohérent et unifié. Désormais, les trois étapes de l'action
dramatique incarnées par chacune des ondines résument parfaitement le drame :
d'abord la trahison inconsciente de l'ondine qui révèle au nain la toute-puissance
de l'or transformé en anneau (ce point de départ du drame a été saisi grâce à
la découverte de la structure annulaire) ; puis, la libération, par Flosshilde, de la malédiction due à l'anneau (signifiée par
le S jaillissant de l'anneau) ; enfin, l'Adoration de l'or après que le
précieux métal ait été restitué au Rhin. « Le mouvement en arche qui
traverse la Tétralogie, de l'anneau perdu à l'anneau restitué, de l'union
perdue avec la nature à l'unité retrouvée » (70), c'est donc cela
que Fantin-Latour aurait saisi dans l'œuvre monumentale de Wagner et qu'il
aurait cherché à restituer dans sa lithographie.
Que le dessein de
Fantin-Latour ait été de traduire tout l'Anneau
du Nibelung dans la seule gravure intitulée Scène première du Rheingold, cela ne
nous étonne guère lorsque l'on connaît l'ensemble de son œuvre plastique en
lien avec la musique(71). Sur un croquis
non daté du Cabinet des arts graphiques du Louvre (Album 4, RF 12674), il avait
noté lui-même : « Un seul tableau réunissant tout Tannhäuser ». Nous avons
nous-mêmes démontré comment il avait réuni dans la gravure du Ballet des Troyens tout l'opéra des Troyens à Carthage(72).
Dans la Scène première du Rheingold,
on peut le vérifier d'une autre façon encore. Nous avons vu précédemment que
Fantin-Latour avait lié l'expression des figures des trois ondines aux effets des motifs musicaux de l'Anneau,
du Rhin, et de l'Or, motifs dont les noms constituent le titre même de l'œuvre
wagnérienne : L'Or du Rhin,
Prologue de l'Anneau du Nibelung (dit
aussi le Ring). D'une manière particulièrement subtile, le projet du peintre est
ainsi confirmé : sous l'apparence du début de L'Or du Rhin, c'est l'essentiel du contenu dramatique de l'Anneau du Nibelung qui s'y trouve
condensé.
2. De la double structure de la lithographie à
l'essence de la Tétralogie
Si la double
structure de l'image dans sa relation aux figures féminines a permis de
comprendre la signification de la représentation figurée du peintre dans son
rapport à L'Anneau du Nibelung
(qu'elle synthétise), dans quelle mesure cette double structure révèle-t-elle
en outre l'essence de l'œuvre wagnérienne ?
Bien des
interprétations ont été données de L'Anneau
du Nibelung. On a de même « beaucoup glosé sur l'ultime page du Crépuscule des dieux » (73). Pour de nombreux commentateurs, « la
superposition des premier et dernier thèmes chantés indiquent que, désormais,
la boucle est bouclée » (74). C'est
l'interprétation de Pierre Boulez qui n'entrevoit « pas de fin réelle.
Départ et aboutissement sont identiques ; l'or a repris sa place, tout
peut recommencer. Et de conclure […] : "Le Ring ou l'éternel retour ?" » (75). Pourtant, grâce
au motif de la Rédemption qui clôt l'œuvre, il existe « une ouverture, une
échappée optimiste », soulignée par Serge Gut qui résume ainsi « le
sens profond de toute la Tétralogie : passer de la création du monde à sa
renaissance transfigurée grâce à l'amour » (76).
En réalité, grâce
au Journal de Cosima Wagner, on connaît la pensée même de Richard Wagner qui
semble avoir délibérément choisi de laisser le drame ouvert à de multiples
interprétations, tout en lui donnant une dimension universelle, voire cosmique,
surplombant les nombreux commentaires de l'œuvre(77). Pour le
compositeur, en effet, « il n'y a pas de fin pour la musique, elle est
comme la Genèse des choses ; elle peut toujours repartir au commencement,
se transformer en son contraire, mais au fond elle n'est jamais terminée » (78). L'idée de cycle et l'idée d'évolution infinie
semblent donc coexister pour Wagner, que ce soit dans la création musicale,
dans la création de la vie ou celle de l'univers – ce qu'il appelle « la genèse des
choses » (on pense au Prélude de
L'Or du Rhin associé à l'idée d'une
genèse) –, et c'est bien ce que signifie l'épilogue de L'Anneau du Nibelung, tendu qu'il est entre l'idée d'un
« éternel retour » engendrée par le rappel du motif des Filles du
Rhin et l'idée d'une « échappée optimiste » apportée par le motif
conclusif de la Rédemption par l'Amour.
La tension du
« clos » et de « l'ouvert » en tant qu'essence même de la
Tétralogie et de la Création dans toutes ses manifestations, c'est précisément
l'Idée que Fantin-Latour a signifié à
travers la double structure de sa gravure conjuguant l'anneau fermé sur
lui-même, symbole d'un mouvement cyclique qui sans cesse « repart au
commencement », et le S ouvert qui peut évoluer indéfiniment en « se
transformant en son contraire ».
D'après le Dictionnaire des symboles, la lettre S
« semble symboliser, comme la spirale, un mouvement d'unification, […]
c'est le symbole d'une unité de mouvement, qui met en relation des êtres, des
éléments, des niveaux différents, voire des foyers opposés. » (79) Et comme pour la spirale, « plusieurs interprètes
y voient aussi le symbole du double processus d'évolution et
d'involution », considérant en outre que cette signification rejoint celle
de la roue, c'est-à-dire « les cycles, les recommencements, les
renouvellements » (80). Ces diverses
acceptions du symbolisme du S qui intègrent la signification de la spirale et
de la roue (associée dans la gravure à l'anneau) s'accordent aux intentions
profondes de Wagner dans la Tétralogie, telles qu'elles ont été retranscrites
par Cosima dans son Journal.
La structure en S
entrevue par Fantin-Latour dans les quatre premières mesures de la première
scène de l'opéra suffirait donc à exprimer l'essence de la Tétralogie. La
remarque n'a rien de surprenant. Schoenberg l'affirme : « Il suffit
d'écouter un vers d'un poème, une mesure d'une pièce musicale, pour être à même
d'en appréhender la totalité » (81). C'est ainsi que
Fantin-Latour aurait saisi dans le motif initial de la scène première de L'Or du Rhin le germe de toute la
Tétralogie.
L'intuition de
Fantin-Latour peut trouver une justification dans le fait que la plupart des
motifs du Ring suggèrent, en se
répétant, des mouvements circulaires, voire spiralés : les uns, commençant
par une courbe ascendante, s'effectuent dans le sens des aiguilles d'une montre
– c'est le cas du motif originel du Rhin (associé dans la gravure à Flosshilde) –, les autres, débutant par une courbe
descendante, progressent dans le sens inverse – c'est le cas du motif de
l'Anneau (associé dans la gravure à Woglinde). La
cellule trois fois répétée du motif des Filles du Rhin qui combine deux mouvements
opposés – d'abord dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, ensuite dans
le sens même des aiguilles d'une montre – réaliserait en quelque sorte une
synthèse des motifs du Ring, ce qui
pourrait légitimer son rôle de « noyau central » des quatre opéras.
L'hypothèse ne
ferait que confirmer les propos de Pierre Boulez déclarant que l'
« une des conceptions les plus irréversibles de Wagner, plus encore que
son langage musical, c'est cette référence permanente de l'ensemble des parties
à un noyau central » (82). Le musicologue se
dit impressionné par un tel « sens de l'organisation de l'énorme
dimension » à partir de « l'élément le plus simple et le plus
neutre – sorte de plus petit commun dénominateur du motif » (83). Ce serait donc le processus créateur de Wagner
lui-même dans la Tétralogie(84) que Fantin-Latour
aurait saisi de manière toute intuitive et traduit dans sa gravure par un
schème géométrique d'une parfaite simplicité et d'une rare efficacité
symbolique.
Mais
est-il possible, à notre tour, de saisir le processus créateur du peintre dans
la Scène première du Rheingold
afin de découvrir le « sentiment particulier » que l'œuvre de Wagner
a éveillé en lui lors de la représentation à Bayreuth et qu'il « laissera
éclater » dans la peinture éponyme réalisée douze années plus tard ?
Comment la traduction de Fantin-Latour, d'abord fidèle aux effets et à l'idée de
l'œuvre wagnérienne, s'est-elle transformée progressivement, par quelques
subtiles modifications de forme et de structure, en une véritable création à
travers laquelle il est parvenu à exprimer son propre idéal ? La seconde
partie de notre article répondra à cette question dans le prochain numéro de la
Lettre d'Information de l'Éducation
musicale.
Michèle Barbe*.
*Michèle Barbe est Professeur émérite en musicologie de
l'Université Paris-Sorbonne où elle a fondé l'équipe de recherche « Musique et
arts plastiques » et dirige, depuis 1997, un séminaire doctoral et post-doctoral interuniversitaire (huit volumes d'actes ont
été publiés dans une collection de l'OMF). Elle est titulaire d'un doctorat
d'État sur Fantin-Latour et la musique. En
2001 et en 2008, elle a initié et organisé deux colloques internationaux dont
elle a ensuite dirigé la publication des actes (Musique et Arts plastiques : analogies et interférences, PUPS,
2006 ; et Musique et arts
plastiques : la traduction d'un art par l'autre. Principes théoriques et
démarches artistiques, L'Harmattan, 2011). À titre personnel, elle a publié
de nombreux articles sur les relations musique et peinture.
(1) Voir Roman Jakobsón, « Aspects
linguistiques de la traduction » [1959], Essai de linguistique générale, traduit de l'anglais et préfacé par
Nicolas Ruwett, t. 1, Les Fondations du langage, éditions de Minuit, 1963, p. 79. Roman Jakobsón y distingue la traduction intralinguistique, interlinguistique et intersémiotique.
(2) Pour Jean-Jacques Nattiez, par exemple, « il convient
très certainement de réserver le mot "traduction" au seul domaine
linguistique ». La Musique, les
images et les mots, éditions Fides, coll.
« Métissages », 2010, p. 13.
(3) Le mot "traduction" provient du
verbe traduire, dont l'origine est le verbe latin traducere :
« faire passer ». Le sens le plus courant est : « faire
passer un texte d'une langue à une autre ».
(4) Voir Jean-Jacques Nattiez, « Peut-on parler de
"traduction" entre musique et arts plastiques ? L'exemple de
Yves Gaucher », dans Michèle Barbe (dir.), Musique et arts plastiques. La traduction
d'un art par l'autre. Principes théoriques et démarches créatrices,
L'Harmattan, 2011, p. 199-206.
(5) Voir Laurence Le Diagon-Jacquin, « Proposition d'analyse comparée selon
Panofsky à travers quelques œuvres des xixe et xxe
siècles », dans ibid., p. 37-54.
(6) Roman Jakobsón, « Aspects
linguistiques de la traduction », art. cit., p. 79.
(7) Scène
du Tannhäuser, 1864, huile sur toile, 97,4 x 130,1 cm. Los Angeles County
Museum of Art.
(8) Voir « Nos artistes : le peintre Fantin-Latour à son atelier », L'Éclair, 14 mai 1892 : « Les wagnériens qui sont nés en
foule depuis la mort de Wagner, me déconcertent tant soit peu, moi qui ai aimé
Wagner et ai cherché à le traduire picturalement depuis 1864 ».
(9) Camille Mauclair, « Un entretien
avec Fantin-Latour », Servitude et
grandeur littéraire, Paris, Ollendorff, 1922, p.
156.
(10) Quatre lettres furent adressées à son ami Edmond Maître et
une à Scholderer après la dernière représentation.
(11) Lettre de Fantin-Latour à Scholderer,
Bayreuth, 30 août 1876, dans Correspondance
entre Henri Fantin-Latour et Otto Scholderer 1858-1902,
Paris, édition de la Maison des Sciences de l'homme, 2011, p. 251.
(12) Pour plus de précisions, voir notre thèse de doctorat d'État
: Fantin-Latour et la musique, tome
III, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 1992.
(13) Lettre de Fantin-Latour à Edmond Maître, 28 août 1876,
Bibliothèque municipale de Grenoble.
(14)En remplçant "langue étrangère" par "tâche », laphrase devient plus claire. Rappelons que le Dictionnaire des Beaux-Arts de Delacroix n'est qu'un projet et que sa
rédaction est restée inachevée.
(15) Eugène Delacroix, « Gravure », Dictionnaire des Beaux-Arts, 25 janvier 1857. Reconstitution et
édition par Anne Larue, Paris, Hermann, 1996, p. 107. C'est nous qui
soulignons.
(16) Voir à ce propos Catherine Kintzler, "Entrer dans la pensée du peintre" : études sur Coypel, de Troy et David", Peinture et musique : penser la vision, penser l'audition, Villeneuve
d'Ascq,
Presses Universitaires du Septentrion, 2002, p. 55 sq.
(17) Walter Benjamin, « La tâche du traducteur », Œuvres, t. I [1972], Paris,
Gallimard, coll. « Folio/Essais », trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz, P. Rusch, 2000, p. 244-262.
(18) Catherine Clément, « L'Anneau raconté à… », L'Avant-Scène Opéra : Numéro spécial
Wagner. L'Anneau du Nibelung. L'Or du Rhin, nos 6-7, nov.-décembre 1976, p. 34 : « La
musique est comme l'inconscient de la parole, lui joue des tours, forme une
autre ligne, trace des ponts, des arcs-en-ciel jusqu'à un point du passé,
cligne de l'œil vers l'avenir. »
(19) Voir Delacroix, "Intérêt", Dictionnaire des Beaux-Arts, 6-8 février 1857, op. cit., p. 119 : On ne peut émouvoir qu'un sujet doué de sensibilité et d'imagination. Ces deux facultés sont aussi indispensables au spectateur et à l'artiste, quoique dans une mesure différente."
(20) Voir Paul Ricœur, « L'expérience esthétique
», La Critique et la conviction. Entretien
avec François Azouvi et Marc de Launay, Calmann-Lévy,
1995, p. 270.
(21) Pierre Lemarquis, L'Empathie esthétique. Entre Mozart et
Michel-Ange, Paris, Odile Jacob, 2015, p. 16.
(22) La première partie de notre article est une version revue,
corrigée et augmentée d'un précédent article : « La
scène première du Rheingold :
une vision de Fantin-Latour », Analyse
Musicale n° 70, Anniversaires Wagner–Verdi, avril 2013,
p. 114-126. La seconde
partie, qui sera publiée dans le prochain numéro de l'Éducation musicale, est entièrement nouvelle.
(23) Scène première du Rheingold, 1876, lithographie (crayon, grattoir et estompe, sur papier vélin brun clair) : 51,2 x 33,7 cm (comp.), s.d.b.d. : « Fantin 76 », inscr. en h. dans la marge « Rheingold, Richard Wagner », inscr. au bas dansla marge : « A Monsieur A. Lascoux / Souvenir de Bayreuth », Harvard Art Museum, Deknatel Purchase Fund, M.15592. http://www.harvardartmuseums.org/art/265276.
À noter que « la lithographie fut imprimée sur des papiers de nuances
différentes, allant du brun au bleu et au blanc » afin de suggérer
« la montée dramatique, au fur et à mesure que le théâtre
s'illumine ». Voir Douglas Druick et Michel Hoog (dir.), Fantin-Latour, Paris, éditions de la réunion des musées nationaux,
1982, p. 277.
(24) Scène première du Rheingold (L'Or du Rhin), 1988, huile sur toile, 116,5 x 79 cm, s.b.g. : "Fantin", Hambourg, Kunsthalle (5274).
(25) Jean-Jacques Nattiez, Musicologie
générale et sémiologie, Paris, Bourgois, 1987.
(26) https://fr.wikipedia.org/wiki/Der_Ring_des_Nibelungen
(27) On
peut se faire une idée des décors du Ring
grâce aux esquisses de Joseph Hoffmann (1831-1904) qu'il avait réalisées
parallèlement : dix-sept grandes aquarelles dont quatorze seront publiées en
1876 sous la forme de photographies en noir et blanc.
(28) Christian Goubault,
« Guide d'écoute », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Prologue. L'Or du Rhin, n°227, Paris, ditions Premières Loges, 2005, p. 21-35. La traduction française est de Françoise Ferlan.
Toutes les citations de cette partie proviennent de la traduction de Françoise Ferlan.
(29) Ce résumé provient d'un manuscrit de Michel Guiomar.
(30) À rapprocher du temps poétique selon Bachelard, dans
« Instant poétique et instant métaphysique », Le droit de rêver, Paris, PUF, 1973, p. 224-225 : « C'est
pour construire un instant complexe, pour nouer sur cet instant des
simultanéités nombreuses que le poète détruit la continuité simple du temps
enchaîné. […] le temps de la poésie est vertical. »
(31) Kandinsky, « Point-Ligne-Plan » (Punk und Linie zu Fläche, München, Albert Langen, 1926), Écrits complets II, traduction française
de Suzanne et Jena Leppien, Paris, Denoël, 1970, p.
69.
(32) Voir Douglas Druick et Michel Hoog (dir.), Fantin-Latour, op. cit., p. 277 : « Fantin érafla hardiment la surface de l'estampe, au moyen
de son grattoir, pour suggérer le mouvement de l'eau et la lumière dansante au
fond de la rivière […] ».
(33) Voir Christian Goubault, « Guide d'écoute », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Prologue. L'Or du Rhin, n° 227, art. cit., p. 30.
(34) Ibid.
(35) Ibid.
(36)
(37) André Boucourechliev, "Commentaire littéraire et musical", L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Prologue. L'Or du Rhin, n° 6/7, Paris, éditions Premières Loges, nouvelle édition, novembre 1992, p. 54.
Boucourechliev souligne que « chant
et orchestre sont ici – comme rarement – à l'unisson ».
(38) À noter que l'Anneau prend encore d'autres aspects dans la
suite de l'opéra, « selon que sa 9e est mineure ou majeure,
jouée avec ou sans fondamentale, sur pédale de tonique ou non ». Voir
Christian Goubault, « Guide d'écoute », . Troisième Journée. Le Crépuscule
des dieux, n°230,
2006, art. cit., p.
13.
(39) Cité dans Christian
Goubault, « Guide d'écoute », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. L'Or du Rhin, n°227, art. cit., p. 32.
(40) Le centre du cercle se situe à l'intersection de la verticale
passant exactement entre le talon de Flosshilde et
l'extrémité des doigts de celle qui plonge et de l'horizontale passant par la
pointe du sein de cette dernière.
(41) Lettre de Mallarmé à Fantin-Latour, 5 février 1877. Cité dans Douglas Druick
et Michel Hoog (dir.), Fantin-Latour, op. cit.,
(42) Lettre de Fantin-Latour à Whistler, octobre 1862
(Bibliothèque municipale de Grenoble) : « Arrangement, disposition,
composition etc., mots mystérieux, lois harmonieuses, nullement de convention,
besoin de l'artiste [...] une affaire de sentiment qui doit être pourtant une
loi, une chose mathématique, comme la forme, la lumière, la couleur [...] mettre
sur un petit espace une image avec toutes les forces de la nature, tous les
principes de la nature... je ne peux plus dire ce que je veux dire, ah ! la plume ne sert que les gens qui ont des banalités à
dire ».
(43) Ibid,
10 novembre 1862 : « Ce que je cherche c'est faire bien, ce bien de
quelques grands artistes [...] cette beauté qui est de tous les temps, de tous
les pays, cette mystérieuse harmonie, ces rapports, deux tons mis à côté qui
produisent un tout vrai, beau, complet, il ne peut y avoir rien de changé [...]
c'est mathématique, c'est deux et deux qui font quatre ».
(44) Pierre Boulez, Penser
la musique aujourd'hui, Paris, Gallimard, 1987, p. 14.
(45) Paul Klee, "Credo du créateur", Théorie de l'art moderne, Bâle, 1920, réed. Genève,
Bibliothèque Médiations, Denoël/Gonthier, trad. P.-H. Gonthier, 1982, p.38.
(46) Ibid.
(47) Précisons que les peintres obtiennent généralement la
division d'or – et c'est le cas de Fantin – par le
rapport 5/8, ce qui équivaut à 1,6 au lieu de 1,618 pour le calcul du nombre
d'or. L'axe d'or horizontal est donc situé aux 5/8 de la hauteur.
(48) Pour le centre du cercle inférieur, l'horizontale qui coupe
la verticale principale passe à la limite d'une ombre située sur le flanc droit
de l'ondine qui plonge. Pour le centre du cercle supérieur, l'horizontale qui
coupe la verticale principale passe au sommet de la main gauche et de la tête
de Flosshilde.
(49) Ainsi pour le talon de Flosshilde,
pour le sommet de la tête de l'ondine supérieure, ou encore pour l'avant-bras
supérieur de l'ondine qui plonge, l'extrémité de ses doigts de la main
inférieure, etc.
(50) Christian Goubault,
« Guide d'écoute », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. L'Or du Rhin, n°227, art. cit., p. 20.
(51) Fantin-Latour ne tient pas compte des intervalles exacts
entre les sons de chacune des cellules mélodiques. Seule importe l'énergie
directionnelle du son
(52) Dans le dernier grand monologue de Brunnhilde
à la fin du Crépuscule des dieux.
(53) Dans l'épilogue instrumental du Crépuscule des dieux, lorsque les ondines reprennent leurs jeux
après avoir reconquis l'anneau.
(54) Voir Richard Wagner, Das Rheingold, Partitura,
Budapest, éd. Könemann Music Budapest, 1994. Le motif
des Filles du Rhin soutient les « Wallala ! »
des Filles du Rhin, p. 40 (mes. 285-291), puis p. 41-42 (mes. 305-312). Il
réapparait lorsqu'Alberich cherche désespérément à
attraper les ondines, p. 44 (mes. 337-340), puis p. 45 (mes. 355-358).
(55) Le motif des Filles du Rhin précède de nouveau les « Walala ! » p. 59-60 (mes. 451-453). Ibid.
(56) Il précède encore les « Walala ! »,
p. 67 (mes. 507-509). Ibid.
(57) Dans la suite de L'Or
du Rhin, ce même motif revient deux fois dans la scène 2. Il accompagne
d'abord les paroles de Loge revenant sur les événements de la première
scène : « Alberich le sombre / brigua en
vain les faveurs des baigneuses » ; il accompagne plus loin les
paroles de Fricka après que Loge ait rappelé à Wotan
que les Filles du Rhin l'implorent pour que l'or leur soit restitué : « Je
ne veux rien savoir / de ces Filles des eaux : / que d'hommes déjà / –
pour mon chagrin – / n'ont-elles pas séduits dans les ondes ». Mais il est
totalement absent des scènes 3 et 4.
(58) Jacques Parrat, Des relations entre la peinture et la musique dans l'art contemporain,
Nice, Z'éditions, 1994, p. 46.
(59) Jean Molino, « Les fondements
symboliques de l'expérience esthétique et l'analyse comparée
musique-poésie-peinture », Analyse
Musicale 4, Paris, Société française d'analyse musicale, juin 1986,
p. 13.
(60) Michel Imberty, Entendre la musique. Sémantique
psychologique de la musique, Paris, Dunod,
p. 28.
(61) Ibid., p. 29.
(62) Voir Jean Azouvi, "Les Origines mythiques du personnage de Wotan", L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. L'Or du Rhin, nos 6/7, 1976, op.cit., p.176..
(63) Fantin-Latour a gravé la première version de l'Évocation d'Erda
la même année que la Scène première du Rheingold, à son retour de Bayreuth. Il réalisera en
tout quatre gravures sur ce même sujet (en 1876, 1885, 1885, 1886).
(64) Voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant
(dir.), « algue », Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, 1969, réed. 1982, p. 24 : « Plongée
dans l'élément marin, réservoir de vie, l'algue symbolise une vie sans limite
et que rien ne peut anéantir, la vie élémentaire, la nourriture
primordiale ».
(65) Brünnhilde a donné préalablement un
dernier conseil aux Filles du Rhin : « O sages sœurs des eaux profondes,
filles ondoyantes du Rhin, je vous
dois un conseil loyal. Ce que vous désirez, je vous le donne : venez le
prendre dans mes cendres ! Que le feu qui me consumera purifie l'anneau
maudit ! Vous, dans les flots, dissolvez-le et gardez pur l'or lumineux
dont le vol fit des désastres. »
(66) Rappelons que dans L'Or
du Rhin, ce thème revient deux autres fois dans la scène 2.
(67) John Deathridge, « Légende de
deux héros. À propos de la difficile naissance du Ring », trad. Josée Bégaud, L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Prologue. L'Or du Rhin, n osnovembre 1992,
op. cit.,
p. 21.
(68) Albert Lavignac, Le Voyage artistique à Bayreuth [1951],
Genève, Minkoff reprint, 1973, p. 434-435.
(69) Le motif dit de la Rédemption par l'amour n'avait été entendu
qu'au troisième acte de La Walkyrie,
lorsque Sieglinde apprenait, grâce à Brünnhilde, qu'elle portait Siegfried en son sein, puis
juste avant l'épilogue du Crépuscule des
dieux, à la fin du grand monologue de Brünnhilde
lorsque celle-ci s'élance dans le brasier.
(70) Jean-Jacques Nattiez, « La Tétralogie de Wagner », La Musique, les images et les mots,
éditions Fides, coll. « Métissages », 2010,
p. 165.
(71) On peut s'étonner du titre Scène première du Rheingold donné à cette
gravure. En effet, dans la marge de la lithographie originale [Fig. 1],
Fantin-Latour n'a inscrit que les mots : « Rheingold, Richard Wagner ».
Tout en indiquant la source de l'image, « Rheingold » laisse une
certaine liberté d'interprétation au spectateur.
(72) « Le ballet des Troyens
ou le drame de Didon : une interprétation gravée de Fantin-Latour »,
dans Ostinato Rigore.
Revue internationale d'études musicales n° 23/04 : Jean-Sébastien
Bach et ses fils, Paris, Jean-Michel Place, 2004, p. 173-206.
(73) André Boucourechliev, « Commentaire littéraire et
musical », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Troisième
Journée. Le Crépuscule des dieux, nos
16/17, Paris, éditions Premières Loges, 1993, p. 118.
(74) Serge Gut, « Les difficultés d'interprétation sémantique
du finale du Crépuscule des dieux »,
Revue française de Musicologie, 1997,
83/1, p. 61-63.
(75) Christian Goubault, « Guide d'écoute
», L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Troisième
Journée. Le Crépuscule des dieux, n° 230, art. cit., p. 98.
(76) Ibid., p. 96.
(77) Pour les différentes interprétations de la fin du Ring, voir Christian Goubault,
« Guide d'écoute », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Troisième
Journée. Le Crépuscule des dieux, n° 230, art. cit., p. 11-12 et p.
96-98..
(78) Cosima Wagner, Journal
I (1869-1872), 23 juillet 1872, Paris, Gallimard, 1977, p. 265. Cité dans
Christian Goubault, « Guide d'écoute », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Troisième
Journée. Le Crépuscule des dieux, n° 230, art. cit., p. 96.
(79) Voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant (dir.) « S », Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 836..
(80) Ibid. pour
« spirale » et « roue », p. 908 et p. 826.
(81) Arnold Schoenberg, « La relation avec le texte »,
dans Wassily Kandinsky et Franz Marc, L'Almanach du Blaue
Reiter, Paris, Klincksieck,
1981, p. 134.
(82) Pierre Boulez, Par
volonté et par hasard, entretiens avec Célestin Deliège,
Paris, éditions du Seuil, 1975, p. 66.
(83) Pierre Boulez cité par André Boucourechliev,
« Commentaire littéraire et musical », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Troisième
Journée. Le Crépuscule des dieux, nos
16/17, 1993, op. cit., p. 120. André
Boucourechliev évoque également ce va-et-vient constant « entre le
microcosme obsessionnel et le macrocosme ivre d'infini, entre la cellule et la
totalité ».
(84) Cela confirme les propos de Nattiez pour qui le passage des
arts plastiques à la musique doit être cherché « en termes de saisie des
principes créateurs – les principes poïétiques – que le peintre perçoit chez le
compositeur en l'écoutant […] ». Jean-Jacques Nattiez, La Musique, les images et les mots, op. cit., p. 72.
***
PROPOS PARTAGÉS
Helga Rabl-Stadler, Présidente
du Festival de
Salzbourg
Madame Helga Rabl-Stadler
est Présidente du Festival de Salzbourg depuis 1995. La carrière éclectique de
cette salzbourgeoise la prédestinait-elle à occuper ce poste ? Sans doute, elle
qui fut journaliste, femme politique, puis a fréquenté le monde économique
jusqu'à devenir Présidente de la chambre de commerce de sa ville, et bien sûr
le monde culturel. Quelle est la fonction du Président d'un festival de musique
tel que celui de Salzbourg ? Assurer l'interface entre le secteur artistique –
du ressort de l'Intendant - et les financeurs, institutionnels et sponsors.
Mais bien plus que cela lorsqu'on connait l'engagement et l'enthousiasme de son
actuelle détentrice. Elle a connu six directeurs artistiques et depuis le
départ prématuré d'Alexander Pereira, assure également cette mission avec
Sven-Eric Bechtolf. Mémoire du festival, pas un
détail ne lui échappe. Sa position est essentielle quant à la pérennité d'une
des plus grandes institutions musicales au monde, visitée par un public venu
des quatre coins de la planète. Elle nous a reçu avec sa cordialité habituelle,
et en français, dans son bureau du Grosses Festspielhaus,
un matin de janvier : hors du stress de la période estivale, alors que la ville
privée de ses hordes de touristes, connait un délicieux ralenti et écoute avec
bonheur les effluves d'un autre festival, celui de la Semaine Mozart.

©Salzburger Festspiele/Andreas Kolarik
Quelle
est selon vous la vraie mission d'un festival comme celui de Salzbourg ?
Je suis infiniment redevable aux créateurs
du Festival, Hugo von Hofmannsthal et Max Reinhardt,
d'avoir eu l'idée qui nous semble presque folle aujourd'hui de créer un
festival, alors que la Première Guerre mondiale battait encore son plein. Ils
étaient persuadés que la compréhension de l'art et l'amour partagé pour toutes
ses formes étaient seuls capables de réunir les peuples européens déchirés par
la guerre. Lorsque l'idée a germé, en 1918, Salzburg était pauvre. Aussi l'idée
qu'un festival de musique pouvait changer les choses, réconcilier les peuples,
cela était aussi inouï qu'évident. C'est Hugo von
Hofmannsthal qui a dit :
« Le Palais du Festival de
Salzbourg est un symbole. Ce n'est pas la création d'un nouveau théâtre ni le
projet de rêveurs fantasmagoriques, et encore moins l'initiative locale d'une
ville de province. C'est une affaire de culture européenne qui revêt une
signification éminemment politique, économique et sociale.»
Et
Max Reinhardt d'ajouter :
« Je crois que Salzbourg, de par sa
merveilleuse situation au centre de l'Europe, la richesse de ses paysages et de
son architecture, ses particularités et ses souvenirs historiques, mais avant
tout aussi grâce à sa virginité intacte, est appelée à devenir un lieu de
pèlerinage pour d'innombrables personnes qui aspirent à trouver la rédemption
dans l'art, après avoir vécu tant d'abominations sanglantes à notre époque.
C'est cette guerre elle-même qui nous a prouvé que le théâtre n'est pas un luxe
pour les riches et les nantis, mais une denrée alimentaire indispensable à tout
un chacun... Jamais auparavant le théâtre n'a vu sa dignité, souvent mise en
doute, confrontée à un problème plus crucial, et jamais il n'a surmonté une
épreuve de manière plus honorable. Après la guerre, son rôle ne sera pas
moindre, surtout si l'on est en droit de croire que la gravité continuera
encore longtemps à marquer les traits de l'avenir. »
Vous vous demandez pourquoi je cite si
souvent Reinhardt et Hofmannsthal ?
Parce que c'est à leur foi imperturbable en la puissance de l'art et en la
capacité de la ville de Salzbourg que le Festival doit son existence. C'est la
raison pour laquelle j'ajouterai cette autre prière de Reinhardt : « Les
meilleurs ne doivent pas être présents seulement sur scène mais également dans
la salle, afin que se produise le miracle suprême que le théâtre est capable
d'opérer lors de soirées fastes ». Cette exigence de qualité est mon
credo. Le projet dramaturgique, qu'il s'agisse d'opéra ou de théâtre, doit être
sous tendu par la volonté de donner le meilleur.
La mission pacifique de l'art est
intemporelle. C'est dire si le Festival de Salzbourg est autre chose qu'un
évènement purement touristique, mais bien une affaire de culture européenne.
C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les ans Daniel Barenboim et son West Eastern
Divan Orchestra, ambassadeurs de paix. C'est aussi pour cela que nous
invitons les jeunes de Il Sistema du Venezuela, porteurs de cet autre projet
culturel vivifiant. Nous donnons en 2016 West
Side Story avec le Simón
Bolívar Orchestra.
Ce qui distingue le Festival de Salzbourg
de celui de Bayreuth par exemple, c'est que contrairement à ce dernier avec
Wagner, Mozart n'est pas le seul musicien à y être honoré. Les plus grands
compositeurs de la musique le sont ici. Cela peut se révéler à la fois plus
difficile et aussi plus facile : plus difficile car le spectre étant plus
étendu, il faut réunir beaucoup d'atouts en termes de régisseurs, d'interprètes
musiciens, de chanteurs, etc.. Mais c'est peut-être
finalement plus facile car on peut avoir les coudées franches pour aller dans
plusieurs directions.
Compte-tenu de votre grande expérience
comme Présidente, quelles sont pour vous les grandes évolutions du festival au
cours de ces années ?
Le mot d'évolution que vous dites est
juste : les vingt dernières années ont été marquées plus par des
évolutions que par des révolutions, malgré les divers changements de direction
artistique. J'aimerais souligner deux grands sujets. Le Festival de Salzbourg
s'est internationalisé, comme ses initiateurs le souhaitaient il y a 100 ans.
Nous accueillons un public venu de plus de 70 pays, dont 35 sont situés hors de
l'Europe. Cela revient à dire que la musique est pour nous le seul langage qui
ne connaisse pas de frontières. Nous voulons persévérer sur cette voie et
ouvrir l'Asie à la musique européenne. La seconde tendance qui me semble
primordiale réside dans le fait que la musique contemporaine est toujours plus
recherchée par le public. On est bien loin de la boutade de Pierre Boulez
disant que le malheur de la musique contemporaine c'est qu'on la joue une fois
et plus jamais ensuite. La permanence de la création, à l'opéra comme au
concert, est une donnée essentielle pour le festival. Et les choses ont bien
changé depuis l'ère Karajan qui ne vit que quelques rares créations. L'opéra
contemporain, The exterminating Angel de
Thomas Adès, que nous avons programmé cette année
sciemment au début du Festival, nous semble donner un signal important : le
Festival n'est pas un musée de l'art lyrique mais une scène ouverte aux
principaux flux et interprétations dans les domaines de l'opéra ; comme il en
va également du concert et du théâtre. L'empreinte de Gérard Mortier a été
essentielle. De nouvelles tendances se sont faites jour aussi dans le domaine
des concerts.
Dans
la conception des programmes de musique de chambre ?
Bien sûr. Mais également dans d'autres
voies. Je veux parler en particulier de l'Ouverture spirituelle qui
marque le début du festival et ce depuis maintenant cinq ans. Je suis
particulièrement reconnaissante à Alexander Pereira de l'avoir pensée. Ce
regard porté sur d'autres musiques que la musique européenne est passionnant et
essentiel, qui permet de juxtaposer aussi les religions. Cette année ce sera la
religion orthodoxe et la musique sacrée des Chrétiens de l'Orient.
Cela
sera-t-il continué dans le futur ?
Absolument. Cette voie sera poursuivie par
le nouvel Intendant qui prendra ses fonctions en 2017, Markus Hinterhäuser.
Quels sont les chefs d'orchestre qui ont
selon vous imprimé leur marque sur le festival ?
La personnalité dominante de l'histoire du
Festival, en tant que chef d'orchestre, c'est naturellement Herbert von Karajan, qui a dominé le Festival de 1957 à 1989.
Riccardo Muti est lui aussi incomparable, il écrit
l'histoire du Festival depuis plus de 40 ans et ses interprétations de Giuseppe
Verdi sont uniques.
Le
reverra-t-on diriger une nouvelle production d'opéra ?
Oui, c'est prévu dans un avenir très
proche. Je ne peux pas encore dévoiler le titre de l'opéra. Mais Verdi est sans
doute un compositeur envisagé...
Dans le domaine des concerts, il y a toute
une série de personnalités qui ont réalisé avec nous ce que Nikolaus
Harnoncourt a exprimé en ces termes : « Si le public ne sort pas
métamorphosé d'une représentation, c'est que nous autres, artistes, n'étions
pas bons. » A propos de ce grand chef, son retrait de la vie musicale me
cause beaucoup de chagrin et laisse un grand vide, non seulement comme musicien
mais aussi comme personnalité et comme pédagogue. Nous avons eu beaucoup de
très bons chefs d'orchestre. Depuis que je suis Présidente, cela va de Sir
Georg Solti, Claudio Abbado, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel jusqu'à Yannick Nézet-Séguin.

Quels
sont les régisseurs qui ont marqué dans l'histoire récente du festival ?
En ma qualité de Présidente, il serait
injuste et dangereux de nommer un ou une artiste plus que l'autre. Car c'est la
diversité des personnalités hors pair qui fait la réputation mondiale du
Festival de Salzbourg. D'un point de vue tout à fait personnel, je peux citer
quelques productions : le Don Carlo
de Herbert Wernicke, La Traviata de Willi Decker,
Le nozze di
Figaro dans la mise en scène de Claus Guth et le
merveilleux Chevalier à la Rose de
Harry Kupfer, l'une des plus réussies des nombreuses
productions données au festival de cet opéra de Strauss. Et bien sûr encore Saint
François d'Assise d'Olivier Messiaen, dans la régie de Peter Sellars.
Y a-t-il une ou des œuvres (opéra, théâtre)
que vous aimeriez voir représenter au festival ?
Comme Présidente, j'ai la chance de pouvoir
exposer mes souhaits personnels lors des discussions autour des programmes.
Reste à savoir s'ils peuvent être réalisés...
Un
regret peut-être...
De
ne pas avoir vu monter Intermezzo de Richard Strauss.
Dans votre rôle de Présidente, avez-vous dû
faire des choix entre les propositions d'un directeur artistique et les
contraintes budgétaires ?
Les différents directeurs artistiques avec
lesquels vous soulignez que j'ai travaillé - et non pas auxquels j'ai survécu,
comme le disent certains commentateurs - m'ont beaucoup apporté. J'ai essayé de
maintenir une continuité dans l'excellence. Les directeurs artistiques ont
toujours beaucoup plus d'idées que ce que nous pouvons vraiment concrétiser.
C'est positif et difficile à la fois. Et c'est aussi la raison pour laquelle je
suis toujours à la recherche de nouveaux sponsors de projets. Motiver les sponsors est l'une
de mes missions et ils répondent favorablement.
Décèle-t-on une influence de leur part sur
la programamtion, comme il a pu en être
au Met de New York ?
Non, il n'y a pas
ici de dépendance par rapport aux sponsors
généraux ou de projets et ils n'ont pas d'influence
sur la programmation.
Pouvez-vous
nous dire quelques mots du programme 2016 ?
Il est impossible de parler dans une
interview d'un programme comportant 192 représentations données sur 41 jours,
et dans 14 lieux différents ! C'est pourquoi je
voudrais ne dire que quelques mots sur l'opéra. Il faut absolument aller
voir l'opéra commandé par le Festival à Thomas Adès.
Je crois vraiment que l'on peut considérer ce compositeur anglais comme le
Benjamin Britten de notre temps. On a par ailleurs du mal à croire que Faust de Gounod n'ait jamais été mis en
scène au Festival de Salzbourg ! Nous le proposons en 2016 avec deux de
mes chanteurs préférés − Piotr Beczala
(Faust) et Ildar Abdrazakov
(Méphistophélès). Comme vous le remarquez, le répertoire français est à l'honneur
durant cette édition, car il y aura aussi une version de concert ce Thaïs de
Massenet avec Placido Domingo et Sonya
Yoncheva. Enfin, il ne faut en aucun cas manquer L'Amour de Danaé, cet opéra de Richard
Strauss qui a marqué l'histoire du Festival. Il a été écrit de 1938 à 1942 et
devait être créé en 1944. Il n'y eut alors qu'une répétition générale dirigée
par Clemens Krauss. A la fin de la représentation,
Richard Strauss présent et ému, prit congé de tous et leur dit son espérance de
les revoir dans un monde meilleur. On sait ce qu'il advint. L'opéra ne fut créé
qu'au festival de 1952. Il n'a depuis été donné qu'une fois en 2002, sur le
choix de l'intendant Peter Ruzicka. Cette année, Krassimira
Stoyanova, notre merveilleuse Maréchale du Rosenkavalier de 2014/2015, chantera le rôle titre. Et
l'œuvre sera dirigée par Franz Welser-Möst, un chef
naturel pour jouer la musique de Strauss. On donnera aussi la trilogie Da Ponte
des opéras de Mozart, montés ces trois dernières années, car 2016 est un
millésime connoté pour Mozart. A cette occasion, la mise en scène de Sven-Eric Bechtolf de Così fan
tutte sera revue pour être adaptée à la Felsenreischule.
Une entorse à la volonté de donner les
opéras de Mozart dans la Haus für
Mozart...
Oui, mais des contingences de programmation
nous ont conduit à cette solution. De toutes façons,
jouer dans la Felsenreitschule est toujours une
expérience enrichissante car ce lieu scénique est unique en son genre.
Qu'en
est-il du développement du programme pour les jeunes ?
En ce qui concerne le programme pour les
enfants et les adolescents, nous proposons à nouveau un opéra pour nos jeunes
amateurs de musique. Cette année, ce sera La
Reine des Fées, d'après The Fairy Queen de Henry Purcell,
un spectacle entièrement conçu par et pour les jeunes, qu'ils joueront dans le
cadre du Young Singers Project. Ce qui passe par des
ateliers de préparation en amont, comme '' Spiel und Spass mit Purcell'' (Jouons
et rions avec Purcell). Il y a de nombreuses autres manifestations dans ce
cadre. Par exemple pour les jeunes de 15 ans, des camps d'opéra, qui seront au
nombre de quatre, autour de L'amour de Danaé, de Don Giovanni,
des Nozze di Figaro et de Faust. Autre
programme : le ''Roche Continents Youth! Arts!
Sciences!'' est un séminaire pour 100 étudiants qui ne sont pas familiarisés
avec la musique. Ils seront au cœur du programme du Salzburg contemporary de musique contemporaine. Les étudiants se
voient aussi proposer des abonnements spécifiques à prix réduits pour les
opéras et concerts du festival.

Les propositions sont, comme vous le
remarquez, plus nombreuses cette année. Elles répondent à une réelle demande.
Nous nous sommes aperçus que deux constats se sont révélés
des idées fausses. D'abord, celui selon lequel les jeunes sont en vacances en
juillet/août ; ce qui est inexact : ils ne le sont pas tous ! Et cet autre qui
veut que le public vienne à Salzbourg sans ses enfants. Au contraire, nous
avons constaté que parmi le public, nombreux sont ceux venant à Salzbourg en
famille avec leurs enfants. Ils sont ravis que des activités de musique leur
soient proposées.
Enfin un mot du « Nestlé and Salzburg
Festival Young Conductors Awards »
qui en est à sa septième année. Un de ses lauréats, en 2014, a été le français
Maxime Pascal.
Propos recueillis
par Jean-Pierre Robert.
***
FESTIVALS!
LA SEMAINE MOZART
DE SALZBOURG

©Salzburg Turismus
Pour leur avant dernière programmation,
Marc Minkowski et Matthias Schulz auront offert une Semaine Mozart de
haute volée. Ce ne fut pas sans son lot d'imprévus, car une cascade d'annulations
s'était invitée à la fête, paraissant troubler le bel ordonnancement : le grand
âge, cause du retrait du chef Nikolaus Harnoncourt et du pianiste Menahem Pressler, la force majeure à l'origine de celui du ténor
Ian Bostridge mais aussi de deux quatuors, le Quatuor
Ebène dont trois des membres étaient sur le flanc, et le Hagen Quartet, son
altiste Veronika souffrant d'un malencontreux mal
d'épaule... Leurs remplaçants propulsaient de nouveaux talents comme le
pianiste prodige Kit Amstrong, le chef espagnol Pablo
Heras Casado, ou confirmaient des valeurs sûres : le
Quatuor Sine nomine ou le Elias Quartett. Comme déjà constaté les éditions précédentes, l'atmosphère qui règne
durant cette manifestation hivernale est tout sauf froide et en même temps fort
recueillie : les séances de sonates de Mozart ou la fameuse trilogie autour de Acis
et Galathée ont révélé un public extraordinairement concentré. Cette
dernière soirée réunissant Haendel, Mozart et Mendelssohn était au cœur du
programme concocté par Marc Minkowski. Plus largement, et aux côtés de Mozart,
une large place était faite à Mendelssohn, le « Mozart de Hambourg »,
et à Henri Dutilleux. Si le premier est justement paré du titre de ''Wunderkind'', le musicien français qui connut la plus
grande gloire sur ses vieux jours, pourrait nul doute être adorné de celui de
merveilleux vieillard ! Au fil de la
petite dizaine de concerts auxquels il nous a été donné d'assister, une suprême
qualité émergeait constamment. En 2017 (26/1-5/2, www.mozarteum.at), pour leurs adieux,
Minkowski et Schulz, appelés à d'autres fonctions, qui à Bordeaux, qui à
Berlin, donneront, parmi une pléiade de concerts, de nouveau une production
scénique : une mise en scène du Requiem de Mozart dans la vision nul
doute hautement imaginative de Bartabas et de ses
forces équestres versaillaises, poursuivant une expérience débutée en 2015 avec
Davide Penitente.
Le concerto de violon de Dutilleux triomphe sous les doigts de
Renaud Capuçon

Tugan Sokhiev et les Viennois ©SM Wolfgang Lienbacher
L'affiche du deuxième concert des Wiener Philharmoniker que dirigeait Tugan
Sokhiev réunissait les trois compositeurs
emblématiques de cette édition : Mozart, Mendelssohn et Dutilleux. La symphonie
KV 385 « Haffner » ouvrait la soirée.
Conçue dans un tourbillon créatif en 1782, au moment de la création de L'Enlèvement
au sérail et du mariage avec Constance Weber, cette symphonie est dédiée à
un des membres influents, Sigmund, de la famille Haffner.
Tugan Sokhiev opte pour une
large formation et cet effectif va sonner. Le premier mouvement est pris
confortable, le ''con spirito'' et son thème vaillant
plutôt tenu sur la réserve. L'andante est sur le versant sérieux, son climat
façon de sérénade se signalant par les touches exquises des violons des
viennois et les brillantes interventions des vents en milieu de mouvement. Le
menuet est gracile quoique peu animé de ce sourire qui doit illuminer cette
page, tandis que le trio de facture rustique fait beau contraste. Le finale
presto montre l'agilité des cordes, dans de superbes glissandos notamment, et
le zest inimitable de cet orchestre. Mais l'ébullition de ce dernier volet, qui
selon Mozart, doit être joué aussi vite que possible, reste entre les mains du
chef russe un peu trop sage. Une conception plus proche de la manière d'un Böhm
que d'un Harnoncourt. Changement radical de climat avec le concerto «
L'arbre des songes » d'Henri Dutilleux. Créé à Paris en 1985 par Isaac
Stern, son dédicataire, et Lorin Maazel à la tête de l'Orchestre National de
France, ce concerto est un formidable chalenge pour son soliste. Quoique le
compositeur refuse de lui faire jouer un rôle de bravoure. Il est immergé dans
l'orchestre qui adopte une position de support, « une façon plus intégrée, avec
un soliste étroitement dépendant de son environnement orchestral, soliste et
orchestre étant animés de la même pulsation rythmique » précise-t-il. La
pièce en quatre mouvements, eux-mêmes reliés par trois interludes, apportant
une respiration, progresse sans solution de continuité, se déployant telles les
ramures d'un arbre. On savoure un son extrêmement transparent qui malgré un
effectif conséquent, évoque comme une musique des sphères, et une palette
lumineuse enrichie d'instruments originaux tels le célesta, le carillon, le
vibraphone, la harpe ou le cymbalum. Mais aussi son lyrisme séducteur dont
Renaud Capuçon épouse l'intensité. Il se joue des
folles difficultés accumulées : jeu plus qu'acrobatique, pizzicatos suivis de
traits filés dans l'extrême aigu, nuances extrêmes de dynamique. Le ton reste
chambriste car les viennois apportent leur finesse légendaire. Tugan Sokhiev conclura le concert
avec la Symphonie « italienne » que Mendelsshon
écrit en 1833, à la suite d'un long périple en Italie. Elle sera jouée là aussi
de manière retenue. Le vivace initial est adorné d'une brillante articulation
des cordes, quoique la pulsation insufflée par le chef aurait gagné à être plus
tendue. Le mouvement lent, débuté en forme de marche, sera presque plaintif
avec un beau contrechant des cordes graves. Les Viennois à leur meilleur. On
prend le temps de savourer le paysage au con moto
moderato, sorte de menuet, doucement expressif, et on admire les cors au trio
central. Le finale, sur une danse de saltarello,
bondit avantageusement même s'il ne libère peut-être pas de fougue
débridée.
Un quatuor dont le nom est de ne pas en avoir...

Quatuor Sine
Nomine ©SM Wolfgang Lienbacher
Remplaçant obligeamment le Quatuor Ebène,
le Quatuor suisse Sine nomine en a conservé le même programme pour ce qui est
des pièces de Mendelssohn et de Dutilleux, substituant le quatuor KV 387 de
Mozart aux deux Divertimentos initialement prévus par leurs collègues français.
Ce premier des Six quatuors dédiés à
Haydn, composé en 1782, souffrira une interprétation immaculée : enlevée mais
gentille au vivace initial, attractif au menuetto,
placé par Mozart en deuxième position, alors que les accents rustiques du trio
font diversion, fort chantant à l'andante cantabile, quoique un peu sage dans
ses accents tragiques, et d'un bel allant au finale molto allegro. Au fil de
cette exécution, on aura admiré la finesse du jeu des musiciens qu'une sûre
complicité unit depuis des années. Cette entente leur permet d'affronter le
Quatuor « Ainsi la nuit » de Dutilleux avec sérénité. Cette pièce,
ils la connaissent bien pour l'avoir en particulier jouée à la salle Pleyel à
Paris, pour le 90 ème anniversaire du maître. Composé
entre 1973 et 1977, créé par le Quatuor Parrenin, il
est constitué de sept parties enchainées, avec un court break après le n° 3
«Litanies », et entre lesquelles sont intercalées quatre ''parenthèses''.
Ne se voulant pas narratif, il évoque des sonorités contrastées par le recours
à la technique de ce que Dutilleux appelle « la croissance
progressive », basée sur la prolifération des sons et des rappels
mémoriels. Et ce par l'utilisation de modes divers : cascades de pizzicatos,
jeu sul ponticello, 1er
violon souvent cantonné dans le suraigu, alternance de jeu plein et avec
sourdine, grands unissons des quatre voix, alors que celles-ci sont traitées
ailleurs de manière étourdissante de couleurs pour exprimer un monde séraphique
ou une plainte, comme un chant douloureux. La pièce se conclut dans un souffle
(« Temps suspendu »). L'interprétation des Sine Nomine est
irréprochable et leur vaut un fier succès. Ils joueront ensuite le Quatuor R 37
de Mendelssohn. Écrit en 1847, en Suisse, après la nouvelle de la mort de
Fanny, la sœur adorée. La tragédie de cette soudaine disparition imprègne la
pièce qui oscille entre douleur et désespoir : un premier mouvement alternant
énergie désespérée et lyrisme incantatoire, un scherzo bardé de traits dissonants, loin des scherzos
aériens d'antan, un adagio sonnant comme un requiem pour Fanny, dans le doux
cantabile du 1er violon, et un finale presque sauvage dans ses affirmations,
proche d'une danse de mort. Le jeune musicien disparaitra à son tour trois mois
plus tard. Souveraine exécution des quatre chambristes suisses qui, en bis donneront
un adagio affetuoso du même Mendelssohn.
Comme sonnent Les Vents français

François Leleux, Gilbert Audin, Éric Le
Sage, Radovan Vlatkovic,
Paul Meyer ©SM Wolfgang Lienbacher
La vague d'interprètes français lancée
depuis 2013 par Minkowski, devait permettre d'entendre un ensemble déjà bien
connu par le disque et au festival de l'Empéri : les
Vents français. Ces mousquetaires (quatre vents) et leur pianiste offraient un
répertoire aussi éclectique qu'impressionnant. Qu'on en juge ! Le Trio pour hautbois,
cor et piano op. 274 de Carl Reinecke (1824-1910
) - qui décidément n'a pas écrit qu'un fameux concerto pour harpe immortalisé
par Lily Laskine - est une pièce charmante, idéale pour entamer un concert à
l'heure du café (15H)! Il manie ce type de mélodies faciles qui plaisaient sans
doute à son auditoire germanique, et une transparence de textures fort
agréable, balançant adroitement le discours tour à tour du hautbois puis du cor
au premier mouvement, puis installant un vif et piquant scherzo. Suit un adagio
où chacun de deux vents brode sur un habile accompagnement du piano et un
finale qui, dans sa ritournelle, laisse un temps la vedette au corniste pour
s'achever en une élégante péroraison. Venait ensuite « Sarabande et
cortège » écrit par Dutilleux en 1942 pour basson et piano. Pièce sans
prétention, dans la veine onirique de Poulenc, elle offre quelques amusants
mélismes presque orientalisants dans sa première séquence et une seconde partie
assez piquante, dont une cadence du basson en forme de marche - celle de L'Apprenti
sorcier n'est pas loin - avant un joli pied de nez final. Avec le Trio
pathétique de Mikhail Glinka, pour clarinette,
basson et piano, retour vers le romantisme exacerbé russe : une œuvre en trois
mouvements enchaînés dont le deuxième donne nul doute à l'entière pièce le ton
de ''pathétique'. Entre autres curiosités, on y croise un solo de la clarinette
dans le registre extrême aigu. Mais le finale tourne un peu court. De Dutilleux, était donné encore la Sonate
pour hautbois et piano de 1947, dont le troisième mouvement allegretto
devait être renié par l'auteur. Il a donc été décidé de ne pas le jouer ici.
Pièce de divertissement, dans la veine d'Ibert et de Françaix, le premier
mouvement, introduit par le piano, laisse libre cours à une fine mélopée du
hautbois qui évolue souvent dans l'aigu. Le larghetto offre une sorte de marche
décidée mêlée de lyrisme retenu. Le concert s'achevait par la réunion des cinq
participants pour l'exécution du Quintette KV 452 pour vents et piano de
Mozart. On sait quel enthousiasme gagne
Mozart en cette année 1784 pour l'écriture pour les vents : tout juste après sa
Sérénade « Gran Partita » pour 12 vents
et contrebasse, écrit-il ce quintette
pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson, créé à Vienne le 1er Avril
1784. Dans une lettre à son père, il n'hésite pas à dire « Je le considère
comme la meilleure œuvre que j'ai jamais composée ». Si les vents sont à
la fête, la partie pianistique n'est pas moins virtuose. L'exécution des
musiciens des Vents français est un régal de finesse, de clarté, d'humour. En
particulier lors de la longue et belle cadence qui orne le finale allegretto.
Un ton de limpidité, de netteté lumineuse, typique de l'esprit français.
La découverte d'un jeune prodige...

Renaud Capuçon et
Kit Amstrong ©SM Wolfgang Lienbacher
L'événement annoncé, la réunion de Menahem Pressler et de Renaud Capuçon
n'aura donc pas eu lieu. Mais une déception peut cacher une surprise. Et
celle-ci fut de taille : le jeune Kit Amstrong qui le
remplaçait dans la partie de piano des sonates de Mozart, aura été une franche
découverte. Ce jeune musicien (*1992) d'origine taïwanaise et qui vit entre
Londres et New York, est un surdoué ! Protégé d'Alfred Brendel qui lui prodigue
ses conseils et avec qui il est au cœur d'un film, « Set the piano stool on fire », il a déjà à
son actif une jolie carrière et plusieurs disques dont deux sous label Sony ( Bach, Liszt). Compositeur à ses heures, il est aussi
pédagogue et est à l'origine d'un projet pour le moins insolite : la
transformation d'une église désaffectée, Ste Thérèse d'Hirson, dans l'Aisne, en
salle de concert (2014). Il assurait donc cette fois la partie de piano des
deux premiers concerts de l'intégrale des sonates pour piano et violon de
Mozart, la suite étant programmée pour l'édition 2017. On sait que Mozart a
composé de telles pièces depuis sa prime jeunesse et tout au long de sa vie.
Une importante série date des années 1777-1779, alors qu'il effectue un long
voyage qui de Salzburg le mène à Mannheim puis à Paris. Les six sonates KV
301-306, publiées à Paris chez l'éditeur Sieber, « pour Clavecin ou Forté Piano avec accompagnement d'un violon » montrent
d'emblée l'importance de la partie de clavier. « Elles ne sont pas
mauvaises » explique-r-il dans une lettre à Léopold, du 6 octobre 1777.
Les quatre premières données lors des concerts de ce mois de janvier 2016, sont
en deux mouvements et signalent une belle interaction entre les deux
partenaires qui jouent aussi souvent à l'unisson (KV 301), distillant de suaves
mélodies et de doux développements. Quelquefois c'est le piano qui mène
franchement la danse (allegro du KV 302), ou alors c'est le violon qui
commence, laissant au piano le soin de broder ensuite (1er mouvement
adagio/allegro du KV 303). La sonate KV 304 est plus austère, en particulier au
tempo di minuetto, découvrant des mélodies doucement
mélancoliques dans la partie médiane richement expressive et réclamant un subtile dosage dynamique de la part des deux interprètes. Amstrong et Capuçon ne sont pas
en reste pour ce qui est du nuancier. Le pianiste offre un jeu d'une douceur
immatérielle et le violoniste un archet souverain. Au milieu de la paire de
sonates KV 301-302, est intercalé l'Adagio KV 540 (1788) d'une élévation d'esprit
inouïe - le manuscrit laisse à l'interprète une certaine discrétion en matière
de dynamique pour en restituer toute l'expressivité. Kit Amstrong
est ici bouleversant. On reste sans voix devant une telle profondeur, une si
poignante gravité qui conduit au sublime lors des dernières phrases, un
déchirement de l'âme. Lors du second concert, entre les sonates KV 303 et 304,
il joue le Rondo KV 501, là encore une pièce que son toucher de velours
ennoblit.

Ultime
répétition peu avant le concert... ©SM Wolfgang Lienbacher
Les Sonates KV 296 et KV 378, publiées
respectivement en 1778 et 1781, font partie d'une autre série de six. Dans la
première, la primauté est clairement donnée au piano qui dans le premier
mouvement vivace, s'affirme décidé. Cela coule de
source sous les doigts de Kit Amstrong, d'une folle
agilité sous des dehors de calme olympien. Un soupir parcourt l'auditoire à la
fin du mouvement. L'andante sostenuto, de par le cantabile du clavier et la
gravité du violon, tutoie le sublime. Et à l'allegretto final, qui cèle
fugitivement un thème annonçant Così fan
tutte, on nage dans la joie la plus pure. La sonate KV 378 montre une belle
parité entre les deux instruments et là encore l'adagio est d'une merveilleuse
densité tandis qu'au finale règne un esprit fou de par la légèreté immatérielle
du jeu des deux musiciens. Le partage des tâches entre violoniste et pianiste
distingue la sonate KV 454 (1784). L'Histoire rappelle que pour la création
viennoise, Mozart s'il écrivit entièrement la partie de violon, laissa
seulement quelques notations pour ce qui concernait celle du piano dont il se
réservait la primeur. Après un allegro parsemé de triolets en forme de
sonneries, l'andante est d'une belle suavité, voire d'équanimité ; ce que les
deux interprètes démontrent avec évidence. L'allegretto conclusif coule comme
une eau pure et s'achève en un petit feu d'artifice du piano. La sonate K 547,
de 1789, porte cette cocasse indication : « Une petite sonate de piano
pour les débutants avec un violon ». Un exercice facile pour le pianiste ?
Rien de moins car la fluidité requise n'est sans doute pas aisée à réaliser ;
comme il en va de la partie de violon. Les choses se complexifient encore au
deuxième mouvement allegro et pas seulement pour ce qui est des moulinets du
violon. Le rondeau développe quelques agréables variations au piano, puis
soudain le violon prend l'avantage. Le chassé croisé que prodiguent Capuçon et Amstrong est
proprement inouï de naturel, de simplicité. Comme il en aura été tout au long
de ces deux mémorables séances de musique pure. Bravo, archi bravo !
Marc Minkowski impose sa trilogie d'Acis et Galathée

Les solistes de la
« version Haendel » ©SMWolfgang Lienbacher
Le projet lui tenait
particulièrement à cœur : monter un triptyque réunissant l'oratorio Acis and
Galatea de Haendel et ses arrangements réalisés
par Mozart et par Mendelsshon. « Une œuvre,
trois mondes », explique-t-il car « les doublons sont rares en
musique ». D'où l'intérêt, en un même jet, de comparer l'original aux deux
autres versions tant sont fascinantes les adaptations réalisées par deux jeunes
génies. L'idée a sans doute germé aussi à partir de la volonté de donner la
mouture de Mendelssohn, si peu jouée. Et
d'ajouter qu'il affectionne particulièrement le Haendel
pour l'avoir dirigé au seuil de ses 18 ans... Acis and Galatea
(1718) répond au genre du « masque », autrement dit une pièce de
nature intimiste, chambriste, écrite pour cinq solistes et petit orchestre de
cordes et continuo, avec ajout de deux hautbois et deux petites flûtes. Un
exemple typique de l'« english pastoral »
imaginée pour conter l'histoire mythologique des amours du berger Acis et de la
nymphe Galatée, au dam du cyclope Polyphème qui projettera un rocher sur le
pauvre jeune homme, le blessant mortellement. C'est à la demande du baron van Swieten que Mozart va orchestrer la pièce en 1788, première
commande de quatre comprenant encore les orchestrations du Messie, puis
d'Alexander's Feast
et de l'Ode à Sainte Cécile. Cette « Pastorale en deux actes de Haendel arrangée par
Mozart », KV 566, est bien différente de l'original. Car la traduction du
texte de John Gay en langue allemande a conduit à adapter la partition. Mais
surtout, l'idée était de mettre au goût du jour une pièce qui passait pour
monotone. Mozart l'a enrichie en lui adjoignant des parties de vents dont deux
clarinettes qui font leur apparition dès l'Ouverture. Sa maitrise de l'écriture
pour ces instruments fait merveille ici. C'est en 1829 que Mendelssohn, qui ne
connaissait vraisemblablement pas alors la version de Mozart, s'attèle à sa
propre réorchestration avec l'enthousiasme de la jeunesse et la palette du
grand orchestre romantique, révélant un potentiel de couleurs insoupçonnées. Le
vaste orchestre comprend trompettes, timbales et une panoplie de vents très
harmoniques ; sans parler du contrepoint d'altos, dans la manière de Bach, dont
le compositeur ne dirigera la Passion selon Saint Matthieu que peu
après. Ce qui est nouveau aussi est le travail sur le chœur. On remarque encore
quelques touches dramatiques dans les solos et le trio réunissant Acis, Galatée
et Polyphème, lequel sonne comme un
morceau opératique, notamment dans l'expression de la fureur de ce dernier.
Cela sonne grandiose et bien loin de la fine pastorale handélienne.
En résumé, la comparaison des trois versions laisse à penser qu'on passe d'une
fine gravure à un beau pastel, puis à une franche peinture à l'huile.

Marc
Minkowski ©SM Wolfgang Lienbacher
La compilation effectuée par
Marc Minkowski permettait d'entendre dans leur intégralité la version de
Mendelssohn comme celle de Haendel, mais pas celle de Mozart dont il a choisi
arbitrairement de ne donner que quelques extraits : l'Ouverture et la musique
d'entr'acte entre les actes I et II. Et hélas pas un seul air. Souci de ne pas
surcharger un concert qui durait déjà près de quatre heures ? On reste sur sa
faim devant le renoncement à aller jusqu'au bout de l'idée, et un peu frustré
du caviardage de l'arrangement de Mozart. Quoi qu'il en soit, l'interprétation
ne souffrait pas le moindre temps mort. Les deux morceaux de Mozart forment une
magistrale entrée en matière, dont une Ouverture généreuse ménageant les
parties de vents signalées. Le contraste avec la vision de Mendelsshon
est saisissant dès l'Ouverture bardée de ses trompettes. Minkowski nous fait
découvrir une musique brillante quoique sans pathos. Il use d'un pianoforte et
les timbales sont malgré tout jouées avec discrétion. Ses Musiciens du Louvre
se découvrent de réels talents pour aborder le premier romantisme. Les voix du Salzburger Bachchor montrent une
superbe maestria. Les solistes sont de haut vol. Julie Fuchs est une Galatée de
belle allure et les deux ténors sont
bien achalandés : Colin Balzer est un Acis de style
tandis que le Damon (l'ami intentionné du berger) de Valerio Contaldo, timbre plus clair, un peu sur la réserve au
début, s'affirme peu à peu par un chant vif argent séduisant. Le Polyphemus de Peter Rose offre une basse chantante qui à
l'heure du trio, contraste fort bien avec les deux amoureux. L'exécution de la
Pastorale de Haendel, qui occupe la seconde partie du concert, est une plus
grande réussite encore. Minkowski est ici chez lui. La petite formation
alignée, de cordes dont se détachent les deux hautbois et les flûtes - le
recorder enjoué d'Andres Locatelli en particulier - est un parangon de finesse.
Il livre une lecture pacifiée, épurée, extrêmement transparente, animée d'une
souple articulation et parée de pianissimos à la limite de l'impalpable.
L'auditoire est sous le charme. Le chœur est justement confié aux cinq
solistes, ce qui donne un sentiment de douceur madrigalesque, en même temps de
rare plénitude. Ils forment un ensemble parfait. On sait Minkowski découvreur
de talents. Les chanteurs réunis font un sans faute. Anna Davin,
de sa voix chaude et sensuelle, est une Galatea d'une
émotion palpable, notamment dans la dernière aria « Heart,
the seat of soft delight ».
Valerio Contaldo qui a troqué les habits de Damon (Mendelsshon) pour ceux d'Acis chez Haendel, atteint sa
plénitude. Samuel Boden, Damon, voix de ténor aigu, à la limite du haute contre
offre avec l'aria « Consider, fond sheperd » un bijou de sveltesse, qu'enlumine
l'accompagnement des deux violons et du hautbois. La basse Krzysztof Baczyk est un solide et expressif défenseur des velléités
vengeresses de Polyphemus. Colin Balzer
complète le quintette dans le rôle épisodique de Coridon.
Cette interprétation est un enchantement de bout en bout.
La Camerata Salzburg, Louis Langrée et Alexander Melnikov

Alexander Melnikov et Louis Langrée ©SM
Wolfgang Lienbacher
Louis Langrée qui
préside aux destinées de la Camerata Salzburg,
orchestre qui fut naguère dirigé par Sándor Végh, proposait un
programme réunissant les trois compositeurs de l'année. De Mozart, on commença
par la symphonie KV 16, à peine plus longue qu'une ouverture d'opéra, dans ses
trois parties contrastées dont un largo hypnotique et un finale preste. La
formation se compose de cordes, de deux cors et du clavecin. Suivait le Concerto
pour piano op. 25 de Mendelssohn : une pièce d'inspiration brillante écrite en
1831, qui fait la part belle au soliste. Comme au premier mouvement dont
l'entame con fuoco, introduite grandiosement
sous la baguette furioso de Langrée. Le piano évolue
dans un emballement à la Liszt, en particulier lors de la cadence, elle-même
introduite par une fanfare de cors et de trompettes ! L'andante apporte quelque
calme réflexion et un tendre lyrisme. Retour tempétueux avec le finale
endiablé, entrecoupé d'une manière de refrain presque vocal initié par le piano
et repris par tout l'orchestre. La péroraison est de nouveau un déchaînement
furieux de la part du soliste. Alexander Melnikov,
qui joue un Steinway et non un de ses instruments anciens favoris, en est la star
incontestée, apportant poigne mais aussi infinies nuances de douceur. En bis,
il jouera une Romance sans paroles. Henri Dutilleux écrivit « Mystères de
l'instant » de 1986 à 1988, qui sera créé par
Paul Sacher à Zürich. L'œuvre est conçue pour 24 cordes, cymbalum et percussions. C'est une chaîne de 10 très
courts instantanés, bâtis sur des chants d'oiseaux, depuis le gazouillis
frénétique de « Appels » jusqu'à l'apothéose finale
d'« Embrasement ». Au fil des diverses séquences aux noms évocateurs,
«Échos », « Espaces lointains », « Rumeurs »,
« Soliloques »..., on décèle de fins solos d'instruments, tels que
l'alto, le violon, les timbales. Et cette impression d'espace interstellaire
qui distingue si souvent la musique du français. L'exécution qu'en livre Louis Langrée est immaculée et à porter au crédit des cordes
translucides de la Camerata Salzburg. Ils concluront
le concert par une fastueuse interprétation de la 39 ème
symphonie KV 543 de Mozart. Qui dans l'acoustique si présente de la grande
salle du Mozarteum, sonne comme il se doit, et bien
différemment que dans les larges vaisseaux des auditoriums modernes. Langrée et ses forces salzbourgeoises sont les chantres
d'une exécution raffinée, bien articulée, d'un bel élan aux mouvements
extrêmes, fort chantante à l'andante et parée de punch au Menuetto
dont le trio rustique détache de savants traits des clarinettes. Rien de
routinier ici. L'esprit de Mozart tout simplement.
Le Quatuor Elias : de Mozart à Schumann en passant par Mendelsshon

Elias String Quartet ©SM Wolfgang Lienbacher
Remplaçant les Hagen, le
Elias String Quartet devait en conserver le programme, à l'exception du
Mozart, le quatuor KV 464 substituant le KV 421. Ces jeunes musiciens, deux
filles encadrant deux garçons, ont déjà à leur actif de nombreux concerts, en
particulier au Wigmore Hall de Londres et des
disques, dont le début d'une intégrale Beethoven. C'est dire leur ambition.
Leur manière : une extrême finesse du trait, une grande retenue. C'est ce qui
caractérise leur lecture du quatuor KV 464 de Mozart, assurément pas l'un des
plus aisés au sein de la série des Six quatuors dédiés à Haydn. Elle est sur le
versant soft au premier mouvement dont l'articulation est volontairement souple
; tout le contraire de la vision des Hagen
(lors de l'édition 2015, cf. NL de
3/2015). Cela se confirme au Minuetto, très, très
sage, et à l'andante où même la cavalcade du violoncelle ne décolle pas
suffisamment. Le finale montre un Mozart définitivement sous dimensionné. Le
quatuor op. 13 de Mendelssohn les voit plus à l'aise, dans le monde foisonnant
du vivace initial, qui rappelle le bouillonnement des symphonies de jeunesse
pour cordes. Mais l'adagio, marqué « non lento », est ici pris à un
tempo bien trop lent, étirant le discours. Il y a cependant de beaux climats
lorsque les choses s'animent. L'intermezzo trace justement cette alternance de
cantabile et de fantastique, dans l'esprit de l'Ouverture du Songe d'une
nuit d'été. Le dernier mouvement joué attaca
énonce son étonnante dramaturgie, qui vers le troisième tiers, d'une cadence du
premier violon mène à une fin très recueillie. Ils joueront ensuite le Quatuor
Op. 41 N° 1 de Schumann (1842), le premier des trois dédiés à son ami
Mendelssohn. Dans l'Introduzione, on note un double
hommage à Bach et à Beethoven et une touche de fantaisie. Cette dernière, on la
retrouve au scherzo dont le ton fantasque, un brin sinistre, diffère de la
manière nocturne et aérienne de Mendelsshon dans ce
type de mouvement. Le court adagio dévoile de belles inspirations et le finale
et ses divers épisodes, dans le goût slave, voire même dans le style musette,
communique l'enthousiasme. Les Elias montrent ici leur musicalité et un souci
des accents qui manquait à leur Mozart.
Du très rare et fort beau Mendelsshon

Dorothea Röschmann
& Pablo Heras-Casado ©SM Wolfgang Leinbacher
L'annonce du retrait du podium
de Nikolaus Harnoncourt a plongé le monde musical
dans la consternation, voire l'embarras compte-tenu des nombreux projets encore
affichés par le maître. Et si l'on a cru qu'il viendrait malgré tout honorer
celui de la Mozartwoche, c'était se méprendre sur sa
volonté irrévocable de cesser de diriger. Quoi qu'il en soit, le troisième
concert des Wiener Philharmoniker garda intact son
programme, confié au jeune Pablo Heras-Casado. Bel
hommage au maestro autrichien qui l'avait méticuleusement concocté : une soirée
Mendelssohn de derrière les fagots, puisque constituée de deux pièces peu
jouées et de la Symphonie Écossaise. Si l'on ajoute que le concert marquait
les débuts du chef espagnol à la tête de la phalange viennoise, on aura une
idée de l'événement! Cela se sera passé le mieux du monde à en juger par
l'engagement des musiciens et leur satisfaction visible aux saluts : adopté
donc dans le cénacle des chefs autorisés à les diriger. L'Ouverture de concert
« Märchen von
der schönen Melusine »
(contes de la belle Mélusine), op. 32, a été écrite en 1833 comme présent
d'anniversaire à la petite sœur Fanny. En deux parties bien contrastées, elle
évoque tour à tour l'atmosphère marine où évolue la sirène, avec ses
ondulations pianissimo et ses fines interventions des bois, et le drame que
vont vivre celle-ci et Raymond, conte de Poitiers qui la courtise en vain.
Cette seconde section dramatique tire de l'orchestre des sonorités généreuses
que Pablo Heras-Cacado
obtient par une direction très physique, sans baguette, faite de grands
impulses des deux bras. Encore plus rare est le Psaume 42 « Wie der Hirsch schreit » (comme brame le cerf ),
composé en 1838, à la suite du voyage de noces d'un Mendelssohn de 29 ans en
Alsace et en Forêt noire. Il sera chéri par l'auteur qui le tiendra comme
« sa pièce favorite de musique d'église », et loué par Schumann
considérant que son ami a « atteint la plus grande élévation comme
compositeur pour l'église ». C'est une partition austère, constituée de
sept parties jouées enchaînées, dont se détachent les trois arias confiées à la
voix de soprano : la première sur un accompagnement de hautbois, la deuxième où
elle est rejointe par le chœur de femmes et la dernière qui débouche sur un
quintette soprano et voix d'hommes (deux ténors et deux basses). La pièce se
termine par un somptueux chœur. Exécution irréprochable de Heras-Casado,
qui à n'en pas douter devait aborder une telle pièce, comme du Arnold
Schoenberg Chor, et surtout de Dorothea
Röschmann, casting de luxe. Venait ensuite la Troisième
symphonie op. 56. Est-elle si « Écossaise » que son épithète
l'indique, qui ne figure pas sur l'autographe ? Pensée lors d'un voyage en Écosse,
elle sera complétée bien plus tard, après un séjour en Italie... Le ton
populaire qui imprègne son premier mouvement fait penser aux brumes du nord et
à un passé historique tumultueux. De fait, le poco agitato puis l'assai animato
évoquent des paysages tourmentés. Heras-Casado, qui
joue toutes les reprises, en donne une lecture incandescente. Le vivace qui
suit, sorte de scherzo, et son thème pentatonique de danse populaire exposé à
la clarinette, sont bondissants. De l'adagio et de son rythme de marche
tragique, il négocie avec bonheur les textures et les viennois sont ici à leur
meilleur. Le vivacissimo final, « allegro guerriero », est on ne peut plus entrainant jusqu'au
finale maestoso, hymnique. Une grande interprétation au crédit d'un chef à
suivre.
Jean-Pierre Robert.
***
Dimitri Tcherniakov empoigne Lady
Macbeth de Mzensk
Dimitri CHOSTAKOVITCH : Lady Macbeth de Mzensk.
Opéra en quatre actes. Livret du compositeur et d'Alexandre Preis
d'après la nouvelle de Nikolaï Leskov « Une Lady Macbeth du district de Mtsensk ». Ausrine Stundyte, Vladimir Ognovenko, Peter Hoare John Daszak, Clare Presland,
Jeff Martin, Gennady Bezzubenkov,
Almas Svilpa, Michaela Selinger,
Kwang Soun Kim, Paolo Stupenengo, Yannick Berne, Brian Bruce, Philippe Maury,
Paul-Henry Vila, Didier Roussel, Hidefumi Narita.
Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Lyon, dir. Kazushi Ono. Mise en scène : Dimitri Tcherniakov.
Opéra de Lyon.

Katerina et
Sergueï (acte I) ©Jean-Pierre Maurin
Monter Lady Macbeth de Mzensk
n'est pas chose aisée. Serge Dorny, le directeur de
l'Opéra de Lyon, a réussi le tour de force de s'attacher un des metteurs en
scène fétiches du moment, le russe Dimitri Tcherniakov.
On sait l'opéra de Chostakovitch porteur de climats puissants, à l'aune de
l'empilement des effets sonores que contient la musique, souvent effrayants. Où
plus d'un régisseur est prêt à aller à fond, quitte à forcer le trait. Tcherniakov est lucide : sa vision est un crescendo
mûrement réfléchi autour du parcours infernal de Katerina Iszmaïlova,
dont le musicien proclamait, dans le programme de la Première au Théâtre Maly de Léningrad en 1934, avoir
« cherché à rendre son personnage positif et digne de la compassion du
spectateur... et la justifier par tous les moyens ». La manière de Tcherniakov n'est pas tant grotesque, encore moins
caricaturale - à la différence par exemple d'Andeas Homoki à Zürich (cf. NL de 6/2013) - que satirique,
grinçante au second degré. La charge érotique n'est pas éludée, souvent
suggérée, plus rarement crue. L'impact tragique en ressort encore plus
impressionnant. Ainsi de l'épisode du plat de champignons réclamé et dégusté
par Boris Izmaïlov, peu après qu'il eut infligé une
sévère bastonnade à l'ouvrier Sergueï : c'est un refus glacé qu'oppose Katerina
aux suppliques de son beau-père dévoré par les effets du poison. De même la
descente des forces de police, qui souvent donne dans le débordement, est ici
plus d'un cynisme ravageur que frôlant l'absurde. Leur arrivée aussi inopinée
que providentielle au milieu des festivités de la noce prend l'allure d'un
ballet hautement sarcastique. La tension, Tcherniakov
la soutient de main ferme dans sa recherche de cohérence au fil de tableaux
s'enchaînant sans solution de continuité dans le contexte unifié d'un décor
expressionniste : les locaux banaux d'une usine, celle du marchand Boris Izmaïlov, avec ses ouvriers accaparés par le va et vient
fébrile des tâches quotidiennes, son secrétariat débordé, dont la jeune Aksinia (violée dans un accès de débauche des mâles) est
l'une des dactylos. Les lieux seront plus tard parés pour la noce de la
patronne avec son nouvel amant, celle-ci ayant pourvu ses ouailles de vêtements
de fête. Au milieu de ce vaste décor, apparaît un autre plus petit,
parfaitement délimité, la chambre à coucher, tapissée de tentures rouges. Cette
sorte de lieu névralgique concentrera tour à tour la solitude de Katerina, ses
premiers doutes alors que se fend l'armure de sa volonté (Interlude II), ses
ébats amoureux avec l'ouvrier Sergueï et leur résolution à faire disparaître ceux
qui les gênent, le mari Zinovy par exemple. Les
portraits et les actions sont scrutés au scalpel. Et Tcherniakov
sait habiter une explication animée comme celle presque musclée entre Zinovy et sa femme, où l'on ne sait pas qui va prendre le
pas sur l'autre. On voit la suite : ce mari, revenu en hâte, sera sauvagement
étouffé par les deux amants, alors qu'il est en caleçon, sa première idée du
retour ayant été de posséder sa femme pour affirmer sa légitimité.

La noce (acte
III) ©Jean-Pierre Maurin
Puis survient au dernier acte comme un coup
de poing. Là où plus d'un régisseur s'est cassé les dents devant ce qui confine
au basculement dramatique de l'œuvre à cet endroit, Tcherniakov
a une idée tout simplement géniale. Il fallait oser renoncer à la didascalie de
la colonne de bagnards déambulant dans la steppe sibérienne, et installer pour
tout décor une cellule étriquée où se retrouve enfermée la condamnée Katerina.
Là va se dérouler l'ultime confrontation avec Sergueï, qu'elle ne va pas
chercher parmi ses congénères bagnards mais qui vient à elle, de même que la
jeune Sonietka, la nouvelle conquête de Serguei, se
trouve assignée dans la même cellule. L'atmosphère claustrophobe de cette
minuscule pièce ne réplique-t-elle pas celle rencontrée avant dans la chambre
des amants ? Formidable idée de continuité en tout cas ! L'humiliation de
Katerina sera insoutenable devant sa rivale prise bestialement sous ses yeux
par celui qu'elle aime toujours à la folie. Et l'épisode des bas de laine sonne
telle une ultime blessure dans ce huis clos infernal à
trois. La résolution est dès lors imparable : le meurtre de cette concurrente
est l'unique issue, dans une vision cauchemardesque de lumière soudain coupée,
aux seules lueurs des torches folles des gardiens arrivés à la rescousse.
Tandis qu'en coulisses le chœur des bagnards égrène sa complainte. Puissant !
Il fallait une interprète d'exception pour soutenir pareille destinée. La
lituanienne Ausrine Stundyte
est de cette trempe. Une incarnation d'une vérité criante, sans fard cependant,
tour à tour murée dans une froideur résolue, puis gagnée par une obsession
irrépressible qui ne connaît pas de frein dans son amour débordant, exclusif,
et qui jamais ne sombre dans le naturalisme facile. Un soprano inextinguible,
tant dans le médium étoffé que dans les aigus fort éprouvants dont
Chostakovitch assaisonne le rôle. Une interprétation rare. Le Boris de Vladimir
Ognovenko, un briscard du Mariinsky,
est lui aussi de classe, voix de basse chantante, portrait cinglant dans ses velléités
de respect de l'ordre familial. Il interprète aussi le rôle du vieux bagnard au
dernier acte, ce qui pour n'être pas catholique musicalement, est
dramatiquement séduisant ; un autre moyen de relier ce dernier tableau aux
précédents ? John Daszak et un Sergueï de poids,
grand gaillard qui sait sa force peu résistible. Reste que le ténor n'a plus la
prime de la jeunesse appréciée souvent dans ses prestations à l'ENO. Belle
basse aussi de Gennady Bezzubenkov
qui dessine finement le portrait satirique du Pope ; et ténor grinçant de Jeff
Martin, dans le Baloud miteux. Est-ce l'effet
« Première » ? Mais la direction de Kazushi
Ono a paru bien sage et manquant de mordant dans les galops endiablés, au début
du moins. Les écarts de dynamique restent mesurés et la musique n'en ressort
pas toujours avec cette hargne incisive qui doit l'habiter. Les passages de
lyrisme sont cependant bien jugés. L'Orchestre de l'Opéra de Lyon révèle une
réelle transparence et une belle finesse instrumentale. Tout comme ses Chœurs
une vaillance et un engagement de tous les instants.

Katerina (Acte
IV) ©Jean-Pierre Maurin
Jean-Pierre Robert.
La Folle journée de Nantes célèbre la Nature

L'auditorium
de la Cité de Nantes, baptisé « André Le Nôtre » ©Marc Roger
La grande fête musicale nantaise
aura encore battu tous ses records. La thématique retenue pour cette 22 ème édition était large puisqu'intitulée « La
nature ». Un thème qui ressortit à un concept hautement fédérateur, comme
il en était l'an passé (« La passion ») et en sera l'année prochaine
(« La danse »). Et n'est donc plus centrée sur un compositeur ou un
groupe de musiciens, ou encore un mouvement musical. Choix permettant de
couvrir indéniablement un champ très vaste, qui autorise à parcourir allégrement
plusieurs siècles de musique et conduit à abolir les frontières entre musiques
''ancienne'' et ''moderne''. On passe de Purcell à Schoenberg, de Haendel à
Chostakovitch, de Beethoven à Takemitsu en un clin
d'œil, de même qu'on déambule de salle en salle, d'un style à un autre en un
tournemain : orchestre, musique de chambre, instrument soliste, etc... Le
public répond favorablement. Parce que le phénomène Folle journée joue à plein.
Le fait d'assister au concert sans contrainte, le format extrêmement souple de
celui-ci, le mélange des genres précisément, le coût peu élevé de chaque
manifestation, ces points cardinaux de la Folle journée demeurent
inébranlables. Enhardi par une ambiance frôlant l'incandescence. Mais s'y
retrouve-t-il toujours ? On a entendu au fil des conversations, pas seulement
d'auditeurs mais aussi de professionnels, que l'heure du choix pour les
premiers n'est pas toujours chose aisée. Parmi les jeunes en particulier dont
certains sont quelque peu désarçonnés par les associations de musiques, les
croisements proposés. Frilosité, manque d'audace, hésitation à franchir le pas
? La question mérite d'être posée. Car si le pari d'une thématique conceptuelle
élargie et donc extensive ne semble pas encore avoir de répercussion sur le
taux de fréquentation d'un auditoire appartenant toujours majoritairement au
middle âge, il ne faudrait pas que les jeunes auditeurs se vivent
paradoxalement un peu laissés sur le bord de la route. Ce qui serait au
demeurant plutôt cocasse à un autre point de vue. Car la jeune génération
d'interprètes est là et bien là pour assurer la relève quel que soit le type de
musique et les genres pratiqués : les jeunes ensembles tâtant la musique dite
''ancienne'' par exemple sont légions et plus experts les uns que les autres.
Et la musique du XX ème finissant comme celle du XXI ème glorieux ne compte plus ses zélateurs. Quoi qu'il en
soit, l'espace d'une douzaine de concerts, on se sera régalé d'une plongée dans
le baroque et même avant, et d'un florilège de moments associant classicisme,
romantisme, XX ème et au-delà.

L'ensemble
Les Ombres ©Marc Roger
On ne présente plus le Ricercar Consort que dirige Philippe Pierlot de sa viole de
gambe. Ils sont depuis trois décennies un des vecteurs du renouveau de
l'interprétation dans le domaine de la cantate et de la musique instrumentale
du baroque allemand. Leur programme intitulé « Le vent », associait
Rameau, Gaultier de Marseille et Marin Marais. Pierre de Gaultier de Marseille
(1642-1696), créateur du premier opéra de la ville de Marseille en 1685, a
laissé deux opéras et des suites instrumentales. On joua ainsi pour quintette
de flûte, violon, clavecin, basse de viole et luth « Le Tombeau de Mr
Gaultier » et un belle passacaille. Extraits de Castor
et Pollux de Rameau, Pierlot et ses musiciens donnaient trois airs, chantés
par la soprano Hanna Bayodi-Hirt, dont le vif «
Brillez, astres nouveaux ». Suivaient quelques pièces de Marin Marais
(1656-1728), pour trio de violon, viole et luth, dont une piquante gigue, puis
« La matelotte » et son amusant
balancement, et « Le tourbillon » qui porte bien son nom. La cantate Léandre
et Héro de Louis- Nicolas de Clérambault (1676-1749) apportait une
conclusion festive alternant airs et morceaux instrumentaux dont une « Tempeste » qui fait penser aux climats venteux des Boréades de Rameau, en moins inventif cependant. On
admire la belle énonciation de la chanteuse franco-marocaine et la beauté
instrumentale de l'ensemble. Un autre ensemble, Les Paladins, dont une des
spécialités est le travail mené sur le parlé-chanté,
offrait un concert tout aussi passionnant associant quatre motets de
Marc-Antoine Charpentier (164-1704) dits « Les Quatre saisons » à,
d'une part une suite de Marin Marais pour viole de gambe et basse continue, et
d'autre part une Suite pour clavecin de Jean-Henry d'Anglebert (1629-1691) :
géniale manière d'entrelarder des parties vocales chantées en latin célébrant
amours profanes et sacrées, et des pièces purement instrumentales. Surtout
qu'interprétées avec le talent des deux sopranos Valérie Gabail
et Salomé Haller, et jouées on ne peut plus idoine par Les Paladins que dirige
Jérôme Corréas de l'orgue positif ou du clavecin. Du
grand art ! Peut-être plus inventifs encore étaient Les Ombres. Cette dizaine
de musiciens, tous fort jeunes, nous entrainaient dans une thématique là encore
porteuse « The mad Love », donc
britannique. Avec des pièces de Purcell, Dowland (1563-1626), Locke (1621-1677)
et John Eccles (1688-735). Quel bonheur que cette façon on ne peut plus
intimiste de jouer de la musique, imposant un silence absolu à la salle, et à
9H15 du matin! Leur Purcell est jouissif de par une
fine articulation. Leur ténor fait merveille de sa voix aiguë mais si bien
placée, dans « One charming night » ou
« Music for à while »,
morceaux envoûtants, le dernier air fini dans un pppp
éthéré. En bis, ils donneront un air extrait de The Fairy
Queen. Un des grands moments de cette édition.
Avec l'ensemble Les Esprits
Animaux, on entre dans le domaine de l'expérimentation. Ces autres jeunes à ne
pas avoir froid aux yeux, lancés à Ambronay,
proposaient une programme baptisé « Clamore Gallinarum » (le chant du coq). Allant de Telemann
(concerto pour violon « Die Relinge » / Les
grenouilles) à Vivaldi (concerto pour flûte « Il Gardelino
/Le chardonneret), et d'un auteur anonyme à Ignaz
Franz Biber (Sonata representativa).
Leur manière confine à une sorte d'improvisation, les coups d'archets
travaillés à la limite de la dissonance pour imiter les chants ou les bruits
d'animaux. C'est le cas de la pièce anonyme où successivement on perçoit
quelques borborygmes de gallinacée. C'est encore plus net au fil de la sonate
de Biber où tour à tour les instruments figurent le son dual du coucou, le
caquetage de la poule, le miaulement du chat, le cri râpeux de la caille,
etc... L'auditoire est plus ou moins attentif et en tout cas décontenancé : mon
voisin confie en catimini ''ils jouent faux » »!
Certainement pas. Mais cette façon de pousser le jeu très loin dans l'imitation
des bruits de la nature peut étonner. Ils savent bien sûr être plus sages,
voire suaves : dans le Vivaldi par exemple dont le concerto « Le
chardonneret », joué par quatre cordes, sonne étonnamment dégraissé. On a
voulu aussi entendre un autre ensemble bien connu La Simphonie
du Marais qui donnait les trois Suites de Water Music de Haendel. Hugo Reyne prend la parole pour demander au public de se relaxer
en vue d'un mirifique voyage maritime qui le conduira sur la Tamise du cœur de
Londres à Chelsea, à seulement quelques encablures. Sa vision de cette
célébrissime partition est sage finalement. Et sa vingtaine de musiciens
sonnent clair, avec deux trompettes fougueuses et deux cors naturels qui ne
feront pas le parcours sans encombre. Mais le plaisir est là, c'est
l'essentiel. Et on savoure ces tunes rabâchés mais combien séduisants. Ils
donnent en bis un adagio de la II ème suite. Puis
Hugo Reyne se lance dans une démonstration de
flageolet, un minuscule instrument destiné à imiter le chant nasillard de
l'oiseau... et à lui apprendre à chanter, l'homme devant la cage lui instillant
ces sons : ceux de la Méthode dite de l'Oiseleur ou comment inculquer au
volatile l'art de bien chanter !

En
avant la musique ! ©Marc Roger
En franchissant les siècles, on
se retrouve vite à Beethoven. Anne Queffélec et
Olivier Charlier donnaient la Sonate pour piano et violon n° 5 en fa majeur op.
24 dite « Le Printemps ». Un piano bien affirmé, qui rappelle
ostensiblement que pour Beethoven celui-ci entend avoir la primauté, et un
violon dont la sonorité un peu sèche n'est pas des plus agréables à l'oreille.
Une interprétation volontariste, loin de la vision intimiste et épurée de Julia
Fischer et d'Igor Levit récemment au Théâtre des
Champs-Elysées. Le premier mouvement évolue en pleine lumière, le deuxième est
d'une belle poétique et le finale bien enlevé. Suivait
la Première Sonate op. 78 de Brahms dont on avait exhumé le sous-titre
apocryphe de « La Pluie », pour sans doute se caler dans la
thématique d'année : concession un peu facile ! L'œuvre les trouve nettement
plus à l'aise et le violon de Charlier se révèle plus séduisant alors que Quféllec se fonde idéalement dans cet irrésistible mélodisme. De Gabriel Fauré, Jean-Claude Pennetier donnait en deux séances l'intégrale des
Nocturnes. Ce grand tenant de l'École française de piano offre une leçon de
style et de goût. On sait les Nocturnes au cœur de la production pianistique du
maître. Musique intérieure, dont le raffinement mérite une écoute attentive ;
ce qui était le cas de l'auditoire, malgré le bruit parasite émanant de la
Grande Halle, par ailleurs occupée à entonner les invraisemblables décibels des
Maîtres tambours du Burundi... Qu'importe, l'essence était là au fil de ces
pièces. Lors de cette première séance, Pennetier aura
conquis par son jeu sans excès d'abstraction et excellant à faire sourdre tout
le lyrisme enfoui dans ces pages associant des climats combien différenciés :
N°4 op 36 et ses sombres accents finaux, mélodisme de
l'op. 33, manière de scherzo du N° 10 op. 99, dramatisme, sous couleur de
chromatisme de l'op. 97, ou encore effets presque ''debussystes'' du N° 12 op.
99.
Si l'on passe à l'orchestre,
Jean-François Heisser et l'Orchestre Poitou Charente
proposaient un programme lui aussi centré sur la musique nocturne. Las ! L'Ouverture
du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn avait des semelles de plomb.
Les choses s'amélioraient avec le scherzo, plus idiomiatique,
et le Clair de lune de Debussy, donné dans l'orchestration d'André
Caplet, joliment poétique. Nuit dans les jardins d'Espagne de Manuel de
Falla, conduit du piano par Heisser, souffrait d'un
manque de souplesse et de mystère. Boris Berezovsky,
un artiste fétiche ici, avait carte blanche : il choisit de donner la Sonate de
Bartók, fort percussive, ce qu'il ne cherche pas à tempérer ; puis un bouquet
de Pièces lyriques de Grieg offrant un subtil lyrisme presque
impressionniste. Beau contraste avec l'univers agité de Bartók. Suivaient la Dumka de Tchaikovski
et des extraits de ses Saisons. Un univers pareillement tranché. Le Trio
Wanderer, lui aussi parmi les artistes phares de la
Folle journée, avait choisi un programme original puisque associant le Notturno op. 148 de Schubert, belle page
poétique, et les Trois nocturnes pour piano, violon et violoncelle
d'Ernest Bloch : pièce rare dévoilant mystère (andante), atmosphère nocturne
(andante quieto, entamé par le cello)
et agité (tempetuoso, avec toujours la primauté au
violoncelle, un instrument célébré par ce musicien). Ils concluaient par les
Sept Romances sur des poèmes d'Alexander Bloch op. 127 de Chostakovitch.
Créées par Galina Vichnevskaïa, Rostropovitch, Oistrach et Richter... Excusez du peu ! Une œuvre plutôt
tragique, étonnamment distribuée aux divers instruments, la voix étant
accompagnée successivement par le seul violoncelle (« Chanson
d'Ophélie »), le piano (« L'oiseau prophète »), le violon
(« Nous étions ensemble »), puis le piano et le cello
(« La ville dort »), le piano et le violon (La tempête »), le
violon et le cello (« Signes mystérieux »),
enfin le trio au complet pour la dernière mélodie
« Musique », qui est aussi un hymne à la nature.

Le
Quatuor Danel / DR
Du même Chostakovitch, le Quatuor
Danel donnait les Quatuors Nos 4 et 5. Le
compositeur occupe une place privilégiée dans le répertoire de cet ensemble
dont les deux violons sont français. Ils en ont enregistré l'intégrale des
quatuors en 2005, récemment réédité chez Alpha. Ce sera un des grands moments
de notre périple : on ne résiste pas à pareille phénoménale intensité, à une
telle plénitude sonore, au souffle incandescent qu'ils mettent dans l'exécution
du 4 ème quatuor, dont le deuxième mouvement sonne
comme une déchirure et le dernier, basé sur un thème yiddisch,
telle une lutte contre l'oppression d'un peuple, d'un artiste aussi. On est totalement
subjugué par les divers climats contrastés du 5 ème :
oppressant (le sigle DSCH d'abord presque crypté, puis au grand jour), d'une
désespérance abyssale, d'un dynamisme ébouriffant aussi. Voilà des visions
marquantes qui ne laissent pas de marbre. En élargissant le spectre chambriste
: le Quatuor Modigliani s'adjoignait Gérard Caussé à
l'atlo et Henri Demarquette
au violoncelle pour La nuit transfigurée de Schoenberg. Cette version
originale pour sextuor à cordes est de loin la plus intéressante. On admire la
rigueur de la vision débutée et terminée dans un impalpable pianissimo et la
rectitude de la construction en arche, habitée de crescendos à la fois limpides
et lourds de sens. Autre saut dans le futur : le Quatuor Voce livrait leur
pénétrante vision de Landscape de Toru Takemitsu, où le japonais
s'est inspiré de la nature. Pour évoquer un paysage plus mental que réaliste au
fil d'un voyage onirique, et une courte exploration du temps qui se diffracte.
Ces très courtes séquences enchaînées, faites de frottements, d'impulsions, de
clusters secs, les voient à leur meilleur, eux qui confient faire leurs débuts
à Nantes. Ils poursuivaient par le Quatuor N° 5 de Kevin Volans (*1949), compositeur sud-africain. Les quatre cordes
sont mêlées à des bruits pré enregistrés, qui d'oiseaux, qui de voix d'hommes
et de femmes, etc... procurant une sorte de
prolongement et d'élargissement du schéma sonore. Reste que la pièce est bien
longue surtout dans sa dernière partie, jouée dans le registre calme et intime,
qui ne dégage pas suffisamment de séduction pour maintenir l'intérêt.
L'exécution est sans doute accomplie.
Jean-Pierre
Robert.
Maurizio Pollini, le patricien du piano

DR
Depuis plus de quarante ans le
récital de Maurizio Pollini rythme la vie musicale
parisienne. Que de bonheur ! Ce grand virtuose, au sens propre et noble du
terme, cultive une certaine sévérité qui ne s'est pas amenuisée au fil du
temps. On l'a d'abord prise pour de la froideur, de l'excessive clarté
italienne. Il y en eut en effet à certains moments de cette prolifique
carrière. Mais depuis longtemps elle a fait place à une objectivité fondée sur
une perception raisonnée des partitions, tempérée d'une extrême élégance.
Pianiste « mental », disent certains ? Peut-être. Qu'importe finalement
: cette lucidité en fait bien un aristocrate de l'instrument, comme il en fut
d'Arturo Benedetto Michelangeli. Qui lui fait aborder
Chopin, par exemple, loin de toute self indulgence ou d'excès romantique. Le
programme de ce récital de février 2016 était de la plus pure veine pollinienne : Schumann et Chopin. Avec en préambule,
l'espace d'un court hommage à son ami Pierre Boulez, les Six Petites Pièces
pour piano op. 19 de Schoenberg : une musique de l'épure que Pollini défend depuis des lustres. Beau geste. L'Allegro
op. 8 de Robert Schumann, peu joué, date de 1835 et semble être l'un des
mouvements d'une sonate projetée puis abandonnée. Ce sont des pages
foisonnantes, cultivant un large ambitus du clavier, annonçant en cela bien des
pièces postérieures. Un hors d'œuvre inédit en tout cas à l'exécution de la Fantaisie
en ut majeur op. 17. Le genre de la fantaisie-sonate est fort prisé à la
période romantique. On pense à la Wanderer Fantasie de Schubert. Mais Schumannn
s'approprie aussi le modèle beethovénien pour une œuvre de dimension
titanesque. Elle a été dédiée à Liszt. Ses trois parties jouées enchaînées sont
autant de visions fantastiques sombres ou éthérées. La première, dont
l'indication est : « à jouer d'un bout à l'autre d'une manière fantasque
et passionnée », propose une entame on ne saurait plus fougueuse,
débordant de passion plus qu'enflammée, celle inspirée pour Clara, cette autre
« bien-aimée lointaine » de celle imaginée par Beethoven. La suite de
cette séquence, « Dans le ton d'une légende », déroule une foultitude
de motifs organisés selon plusieurs manières : le monde des contes germaniques,
le ton de nocturne, le style de romance. La deuxième partie « Modéré, avec
une énergie constante » associe les deux paramètres schumanniens du mode
rythmique affirmé, quasi symphonique, et des effluves poétiques. La coda sera
emplie de sauts vertigineux exigeant beaucoup de l'interprète. Familier de
cette pièce, Pollini surfe sur son extrême mouvance.
Le troisième épisode, « Lent et soutenu, dans une sonorité constamment
douce », sorte d'hymne à la nuit, cher aux poètes romantiques, le pianiste
italien en extrait le suc avec panache. Une exécution qui allie sens de
l'architecture et souci du détail, souffle et apaisement. Et un pianisme qui, s'il n'aligne peut-être plus sa légendaire
infaillibilité, la compense par l'intensité de la pensée. Place à Chopin en
seconde partie de concert et à des pièces qu'affectionne le pianiste. La Barcarolle
op. 60 est prise avec une certaine retenue. Puis les deux Nocturnes de
l'op. 55 : un andante très brodé, puis un lento sostenuto, un peu ésotérique,
exhalant le fameux Zal polonais. Pollini
restitue ici un irrésistible sentiment de géniale improvisation. Avec la Polonaise-Fantaisie
op. 61, place aux grands déferlements. Cette dernière de la série des
Polonaises est magistrale en ce qu'elle dépasse le genre, « la plus libre
que Chopin ait jamais écrite », dira le
compositeur Guy Sacre. L'intimisme de la section centrale est singulier. Le
récital se terminait avec le Scherzo op. 39, cher à Pollini.
Sa vision s'avère d'un modernisme étonnant, bousculant le tumultueux même du
morceau, ces « jeux terrifiants » dont parle Cortot. Dix bonnes
minutes de bis de Chopin prolongent l'enchantement et le plaisir souverain que
sait distiller Maurizio Pollini.
Jean-Pierre
Robert.
Une découverte majeure : l'Orfeo de
Rossi
Luigi ROSSI:
Orfeo.
Tragicomédie en trois actes. Livret de Francesco Buti.
Judith van Wanroij, Francesca Aspromonte, Guiseppina Bridelli, Giulia Semenzato, Luigi de
Donato, Ray Chenez, Renato Dolcini,
Dominique Visse, Victor Torres, Marc Mauillon, David Tricou. Chœur de l'Ensemble Pygmalion. Ensemble Pygmalion, dir. Raphaël Pichon. Mise en scène : Jetske
Mijnssen. Opéra de Nancy.

©Opéra
national de Lorraine
L'Opéra de Nancy vient de frapper
un grand coup avec la « re
création » de l'Orfeo de Luigi Rossi, Si
le spectacle est une coproduction avec les opéras de Versailles, de Caen, de
Bordeaux et le CMBV, la primeur en fut réservée à la Lorraine ! C'est à Raphaël
Pichon, inlassable défricheur, que l'on doit la redécouverte de cette œuvre au
passé à la fois original et glorieux. Compositeur italien rapidement propulsé à
Rome, où il occupera le poste d'organiste de l'église Saint-Louis-des-Français,
Luigi Rossi (c.1597-1653) fut appelé à la cour de France par le cardinal de
Mazarin qui souhaitait offrir à sa patrie d'adoption un opéra. Ce sera le
premier du genre. Rossi avait déjà à son actif un premier titre Il Palazzo incantato di Atlante (1642),
inspiré de l'Orlando Furioso de l'Arioste et de nombreuses cantates.
Cette fois, il va présenter une pièce mêlée de tragique et de comique. L'opéra
sera créé au Théâtre de la Reine au Palais royal en 1647 avec un luxe inouï :
machineries somptueuses dues à Giacomo Torelli, maître absolu de cet art à
l'époque, engagements de castrats et même d'un chorégraphe. Le succès fut
immédiat. Puis l'œuvre sombra dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'en 1888, Romain
Rolland retrouve la partition dans la Bibliothèque Chigi de Rome. La première
scénique attendra encore un siècle et 1984, à Pérouse et à Milan, puis 1990
pour sa première intégrale discographique par William Christie (label Harmonia Mundi). Raphaël Pichon se mit au travail pour reconstituer ce ouvrage de proportions gigantesques. Des 6 heures qu'il
comptait à l'origine, il est parvenu à établir un projet tenant en 3H 45,
moyennant coupes claires : en resserrant la trame, dégagée de plusieurs de ses
intrigues secondaires, et en supprimant Prologue et Épilogue, peu en rapport
avec elle, puisque pensés à la louange du monarque régnant, Anne d'Autriche en
l'occurrence. L'histoire est celle légendaire des amours malheureux d'Orfeo et d'Euridice. Mais ici un
troisième personnage prend une signification toute particulière : le berger Aristeo, follement épris de celle-ci, et qui va tenter de
la conquérir avec la complicité agissante de Vénus et d'un de ses factotum, une Vieille femme entreprenante. Le clan d'en
face, pro-Orphée, est mené par Momus et Apollon. Un
triangle amoureux est ainsi au cœur des débats. Les noces d'Orfeo,
qui occupent la première partie, tournent mal. Puis Euridice
est mordue mortellement par le serpent, en fait apporté par Aristeo
qui n'a d'autre réponse que la perte volontaire de celle qui refuse d'accéder à
sa flamme. Aux enfers, Aristeo perd la raison et Orfeo se voit offrir une seconde chance, moyennant la
promesse de ne pas regarder son adorée. On sait ce qu'il advint. Mais - lieto fine - le jeune homme, au moment de se donner la
mort, est averti par Jupiter qu'il peut rejoindre Euridice
au royaume des étoiles. L'opéra revisite donc le mythe pour une meilleure
efficacité dramatique. La musique est d'une incroyable richesse car outre
qu'elle fait une large place aux arias et aux lamenti,
elle utilise les ensembles, chœurs, trios et duos vocaux. Surtout les
récitatifs sont traités avec une densité rare, seco
avec le continuo ou accompagnato. L'instrumentation
mêle les instruments de facture française, savoir les cordes (les fameux 24
Violons du Roy), et une pléiade d'instruments de facture italienne tels que la
lira da braccio, instrument de la Renaissance,
ancêtre du violon, le colascione, luth à long manche
et six cordes, ou des vents comme le flageolet, la flûte à bec et la doulciane, préfigurant le basson. Les cuivres ne sont pas
moins prodigues avec les cornets et saqueboutes. Pichon a reconstitué cet
orchestre mirifique y ajoutant pas moins de trois clavecins.

Francesca
Aspromonte (Euridice) & Judith van Wanroij (Orfeo)
©Opéra
national de Lorraine
La réalisation scénique est des
plus intéressantes. La metteuse en scène hollandaise Jetske
Mijnssen a renoncé à une interprétation didascalique au profit d'une approche intemporelle du
mythe, fondée sur la triangulation amoureuse et le vécu d'Orphée, un homme
finalement de notre époque, balloté entre ses sentiments et la dure réalité des
actes d'autrui : l'intrusion d'Aristeo dans un
parcours a priori linéaire. Vue de cette manière, la trame est porteuse d'un
drame fort : la comédie humaine, ses désirs, ses fantasmes, ses échecs et sa
possible sublimation. Point de machinerie donc. Mais un espace ouvert, sans
référence à un lieu précis, pour les préparatifs et les fêtes de la noce au Ier
acte, puis pour illustrer les tentatives de Venus et de son acolyte aux fins de
détourner Euridice de son amour pour Orfeo. Et enfin un tableau des enfers qui s'illustre dans
une chambre mortuaire où l'on vient rendre hommage à la défunte. La régie est
imaginée en un processus en miroir : à la première scène qui voit Orfeo seul, comme se poser quelque interrogation
existentielle, tandis que la seule harpe égrène ses tristes volutes, répond la
scène ultime où il se retrouve de nouveau seul face à lui-même. Entre ces deux
extrêmes, le déroulement théâtral donnera à voir les tribulations des
personnages, les trois principaux et ceux qui les guident ou
les téléguident. Une direction d'acteurs extrêmement serrée, qui fait penser à
celle si dense de Claus Guth pour la version scénique
du Messie de Haendel, vue aussi à Nancy, procure ce sentiment d'une
action habitée, sans temps mort, malgré la longueur des épisodes ou des sous
épisodes. Ces derniers sont magistralement intriqués dans la trame essentielle.
Les tribulations de la Vieille femme en particulier, cette envoyée de Vénus, qui
ne s'embarrasse pas de précautions oratoires : qui au « Sois
audacieux » lancé par Vénus à Aristeo,
surenchérit « Qu'importe le remède quand il apporte une vraie
guérison », car « Changez de mari! Amants,
si vous ne désirez pas souffrir et toujours languir ainsi, changez d'amour
chaque jour ». Dominique Visse est ici proprement impayable et rachète ce
qui peut confiner à un filet de voix par une composition d'un étonnant naturel.
Plus tôt, les festivités des noces auront montré leurs excès et cette mélancolie
perverse qui souvent peut s'emparer d'une société un peu éméchée. Jetske Mijnssen introduit du
mouvement partout et nul statisme n'envahit les esprits ou les lieux. Ses trois
principaux sont croqués avec soin et pourvus d'une vie intérieure. Ils sont magnifiquement
distribués : Francesca Aspromonte est une Euridice
jeune, gaie, voire piquante, à la voix de soprano pure. Judith van Wanroij un Orfeo sensible et là
aussi fort bien chanté ; et il est dommage que le personnage ne soit vraiment
distingué musicalement qu'au troisième acte. Giuseppina
Bridelli propose d'Aristeo
un portrait d'une fine sensibilité et un chant inextinguible. Tous les autres,
dont Marc Mauillon, Momus,
Renato Dolcini, Satyre, Victor Torres, Endimione puis Caronte, et la basse Luigi di Donato, Augure
et Pluton, sont de haut vol. Les chœurs évoluent sur les mêmes cimes. Tout cela
ne serait pas sans la conviction qu'apporte la direction de Raphaël Pichon et
la finesse instrumentale de ses musiciens de Pygmalion : des coloris diaprés, aux
cordes et aux vents, dont la finesse de la flûte et de la doulciane
et la sûreté des cornets. On admire comment ce jeune chef impose le silence à
la salle, avec quelle douceur il attaque les phrases et conduit de main experte
l'accompagnement des airs et ensembles. Il se dégage de cette interprétation
une chaleur communicative comme une impression de bien-être sonore. De la très belle ouvrage.
Jean-Pierre
Robert.
Sur les cimes du beau chant handélien
Georg Friedrich HAENDEL: Rinaldo. Opéra
en trois actes. Livret de Giacomo Rossi d'après La Jérusalem délivrée du
Tasse. Franco Fagioli, Julia Lezhneva,
Katerina Gauvin, Daria Telyatnikova, Andreas Wolf,
Terry Wey. Il Pomo d'Oro, dir. Stefano Montanari. Version de concert au Théâtre des Champs-Elysées.

Franco
Fagioli, ici à l'abbaye d'Ambronay
©Bertrand Pichène
Après Partenope
le mois dernier (Cf. NL de 2/2016) le théâtre des Champs-Elysées
proposait Rinaldo, dans une exécution particulièrement étudiée. Premier
opéra créé pour la scène londonienne, donné en 1711 au Queen's
Theatre sous la direction du compositeur, Rinaldo
marque un des succès les plus retentissants de la carrière de Haendel. Plus que
l'intrigue quelque peu chaotique, inspirée de La Jérusalem libérée, la
musique ravit les premiers auditeurs, comme elle continue à le faire
aujourd'hui, à la scène, au concert ou au disque. C'est le triomphe de l'aria
da capo bien sûr, souvent truffé d'acrobaties vocales insensées. Mais pas
seulement : les ensembles y sont nombreux, duos en particulier, d'une belle
facture mélodique. Et surtout une orchestration fastueuse mêlant aux cordes
trois flûtes dont un recorder, deux hautbois, un basson et un brelan de quatre
trompettes. L'invention mélodique est sans cesse à l'affût, même si bien des
morceaux vocaux ont été puisés dans des ouvrages antérieurs quoique réécrits et
largement améliorés. A ce titre l'aria fameuse « Lascia ch'io pianga » que chante Almirena
à l'acte II, provient de Il trionfo del tempo e del disinganno, un oratorio romain. Quoi qu'il en soit, la
palette vocale parait sans égale. Et chacun de six personnages se voit gratifié
de morceaux somptueux, aptes à mettre en valeur les talents de leur titulaire.
Cette exécution de concert le démontrait à l'envi. Car on avait réuni un
plateau assez inouï. Le jeune contre ténor Terry Wey distille un fort intéressant discours dans le rôle comprimario d'Eustachio. Andreas
Wolf, de sa voix de stentor magistralement conduite, emplit l'auditorium de
sonorités mâles dans l'aria « sibillar
gli angui d'aletto » et fait montre d'esprit lorsque le personnage
est confronté à la sournoiserie de la magicienne Armide.
De Godefroy, distribué à l'origine à un castrat, la mezzo Daria Telyatnikova, un nom nouveau en poste au théâtre Mariinsky, offre une interprétation extrêmement nuancée,
qu'on prend d'abord pour de la réserve, mais qui s'avère bientôt un atout
d'interprétation. La jolie polonaise Julia Lezhneva,
jadis découverte par Marc Minkowski, et depuis fidèle interprète de Haendel,
déploie un timbre riche dans Almirena : que ce soit
dans l'aria « des oiseaux » où accompagnée du minuscule filet d'un
délicat chalumeau, elle roucoule un chant éthéré, ou à l'heure de « Lascia c'hio pianga »,
presque hypnotique et ému de poésie. L'Armide de
Karina Gauvin, déjà entendue à Glyndebourne, est un
parangon de beau chant handélien, dévoilant les
diverses facettes contradictoires du personnage, depuis « Furie terribili » et ses strettes rageuses des violons
fouettant de périlleuses vocalises, aux diverses autres arias grandioses dont
est constellé ce rôle de magicienne. Enfin, la star assolulto,
Franco Fagioli, offre de Renaud un portrait vocal
proprement étourdissant. Un timbre ensorcellant,
d'une finesse étonnante. La partie titre est nul doute pourvu des plus beaux
airs. On n'oubliera pas de sitôt cet enchainement de trois morceaux au final de
l'acte I : « Cara sposa »,
d'une ligne suprêmement balancée, marquée après un silence évocateur, par une
reprise, le da capo, différemment négociée et une fin dans un souffle. Puis
« Qual ingrato »,
sur un accompagnement de viole et de basse, délicatement distillé. Enfin « Venti, turbini »
aria di furore déversant ses vocalises sur un
orchestre déchainé. Du grand art. Qui nous vaudra encore avec « Or la tromba », un morceau où la voix se mesure à quatre
trompettes dans une joute inouïe qui voit le chanteur enchaîner les traits les
plus tendus et s'envoler dans des aigus dignes d'une soprano colorature. C'est
par de telles acrobaties vocales que les castrats faisaient se pâmer les
premiers auditeurs. Ce sont ces merveilles vocales qui enflamment la salle ce
soir. Stefano Montanari, remplaçant Riccardo Minasi, et lui-même également violoniste, premier violon de
l'Academia Bizantina, offre une direction qui à
l'orée du concert, surprend par sa retenue et un certain parti lymphatique.
Surtout que dirigeant un ensemble de taille réduite, Il Pomo
d'Oro. Mais le souci d'allègement se révèle vite
payant comme la recherche de raffinement de la texture et d'accentuation sans
manière tranchée mais au contraire subtilement différenciée. Les fins de
phrases sont ainsi soignées, avec un ralentissement bien senti. Les voix
profitent indéniablement de cette souplesse générale du discours et les
chanteurs doivent lui en être gré. Un vrai festin.
Jean-Pierre
Robert.
Valery Gergiev, les Viennois et Yuja Wang

Les
Wiener Philharmoniker au Musikverein
de Wien ©Terry Linke
Pour leur concert de résidence
parisienne, les Wiener Philharmoniker étaient dirigés
par Valery Gergiev : des retrouvailles, car le chef
ossète ne les avaient pas conduits depuis un certain temps. Mais elles sont
l'occasion d'une mini tournée européenne, suivie d'un long voyage aux USA et en
Amérique du sud. Autre événement marquant de ce concert : la première
collaboration de la pianiste Yuja Wang avec
l'orchestre. Elle s'effectua avec un concerto de Mozart, ce qui a priori relève
de l'improbable tant pour elle que pour le chef. Leur interprétation du
Concerto pour piano N° 9 dit « Jeunhomme »,
du nom de son inspiratrice la virtuose Mlle Jeunhomy,
est très intéressante. On sait ce concerto prodigieusement intéressant en ce
qu'il marque chez Mozart une transition entre le style presque galant des
premiers opus livrés à l'instrument et la grande manière des pièces
ultérieures. Ici, le soliste se voit doté d'un poids insoupçonné dès l'allegro
initial : échange soutenu avec l'orchestre, discours volubile, que Yuja Wang soutient avec une assurance mêlée de réserve. Le
sentiment s'installe d'une lecture intimiste, comme si la musicienne se livrait
à elle-même une confidence. Alors que l'orchestre de Gergiev,
exclusivement constitué de cordes et de vents réduits (deux cors, deux
hautbois), prône un soutien plus brillant. La profondeur abyssale de
l'andantino, une effusion plaintive poignante, Wang ne cherche pas à l'appuyer.
Au contraire, son toucher presque immatériel donne à ces pages une couleur
mélancolique. Et la courte cadence, comme ce fut le cas pour celle du mouvement
précédent, se pare de pianissimos à la limite de la joliesse. Le rondo final,
si enjoué après ces débordements de tristesse, va s'envoler allègrement sous
les doigts de la pianiste décidément à l'aise dans ce classicisme. Puis
soudain, de nouveau une note émue, ces pages médianes où Mozart s'épanche
encore, jusqu'à la cadence qui ramène la joie conquérante. L'heure des bis
donne lieu à un concert dans le concert et à un amusant épisode : Yuja Wang joue d'abord un largo bien connu de Mozart, puis
fêtée, s'en revient pour livrer... un ragtime endiablé ! Cette rupture
inattendue, fort magistralement assumée, n'est pas du goût de certains au
Paradis du théâtre. Elle revient encore, et pied de nez aux grincheux, entonne
un arrangement-paraphrase jazzy follement déjanté de la Marche turque : tout le
monde est forcé de rendre les armes devant pareille maestria. On ne savait pas
la jeune personne si facétieuse !

Yuja Wang / DR
Le morceau de résistance était la
Symphonie Manfred op. 58 de Tchaikovski (1866,
dédiée à Balakirev). Où l'on retrouve le Gergiev des
grands soirs et un orchestre fidèle à sa réputation. Calé entre la Quatrième et
la Cinquième Symphonie, cette œuvre est un peu une énigme. Loin de la
perfection formelle de celles-ci et de la Sixième Pathétique, il en émane une
force brute, une puissance titanesque, une radicalité, voire une sauvagerie qui
dépassent tout ce que l'auteur a pu écrire pour l'orchestre. Le sentiment de
morcellement n'a jamais été aussi présent, quel que soit le mouvement. Ainsi du
premier, marqué « lento lugubre », qui sur une entame des cordes
graves lancées en traits hachés, des bassons et des cuivres sévères, établit un
climat plus qu'austère : toute la fatalité romantique exacerbée du héros de
Byron, lui-même démarqué du Faust de Goethe, climat qui va se télescoper
avec un autre, plus avenant, celui inspiré du personnage d'Astarté. Gergiev forge ces séquences chaotiques, passant de l'ardeur
tempétueuse à la veine mélancolique, déchainant de rugueux roulements de
timbales ou des effluves éthérées des harpes. Le « vivace con spirito », sorte de scherzo, livre un parcours tout
aussi accidenté, où l'accalmie, lorsqu'elle apparait, s'avère de brève durée.
Les bois sont poussés à la limite d'une sonorité ''infernale'', les flûtes en
particulier sur le fil du rasoir. Les Wiener sont étonnants de pugnacité. Avec
l'andante con moto, Tchaikovski livre un grand moment
de lyrisme, très chantant, comme une pastorale italienne - hommage à Harold
en Italie de Berlioz, qui se serait vu proposer le sujet par Balakirev. On
décèle un rythme de marche, vite abandonné, par un retour de fanfares
martiales. Le finale, « con fuoco »,
ressortit à la bacchanale, à l'épopée emplie de rythmique effrénée, traversée
d'éclairs de lyrisme, jusqu'à une coda en forme de choral où l'orgue est de la
partie. C'est dantesque et prend aux tripes. Car Valery Gergiev,
qui connait son affaire, tire de cet orchestre fabuleux (qui alignait tous ses
premiers couteaux), des sonorités inouïes. Il sait comment assembler ces
morceaux épars pour les lier en un tout cohérent et donner un sens à une symphonie
qui finalement n'en est peut-être pas une, non plus qu'un poème symphonique
d'ailleurs : une œuvre sui generis, de la plus pure veine tchaikovskienne.
Un bis, une valse lente du même compositeur, clôt de manière hypnotique la
soirée et Gergiev, aux saluts, s'efface devant ses
musiciens, héros de la fête.
Jean-Pierre
Robert.
L'opéra parodié ou la parodie à l'Opéra
Florian Leopold GASSMANN: L'Opera
seria. Commedia per musica
en trois actes. Livret de Ranieri de' Calzabigi.
Version révisée par René Jacobs. Marcos Fink, Pietro Spagnoli,
Thomas Walker, Mario Zeffiri, Alex Penda, Robin Johannsen, Sunhae
Im, Nikolay Borchev, Magnus
Staveland, Stephen Wallace, Rupert Enticknap, B 'Rock Orchestra et musiciens de l'Orchestre
symphonique de La Monnaie, dir. René Jacobs. Mise en scène : Patrick Kinmonth.
Théâtre de La Monnaie au Cirque Royal de Bruxelles.

©Clärchen & Matthias Baus
C'est à René Jacobs que l'on doit la
redécouverte de L'Opera seria
de Florian Leopold Gassmann (1769-1774). Il y a
quelque trente ans, il s'est pris de passion pour cet opéra pas comme les
autres, d'abord intrigué par sa qualité littéraire - un livret de Raniero de' Cazlzabigi, l'auteur
de ceux d'Orfeo ed
Euridice et d'Alceste de Gluck!- et surpris par sa veine musicale. Il l'a donné
plusieurs fois en Allemagne et même à Paris, en 2003 au Théâtre des Champs
Elysées. Et puis ce titre codé : « Un opéra intitulé l'Opera
seria ne pouvait guère être un opéra sérieux » !
De quoi s'agit-il ? De se moquer du genre opératique par une vraie caricature
des clichés qu'il véhicule : un art qui enflamme et passionne tous ceux qui le
pratiquent et où l'on s'agite beaucoup. Conçu peu après la publication sous le
manteau, à Venise, d'un pamphlet anonyme – mais dont l'auteur se révéla être
Benedetto Marcello – et titré ''Il teatro della moda'', vrai brûlot
satirique, L'Opera seria de
Gassmann va étriller les défauts symptomatiques d'un sous genre particulier,
celui de l'opera seria
précisément, en empruntant le veine bouffe. Rien de tel pour en filigrane
dénoncer les mœurs pratiquées dans le landerneau lyrique de l'époque et ses
personnages essentiels : le directeur de théâtre, alors appelé impresario, Fallito/faillite, qui se lamente sur les affres du métier
et brocarde les us et coutumes du genre seria, comme
le fera son lointain successeur La Roche dans le Capriccio de Richard
Strauss, le musicien sur son petit nuage, Sospiro/soupir,
le poète librettiste Delirio/délire qui ne conçoit
pas de revoir sa copie, le primo Uomo, Ritornello/ritournelle, parangon de ténor capricieux, la
Prima donna Stonatrilla/trille discordant, appelée
encore Detonante, délirante d'assurance, la seconda
Dama Smorfiosa/mijaurée. Pour illustrer tout cet
arsenal et ses tics, est imaginée la répétition d'un opera
seria, (objet de l'acte II), après une présentation
des divers protagonistes (acte I), et suivie de la première dudit opéra (acte
III). Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu : l'impresario exige qu'on
coupe dans le texte, au grand dam du musicien et du poète qui se rejettent l'un
sur l'autre la charge de cet élagage. La prima donna s'en vient à la onzième
heure et exige tout, le ténor star demande qu'on lui imagine un autre air, cet
« air de valise » qui tiré de son propre répertoire, lui permettra de
mieux briller. La seconda dama fait des caprices et menace de s'évanouir à
chaque effort demandé ; le maître de ballet réclame sa part du gâteau dans la
conduite du spectacle... Chacun des actes se conclut en catastrophe : le
premier dans la confusion générale car décidément rien ne fonctionne entre
personne, le deuxième dans un chaos indescriptible (le metteur en scène
ajoutant même ici une alerte incendie) car la tempête fait rage dans les
esprits et sur le plateau, et le troisième en queue de poisson car la première
de l'opéra tourne au fiasco, huée par l'auditoire, tandis que les mères de
chanteuses, qui ont dans l'œuvre un rôle déterminant, tirent la morale,
renvoyant la responsabilité de l'échec à l'autre. A moins que celle-ci ne soit
tout simplement autre, car comme l'observe Jacobs « la maison d'opéra est
un véritable asile de fous ». Cette satire du seria
par le biais bouffe est surtout agencée de main de maitre par Gassmann dont la
composition musicale combine de manière adroite deux univers qu'a priori tout oppose
: l'aspect libéré de l'opera buffa
et les codes étriqués de l'opera seria.
On n'en finirait pas d'en signaler les éléments : des arias introduits par des
ritournelles d'une longueur exagérée, des récitatifs en dehors des stricts
canons, la voix se démarquant de l'accompagnement orchestral, des modes vocaux
résolument en opposition avec ce qui est dit, exhibitionniste là où le texte
requiert le recueillement, etc... La musique se signale par son inventivité et
sa finesse. L'enchaînement des récitatifs avec les airs est d'une étonnante
liberté. Elle et offre même un côté « moderniste » pour son temps,
et, à son meilleur, annonce Mozart. Ainsi de cette aria
qui au beau milieu du II ème acte, capte l'attention
avec son introduction au clavecin, sa superbe ritournelle orchestrale et une
progression inattendue, puisque débouchant sur un duo ; ou encore tel autre air
avec basson obligé. Si quelques longueurs se font jour aux 2 ème et 3 ème actes, la veine de
la caricature ne souffre pas de baisse de tension, car toujours bien sentie

Finale de
l'acte II ©Clärchen & Matthias Baus
La réalisation scénique due à Patrick Kinmonth est originale. Finalement, le lieu du Cirque Royal
(retenu en raison des travaux à La Monnaie et d'une saison hors les murs)
convient : l'absence de cadre de scène, la vastitude de l'espace offrent à ces
tribulations comico-satirique une belle respiration. Kinmonth a imaginé un dispositif fait de deux plateaux
assemblés l'un derrière l'autre, les musiciens étant disposés entre les deux,
et se retrouvant donc au centre de l'échiquier, le chef dirigeant soit de face
soit de dos selon les exigences de la mise en scène. Autour, des tables avec
lumignons figurent les coulisses d'un théâtre. Une belle solution de continuité
unit ces divers paramètres. Cet effet gigogne autorise une fluidité certaine du
débit, surtout lorsque plusieurs actions évoluent simultanément. La direction
d'acteurs soignée trace des portraits savoureux de chacun des personnages,
caricaturé à partir de ses propres travers. Les traits d'humour abondent : le
directeur muni de sa paire de ciseaux pour sabrer la prose du poète, le ténor
infatué à l'envi, aussi bêta qu'un... ténor, la seconda dama qui fait la
mijaurée, le frénétique maitre de ballet... Les ensembles sont habilement agencés
: cercle de toute la troupe au début adoptant une gestique hyperbolique durant
les trois temps de l'Ouverture, désopilants échanges aigres doux entre musicien
et poète, crêpage de chignon entre les sopranos revendiquant la primauté à
l'applaudimètre, échanges serrés entre le ténor et le poète, le premier
s'entêtant à s'en tenir à ce qu'il croit plus gratifiant. Une constante
animation durant les airs leur ôte leur côté volontairement fastidieux et la
bronca du III ème acte, moyennant un brelan de
camelots dans la salle, est plus vraie que nature... Un ''vrai'' chahut à s'y
méprendre. Côté costumes, on passe du XVII ème au
XVIII ème et à aujourd'hui, in fine lorsqu'on
rabiboche les morceaux après le désastre. Tout cela assoit une intéressante interaction
avec le continuum musical. La troupe se donne à fond, qui sait manier le
burlesque, jouer le second degré du grotesque, assumer l'auto dérision, même si
pas toujours à l'aise avec les invraisemblables acrobaties vocales exigées.
Certains noms étaient de la production du Théâtre des Champs-Elysées, comme
Alex Penda, la prima donna, de grande et fière
allure, Piero Spagnoli, qui de Fallito
passe à Delirio, et brille par l'abattage et une sûre
italianità, et surtout Mario Zeffiri,
le ténor star Ritornello : type de timbre de ténor
très aigu, souvent traité en voix de fausset, enivré de fatuité. On remarque
aussi la belle performance de Sunhae Im, Porporina, la piquante seconda dama de Robin Johannsen et
le fringant maitre de musique Sospiro de Thomas
Walker. Mais le héros de ce spectacle est bien René Jacobs, justement fêté par
le public. Qui distille cette musique attrayante, souvent figurative dans sa
dynamique, par exemple lorsqu'on parle du hoquet de l'âne ou du saut... des
dauphins, explicitant par un amusant bagout ce que le texte peut avoir de
métaphorique, fort entrainante et toujours intéressante même dans ses longues
ritournelles du finale à couplets du III ème acte. Son orchestre B' Rock, augmenté de musiciens de
celui de La Monnaie, sonne clair et charpenté. Du très beau travail.
Jean-Pierre Robert.
Gianandrea Noseda embrase la
Philharmonie de Paris

DR
C'est assurément le feu de l'enfer qui anima
tout du long ce Requiem de Verdi,
terrifiant et tendu, mené de main de maitre par le fougueux chef italien Gianandrea Noseda. Un Requiem comme rarement entendu ce dont
témoigna le silence prolongé du public subjugué après les dernières notes du Libera me, ensuite suivi de nombreux
rappels et ovations. Une interprétation ciselée, sculptée, effrayante, riche en
couleurs, en nuances et en émotions, menée sur un tempo rapide et conduit au
millimètre par un Noseda totalement investi à la tête
d'un Orchestre de Paris particulièrement réactif, engagé et appliqué. Une
partition de Giuseppe Verdi dont on connait l'histoire, esquissée en 1868 pour
la mort de Rossini, achevée en 1874 et donnée à la mémoire du poète Alessandro
Manzoni, ami de Verdi, mort un an plus tôt, chantre de l'indépendance et de la
réunification italienne. La Messa da requiem
suit la liturgie catholique romaine en sept parties, mais il serait vain d'y
rechercher une quelconque ferveur religieuse car il s'agit plutôt d'un œuvre
profane, un opéra en habits ecclésiastiques, comme disait Hans von Büllow, où résonnent
douloureusement tous les affres de la condition humaine face à la mort, un
drame vécu et ressenti par Verdi au plus profond de lui par le décès, entre
1838 et 1840, de deux de ses enfants et de sa première épouse. Une partition
magistrale nécessitant grand orchestre, chœur et quatre solistes (soprano,
mezzo, ténor et basse) s'ouvrant sur l'Introït
chanté pianissimo sur le souffle des cordes graves, suivi d'un gigantesque Dies Iraes où
se déploie une vision tragique de la condition humaine au travers des clameurs
déchirantes du chœur, des appels de cuivre et des interventions des solistes,
avant que ne réapparaisse la lumière du Sanctus et du Lux aeterna et
le Libera me conclusif. Pour une
telle œuvre il faut un quatuor vocal de choix : Erika Grimaldi, puissante même
si le timbre parait quelque peu aride et métallique, Marie-Nicole Lemieux à la
tessiture étendue, mais au vibrato gênant, Saimir Pirgu à la voix chaude, aux aigus larges et ronds, ténor
verdien par excellence dont le très attendu Ingemisco manqua toutefois de
legato pour convaincre tout à fait, et enfin Michele Pertusi, solide donnant à chacune de ses interventions la
profondeur abyssale requise malgré une projection moindre que les autres
chanteurs. Reste à signaler l'excellence du Chœur de L'Orchestre de Paris, souverain
de bout en bout et notamment lors du déchirant Lacrymosa. Un requiem qui
restera, à n'en point douter, dans les mémoires par sa qualité
d'interprétation, mais également par son coté un peu
caricatural très théâtralisé. Dommage cependant que Paris n'ait pu retenir un
tel chef pour une quelconque de ses très belles phalanges !
Patrice Imbaud.
Semyon Bychkov & le Royal Concertgebouw Orchestra : Héroïques !

DR
Le Royal Concergebouw
Orchestra et Semyon Bychkov
étaient de passage à la Philharmonie de Paris dans le cadre d'une tournée
européenne. Un programme on ne peut plus classique mais alléchant compte tenu
de la notoriété mondiale des intervenants, associant le Concerto n° 5 dit « Empereur »
de Beethoven avec le pianiste brésilien Nelson Freire en soliste, et Une Vie de héros de Richard Strauss. L'Empereur est le dernier et le plus
célèbre des concertos pour piano du maitre de Bonn, composé en 1809, celui où
l'équilibre entre orchestre et soliste est le plus abouti en faisant le chef de
file des concertos romantiques à venir. Une œuvre ample, fière, héroïque,
martiale et solennelle dans le premier mouvement, méditative dans le second et
frénétique dans l'irrésistible rondo final.
Nelson Freire en donna une lecture de bonne facture faisant montre d'une
science profonde du jeu pianistique, riche en couleurs et émotions, malgré
quelques imperfections techniques évidentes dans le troisième mouvement,
probablement dues à un tempo trop rapide, d'où une certaine confusion entre les
deux mains. L'accompagnement orchestral fut en revanche un modèle du genre non
seulement du fait de l'excellence de la phalange batave mais également par la
direction souple et féline du chef russe qui sut parfaitement maintenir
l'équilibre entre soliste et orchestre, ménageant avec bonheur aspect martial
et poésie. Le bis donné par le pianiste brésilien emprunté à l'Orphée de Gluck conquit définitivement
la salle. Une Vie de héros de Richard
Strauss fut indiscutablement le grand moment de la soirée. Dernier des poèmes
symphoniques de Strauss, composé en 1898, c'est une partition autobiographique
fictive, identifiant en partie Strauss au héros, pouvant rapidement devenir
grandiloquente si l'on n'y prend pas garde, caractérisée par ses audaces
harmoniques que l'on retrouvera dans les premiers opéras straussiens, Salomé et Ekektra. Plus qu'une fidèle évocation du héros et de ses affres, où l'on
touche les limites de la musique à programme, c'est bien dans la richesse de
l'orchestration, dans l'opulence et dans la beauté des timbres qu'il faut
trouver tout le génie de cette musique, ici magnifiée par un orchestre reconnu
comme un des meilleurs du monde. Là encore Semyon Bychkov nous en livra une vision d'une lumineuse clarté qui
culmina dans les derniers accords laissant la salle dans un silence hélas
encore une fois troublé par des applaudissements précipités et intempestifs…Au
chapitre des félicitations, on pourrait sans excès citer tous les pupitres.
Nous n'en retiendrons que les plus marquants, violon solo (Vesco
Eschenazy) cor solo (Felix Dervaux)
hautboïste solo (Alexei Ogrintchouk)
sans oublier la petite harmonie dans sa totalité et les contrebasses
somptueuses.
Patrice Imbaud.
Mithridate au Théâtre des Champs-Elysées : Uniquement
pour les voix !
Wolfgang
Amadé MOZART: Mithridate. Opera seria en trois actes. Livret de Vittorio Amadeo Cigna-Santi, d'après la pièce éponyme de Jean Racine.
Michael Spyres, Patricia Petitbon,
Myrto Papatanasiu, Sabine Devieilhe, Christophe Dumaux,
Cyrille Dubois, Jaël Azzaretti.
Le Concert d'Astrée, dir. Emmanuelle Haïm. Mise en
scène : Clément Hervieu-Léger.

©Vincent Pontet
Toutes les œuvres rares (la dernière version
scénique de Mithridate fut donnée en
2000 au Théâtre du Châtelet à Paris) ne sont pas des chefs d'œuvre injustement
traités par la postérité. Mithridate fait
probablement partie de celles-ci, car excepté le fait que cet opéra ait été
écrit par un jeune adolescent surdoué de 14 ans et qu'on y reconnaisse en germe
tout ce qui fera du jeune compositeur, le grand Amadeus (aimé des dieux) à
l'origine des chefs d'œuvres ultérieurs que l'on connait, force est de
reconnaitre qu'en dehors de son intérêt historique musicologique permettant de
juger des performances impressionnantes des castrats de l'époque, de
l'orchestration et de la pyrotechnie vocale exceptionnelle, ce qui n'est pas
rien bien sûr, il reste peu de chose
pour en faire un véritable opéra, surtout dans cette dernière production
caractérisée par l'indigence flagrante de la mise en scène. Ce premier opéra seria de Mozart fut donc créé le 26 décembre 1770 au Teatro Regio Ducale de Milan
(future Scala) résultant d'une commande du Comte Karl Joseh
von Firmian, vice Roi d'Italie, gouvernant le duché de Lombardie au nom
de l'Archiduc autrichien Ferdinand. Mozart se trouvera, par cette commande,
condamné aux contraintes de la forme, notamment à l'ennuyeuse succession d'aria
da capo, et soumis aux exigences des chanteurs disponibles. Le livret quant à
lui, ne présente pas de grande originalité, reposant sur le trio bien connu,
soif de pouvoir, amour et trahison.

©Vincent Pontet
Que retenir donc de cette dernière production
du Théâtre des Champs Elysées ? D'abord, et surtout, pour ne pas dire
exclusivement, la qualité vocale superlative du trio féminin, Patricia Petitbon (Aspasie) Myrto Papatanasiu (Xipharès, rôle
travesti, initialement chanté par un castrat) et Sabine Devieilhe
(Ismène), confirmant chacune leur statut reconnu de chanteuses mozartiennes
accomplies, par la beauté lumineuse et poignante de leur chant, leur aisance
vocale, la souplesse de la ligne, la précision des vocalises et leur legato
sublime. Trois personnalités vocales différentes. Pour Aspasie, le dramatisme,
le registre étendu. Pour Xipharès, un timbre plus
sombre correspondant au personnage masculin. Pour Ismène, un chant plus délicat
et très tendu. Ce magnifique casting vocal féminin nous offrant de grands
moments de musique, pour n'en citer que quelques uns,
comme l'air d'entrée d'Aspasia « Al destin, che la minaccia » suivi de « Nel sen mi palpito »
ainsi que la sombre cavatine « Pallid'ombre che sorgete ». Citons
encore le superbe duo entre Aspasie et Xypharès du
deuxième acte et pour conclure le merveilleux air de Xypharès
avec accompagnement de cor solo « Lungi da te »
ainsi que le très virtuose « In faccia all'ogretto »
d'Ismène. Le Pharnace du contre ténor Christophe Dumaux tint sa place, mais la voix manqua de corps et le
timbre sonna un peu nasal. Cyrille Dubois, en revanche, dans le rôle de Marcus,
nous séduisit immédiatement par sa facilité vocale, sa puissance et son timbre
dans son air unique du troisième acte, un chanteur à suivre… Belle prestation à
signaler de Jaël Azzaretti
en Arbate.
Mais la grande désillusion vint assurément de Michael Spyres (Mithridate) pourtant habitué du rôle
semble-t-il ! Sans doute s'agit il, à sa
décharge, d'un rôle particulièrement exigeant par la largeur de la tessiture
requise, l'existence de grands intervalles et la difficulté des ornementations,
toutes difficultés que Michael Spyres ne parvint
jamais à assumer totalement, son chant n'ayant de charme que dans le médium, se
serrant dans l'aigu, parfois à la limite de la justesse.
Dans la fosse on est également déçus devant
la prestation assez insipide du Concert d'Astrée et la direction atypique
d'Emmanuelle Haïm, rendant cette partition terne, sans couleurs, sans nuances
et sans entrain pénalisant un peu cette production du TCE ; achevée
définitivement par la calamiteuse mise en scène de Clément Hervieu-Léger.
Inutile de chercher un quelconque fil directeur, il n'y en a pas : pas de
dramaturgie, pas de direction d'acteurs qui passent le plus clair de leur temps
à s'habiller, se déshabiller, jouer avec des bouts de tissu, jeter des chaises
ou courir sur la scène, dans un décor unique et hideux représentant un théâtre
désaffecté occupé par des réfugiés de guerre… Ceux qui y verraient un
quelconque théâtre dans le théâtre en seront pour leur frais ! En bref, un
opéra comme une ébauche mozartienne et une production assez quelconque qui ne
vaut que par les voix féminines magnifiques, justifiant à elles seules le
détour par l'Avenue Montaigne.
Patrice Imbaud.
Gil Shaham, le violon dans la joie

DR
Ce concert de l'Orchestre de Paris avait un
double intérêt, d'une part la venue sur la scène de la Philharmonie de Paris
d'un des plus grands violonistes du moment, le violoniste israélo américain Gil
Shaham, dans un monument du répertoire, le Concerto pour violon et orchestre de
Brahms et, d'autre part, une merveilleuse pièce orchestrale de Bartók, Le
Prince de bois, exceptionnellement donnée dans sa version intégrale,
conduite par le fameux chef américain David Zinman.
Le Concerto pour violon de Brahms
ouvrait donc cette soirée prometteuse sur une magnifique interprétation de Gil Shaham où rien ne manqua, superbe sonorité du Stradivarius
de 1699 « Comtesse de Polignac », élégance de la ligne, virtuosité du
jeu, cadence de Joachim, dédicataire de l'œuvre, complicité joyeuse avec
l'orchestre (le dialogue entre le violon et la petite harmonie au début du
second mouvement fut un moment de rare émotion), le tout animé par un évident
plaisir de jouer et une empathie palpable avec le public conquis dès les
premières notes. Deux bis extraits des sonates et partitas pour violon seul de
Bach, comme deux moments délicats de musique pure, concluaient cette première
partie. Le Prince de bois de Béla Barók (1881-1945), dans sa version intégrale, occupait la
deuxième partie. Ballet en un acte datant de 1917, comprenant quatorze
mouvements enchainés, nous contant l'histoire des amours contrariées de la
Princesse, du Prince et de son avatar de bois. Une réflexion sur les faux
semblants et l'éloge d'une Nature volontiers capricieuse, hostile et
consolatrice, menée par un orchestre opulent où s'affirme déjà le Bartók de la maturité par l'originalité des
couleurs harmoniques, l'énergie rythmique et les échos de la musique populaire
hongroise. Par sa science de la direction, sa précision et ses choix
d'interprétation, David Zinman sut rendre à cette
partition peu connue et rarement jouée (La Suite
d'orchestre abrégée datant de 1931 étant plus fréquente en concert) tout
son lustre instrumental, sa capacité d'évocation en même temps que son
symbolisme tragique, avant de se conclure sur la paix retrouvée. Une très belle
soirée de concert où soliste, orchestre, chef et programme rivalisèrent dans
l'excellence !
Patrice Imbaud.
Création française du Concerto
n° 2 pour violon et orchestre de Magnus Lindberg

© Chris Lee
Un double évènement musical expliquait
probablement la foule des grands soirs sur les bancs de la Philharmonie de
Paris : la création française du Concerto
n° 2 pour violon et orchestre de Magnus Lindberg,
compositeur finlandais actuellement en résidence auprès du « Philhar », et la venue à Paris, pour cette création,
du chef américain Alan Gilbert qui quittera prochainement la direction musicale
du Philharmonique de New York. Une rencontre qui ne surprendra personne quand
on sait que de 2009 à 2012, le compositeur finlandais fut en résidence à
l'Orchestre Philharmonique de New York pour lequel il composa plusieurs œuvres
et notamment Expo, crée justement
pour la titularisation d'Alan Gilbert à la tête de la phalange américaine en
2009. Magnus Lindberg, né en 1958 à Helsinki est,
sans nul doute, une des figures marquantes de la musique dite contemporaine
avec un catalogue comptant plus d'une centaine d'œuvres dont les points
d'ancrage semblent être une dimension dramatique, une trajectoire avec de forts
contrastes associant densité sonore et mouvement. Après des études de piano, il
suivit l'enseignement de l'Académie Sibelius, puis séjourna à Paris tout en
explorant l'avant-garde musicale européenne. Élève des écoles sérielle et
spectrale, son œuvre s'orienta progressivement vers une sorte de néo
classicisme moderniste. Ce Concerto n° 2
pour violon est le résultat d'une commande, et a été composé en 2015 et
créé la même année par le violoniste allemand Frank Peter Zimmermann qui en est
le dédicataire. Bien différent du premier concerto (2006), le second nécessite
un grand orchestre avec une partie de violon virtuose mais jouable dans un dialogue
avec l'orchestre assez fluide où instrument soliste et orchestre, traités comme
deux entités distinctes, apparaissent tour à tour au premier plan, se mouvant
dans l'espace sonore. Une œuvre de qualité, souverainement servi par Zimmermann
qui en avait assuré la création mondiale à Londres en décembre dernier, sous la
direction de Jaap van Zweden
à la tête du LPO. Le reste du concert, dans un autre registre, était totalement
dévolu à Schumann avec l'Ouverture de
Manfred (1848) et la Symphonie n° 1
(1841). Deux partitions là encore bien dissemblables, la première tourmentée, à
l'image du héros byronien, conduite avec beaucoup de souplesse et de tension
dans le discours, éminemment romantique, sensuelle et poétique, la seconde où
l'on peut sentir en filigrane quelques accents beethovéniens, tout empreinte de
bonheur et de joie (Clara et Robert viennent enfin de se marier), dirigée avec
une certaine galanterie permettant au « Philhar »
de faire la démonstration de la qualité superlative de ses différents pupitres.
Une très belle soirée !
Patrice Imbaud.
Mendelssohn par Yannick Nézet-Séguin à la
Philharmonie de Paris

DR
Un cocktail assez détonant que cette
rencontre entre deux personnalités bien typées, Felix Mendelssohn d'une part,
en qui Debussy voyait l'image d'un notaire élégant et facile, et d'autre part
le fougueux et parfois atypique chef d'orchestre canadien, Yannick Nézet-Séguin, à la tête pour l'occasion d'une de plus
belles phalanges européennes, le Chamber Oorchestra of Europe. Un corpus symphonique de cinq œuvres,
si l'on excepte les symphonies de jeunesse, donné en deux concerts consécutifs.
Des compositions marquées par un lyrisme certain mais contenu, par des couleurs
orchestrales marquées nourrissant un important potentiel d'évocation et un
certain classicisme de la forme. Le concert inaugural affichait donc, deux
symphonies totalement différentes. La Symphonie
n° 3 dite Écossaise (1841) résultant
d'un grand voyage que le compositeur allemand entreprit en Europe de 1829 à
1831, a été créée au Gewandhaus de Leipzig et dédiée
à la jeune reine Victoria. Elle évoque les Highlands écossais dans un savoureux
mélange de brumes, de nostalgie, de ruines, de montagnes, de danses écossaises
et de combats évoquant la rude et difficile histoire de cette contrée mythique,
riche en sortilèges. Elle comprend quatre mouvements, le premier où se
répondent mélodies des vents et vagues houleuses des cordes, un second bâti sur
une romance populaire écossaise très dansante, un troisième alliant marche
funèbre et complainte élégiaque du cor, un finale grandiose
et surprenant qui fait, là encore, la part belle à la petite harmonie. Yannick Nézet-Séguin en donna une interprétation empreinte de
tension dans un habile compromis entre mélodie et drame, très expressive dans
la ligne, riche en images et couleurs, très nuancée, mais forçant parfois le
trait au point de tomber par instant dans une caricature
seyant mal à la personnalité du compositeur (les excès du chef canadien
participant de son attachant charisme…). Venait ensuite la solennelle Symphonie n° 2 dite « Lobgesang » (Chant de louanges). Une
Symphonie-Cantate (1840) rarement jouée témoignant de l'intérêt de Mendelssohn
pour la voix, rappelant sa foi religieuse sincère et sa filiation revendiquée
pour les maitres du passé comme Bach et Haendel. Composée pour la célébration des 400 ans de
l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, elle fait se succéder quatre
mouvements, les trois premiers instrumentaux (la Symphonia)
et une section chorale finale (Cantate) nécessitant un grand chœur, deux
sopranos et un ténor, dans une écriture très polyphonique. Une excellente
occasion de faire valoir toute la magnificence de l'orchestre tous pupitres
confondus, avec notamment une exceptionnelle petite harmonie et une mention
particulière pour la clarinette de Romain Guyot, le cor de Jasper de Waal et
des cordes somptueuses conduites par Lorenza Borrani. Quant au trio vocal (Karina Gauvin, Regula Mühlemann et Daniel Beyle)
il sut se hisser au niveau d'excellence du RIAS Kammerchor,
en regrettant toutefois l'important vibrato de la chanteuse canadienne. Une
interprétation habitée, charnelle et dynamique des symphonies de Mendelssohn.
Une magnifique soirée, un excellent orchestre et un grand chef !
Patrice Imbaud.
Pour le 150ème anniversaire de la naissance d'Erik Satie
Dans le cadre de l'intégrale pour piano seul
de Satie, à l'Auditorium du Musée d'Orsay, et au cours des trois premiers
concerts, on a entendu les tubes mais aussi des œuvres moins jouées, moins
connues, des pièces plus attachantes et d'autres ennuyeuses. Il existe diverses
manières d'interprétation de cette musique : avec une certaine ironie, avec
légèreté ou avec beaucoup de sérieux, peut-être trop, ou encore avec un certain
romantisme mal venu. Ces concerts étaient intéressants quant à l'approche si
différente qu'on peut avoir des œuvres. Celui de Nima Sarkechik,
qui a fait l'ouverture, était parfait : entre chaque œuvre il racontait ce
qu'avait annoté Satie pour jouer ses partitions. Il y a de quoi être perdu, et
il en ressort qu'une certaine liberté est laissée à l'interprète. Sarkechik fait montre d'une certaine décontraction, d'une
habilité, d'une variété de ton pour jouer les œuvres ; ce qui donnait à son
récital un éclat particulier et jubilatoire. Tout le contraire avec Vanessa
Wagner : on était à une sorte de grand messe.
Il ne fallait pas applaudir, il fallait écouter religieusement. Aussi les Gnossiennes et les Nocturnes en
devenaient-ils d'un ennui mortel, et la Gymnopédie n°1 une œuvre romantique... Il ne fallait pas avoir écouté
l'intégrale d'Aldo Ciccolini avant le concert ! Avec
Guillaume Vincent, changement de ton. Il interprétait Satie pour la première
fois, c'était une découverte pour lui. D'où une certaine fraîcheur, par son
touché et la curiosité à découvrir des œuvres peu connues - « Musiques
intimes et secrètes », « Verset laïque et somptueux » … Dans la
manière de caresser le clavier, il apportait une sensualité mutine fort
plaisante. Il termina son concert avec une Passacaille de toute beauté.
Voilà un jeune pianiste d'à peine 25 ans à suivre. Avec ce début prometteur de
l'intégrale on n'a qu'une hâte c'est d'entendre la suite.
Suivront en effet, au mois de mars, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene en duo (le 8 à 12h30), David Kadouch (le 15 à 12h30), Pascal Rogé
(le 29 à 12h30), et enfin un petit opéra, « Mémoires d'un
Amnésique », écrit et réalisé par Agathe Mélinand
sur des musiques et des mots du compositeur (le 7 avril à 20h30 et le 3 à 16h) .
Stéphane Loison.
Festival de Création Musicale de radio France – 26éme édition : Oggi l'Italia !

Chaque année, en février, la Maison de la
Radio vibre au son des musiques de notre temps. Dix huit
ans après avoir célébré Luciano Berio et ses contemporains, le festival
Présences a permis d'entendre, de découvrir, d'apprécier, les personnalités
marquantes d'aujourd'hui d'une Italie multiple. En ouverture, Luca Francesconi, Fausto Romitelli –
grand artiste trop tôt disparu – ont été interprétés magnifiquement par le
Philharmonique sous la direction de Mikko Franck. Salvatore Sciarrino, Franco Evangelisti,
Marco Momi, c'est l'exceptionnel pianiste Nicolas Hodges qui les a joué. D'autres
compositeurs ont été entendu pendant cette semaine comme Francesco Filidei, Mario Stroppa, Aurelio Cattaneo, Francesca Verunelli et
puis aussi Berio, Nono et Ivan Fedele. Outre le
Philharmonique, les Cris de Paris, l'ensemble 2C2m, MDI, le quatuor Prometeo, Le Balcon, Solistes XXI ont joué avec beaucoup de
tenue ces compositeurs. C'était aussi la dernière édition préparée par le
talentueux et humoristique Jean-Pierre Derrien qui prend sa retraite. Des
Français ont aussi été joués durant ce festival : Henri Dutilleux dont on
célèbre le centenaire de la naissance, Édith Canat de
Chizy qui a composé sur des poèmes italiens et qui a
vécu en Italie, Gérard Grisey qui a composé sur des textes
de Piero della Francesca. La semaine s'est terminée
sur une interprétation éblouissante par Le Balcon dirigé par Maxime Pascal,
d'une œuvre de Fausto
Romitelli « Professor Bad Trip ». Juste
avant, quatre madrigaux amoureux de Gesualdo ont été chantés par la soprano Léa
Trommenschlager accompagnée de bassons et d'une
guitare électrique. On rejoint ainsi la phrase de Berio qui s'exclamait ;
« Je crois qu'il faut vivre dans l'esprit de la fin de la Renaissance et
des débuts du baroque ». Forza Italia !
Stéphane Loison.
***
L'ÉDITION MUSICALE
ORGUE
Jean-François
TAPRAY : 5 pièces inédites : 4
Noëls et Air de l'écho pour orgue.
Facile. Delatour : DLT2547.
Jean-François Tapray
(v. 1737 – v. 1819), est une redécouverte récente. On en lira l'historique sur
la partition ou le site de l'éditeur. Rendons donc grâce à Yannick Merlin de
nous faire découvrir ces œuvres qui ne manquent pas d'originalité. Pour en
rendre tout le suc, il faudra disposer d'un instrument haut en couleurs. Nous
possédons la composition de l'instrument dont disposait l'auteur : un
trois claviers pédaliers riche en anches et en mixtures. Comme l'auteur n'a pas
indiqué de régistration, il faudra faire preuve de goût et d'imagination… La
préface qui précède cette édition y aidera fortement.

Gérard
HILPIPRE : Triptyque pour orgue. Moyen. Delatour :
DLT2482.
Il s'agit de la première œuvre pour orgue
écrite par l'auteur en 1986-87. Le premier volet, intitulé Genèse, s'ouvre sur de larges accords fortissimo auxquels succèdent
un tempo agitato. Les différents moments se succèdent pour se terminer par un « Grave »
paroxystique. Espaces est un mouvement lent, méditatif :
Lento mysterioso (extrêmement soutenu, statique, dans
une atmosphère profondément contemplative). Lui succède Arche : Tumultuoso, (dans un perpétuel et puissant jaillissement).
L'ensemble est extrêmement coloré, vibrant de vie
.

Yves
LAFARGUE : Sur le nom de Jules Magen pour
orgue. Moyen. Delatour : DLT2398.
Avant tout commentaire, on a tout
simplement envie de dire : quelle belle œuvre ! D'autant qu'on peut
l'écouter intégralement sur le site de l'éditeur (et Youtube)
dans une vidéo qui fait découvrir en même temps l'instrument sur lequel elle a
été réalisée et l'église qui sert d'écrin à cet instrument. Il s'agit de
l'orgue de Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn et Garonne, construit par Jules Mangen en 1850, revu
par ses fils en 1886 et aujourd'hui restauré. Pour ne pas donner trop de
détails techniques, disons simplement que la pièce a été conçue pour un
instrument typique de l'esthétique de Cavaillé-Coll dont le facteur Jules Mangen a été l'élève. L'ensemble est prenant, priant et
peut constituer autant une œuvre de concert qu'une pièce liturgique. Il faut
disposer, cependant, d'un instrument riche en fonds de 16 et 8 pieds…

Yves
LAFARGUE : Strophe pour orgue. Difficile. Delatour : DLT2399.
Cette pièce a été écrite pour le concours
de composition Dom Bedos de Bordeaux en 2002. Il s'agissait d'utiliser les
sonorités typiques de l'orgue classique français représenté ici par l'orgue Dom
Bedos de l'église Sainte Croix de Bordeaux, restauré par Pascal Quoirin. L'auteur a choisi de s'inspirer des quatre
premiers vers de l'hymne Ave maris stella, en en traitant les mélodies comme autant de
thèmes musicaux et les développant selon les différentes formes classiques.
L'ensemble est somptueux mais devra bien entendu être joué sur un instrument
capable d'en rendre la richesse de couleurs. On peut écouter l'intégralité de
la pièce sur le site de l'éditeur ou sur Youtube.

PIANO
Bruno
PUREN & Cécile EMERY : Apprendre
le piano par les chansons & leur accompagnement. Volume 1 pour
débutants ou recommençants. Volume 2 à partir de la
cinquième année. Fortin-Armiane.
Voilà un ouvrage tout à fait novateur, et
pourtant tellement « évident » dans sa démarche… Le premier volume
couvre tout le premier cycle et le deuxième tout le second. Bien sûr, il faudra
compléter les volumes par un répertoire complémentaire que chaque professeur
pourra choisir selon ses critères habituels. De même, cette méthode ne suppose
pas d'abandonner sa propre méthode. Ce qui est fondamental, c'est la démarche
qui consiste à chanter, à mémoriser, à harmoniser, à transposer chacune des
chansons proposées. Autrement dit, il s'agit avant tout de former la
« pensée musicale » de l'élève quel que soit son âge. Dès le début,
il est proposé à l'élève de chanter en s'accompagnant, l'accompagnement étant
en même temps expliqué dans sa structure. Cette pratique se poursuit en
s'approfondissant tout au long de la méthode. Ajoutons que le terme
« chanson » recouvre aussi bien des thèmes classiques que de thèmes
de variété ou de comédies musicales. Il y a aussi parfois des rapprochements
passionnants : notons, dans le volume 2, la comparaison entre L'hymne à l'amour d'Edith Piaf et Frülingsnacht de Schumann… C'est tout à fait
pertinent et passionnant ! A1joutons que l'ensemble est complété par un
site participatif http://apprendrelepianoparleschansons.com/
On peut retrouver aussi les vidéos sur Youtube :
https://www.youtube.com/user/brunopuren
On ne peut donc que recommander chaudement ce travail remarquable. Les
disciples de Maurice Martenot s'y retrouveront pleinement.


Nathalie
BÉRA-TAGRINE : Méthode
Tagrine. Mes premières années de piano et de
solfège. Van de Velde : Vol. 1 :VV291 ; vol. 2 VV296.
A première vue, cette méthode parait assez
traditionnelle. En fait, elle systématise l'expérience d'une pédagogue, par
ailleurs concertiste, mais qui a consacré la plus grande partie de sa vie à
l'enseignement, suivant en cela l'exemple de sa mère, Nadia Tagrine,
qui a tant contribué, pendant plus de vingt ans avec Roloand-Manuel
à faire connaître et aimer la musique dans l'émission « Plaisir de la
musique ». La plupart des pièces présentes dans ces deux volumes ont été
composées ou harmonisées par l'auteur. Ce sont des modèles de goût qui
formeront avec sureté l'oreille mélodique et polyphonique des élèves. Les
volumes sont accompagnés de deux CDs sur lesquels on peut retrouver l'ensemble
des pièces et qui sont, eux aussi, un modèle d'interprétation. On peut faire
vraiment de la belle et bonne musique avec peu de notes… Ajoutons que le côté
systématique de la méthode permet, paradoxalement, une grande souplesse dans sa
mise en œuvre. Ce n'en est pas la moindre qualité.
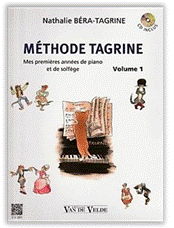

Nathalie
BÉRA-TAGRINE : Pièces
récréatives pour piano. 4 volumes.
Van de Velde : VV303, VV304, VV 305, VV 306.
Cette série de pièces progressives, depuis
le tout début jusqu'à un niveau plus avancé ont en commun de constituer à la
fois, sans le dire, des études progressives, et d'être en même temps de
délicieuses petites œuvres admirablement composées et harmonisées. Sans en
avoir l'air, différents styles de musique sont proposés, qui permettent
d'élargir le goût et la culture des élèves. C'est un répertoire de pièces
courtes, mais de grande qualité.

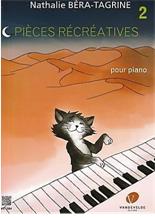

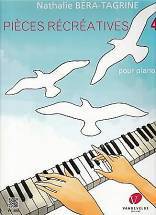
SCHUMANN :
Album für die Jugend. 43 Klavierstücke op. 68 pour piano. Bärenreiter :
BA9641.
A quoi bon une nouvelle édition du célèbre Album pour la jeunesse pourrait-on se dire ? Mais celle-ci
se justifie pleinement. D'abord parce qu'il s'agit d'une édition critique, avec
une copieuse préface et de précieuses indications critiques et
d'interprétation. Mais aussi, on y trouve deux appendices contenant des pièces
autographes mais non retenues dans l'édition imprimée, et ces pièces sont
pleines d'intérêt. Et enfin, on y trouve en allemand, anglais et dans la
traduction française de François (Franz) Liszt ces « Conseils aux jeunes
musiciens », placés à la fin du volume, mais qui devraient l'être en tête,
conseils valables pour tous les musiciens jeunes ou… moins jeunes ! Ils
ont, près de deux siècles après avoir été écrits, gardé toute leur pertinence.
Nous oserons même dire qu'ils sont plus que jamais d'actualité ! Chaque
professeur pourra les faire méditer un par un à ses élèves et… les méditer pour
lui-même. Ajoutons que, pour la première fois, cette édition inclut les
indications de pédale de Clara Schumann.

Matthieu
STEFANELLI : Jeux de mime. 10 études enfantines pour piano. Facile. Delatour : DLT02456.
Basée sur l'observation d'un animal,
chacune de ces études en décrit physiquement l'attitude en l'appliquant à un
travail technique précis. C'est donc bien d'études progressives dont il s'agit.
Chaque posture, chaque geste est soigneusement expliqué et illustré par des
photographies, ce qui n'empêche pas une certaine poésie de se dégager malgré
tout. L'ensemble est progressif et le côté méthodique de ces Jeux de mime
n'est pas l'élément le moins intéressant du recueil.
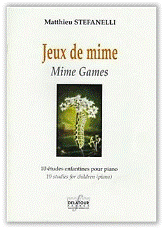
CHANT CHORAL
Charles
GOUNOD : La prière et l'étude. 4
voix égales. Poèmes de Charles Turpin. La Sinfonie
d'Orphée : LSO-0105.
C'est grâce à Musicora
que nous avons découvert cette maison d'édition au catalogue très intéressant.
On le trouvera, ainsi que l'adresse des éditions, sur http://www.lasinfoniedorphee.com/ Cette partition est publiée en lien avec
la parution d'un cahier-répertoire consacré au mouvement orphéonique français,
écrit par Françoise Passaquet et publié par le Centre
de Documentation pour l'Art Choral de Liaisons Arts Bourgogne (http://www.le-lab.info/cdac/ ). Ces
dix-sept courtes pièces, dont la plupart sont en fait à trois voix égales, sont
censées retracer la journée de l'écolier modèle (chrétien). Elles ont été
composées pour l'institution orphéonique de la ville de Paris, dont Gounod
s'occupera de 1852 à 1860 et pour laquelle il écrira des œuvres originales, des
transcriptions, des arrangements adaptés aux groupes dont il avait la
responsabilité. La journée de l'écolier d'avant 1905 est une journée qui ne
connait pas encore la laïcité. A côté des mathématiques, de l'histoire, de la
géographie, on y trouve la prière du matin, et celle du soir. Les pièces,
écrites ici pour voix d'enfants, sont d'une grande simplicité, parfaitement
adaptée aux écoliers de la Ville de Paris. Simplicité ne veut pas dire
pauvreté : très faciles, elles n'en sont pas moins fort jolies… On pourra
sourire aux textes du poète Charles Turpin, délicieusement surannés. Pour le
reste, on se reportera à la présentation pleine de sensibilité, d'empathie et
de compétence de Françoise Passaquet.

CHANT
RAMEAU
Jean-Philippe : Airs d'opéra. Dessus
(Soprano). Vol. 2. Bärenreiter : BA9192.
Après un premier volume dont nous avons
rendu compte dans la lettre 94 de juillet 2015, en voici un deuxième, toujours
en coédition avec le Centre de musique baroque de Versailles et la Société
Jean-Philippe Rameau. Grâce à cela, nous avons droit à une copieuse et
passionnante préface en français de Sylvie
Bouissou, Benoît Dratwicki et Julien Dubruque, abordant tous les aspects de cette publication à
commencer par ce qui concerne la voix de « dessus ». Chaque
« air » est introduit, commenté. Bref, il s'agit à la fois d'une
édition critique et d'une édition de travail tout à fait remarquable.
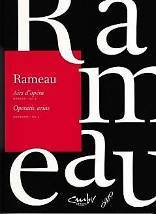
PIANO
Stéphane
MICHOT : Trois regards… pour piano. Moyen. Delatour :
DLT2538.
«Puisant leurs sources dans le passé, ces
regards cohabitent, s'entrecroisent, s'interrogent, s'équilibrent. Car au fil
du discours émerge l'inspiration nouvelle de l'auteur, sorte de second souffle
tourné vers l'avenir...» C'est ainsi que l'auteur lui-même présente cette œuvre
en trois mouvements : Prélude, enrobé
de pédale, Klavierstück au caractère mystérieux, et Le Poète parle – Der Dichter
spricht. Il est, pensons-nous, inutile de
souligner la référence à Schumann.
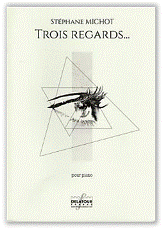
Jean-Luc
GILLET : Fulgure pour piano. Assez difficile. Delatour : DLT2530.
On lira avec intérêt les explications
cinématographiques données par l'auteur mais il n'est pas sûr qu'elles soient
indispensables pour interpréter cette pièce fort agréable qui crée tout
simplement une ambiance sonore à la fois colorée, mystérieuse, un peu
envoutante. On pourra en juger en l'écoutant sur le site de l'éditeur.
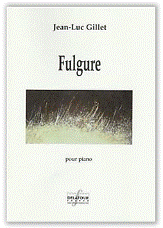
VIOLONCELLE
Rose-Marie
JOUGLA : Tango 13 pour
violoncelle et piano. Difficile. Delatour :
DLT2509.
Cette pièce est la transcription pour violoncelle
de la pièce pour violon et piano que nous avons recensée dans notre lettre 76
de décembre 2013. On pourra donc se reporter à cet article pour y voir toute
les qualités de cette œuvre. Rappelons que la version pour violon peut être
écoutée intégralement sur le site de l'éditeur (et sur YouTube).

FLÛTE
TRAVERSIERE
Bernard
COL : Sonatine pour 2 flûtes traversières. Moyen. Delatour : DLT2534.
Délicieuse, primesautière, ce sont les
adjectifs qui surgissent lorsqu'on écoute, sur le site de l'éditeur cette très
jolie sonatine. Le second mouvement, plus rêveur, comme il se doit, ne
contredit pas l'impression première. Quant au troisième, c'est un presto
endiablé. Le tout se décline dans un langage qu'on pourrait qualifier
de post-tonal. Mais ce qui importe, c'est que c'est tout simplement charmant.
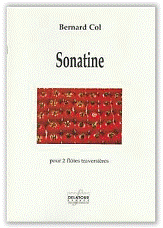
Vincent
FREPPEL : Paysage pour flûte et piano ou orgue. Facile. Delatour : DLT2523.
Un 6/8 langoureux déroule son rythme de
sicilienne sur des harmonies aux couleurs changeantes, peignant les différentes
faces d'un paysage qui se modifie sous nos yeux. L'ensemble se termine par une
envolée lyrique aboutissant à un fortissimo, puis le calme revient, terminant
par un rayon de soleil sur un accord de la Majeur.

CLARINETTE
Marc-Antoine
DELATTRE : Mazazelle pour
clarinette et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2940.
Cet Allegretto cantabile porte bien son
nom : une jolie phrase chantante se déploie dans une mesure à trois temps
rythmée par les « deux croches » du premier temps qui lui donne un
petit air dix-huitième siècle fort bien venu, tandis qu'apparaissent ensuite un
accompagnement en arabesque. L'ensemble est vraiment plein de charme et de
poésie et devrait beaucoup plaire à ses jeunes interprètes.

Rémi
MAUPETIT : B.L.J.M. pour clarinette
et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2876.
Avouons notre ignorance en ce qui concerne
le titre… Quoi qu'il en soit, l'ensemble est plein de poésie. Clarinette et
main gauche du piano dialoguent dans une sorte de canon tandis que la main
droite fait entendre des accords qui résonnent comme des cloches. On passe
alors de 66 à 104 et le piano se lance alors dans un thème syncopé auquel
répond ensuite la clarinette. Les deux instruments dialoguent alors avec
vigueur pour aboutir à un paroxysme qui se termine par un court decrescendo. Il
s'agit d'une pièce variée à l'atmosphère parfois un peu inquiétante, et fort intéressante.

SAXOPHONE
Éric
FISHER : Les Douze Épisodes du Caillou
pour 2 saxophones
soprano. Assez difficile. Delatour : DLT2604.
On verra sur la partition ou le site de
l'éditeur le cheminement de la pensée de l'auteur. Il s'agit d'une écriture
utilisant toutes les techniques contemporaines de l'instrument. Un petit
« caillou », c'est-à-dire un petit motif mélodique, subit successivement
divers avatars « à travers diverses vicissitudes sonores »…

Thierry
ALLA : Parietal pour
saxophone baryton. Difficile. DLT2575.
Cette pièce a été inspirée à l'auteur par
les peintures rupestres et leurs
techniques du « soufflé » et du pochoir. Un ou une saxophoniste joue
et chante à la fois, mais chante dans son instrument. L'ensemble est donc écrit
sur deux portées bien qu'il y ait un seul interprète. Toutes les techniques de
la voix et de l'instrument sont utilisées. L'ensemble crée une ambiance qu'on
pourra découvrir intégralement en vidéo sur le site de l'éditeur.

Philippe
DÉMIER : Quartetto pour quatuor de saxophones. Delatour : DLT2572.
L'œuvre comporte deux mouvements
séparés : Hésitations et Poursuites. Le premier mouvement oscille
entre modalité et atonalité. Les hésitations du thème initial justifient le nom
du mouvement. Le deuxième mouvement est par contraste une pièce de virtuosité,
oscillant entre rondo et fugue. On pourra lire la présentation complète sur le
site de l'éditeur. L'œuvre date de 1985 et caractérise une étape de la pensée
créatrice du compositeur.

Émile
BOUSSAGOL : Romance sentimentale et
Bagatelle pour saxophone alto et
piano. Collection Musique & Patrimoine. Assez facile. Delatour :
DLT2595.
Emile Justin Prosper Boussagol
est un compositeur parisien né à Montmartre en 1854 et mort à Paris en 1917.
Harpiste renommé, chanteur, il fut aussi un compositeur connu dont deux œuvres
furent représentées coup sur coup à l'Opéra-Comique. Les deux charmantes pièces présentées ici permettront
au jeune interprète de montrer toute sa musicalité. Comme toujours dans ces
petites œuvres, il conviendra de ne pas rajouter d'effets inutiles : tout
est écrit, et bien écrit. La partie de piano est facilement abordable par un
élève de niveau moyen.

Bruno GINER : DIY (Do It Yourself) pour 2 saxophones baryton.
Difficile. Delatour :
DLT2455.
Il est évidemment difficile de parler du
résultat final, car celui-ci dépend beaucoup des qualités intrinsèques
d'improvisation et d'écoute des deux interprètes. Néanmoins, on peut dire que
le procédé est tout à fait intéressant et que le canevas fourni par l'auteur
constitue un cadre plein de richesse qui joue sur les rythmes, les timbres, les
couleurs, les frottements… Ce sera certainement passionnant à mettre en œuvre.
.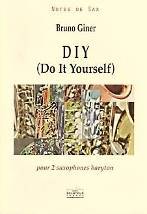
Bruno GINER : Deux
petits chorals pour 3 saxophones
alto ou ensemble. Assez facile. Delatour :
DLT2559.
On ne peut que se
réjouir de voir cette forme musicale présentée aux élèves, elle qui a tant
nourri la musique principalement germanique – mais pas seulement, loin s'en
faut ! – et qu'on est étonné de voir si rarement reconnue quand elle se
présente. De Luther à aujourd'hui, en passant par Bach, Mendelssohn, Schumann,
Brahms, Wagner, Franck, Saint-Saëns, Honegger et tant d'autres, cette forme a
été illustrée de bien des manières. Les deux petits chorals d'écriture atonale
présentés ici sont bien écrits dans l'esprit de cette forme. Le deuxième, comme
le dit l'auteur, « n'est qu'un jeu d'écriture puisqu'il s'agit du premier
choral renversé et rétrogradé avec permutation des parties ». Jeu
d'écriture, certes, mais le résultat n'en est pas moins intéressant !

SAXHORN
BASSE/EUPHONIUM/TUBA
Rémi
MAUPETIT : Week-end prochain pour saxhorn basse, euphonium ou tuba et
piano. Fin de 2ème cycle. Lafitan :
P.L.2879
Que voilà un week-end bien occupé… Après
une introduction du piano en forme de marche, le saxhorn déploie des arabesques
puis un rythme de samba s'installe sur quelques mesures avant un retour au
rythme original. A cela succèdent quelques mesures de 5/8 en 3+2 puis le piano
introduit par une sorte de choral une mélodie chantante du saxhorn qui débouche
sur une cadence et un retour à la première partie. Cette pièce permet aux
instrumentistes de déployer toutes leurs qualités mélodiques et rythmiques dans
un langage bien agréable et original.

TROMPETTE
Vincent
FREPPEL : Cathedral Music
pour trompette en ut et orgue. Facile. Delatour :
DLT2522.
Un refrain et deux couplets dévolus à
l'orgue seul se déroulent sur un rythme martial, mais qu'il est difficile de
qualifier de marche, car il difficile de marcher à cinq temps. L'ensemble est
solennel et illustre bien son titre. La coda se termine en apothéose pour les
deux instruments.

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Romain
TALLET : Racine pour clarinette en sib et saxophone soprano. Moyen avancé. Delatour :
DLT2589.
Les deux instruments se fondent et
s'affrontent en même temps dans un paroxysme de rythmes et de sonorités qui se
termine par une isorythmie fortissimo.

Romain
TALLET : La lune en deuil pour saxophone alto et violoncelle.
Facile. Delatour : DLT2602.
« Contemplation documentaire
zoologique. Mélancolie discrètement perturbée. » Effectivement, on peut
dire qu'il s'agit d'une Elégie où deux parties lyriques et contemplatives sont
séparées par une partie agitée qui ramène à l'apaisement. C'est joli, lyrique
mais n'est quand même pas pour débutants.

Jean-Christophe
ROSAZ : Et si au-dessus des nuages. Sur
un poème de Max Alhau. Moyen. Delatour :
DLT2607.
Il s'agit autant d'interprétation que
d'improvisation. Si récitant et interprète parcourent d'abord dans l'ordre les
neuf courtes sections, ils peuvent les reprendre ensuite dans un autre ordre,
en improviser d'autres y compris en ce qui concerne le texte. Bref, il s'agit
d'une œuvre poétique, lyrique et susceptible de nombreuses interprétations…
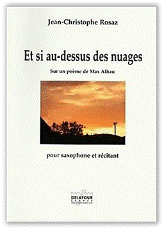
Piotr
TCHAÏKOVSKY : Nocturne op. 19 n° 4 pour Contrebasse et Orchestre ou Quintette à cordes.
Arrangement : Régis Prudhomme. Delatour :
DLT2422.
Tchaïkovsky a lui-même transcrit pour violoncelle et
piano cette quatrième pièce qui fait partie des six pièces op. 19 pour piano.
Il rajoute à cette occasion une cadence et modifie la tonalité. Daniel Marillier et Régis Prudhomme ont réalisé leur propre
transcription à partir des deux versions du Nocturne
et dans une tonalité adaptée au registre de la contrebasse. L'ensemble,
fort intéressant, a été enregistré sur CD. Une version pour contrebasse et
piano a déjà été réalisée par Daniel Marillier, dont
il a été rendu compte dans notre lettre n°40 de juin 2010 (DLT1757).
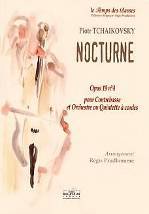
Daniel
Blackstone.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Michel Gérard : Le Hautbois.
Histoire et évolution. Sampzon, DELATOUR FRANCE
(www.editions-delatour.com), 2015 (réf. BDT 0067), 131 p. – 20 €. Play
list YouTube https://www.youtube.com/user/editionsdelatour.fr
Les publications récentes (livres et disques) privilégient volontiers
les instruments de musique et le répertoire adéquat cultivé par les
compositeurs contemporains. Michel Gérard s'adresse à un large public, néophyte
ou professionnel. Ses descriptions organologiques sont associées à plus de 200
illustrations et photographies, dont certaines inédites. La lecture peut être
accompagnée par l'écoute d'enregistrements concernant l'esthétique
contemporaine (cf. play
list).
Ce livre est structuré en quatre grandes parties, faisant suite à une
présentation de la facture du hautbois sous ses diverses formes. La première
concerne l'historique de l'instrument : hautbois du XVIIe siècle, suivi de l'instrument baroque pratiqué notamment par Michel
de La Barre et Jean Hotteterre à La Couture-Boussey où sont fabriqués des chalumeaux et musettes très
appréciés à la Cour de Louis XIII. Le hautbois comprend deux clefs dont le « timbre
doit permettre toutes les inflexions de la voix humaine » (cf. J. S. Bach), puis de nouvelles s'y
ajoutent jusqu'à douze et même treize en Autriche, avec pompe d'accord. Au XIXe siècle, l'instrument moderne — enrichi des acquis, entre autres, de
la flûte système Boehm, en Allemagne — est repris en France par Louis-Auguste
Buffet, puis Frédéric Triébert, avec ajout de
nouvelles clefs (en boule, montées sur socle métallique) ; c'est ce
hautbois « système conservatoire » qui s'imposera en Europe. Au XXIe siècle, le facteur Marigaux lance une
nouvelle conception pour les têtes. Le hautbois peut aussi être préenregistré
(timbres, bruit de clés) dans le cadre de la musique électroacoustique, par
exemple Musique pour hautbois et bande
magnétique (A. Dobrowsky, 1965), avec prise de
son spécifique. La deuxième partie concerne l'aspect organologique très
technique (anche, gougeage, taille, montage,
matériel, accessoires…). La troisième présente les typologies et la famille du
hautbois, entre autres cor anglais, hautbois d'amour,
hautbois baryton, basson, heckelphone, musette…,
bombarde (Bretagne), raita
(Afrique du Nord), suono
(Chine). Les hautbois sont souvent regroupés : Douze Grands Hautbois du
Roi, sous Louis XIII ; La Grande Écurie, avec hautbois et musettes du
Poitou, sous Louis XIV. De nos jours, la relève sera assurée par la Double Reed
Society, l'Association Française du Hautbois et autres Bandes (Bordeaux, Metz,
Mulhouse, Paris-Nanterre). La quatrième partie aborde les techniques avec de
nombreuses définitions très précises. La Bibliographie
concerne les livres spécialisés ; elle renvoie également à des revues et
partitions.
Cette étude d'ensemble — historique, technique et esthétique,
remarquablement illustrée, relevant d'une solide expérience pédagogique, dans
laquelle ils découvriront, entre autres, le compositeur et hautboïste
contemporain Gilles Silvestrini — ravira les historiens, facteurs,
instrumentistes et mélomanes. Informations indispensables.

Édith Weber.
Pascal TERRIEN : Réflexions didactiques
sur l'enseignement musical. Sampzon, DELATOUR FRANCE
(www.editions-delatour.com), Collection Musique/Pédagogie, 2015, 169
p. (BDT 0070) – 15 €.
Le sous-titre : Approches
théoriques, études de cas, épistémologie et histoire des pédagogies résume
à lui seul les préoccupations pédagogiques et l'orientation didactique de
Pascal Terrien, Maître de Conférences à l'Université d'Aix-Marseille et
Professeur de Sciences de l'Éducation au CNSMD de Paris (Département de
Pédagogie).
À partir des programmes officiels de l'Éducation Nationale et de sa
vaste expérience d'enseignant en saxophone et éducation musicale, l'auteur
montre combien cette discipline est en mutation. Ses investigations reposent
sur des sources solides : Journal
Officiel, imposante Bibliographie avec d'excellentes références (J. Piaget,
J. Sloboda, M. Imberty, G. Snyders, A. Zenatti…) ; elles recoupent un faisceau de
disciplines : théorie et pratique, anthropologie et sociologie, didactique
et sciences cognitives et même mathématiques ou encore musiques acousmatiques.
En dix chapitres bien circonscrits, Pascal Terrien ouvre de larges perspectives
émanant d'actions conjointes entre
professeurs et élèves et d'expériences
vécues sur le terrain en de nombreuses circonstances et à des niveaux
variés.
Cette importante contribution à la transmission des savoirs musicaux
et du geste musical représente le dernier état de la question ; elle
suscitera la réflexion des professeurs de musique et des formateurs qui
disposeront ainsi de suggestions pédagogiques pour l'avenir. Que de pistes de
réflexions en perspective…

Édith Weber.
François ROSSÉ,
Thierry ALLA et alia : Questions de tempéraments. Sampzon,
DELATOUR FRANCE (www.editions-delatour.com), 2015, 104 p. (réf. BDT 0073) – 23 €
(avec DVD encarté).
Tempéraments, Association bordelaise de compositeurs (fondée en 1998), a pour
objectif d'encourager, promouvoir et diffuser la création musicale (édition, création,
enregistrement, concerts…) ; à ce titre, elle a organisé une rencontre
hors du commun « en résidence »
autour de questionnements compositionnels.
Préfacé par Jean-Louis Agobet, ce livre-DVD
résulte donc de la confrontation de compositeurs, improvisateurs,
électroacousticiens et instrumentistes (piano, accordéon, guitare, vielle à
roue, mandoline, contrebasse), réunis en 2014, à Bordeaux au Théâtre Molière
pendant deux ans semaines. Ils y ont créé, filmé et enregistré des œuvres
musicales ainsi qu'un spectacle entre
écriture et improvisation. Prolongeant le riche passé musical de cette
Ville, représenté entre autres au XXe siècle par
Henry Barraud, Henri Sauguet, puis Jean-Michel Damase, six compositeurs du XXIe siècle précisent leurs motivations.
François ROSSÉ, d'origine vosgienne, élève de Messiaen à Paris, est à
la recherche de l'originel, du vécu physique du geste instrumental
(chorégraphie), dans une visée anthropologique, il insiste aussi sur
l'influence de l'oralité, et évoque le « décapage de sa culture
occidentale… à travers des situations culturelles non occidentales »,
qu'il redécouvre finalement tout en revalorisant l'espace acoustique. Il
définit la notion de compositeur, sa dimension sociale et humaine dans un
certain « flou » caractérisant notre époque. Ses nombreuses œuvres
illustrent sa démarche esthétique.
Thierry HALLA — après des études très traditionnelles à l'Université
de Tours, puis auprès de Michel Fuste-Lambezat au
Conservatoire de Bordeaux — ne « pense pas faire autre chose que de la
musique actuelle ». Il s'intéresse au son et au timbre, à l'héritage des
grands compositeurs (de Debussy à Ligeti), et souligne les exigences de la
création artistique, de la technicité ; il relève la diversité des
mouvements artistiques. Cette « résidence » lui a permis de sortir de
ses tics d'écriture, d'expérimenter des fragments, puis le spectacle lui-même.
Pour lui, l'œuvre musicale est avant tout une expérience humaine.
Didier Marc GARIN — lors de ses études en Allemagne en 1991— a souhaité
se dégager du formalisme. Il s'est lancé dans l'Opéra (autour de la Divine comédie de Dante), se déclare
proche de la philosophie de l'incertitude et aspire à une certaine sérénité. Il
conclut que « le vécu intensément partagé restera à jamais unique et
indélébile », et voit dans la musique un « art de
partage ». Ses propositions musicales écrites
devaient déboucher sur des séquences
d'improvisation (instruments divers), en principe sans chef, mais il en a
assuré la direction.
Philippe LAVAL, guitariste, compositeur, poète…, bon vivant, hors du
commun, spécule sur le bruit, son organisation artistique, son exploitation et
sa réalisation en plusieurs étapes : « Écrire consiste à mettre sa
pensée en signes » ; Écrire représente une « solitude… on verra bien ». Ses
réactions sont très tranchées ; son style est original, percutant, direct,
parlé et peu académique. À propos de la Résidence organisée par l'Office
Artistique de la Région Aquitaine, il reconnaît y avoir « mis le feu aux
poudres ».
Christophe HAVEL, musicien, acousticien et électroacousticien,
préconise « la musique mixte orientée vers un nouvel hybride » (cf. Illustrations), l'enrichissement de
la palette sonore en une nouvelle équation : « musicien acoustique +
musicien électroacoustique => musique hybride » engendrant une nouvelle
situation musicale. Pour l'auditeur qui perçoit un dialogue entre deux
improvisateurs, il en résulte un discours monosémique.
Étienne ROLIN se livre à des expériences sur le spectre des sons, la
peinture des sons (sound painting) aboutissant à un
élargissement du langage contemporain. Il s'imagine « compositeur comme un
improvisateur ayant tout son temps », puis « improvisateur comme un
compositeur en temps réel », mais aussi « plasticien du présent ».
Il a le mérite de défendre l'intériorité de l'écoute.
Ce compte-rendu de si fructueuses réunions « en résidence »
est accompagné de commentaires personnels, d'illustrations très révélatrices et
d'analyses ponctuelles, ainsi que d'un DVD encarté avec interviews, exemples de
musiques improvisées, musiques écrites et œuvres « mixte écrit/impro ». L'association Tempéraments est ainsi à
l'origine de cette extraordinaire initiative de création collective réunissant
des acteurs de tempéraments ô combien différents. À lire, à écouter et à
réécouter : « l'envie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas… »
(Ph. Laval).

Édith Weber.
Centre de
documentation pour l'Art Choral, Cahier répertoire : Le mouvement orphéonique français.
Dijon, LAB (Liaison Arts Bourgogne) (www.le-lab.info ), n°11, octobre 2015, 43 p. -10 €.
Comme le fait observer Françoise Passaquet,
le mouvement orphéonique remonte à la fin du XVIIIe siècle, évolue lors de la Révolution française car le peuple doit
chanter aux fêtes particulières — cf.
Hymnes d'Étienne-Nicolas Méhul
(1763-1817), de François-Joseph Gossec (1734-1829). Il sera encouragé par
l'industrialisation progressive (Schneider, Schlumberger, Renault, Péchiney…)
et l'arrivée du chemin de fer permettant aux ouvriers et aux paysans de se
regrouper. La création des Orphéons
(voix d'hommes, éventuellement d'enfants) encourage l'éducation populaire et
l'enseignement mutuel, car les parents peuvent s'associer aux écoliers pour
chanter. Ces sociétés chorales réunissant de nombreux corps de métier
favorisent l'émulation, l'entraide et le sens moral.
Les diverses rubriques mentionnent les idées de Saint-Simon
(1760-1825) et de Guillaume-Louis Bocquillon, dit Wilhem (1781-1842) qui insiste sur le rôle de
l'enseignement musical dans les écoles de la Ville de Paris, fonde
l'Association des Orphéons et fera appel à des musiciens de talent pour élever
le niveau choral. Eugène Delaporte (1818-1886) étend le mouvement à la
Province. À titre indicatif, en 1850, quelque 2000 voix sont réunies. En 1870,
de très nombreux chanteurs et instrumentistes célèbrent la Sainte Cécile avec
concerts, banquets, feux d'artifice et bals. Ces manifestations nécessitent un
large répertoire vocal : chants religieux (Messes, Ave Maria,
Prières), populaires, militaires et chants de circonstance (H. Berlioz : Chant des Chemins de fer), pour vanter
les mérites de l'industrie, encourager les travailleurs et stimuler la
fraternité. Après 1870, Orphéons (voix d'hommes) et Fanfares (avec vents, bois,
cuivres, fifres, saxophones) coexistent. Pendant la Première Guerre mondiale,
le mouvement orphéonique perd de nombreux membres ; l'institution tombera
dans l'oubli et les modes de divertissement changeront, notamment avec le
lancement des congés payés. Ce rappel historique — allant de la fin du XVIIIe siècle à l'Entre-deux-guerres — a défini le mouvement orphéonique en
tant qu'institution, en a précisé l'évolution et démontré son apport
pédagogique, didactique, moral, sociologique et politique. D'ailleurs,
l'historien Georges Escoffier affirme que « À travers l'exemple de l'orphéon
apparaît encore une fois clairement la complexité du champ des interrelations
musique-société qui reste largement à explorer » (p. 26).
Ce « CAHIER RÉPERTOIRE » propose également, à l'attention
des enseignants et des chefs, une vaste Bibliographie intitulée « Des
œuvres à chanter », classée chronologiquement et alphabétiquement par
compositeur, allant du XIXe siècle au
début du XXIe, où se côtoient aussi bien Ch. Gounod (1818-1893), C. Saint-Saëns
(1835-1921), Jaques-Dalcroze (1855-1950) que Francine Cockenpot
(1918-2001) ou encore — plus proche de nous — Jean-Jacques Werner (né en 1935).
Excellente mise au point historique et incontournable plaidoyer en faveur du
chant choral : hier et aujourd'hui.

Édith Weber.
« Mozarteum. Das
erste Haus für Mozart ». Photos
de Fritz von der Schulenburg.
1 vol. 26x28
cm, Internationale Stiftung Mozart, Mozarteum/Strube Verlag (www.strube.de) (VS 9169), 2014, 184 p., 233 Illustrations. 34, 50 € (+ frais de
port : 15 €).
Paru pour le Centenaire du Mozarteum
(bâtiment et institution), dont le nom est si représentatif, significatif et
symbolique, avec le concours de sept auteurs et en sept chapitres, ce livre au
format 26 x 28 cm apporte une multitude de renseignements accompagnés
d'illustrations pertinentes et judicieusement sélectionnées. En effet, le 6
août 1910, la première pierre du Mozarthaus (futur Mozarteum) a été posée par l'Archiduc Eugen (1863-1954). Il
sera inauguré en 1914 et deviendra un haut-lieu de concerts, d'enseignement, de
documentation et de rencontres, ayant pour objet de préserver l'héritage
mozartien, de susciter des vocations, d'organiser des concerts autour de
sommités internationales.
Au fil des pages, les lecteurs visiteront et visualiseront ces lieux
prestigieux, des sous-sols aux combles, ils seront subjugués par le charme de
cet édifice polyvalent peu commun, avec beaucoup de relief et une rare
luminosité, comme il ressort des photographies de Fritz von
Schulenberg, spécialisé dans les représentations
d'intérieur et qui rehaussent encore la valeur de cet ouvrage si bien conçu.
D'un étage à l'autre, ils pourront voir le Bar, le Foyer, la Garderobe
(vestiaire) avant de pénétrer dans l'imposante Grosser
Saal, salle de concerts (parterre, loges) avec son
Grand Orgue, au rez de chaussée, comportant également
des salles de répétition et de cours (isolées et insonorisées) servant à
l'École de Musique devenue Université. Avec ses qualités acoustiques exceptionnelles,
la Salle de concerts a été considérée par le compositeur et clarinettiste Jörg Widmann comme l'« une des plus belles au monde ».
De larges escaliers mènent à la Wiener Saal, autre
salle de concert, de capacité plus réduite, à la Bibliothèque (Bibliothecca Mozartiana),
et donnent accès à la salle du Conseil (dotée de matériel informatique récent)
et aux divers bureaux administratifs. Enfin, sous les combles, sont regroupés
des fonds d'anciennes partitions. Les lecteurs côtoieront de nombreux acteurs :
présidents, curateurs, maîtres de chapelle, administrateurs, architectes
successifs, mécènes, musiciens — par exemple : Lilli Lehmann (1848-1929).
Ils retrouveront des documents : programmes de Festivals, extraits de
presse, plans d'architectes, cartes postales, mais aussi gravures et peintures
d'époque, sans oublier, entre autres, les lustres, candélabres, pièces de
mobilier, angelots (dans le vestibule) et même les parquets en marquèterie. Les
chercheurs seront intéressés par les documents d'archives conservés à la
Réserve de la Mozartstiftung ; les historiens d'art, par les
peintures à l'huile, les portraits et gravures ; et les historiens, par
les sources solides : Archives municipales, Künstlerdatenbank exploitées par
les auteurs et le photographe pour les commentaires et les illustrations. Les
sociologues pourront se livrer à une étude des publics successifs et à leur
origine sociale ; enfin, les économistes seront intéressés par les prix
des billets. Les Amis de Mozart seront comblés.
Dans cet ouvrage documentaire si bien ciblé et illustré, et de
lecture agréable, le passé et l'esprit mozartien et salzbourgeois restent très
vivants, sous des aspects complémentaires et indissociables : musicaux,
architecturaux, photographiques et événementiels. Une vraie réussite du genre.

Édith Weber.
Michel SCHMITT : L'Alsace et ses
compositeurs, de la Renaissance à nos jours. Sampzon,
DELATOUR FRANCE (www.editions-delatour.com), BDT 0036, 2015, 2 vol. 929 p. - 69 € (les 2 volumes).
Résultat de dix ans de travail acharné et de recherches minutieuses,
ce Catalogue offre un bilan de la vie musicale régionale particulièrement
imposant et révélateur du passé historique mouvementé de l'Alsace au cours des
siècles, avec sa double culture rhénane. Il sera très utile aux chercheurs qui,
jusqu'ici, ne pouvaient se référer qu'à trois sources limitées dans le
temps : J. M. F. T. Lobstein : Beiträge zur Geschichte der Musik im Elsass und
besonders in Strassburg von der ältesten bis auf die neueste Zeit, (Contributions à l'histoire de la musique…), Strasbourg, Ph. D. Dannbach,
1800 ; Martin Vogeleis : Quellen und Bausteine zu einer
Geschichte der Musik und des Theaters im Elsass (500-1800) — (Sources et éléments pour
une histoire de la musique…), Strasbourg, F. X. Leroux, 1911 (reprint Genève, Minkoff, 1979, non signalé), et Édouard Sitzmann :
Dictionnaire de biographie des hommes
célèbres de l'Alsace…, 1909 (rééd. 2013).
Michel Schmitt a actualisé ces données et recensé plus de 700
compositeurs nés en Alsace, y ayant fait carrière, installés dans cette
Province ou ailleurs. Comme il le précise : « Pour certains,
l'écriture est un métier », et « pour d'autres, la composition est un
loisir ». Cette vaste investigation aura pour conséquence de signaler des
noms très célèbres, mais aussi de faire connaître d'honnêtes musiciens, mais
également d'attirer l'attention sur la diversité des formes cultivées. Son plan
systématique comprend, pour chaque patronyme : 1. Éléments biographiques,
2. Bibliographie sommaire, 3. Compositions (classées par genres et effectifs)
avec éventuellement quelques témoignages. Toutefois, de simples titres courants
faciliteraient grandement la consultation de ces volumes si denses ; il
conviendrait aussi de signaler sur la première de couverture, pour le Tome
1 : A-L et pour le Tome 2 :
M-Z et, pour les Index, de préciser les pages auxquelles les noms renvoient. Ce
vaste contenu aurait aussi pu faire l'objet d'une découpe des volumes par
époque. Les sources exploitées sont solides : Archives de Strasbourg et de
l'Eurométropole, Bibliothèque Nationale et
Universitaire (avec son riche fonds français et allemand), Médiathèque Malraux,
Bibliothèque du Grand Séminaire, Médiathèque du Séminaire Protestant, et sources
secondaires (dictionnaires…).
Les lecteurs curieux trouveront un large aperçu des formes cultivées : musique
instrumentale, de chambre, d'orchestre et, éventuellement, musique électronique
ou électroacoustique, musique vocale et spectacles musicaux (cf. notice François-Bernard Mâche, qui a
dirigé l'Institut de Musicologie de l'Université de Strasbourg de 1983 à 1994).
Ils apprécieront encore les divers métiers de la musique représentés en
Alsace — dont certains sont cumulés par la même personne — : par exemple,
clarinettiste (Charles Thomann) ; guitariste
(Pierre Schott, en outre auteur-interprète, Ingénieur diplômé de l'École Louis
Lumière, compositeur) ; compositeur, pianiste et jazzwoman
(Frédérique Trunk, née à Colmar, résidant à Toulouse,
ayant fait ses études au Conservatoire de Mulhouse et à l'Institut de
musicologie de Strasbourg) ; éditeur, organiste, compositeur, pédagogue
(Daniel Schertzer, né en 1928, directeur de la maison
d'édition « Musica sacra ») ;
compositeur, chef d'orchestre et de chœur, producteur, pédagogue et ingénieur
(Guy Reibel, né à Strasbourg en 1936). Les organistes
sont nombreux : le Chanoine François-Xavier Mathias (1871-1939), titulaire
de l'Orgue de la Cathédrale, Supérieur du Grand Séminaire et enseignant ;
Émile Rupp (1872-1948), organiste de l'Église Saint-Paul, compositeur,
transcripteur et arrangeur ; plus proches de nous : Pascal Reber (né
en 1961), organiste de la Cathédrale, et son professeur, Daniel Roth (né à
Mulhouse en 1942), organiste de Saint-Sulpice et dont
la carrière est internationale… Les lecteurs trouveront, en plus, des
informations sur les Directeurs du Conservatoire : l'allemand Hans
Pfitzner (1869-1949) auquel succédera Guy Ropartz (1864-1955) de 1919 à
1929 ; sur le bibliothécaire et collectionneur de mélodies françaises et
de chansons alsaciennes, Jean-Baptiste Théodore Weckerlin
(1821-1910) ; sur le directeur de l'Orchestre de Radio Strasbourg, Louis
Martin (1907-1978).
Les notices reflètent encore l'histoire
événementielle de l'Alsace. Charles Émile Lévy, alias Émile Waldteufel
(1801-1888), le « roi français de la Valse », a écrit une œuvre en
1834 pour l'inauguration de la Synagogue de Strasbourg (rue Sainte-Hélène). La
messe Victimae paschali de
Joseph Ringeissen (1879-1952) a été créée lors de la
messe du 26 novembre 1918 pour célébrer l'entrée des troupes françaises à
Strasbourg, le 22 novembre. La réouverture de l'Université française, le 23
novembre 1919, a été marquée par un grand Concert de Gala, sous la direction de
Guillaume Riff, trompettiste, chef et pédagogue. Pour sa part, Yvonne Rokseth (1890-1948), professeur à l'Université de
Strasbourg, a composé en souvenir de la Libération (23 novembre 1944) son œuvre
pour chœur : Au Général Leclerc,
créée ultérieurement par Fritz Münch (1890-1970) et
le Chœur de Saint-Guillaume. Le 450e
anniversaire de la venue de J. Calvin à Strasbourg a été marqué par l'œuvre de
commande pour chœur, récitant et orchestre : Évocation de Daniel Schertzer (né en
1928) donnée au Conservatoire en première audition en 1988. La situation linguistique particulière de
l'Alsace affecte le répertoire vocal en allemand, dialecte alsacien, français,
mais aussi latin pour la liturgie catholique. Elle concerne l'inspiration et
les titres, par exemple : D'r Hans im Schnokeloch, œuvre pour
piano du violoniste et chef d'orchestre, Auguste Bopp ou encore sa Polka Haut Koenigsbourg
(Château, Bas-Rhin). Le contexte politique a forcé certains compositeurs à
quitter l'Alsace pour s'installer et faire carrière en France, par exemple Léon
Boëllmann, célèbre notamment par ses Heures mystiques et sa Suite gothique.
Dans ces deux volumes, défilent, à travers les siècles, de nombreuses
célébrités : Othmar
Nachtgall (Luscinus)
(1480-1537), théoricien ; lors de la Réforme, W. Dachstein,
M. Greiter, S. Polio, C. Spangenberg…
Parmi les noms les plus significatifs, figurent Christoph-Thomas Walliser (1566-1648) — qui a même sa rue à Strasbourg
depuis 1996 —, Sébastien de Brossard (1655-1730), prêtre, théoricien,
compositeur, bibliophile, maître de chapelle à la Cathédrale de Strasbourg,
fondateur d'une Académie de Musique, auteur du premier Dictionnaire de Musique en langue française (1701). À signaler,
entre autres, la famille des facteurs d'orgues Silbermann,
le théologien et liturgiste Frédéric Spitta, la pianiste Marie Jaël, le chef Paul Bastide, Mgr Alphonse Hoch (1900-1967), chef de chœur à la Cathédrale, président
de l'Union Sainte Cécile et instigateur de la Commission Diocésaine des Orgues.
Des compositeurs célèbres sont mentionnés, tels que Léon Boëllmann
(né en 1862 à Ensisheim, mort en 1897 à Paris, où il s'était installé après
l'Annexion allemande de l'Alsace en 1870) ; Marie-Joseph
Erb (1858-1944), Guy Reibel
et, plus proches de nous, Jean-Jacques Werner (né à Strasbourg en 1935), chef
de nombreux orchestres, mais aussi corniste, harpiste, pédagogue et directeur
de conservatoire, compositeur dont la production prolifique englobant tous les
genres (p. 818-827) et diffusée à l'étranger, qui gagnerait beaucoup à l'être
davantage en France.
Cet ouvrage monumental comporte un Index des auteurs d'Alsace cités (dans la bibliographie), un Index des compositeurs d'Alsace, des
Tableaux synoptiques (Lieux de naissance, de résidence ; parcours
professionnel) ainsi qu'une Bibliographie.
Incontournable outil de travail et de référence, il reflète, au fil des pages,
la vie musicale et culturelle, cultuelle et liturgique, événementielle et
institutionnelle en Alsace du XVIe au début du
XXIe siècle.


Édith Weber.
« La
musique fait sa révolution ». Les Dossiers d'Alternatives Économiques,
Décembre 2015, Hors-série n°2 bis, Quétigny, 2015 (www.alternatives-economiques.fr), 98 p.
– 9, 50 €.
Ce numéro, avec un titre accrocheur, implique un discours à la fois
historique, sociétal, économique et politique relatif à la multiplicité des
formes et pratiques musicales : chansons actuelles, rock, pop, hip hop,
hard rock, musiques électroniques… La musique « rythmant la vie des
sociétés humaines depuis toujours » a, au cours des siècles, suscité de
nombreuses techniques et une grande évolution du goût et de l'émotion. Cette
« révolution » de la musique est, en fait, favorisée par l'apport
récent de l'informatique et du numérique.
Dans son éditorial, partant de l'état de la musique au quotidien, de
son écoute, de ses acteurs et des mélomanes, Marc Chevalier observe que
« la manne sonore déferle partout », que le
numérique « n'est pas qu'une bénédiction » et qu'il
« démultiplie les possibilités de la création ». Ce constat est à la
fois réaliste et paradoxal. Les modes d'écoute varient selon les publics
immergés dans la musique à la maison ou au travail. Les genres musicaux
évoluent tout comme les supports : de la cassette au disque compact, puis
au fichier mp3, sans oublier la musique électronique, la numérisation et YouTube. Les goûts sont affaire de générations et
d'appartenance socioprofessionnelle. Les jeunes privilégient la chanson
française, d'autres la chanson internationale ou encore le rock. Le classique
est en phase de déclin sauf pour les 60 ans et plus. La musique peut apporter
une évasion et une détente. Toutefois, la pratique instrumentale régresse. Il
faudrait (cf. p. 19) revenir à un
apprentissage traditionnel de l'histoire de la musique et du solfège et ne pas
sous-estimer la vocation sociale de l'orchestre. Ce bilan de la situation au
début du XXIe siècle suscite de nombreux questionnements. Les 27 contributions —
étayées de statistiques, graphiques percutants et grilles par tranches
d'âge — traitent, outre la pratique,
« la vie après le disque » (industrie, export, festivals en quête
d'un nouveau souffle) ; la menace de la « destruction
créatrice » du streaming, le star system,
les concerts, l'exemple de David Bowie « portrait d'un artiste entrepreneur ».
Plusieurs interviews sont centrées autour du numérique, des problèmes de la
protection juridique des auteurs et de leurs droits, du financement de la
création, mais aussi de l'« utopie de la création numérique pour
tous ». Enfin, la dernière partie de ce volumineux Dossier concerne
« le cerveau enchanté », les « vertus thérapeutiques » de
la musique (en cas de dépression, d'anxiété, de maladies de Parkinson, d'Alsheimer) pouvant apaiser, détendre ou stimuler.
Selon l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss (1908-2009),
la musique existe probablement depuis la naissance de l'humanité, depuis le
Paléolithique supérieur (sifflets, percussions de l'homo sapiens). En
conclusion, l'ethnomusicologue Simha Arom, directeur de recherche émérite au CNRS, affirme que
« ce qui est universel, c'est l'omniprésence de la musique ; elle est
un marqueur identitaire dans toutes
les sociétés », mais il déplore qu'elle connaisse « une déperdition
liée à la mondialisation ». Approche très éclairante.

Édith Weber.
Colette MOUREY : L'intelligence
musicale. 1 vol Crans-Montana
(Suisse), Éditions Marc Reift (www.reift.ch). (EMR 18752), 58 p. +
Catalogue de la Collection C. Mourey (3 p.)
Partant du point de vue que l'intelligence musicale est « doublement
rationnelle et intuitive » et que « l'audition est à la fois de
caractère subjectif et objectif », Colette Mourey,
musicologue, enseignante et guitariste, constate que la musique, « proche
de l'intelligence linguistique mais aussi de l'esprit scientifique » (p.
54) nécessite une attention « aiguisée, forgée par la volonté » et
devant être longuement soutenue.
À l'aide d'exemples musicaux pertinents, de nombreux schémas,
d'extraits de partitions et de diagrammes — tout en rappelant que la pensée
musicale est abstraite et sollicite l'écoute corporelle globale et que les
émotions sont associées à l'intelligence —, l'auteur distingue trois types.
Premièrement, l'intelligence rythmique est
le fondement des cultures orales (cf.
danses primitives, métrique binaire et ternaire aboutissant à l'« a-métrie » dans la musique contemporaine. Elle est
tributaire des effets vibratoires et des niveaux de pulsation (battements du
cœur, algorithmes), du bipartisme (ouvert/clos) et du tripartisme (A B A'), la
musique possède un « potentiel de libération » (p. 27). Deuxièmement,
se greffant sur l'intelligence rythmique, l'intelligence
mélodique a besoin d'échelles musicales (ou modes). Dans le cas de
l'improvisation, le musicien exploite des motifs, peut les orner mais doit
respecter l'architecture du mode. Dans le cas de la musique écrite, le
compositeur choisit son échelle que l'interprète devra reconnaître. L'auteur
rappelle l'évolution historique : modalité et modes d'Église au Moyen
Âge ; modalisme (majeur/mineur) entre 1750 et 1820 ; élargissement
aboutissant à la polytonalité, à l'atonalité et au dodécaphonisme depuis la fin
du XIXe siècle. La hiérarchisation des degrés, le choix des registres
(grave, médium, aigu) contribuent à l'expressivité et aux effets de tension à
travers la structure de la phrase musicale (exposition, transition,
développement) ; elle peut être stable ou modulante. Troisièmement, l'intelligence harmonique, connaissant un
développement assez complexe dans la musique occidentale, est une « combinatoire
scientifique » entre harmonie et contrepoint, faisant appel à une voix
principale et des contrechants, alors que l'harmonie — tout en tenant compte de
la mélodie — peut exploiter des basses fonctionnelles et des accords arpégés.
L'orchestration fournit les coloris et les timbres. L'audition et la perception
polyphonique sollicitent la pensée, l'émotion, le geste et exigent une
concentration soutenue. La perception, à la fois conceptuelle et analytique,
deviendra écoute, appellera la discrimination, aboutira à la découverte du
monde et incitera à un retour sur soi.
Telles sont — allant pour l'essentiel au plus près des propres termes
et définitions de l'auteur — les principales orientations de cette publication,
résultant d'une vaste expérience, d'un solide sens de l'observation et de la
discussion. Colette Mourey s'appuie en partie sur les
travaux de Howard Gardner (1983) à propos des intelligences multiples. Elle a
le mérite de prolonger les théories de la perception lancées vers 1960 par
Robert Francès, puis Michel Imberty,
Arlette Zenatti… et démontre à quel point ces trois
types d'intelligence musicale associés à une perception volontariste sont
complémentaires et imbriqués. En fait, cette publication des Éditions Marc Reift n'est qu'un commencement, et l'auteur annonce
d'autres parutions (chez Delatour France). À suivre.

Édith Weber.
Nicolas MARTY
(textes réunis, traduits et introduits par) : Musiques électroacoustiques.
Analyses<->Écoutes. Sampzon,
Éditions DELATOUR FRANCE (www.editions-delatour.com), 2016, 231 p. – 32 €.
Du 17 au 20 septembre 2014, à l'Université de Louvain, Nicolas Marty
a organisé la session Listening to electroacoustic
music through analysis,
réuni, traduit et introduit les interventions. Ces Actes préfacés par François
Delalande comprennent 11 communications axées autour de deux
perspectives : théoriques et analytiques, puis abordent les
« Écoutes, analyses et transmissions des musiques électroacoustiques, mais
aussi acousmatiques ». Elles sont liées aux problèmes d'écoute, de
perception et de réception, partant du fait que « l'écoute guide
l'analyse » (des musiques instrumentales, vocales, acousmatiques, mixtes,
concrètes et des « musiques des sons ») et s'appuyant sur les
recherches antérieures de Pierre Schaeffer (objet musicaux), J.-J. Nattiez
(sémiologie)…, sur les œuvres musicales de Pierre Henry, entre autres, ainsi
que sur les expériences de Lasse Thoresen (Fig. 7) et
les idées de Stéphane Roy, Leigh Landy, François
Delalande. Cette session a abordé de nombreux aspects : recherche de
vocabulaire et d'outils intellectuels et matériels ; justification
épistémologique ; hiérarchie des sons ; approche constructiviste de
l'analyse de la musique électroacoustique ; sonologie ;
approches pictographique, créative, écologique…
L'affirmation : « l'écoute guide l'analyse et
vice-versa » est confirmée par la diversité des écoutes. Elle sert de fil
conducteur d'une contribution à l'autre. À noter l'idée que « l'analyse et
l'écoute dépendent d'une médiation ou sont influencées par celle-ci » (p.
33). Cette pédagogie assistée nécessite un entretien d'explication ou un
entretien semi-directif. À noter également l'analyse spectromorphologique ;
l'Analyse Comparative Automatique de la Musique
Électroacoustique (ACAME) ou encore l'E
analyse avec différents logiciels d'acousmographie. Enfin, la synthèse des principes théoriques
(cf. p. 160, Fig. 1) est du ressort
de la spectromorphologie, de la typomorphologie…
D'autres disciplines sont aussi sollicitées : phénoménologie cybermétrique, science de l'organisation, écoute
herméneutique et transculturalité. Elles témoignent
de l'extrême variété des démarches, des paramètres et de la variété des
esthétiques musicales en cause pour aborder cette « musique des
sons ». Les communications sont suivies de très utiles éléments bibliographiques :
ouvrages ou articles en anglais et en français relatifs à plusieurs disciplines
concernées : perception de la musique, linguistique, comportements, Gestalttheorie,
sciences cognitives, systèmes interactifs, données environnementales, conduites
d'écoutes, phénomènes de conscience…) soulignant encore la complexité de ces
Actes autour de la réciprocité entre « Analyses et Écoutes ». Dans la
Keynote (p.
209), Leigh Landy pose la question
fondamentale : « Comment l'analyse fondée sur l'écoute peut-elle
faciliter la compréhension et l'appréciation de la musique
électroacoustique ? »
En conclusion, la réponse s'avère positive : voilà ce que démontrent,
par une extrême variété des approches et des œuvres citées, les démarches de
cette session autour du titre « L'écoute de la musique électroacoustique à
travers l'analyse ». Au final, « l'Analyse renvoie à l'écoute »
et vice-versa ; par conséquent, l'écoute est indissociable de l'analyse.

Édith Weber.
***
LE BAC DU DISQUAIRE
Johann Sebastian
BACH : 6 Sonatas à 2 clav. et Pedal BWV 525-530. Ulrich Böhme, orgue. 2 CDs RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP 608586. TT.: 82' 55.
Le 9 mars 2016 —
faisant suite au lancement de ce disque le 12 février 2016 —, l'Église
Saint-Thomas de Leipzig, au riche passé historique, fêtera les 30 ans de
service de son organiste titulaire, Ullrich Böhme, au
rayonnement international.
Il a enregistré les
6 Sonates en trio de Bach à cinq
instruments différents se rattachant certes à l'esthétique baroque, mais
présentant des diversités de paysages sonores et de couleurs spécifiques et
bénéficiant de conditions acoustiques particulières. Outre l'« Orgue
Bach » — dont il est le brillant titulaire —, il a retenu 4
instruments : l'Orgue Hildebrandt (1746) à Naumburg ; les Orgues de
Gottfried Silbermann (1683-1753) à Freiberg (1714) et
à la Hofkirche de Dresde (terminé par Hildebrandt),
ou encore le Dreifaltigkeitsorgel
à l'Abbaye bénédictine d'Ottobeuren, en Bavière, instrument influencé par le
facteur alsacien Andreas Silbermann (1678-1734) qui a
notamment réalisé l'Orgue historique de l'Église luthérienne Saint-Thomas à
Strasbourg. Les 6 Sonates à 2 Clav. et Pedal
(BWV 525-530) ont été composées vers 1730. Comme de juste, Ulrich Böhme se
réfère au manuscrit autographe de Jean Sébastien. Johann Nikolaus
Forkel, son biographe, précise bien qu'elles sont
destinées à l'orgue avec pédale obligée. Ces œuvres, réalisées par le Cantor en
pleine possession de ses moyens, ne peuvent être abordées que par un
instrumentiste maîtrisant parfaitement toutes les difficultés techniques :
agilité des doigts, vélocité des pieds et leur coordination précise. Elles
n'ont rien de commun avec la « forme sonate » classique. Elles
comprennent généralement un mouvement lent central encadré de deux mouvements
rapides, par exemple Allegro, Andante, Allegro ou Vivace, Largo, Allegro, mais aussi Adagio-Vivace,
Andante, Un poco allegro (n°4, BWV 528). Les mouvements lents sont
particulièrement méditatifs, expressifs et intériorisés ; les mouvements
rapides, bien enlevés avec précision.
Avec ces
enregistrements en des lieux divers contribuant à l'originalité de cette
réalisation, l'actuel organiste de Saint-Thomas rend un bel hommage à son
illustre prédécesseur à Leipzig. Ce disque s'impose par sa haute musicalité,
ses nombreuses qualités d'interprétation, mais aussi par les paysages sonores
et les registrations variées et surtout le déploiement de tant de coloris.
L'église Saint-Thomas de Leipzig peut s'enorgueillir de bénéficier des services
d'un tel organiste : Ad multos annos.

Édith Weber.
Jean-Jacques
WERNER : Œuvres
pour orgue – Bozidar KANTUSER : Intégrale de l'œuvre
pour orgue. Georges Delvallée, orgue. 2CDs
AZULEJARIA (www.azulejaria-cdaudio.com ) : AZ 6971. TT : 44'57+ 51'47.
Jean-Jacques
Werner, compositeur et chef d'orchestre de réputation internationale, est né le
20 janvier 1935 à Strasbourg, et a donc fêté ses 80 ans en 2015. Ses attaches
luthériennes, son intérêt pour l'hymnologie protestante et notamment Jean
Sébastien Bach sont bien connus. Les œuvres sont interprétées en connaissance
de cause par Georges Delvallée
(né deux ans après le compositeur), à l'Orgue Haerpfer-Erman (1967) de la Basilique de Saint-Quentin, instrument à
quatre claviers : Positif, Grand Orgue, Récit expressif, Écho et pédalier
avec, entre autres, Bombarde 32' et Ranquette 16'.
Ses nombreux jeux permettent d'exploiter et d'associer des timbres très variés.
Le premier CD de ce
coffret comprend une sélection de Préludes
de choral composés en 1962 dans lesquels Jean-Jacques Werner traite des
chorals luthériens, entre autres : Gottes Sohn ist kommen ;
Erbarm'dich mein, o Herre Gott ; Nun danket alle Gott ou encore
l'incontournable Ein feste Burg/C'est
un rempart que notre Dieu (en deux parties). Comme le souligne le
compositeur, il va « au plus près du sens théologique du texte ». Le Cantique de Siméon : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix, créé en 1983, est une commande du
Conservatoire de Paris ; son langage d'une grande densité harmonique
spécule sur des timbres très recherchés. Composée dix ans avant, son œuvre
intitulée Spiritual, pour violon et
orgue, est interprétée en parfaite connivence par Annie Jodry,
la célèbre violoniste, et Georges Delvallée, son
organiste de prédilection. La Toccata,
deuxième partie de son Triptyque pour orgue (1959) démontre l'écriture
très personnelle de ce compositeur si attachant et de réputation internationale.
Le second CD
présente l'Intégrale de l'œuvre pour orgue
de Bozidar Kantuser,
né en 1921 en Slovénie. Selon le texte de présentation de Jean-Loup Chirol, d'abord installé à Ljubljana, il est formé par le
compositeur S. Koporc ; déporté en Italie, il
s'en évadera pour rejoindre la résistance yougoslave en 1944. Il reprend
ensuite ses cours de composition. Dans les années 1950, installé à Paris, il
est l'élève d'Olivier Messiaen et de Tony Aubin. Après des voyages :
France, États-Unis, Yougoslavie, il meurt à Paris en 1999. Il a le mérite
d'avoir créé la Bibliothèque Internationale de Musique Contemporaine qui porte
son nom. Son Prélude et Fugue, op. 1
pour piano (1946) a été adapté pour orgue par Georges Delvallée
qui est aussi dédicataire de How long…
(1974), d'après le Psaume 13 : Jusques à quand, Éternel,
m'oublieras-tu ? qu'il a créé en 1982, de
même que les cinq Préludes : Mystères, Carillons, Nocturnes, Ferveur, Passion. Son Esquisse —
en deux parties, baignant d'abord dans l'agressivité, puis dans le calme — et
sa Toccata de caractère tragique et
angoissé sont enregistrées pour la première fois dans une version révisée à
partir de manuscrits et notes du compositeur par leur dédicataire, Georges Delvallée. Grâce à lui, ce coffret contribuera largement à
une meilleure connaissance de l'œuvre organistique de Jean-Jacques Werner et Bozidar Kantuser. Version de
référence.

Édith Weber.
« Flaschenpost-Geheimnisse.
Paul DUKAS und seine Schüler
ALAIN, MESSIAEN und DURUFLÉ ». Sebastian Heindl, orgue. 1CD
RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de ): ROP 6115. TT : 69'02.
Interprété par le
très jeune organiste leipzicois, Sebastian
Heindl au Grand Orgue Schuke
de la Cathédrale de Magdebourg, ce disque, « sans illusions »,
intitulé : « Bouteille à la mer-Curiosités », associe, en fait,
quatre compositeurs français ; le sous-titre précise « Paul
Dukas et ses élèves… ». L'interprète a réalisé une spectaculaire
transcription pour orgue du ballet La
Péri de Paul Dukas (1865-1935). En fait, La Fanfare introductive — nécessitant un orchestre de cuivres au
grand complet — est rendue à l'orgue de façon très impressionnante et tout à
fait plausible, grâce à une registration oscillant entre puissance et calme.
L'Orgue Schuke se prête parfaitement à la restitution
de ce poème dansé réalisée en première mondiale par l'audacieux organiste.
Poursuivant son programme de musique française, il s'est souvenu de Jehan Alain
(1911-1940) dont il interprète deux Fantaisies
dans le langage du XXe siècle ; la Deuxième, composée en 1936, s'inspire
du folklore d'Afrique du Nord « souvent interprété par le charmeur de
serpent sur son petit hautbois ou encore clamée par le muezzin du haut du
minaret », comme le rappelle la regrettée Marie-Claire Alain. Cette œuvre
résume les recherches du compositeur sur les plans mélodique, rythmique et
polymodal ; en outre, il a pris soin de préciser les registrations
souhaitées pour rendre des atmosphères si variées. Olivier Messiaen (1908-1992)
est représenté par L'Ascension en 4 Méditations symphoniques. D'abord prévue
pour orchestre en 1932 et créée en 1944, l'œuvre a été arrangée pour orgue en
1934, et porte les titres : I. Majesté
du Christ demandant la gloire à son Père (Jean, 17, 1), Choral majestueux
de structure répétitive ABA' mettant l'accent sur l'exaltation du Christ. II. Alleluias sereins d'une âme qui désire le ciel
(Messe de l'Ascension), supplication de caractère serein avec alternance
refrain-couplet. III. Transports de joie
d'une âme devant la gloire du Christ… se présentant comme une
improvisation. IV. Prière du Christ
montant vers son Père (Prière sacerdotale évoquant l'entrée du Seigneur
ressuscité au ciel).Messiaen souhaitait conclure dans une atmosphère
mystérieuse si bien rendue par le talentueux jeune organiste. Cette production
si originale se termine par le Choral
varié sur le Veni Creator Spiritus op. 4 de Maurice Duruflé (1902-1986), œuvre de
concours de composition datant de 1930 dans laquelle l'Hymne est suivie de 4
variations. À peine âgé de 17 ans, Sebastian Heindl inaugure une belle carrière d'organiste. Bien plus
qu'une « bouteille à la mer », il fera longtemps encore parler de
lui. À écouter avec curiosité et respect.

Édith Weber.
« Marie et Jésus, son Fils ». Chant grégorien.
Schola of Saint John's
Abbey and University. 1CD JADE. (www.jade-music.net ) : CD 699 874-2. TT : 54' 28.
Voici le chant grégorien made in USA
émanant de la
Schola of Saint John's Abbey and University dans le Minesotta. Comme il se doit,
leur parti pris repose, sur les indications rythmiques des neumes (sans
portées) ; elles sont respectés par les chanteurs, moines et étudiants
(essentiellement en théologie et musique). Ils sont placés sous la direction
attentive du Frère bénédictin Anthony Ruff (OSB), liturgiste chevronné,
professeur de théologie — conférencier et organiste — qui a, entre autres,
collaboré à la traduction anglaise pour le récent Missel romain (2011). Regroupées sous le générique : Mary and Jesus Her son, les pièces proposées sont destinées soit à la
Messe, soit à l'office ; elles sont extraites du Graduale Romanum et du Graduale simplex (post Vatican II) et du Liber Hymnorum. Différentes formes sont
représentées : nombreux Introït
ainsi que des Hymne, Répons, Traits et Séquences.
Leurs versions se rattachent aux tendances actuelles de Damien Poisbleau (né en 1961) qui, pour rendre fidèlement
l'oralité de ce corpus, tient largement compte des sources et des principes
sémiologiques. Les chants traditionnels célèbrent Marie (Ave Maria), la Nativité et la
Crucifixion de Jésus, présentés intégralement avec textes latins et traduction
anglaise. Les temps et circonstances liturgiques concernent, entre autres, le
4e Dimanche de l'Avent, la Messe de Noël et également l'ordinaire de la Messe
de la Vierge Marie. L'Alleluia Diffusa est gratia, traité
ultérieurement par de nombreux musiciens, sert de conclusion à cette petite
Anthologie (15 titres) réalisée par Anthony Ruff et sa « Schola à la pointe de la recherche en
matière de chant grégorien ».

Édith Weber.
Maurice EMMANUEL : Salamine, Tragédie lyrique.
Flore Wend, Bernard Demigny,
Jean Giraudeau, Joseph Peyron, André Vessières,
Lucien Lovano. Orchestre et Chœurs de la RTF, dir. Tony aubin. 1CD
Disque FY & du SOLSTICE (www.solstice-music.com) : SOCD 301. TT : 71'49.
Maurice Emmanuel
(1862-1938) et Théodore Reinach (1860-1928) étaient très férus de tragédie et
de musique grecques. Pendant l'Entre-deux-guerres, ce dernier
a réalisé une nouvelle traduction (française et versifiée) de Salamine d'après Les Perses d'Eschyle. Ce
disque en Première mondiale (2014) évoque les épisodes tragiques de la bataille
entre Perses et Grecs. Les DISQUES FY & DU SOLSTICE ont repris une archive
INA (enregistrement réalisé à Paris, le 22 mars 1958, mise en ondes
musicales : Lucien Duchemin) ; les
discophiles seront ravis de retrouver les sonorités de l'Orchestre et des
Chœurs de la RTF (chef des chœurs : René Alix) ainsi que les voix si
familières de Flore Wend (soprano, la Reine Atossa), Bernard Demigny
(baryton-basse, le Messager), Jean Giraudeau (ténor, Xerxès), Joseph Peyron
(ténor, un Dignitaire de la Cour), André Vessières
(basse, l'Ombre de Darius), Lucien Lovano (baryton,
le Coryphée), tous placés sous la direction de Tony Aubin. Comme le rappelle
Yvette Carbou (direction de la production) :
« 85 ans après sa création à l'Opéra de Paris (1929), cette œuvre est pour
la première fois portée au disque ». La Tragédie lyrique Salamine est structurée en 3
Actes : le premier se situe devant le Palais, le deuxième devant le
tombeau de Darius et le troisième sur « Une place entourée de cyprès. À
l'horizon : des montagnes neigeuses ; éclairage crépusculaire ».
Les récits sont complétés par le Chœur (avec interventions de solistes). Les
protagonistes sont l'indispensable Coryphée, la Reine Atossa,
le Messager, un Dignitaire de la Cour, l'ombre de Darius, Xerxès (qui,
désespéré, évoque sa mort et se lamente sur son sort funeste : ...Las, hélas ! Hélas ! et, pour conclure : deux voix féminines ajoutent :
Ah !)… En fin théoricien de la
musique grecque, Maurice Emmanuel fait appel, entre autres, aux modes grecs
anciens. La présentation très circonstanciée de Christophe Corbier rappelle
qu'il s'agit d'« une œuvre lyrique importante de l'entre-deux-guerres que
ressuscite aujourd'hui le disque, une œuvre dans laquelle Emmanuel, de son
propre aveu, a voulu exprimer sous une forme moderne "la pensée toujours jeune
du viel Eschyle". » L'ensemble s'impose à la fois par son
énergie, son rythme, sa couleur locale, son modernisme relatif pour l'époque,
les intonations spécifiques du Coryphée, la diction précise des chanteurs et
des interventions percutantes de l'orchestre, sans nuire au caractère lyrique
et à l'émotion. Double devoir de mémoire (sujet grec, critères d'interprétation
en 1958) oblige : cette première discographique — avec cette remarquable
Défense et illustration de la Tragédie grecque telle qu'elle était perçue au
début du XXe siècle — a rempli son contrat.

Édith
Weber.
« Correspondances
RAVEL, SCRIABINE, CHOPIN ». Brigitte Fossey, récitante,
Corinne Kloska, piano. 1CD SOUPIR ÉDITIONS (lo.worms@wanadoo.fr ) : S233. TT : 70' 36.
Selon une tendance
actuelle, lors de conférences, de services religieux radiodiffusés, des pièces
musicales sont associées à des textes lus (ou l'inverse). Placé sous le signe
des Correspondances entre poésie et
musique, les poèmes dits par la voix suggestive, voire mystérieuse de la
talentueuse comédienne Brigitte Fossey sont
magnifiquement illustrés au Piano Fazioli (F 278) par
Corinne Kloska (de père polonais et de mère
italienne), si sensible aux formes et aux atmosphères. Elle interprète des Mazurkas de Frédéric Chopin (1810-1849),
des Études et une Polonaise d'Alexandre Scriabine
(1872-1915) des extraits Gaspard de la
nuit de Maurice Ravel (1875-1937). Selon le texte d'accompagnement, elles
ont réussi « une synthèse extraordinaire entre un langage musical émouvant
plongeant ses racines dans le XIXe siècle et une écriture moderne héritière
directe de l'avant-garde russe ». Scriabine faisant le lien entre les deux
siècles. » Elles souhaitent créer des « passerelles entre le monde
romantique de Chopin et la modernité de Ravel. Pari tenu.

Édith Weber.
0« Solo clarinet » : Pièces
pour clarinette de Christophe BERTRAND, Brian FERNEYOUGH, Alberto POSADAS, Ivan
FEDELE, Helmut LACHENMANN, Yann ROBIN. Armand Angster.
1CD TRITON (www.disques-triton.com) : 01612231. Diffusion : CD DIFFUSION
(www.cddiffusion.fr ).
TT : 79' 56.
Armand Angster propose une mini Anthologie d'œuvres pour diverses
clarinettes (et électronique). Son répertoire va de Mozart aux œuvres du XXIe
siècle et à l'improvisation. Il pratique aussi le jazz, organise des stages. À
Strasbourg, il est professeur à la Haute École des Arts du Rhin, dirige
l'Ensemble contemporain du Conservatoire et de l'Académie. Il se produit en soliste
en France et à l'étranger. Son programme cosmopolite comprend d'abord Dikha (du grec, signifiant « partagé en
deux »), composé par Christophe Bertrand en 2001 pour clarinette et
électronique, réalisé à l'IRCAM, respectant les proportions métriques du Haiku japonais.
Selon le compositeur : « La première partie est principalement axée
sur la base de la fusion de la clarinette et son miroir virtuel : les
traitements utilisés dans la partie électronique sont issus exclusivement
d'échantillons de clarinette, les « défauts » de jeu de
l'instrumentiste (tels les respirations, les bruits de clé, les transitoires
d'attaque) faisant partie intégrante du discours musical ». La deuxième
partie fait appel à la « superposition/démultiplication d'ostinatos
fébriles », aux timbres changeants (quarts de ton), aux cliquetis, à des
contrepoints aux nombreux accents et « spatialisés à travers l'espace
scénique ». La troisième partie fait appel à la virtuosité de la
clarinette, alors que l'électronique joue le rôle d'un orchestre. Armand Angster fait preuve d'une virtuosité éblouissante et
tonitruante. Time and Motion Study (1971-1977) pour clarinette basse, de Brian Ferneyough, est une œuvre autoréflexive eu égard à son mode
d'expression nécessitant une parfaite maîtrise technique de l'instrument. Sinolon (2000)
— unité engendrée par une diversité d'éléments et dans la diversité — se
présente, selon Alberto Posadas, en marge de la tradition d'écriture pour
clarinette et exige « une grande résistance mentale et physique ». High (2005) d'Ivan Fedele
— à la mémoire de Miles Davis — baigne dans le jazz. Enfin, Dal niente
(Intérieur III) pour clarinette (1970), de Helmut Lachenmann,
se rattache à la musique concrète instrumentale, avec de nombreux changements
de doigtés, d'attaques et d'articulations. Le compositeur y mise sur « la
perception emphatique de la dimension anatomique du son ». Art of Metal II
(2007) d'Yann Robin nécessite une clarinette contrebasse métal et un dispositif
électronique en temps réel. Cet instrument résulte de la collaboration avec
Alain Bilard. Parcours inouï.

Édith Weber.
« Roaring Dramas ».
Arrangements pour violon et piano d'opéras italiens. Albek Duo. 1CD VDE GALLO (www.vdegallo-music.com ).
CD 1465. TT : 59' 46.
L'Albek Duo associe les jumelles suisses Ambra Albek (violon et alto) et Fiona Albek
(piano), déjà présenté en 2014 à nos lecteurs
à propos de leur disque intitulé Sound
in Search of a Past.
Elles nous proposent cette fois-ci des arrangements pour violon et piano
réalisé par Alessandro Lucchetti (né en 1958) à
partir de thèmes d'Opéras de trois compositeurs italiens. Giacomo Puccini
(1858-1924) est représenté par deux Fantaisies :
l'une sur des thèmes de l'Opéra Tosca
(2009), l'autre d'après La Bohême
(2012) ; Pietro Mascagni (1863-1945), par la Fantaisie sur des thèmes de l'Opéra La Cavalleria
rusticana (2010), et Ruggero
Leoncavallo (1857-1919) par I Pagliacci (2011). Ces arrangements récents prouvant
l'intérêt de la démarche originale, se présentent à la manière de pots-pourris
agréables à entendre et divertissants pendant une heure. Fraîcheur,
spontanéité, mais surtout capacité à restituer les atmosphères et le caractère
passionnel des opéras sont au rendez-vous.
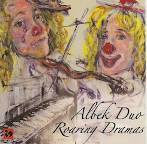
Édith Weber.
Joanna BRUZDOWICZ : « 16 Tableaux d'une
exposition Salvador Dali ». Tomasz Jocz, piano, Karolina Piatkowska-Nowicka, violon,
Krzysztof Pawlowski, violoncelle. 1 CD ACTE PREALABLE
(www.acteprealable.com) :
AP0350 ? TT : 59'12.
Joanna Bruzdowicz, polonaise naturalisée française, née à Varsovie
en 1943, est une compositrice très originale, fondatrice et directrice du
Festival de Musique classique de Céret, et a réalisé de nombreuses productions
audiovisuelles et cinématographiques, par exemple : ses 16 Tableaux d'une exposition Salvador Dali (à
ne pas confondre avec ceux de Modeste Moussorgski), pages descriptives parmi
lesquelles figurent : Portrait de
Paul Éluard, Portrait de Picasso,
Christ de Saint Jean de la Croix ;
Nature morte vivante ou encore Le Sommeil, Girafe en feu, La Gare de
Perpignan et le plus original :
Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade une seconde
avant l'éveil. Le pianiste Tomasz Jocz a fait ses
études à Gdansk ; en France auprès de Bernard Ringeissen ;
en Russie, avec Alexei Orlovetzky
et, en Angleterre, avec Bernard Roberts. Il brille par sa virtuosité et son jeu
perlé dans les traits fulgurants, par sa musicalité dans les passages plus
intériorisés ou impressionnistes. Il s'associe à Karolina
Piatkowska-Nowicka (violon)
pour interpréter la Sonate : Spring in America, dans laquelle des passages expressifs, de
bravoure (jazzy) et de passion alternent. Avec Krzysztof Pawlowski
(violoncelle), il propose une version très prenante de la Sonate
intitulée : The Song of Hope and
Love évoquant, tour à tour, la passion, l'émotion, la colère et encore
l'expression, grâce à la chaude sonorité du violoncelle parfois à découvert et
à l'accompagnement pianistique en parfaite connivence. Encore une révélation
d'Acte Préalable — dont l'œuvre éponyme d'Alexandre Scriabine a servi de
libellé.

Édith Weber.
Tadeusz Zygfrid KASSERN.
Tadeusz MAJERSKI : Piano Works. Elzbieta Tyszecka, piano. 1 CD
ACTE PREALABLE (www.acteprealable.com) :
AP0345 TT : 73'31.
Le compositeur
polonais Tadeusz Zygfryd Kassern,
est né en 1904 à Lvov. Il a vécu en Pologne et, lors de la Seconde Guerre
mondiale, a dû utiliser une fausse identité en raison de son origine juive,
puis il a demandé asile aux États-Unis. À New York, il a enseigné notamment à
l'École de musique Dalcroze. Il est mort en 1957.
Parmi ses œuvres pour piano, figurent quatre Sonatines en trois mouvements faisant alterner des tempi rapides
avec un mouvement lent central, la quatrième étant dotée de titres
anglais : Fast/Slowing, Slow,
Swing-like et la Coney Island Sonatina, aux titres originaux : The Big Brassy Show, Serpent
Lady, Surf Boogie-Woogie.
Le second compositeur, pédagogue et pianiste polonais, Tadeusz Majerski, est né 1888 et mort en 1963. Après avoir étudié à
l'Université et au Conservatoire de la Société musicale de Galicie, il a été
particulièrement attiré par la musique du XXe siècle, notamment de Karol
Szymanowski et de M. Karlowicz et par la musique
dodécaphonique. Ses Préludes sont
brefs, de même que son Allegro con brio
et son Lento misterioso.
Elzbieta Tyszecka, à l'abondante discographie (21 disques, dont 17
sous le Label Acte Préalable) rend honneur à ses compatriotes. Sous ses doigts
agiles, les mouvements diversifiés (Allegro,
Presto, Adagio, Andante), les
climats variés (mystérieux, passionné, très expressif), les descriptions,
par exemple : In the Gondola,
The Peanut Vendor (Le vendeur de cacahuètes), The Fortune Teller (Le diseur
de bonne aventure) et la diversité rythmique (Marcia de la Sonatine II,
Boogie-Woogie de la Coney Island Sonatina) n'ont pas de secret
pour elle. Elzbieta Tyszecka
s'impose par ses qualités : sonorité étudiée, bonne conduite de la basse,
précision d'attaque, mais aussi par l'expressivité et la musicalité dans les
mouvements lents et par son sens du rythme. Une belle Défense et illustration à
l'actif du Label Acte Préalable en vue de la promotion des compositeurs
polonais peu connus en France.

Édith Weber.
« Fulgurances ».
Yejin Gil, piano, joue Unsuk
CHIN, Pierre BOULEZ, György LIGETI, Olivier MESSIAEN. 1CD Disques
FY et du SOLSTICE (www.solstice-music.com): SOCD 300. TT : 71'14.
La pianiste
sud-coréenne Yejin Gil, née en 1980, a été l'élève à
la Kaywon Arts High School,
puis à la célèbre Université Nationale de Séoul. Elle est passionnée par la
musique européenne et, en particulier, par le répertoire du XXe siècle, comme
le prouve son programme qui débute avec Six
Études pour piano de sa compatriote, Unsuk Chin
(née en 1961), ayant étudié à Séoul, puis à Hambourg notamment auprès de G.
Ligeti, et résidant à Berlin. Dans la première en Do, la pianiste virtuose s'impose par sa précision d'attaque ;
dans la deuxième : Sequenzen,
elle met en valeur les différents plans sonores. Les Études suivantes sont intitulées : Scherzo, Scalen,
Toccata (percutante, avec des
« flaques sonores »), Grains (avec
une extrême vélocité). Incises du
regretté Pierre Boulez (1925-2016), selon la version de 2001, œuvre très
développée, est interprétée magistralement par la pianiste. György
Ligeti (1923-2006) — qui a beaucoup influencé son ancienne élève Unsuk Chin — est représenté par quatre Études pour piano appartenant au Troisième Livre avec des éléments stylistiques très particuliers. White on White (N°15) sur les touches
blanches ; Pour Irina (N°16),
calme puis frénétique ; À bout de
souffle (N°17), spéculant sur la nuance pianissimo ;
Canon (N°18), réalisé entre les
mains, faisant appel à des tempi vivace,
presto et, en conclusion, à un canon
lent avec des accords. Enfin, Quatre
Études de rythme d'Olivier Messiaen (1908-1992), œuvres à finalité
pédagogique, commencées en 1949, lors des Cours d'été de Darmstadt, inaugurent
la nouvelle musique contemporaine. Messiaen rappelle que « la musique est
constituée de 36 sons, 24 durées, 12 attaques et 7 dynamiques ». Le
sérialisme prend ici le pas sur le timbre et la couleur. Yejin
Gil réserve un sort royal à ces musiques tour à tour didactiques, figuratives
ou démonstratives. Cette exceptionnelle Anthologie pianistique des XXe et XXIe
siècles, accompagnée de « photos Solstice » très révélatrices, se
termine aux accents de Par Lui tout a été
fait, 6e pièce des Vingt regards sur
l'enfant Jésus, composés en 1944, spéculant sur la forme de la fugue et un
rythme non rétrogradable. Elle démontre la grande
passion et la fulgurante maîtrise pianistique de Yejin
Gil.

Édith Weber.
« Il due Orfei ». Giulio CACCINI : arias extraits de
« Le nuove musiche »
et de « Nuove musiche
e nuova maniera di scriverle ».
Jacopo PERI : airs tirés de « Le varie musiche ».
Marc Mauillon, chant. Angélique Mauillon,
arpa doppia. 1CD Arcana : A393 (distribution : Outhere).
TT.: 57'12.
Giulio Caccini (1551-1618) et Jacopo Peri (1561-1633 ) sont deux
Orphée, rivaux au demeurant, en tout cas chantres du beau chant de la
Renaissance. Marc Mauillon et sa sœur Angélique Mauillon ont imaginé un programme passionnant d'arias de
ces deux compositeurs qui finalement se retrouvent dans l'idée de donner un
nouveau souffle à la monodie accompagnée florentine, à renouveler, sinon
révolutionner, le recitar cantando en
expérimentant un style nouveau de déclamation, dit ''stile
rappresentativo'' ou ''recitativo''
et d'accompagnement pour la soutenir, le ''basso continuato'' ou ''continuo''. Dans le dessein d'une plus
grande vraisemblance expressive. Caccini a publié deux opus musicaux à cet
effet : « Le nuove musiche »
en 1602, et les « Nuove musiche
e nuova maniera di scrivelde »
en 1614. On y admire de doux chant d'amour (« Amarilli
mia bella » ou « Perfidissimo volto »,
l'épanchement amoureux (« Tutto 'I di piango », sur un texte de Pétrarque) ou encore la
confidence enjouée et prolixe (« Odi,
Euterpe »). Quant à Jacopo Peri, il écrit
« Le varie musiche » en 1609. Le style est
plus recherché, du fait de ses origines patriciennes sans doute. On savoure la
manière de berceuse de « Tu dormi », si différente de la franche
gaieté de « Tra le donne onde s'onora ». Ce style s'affirme encore à l'heure du grand
épanchement de « Tutto 'I di piango ».
Il est fascinant de comparer comment, sur le même texte, varient les approches
de chacun des deux musiciens : là où celle de Caccini est simple, directe, et
fuit l'affectation, non sans favoriser la virtuosité du chant, Peri se montre plus savant. Trois intermèdes instrumentaux,
empruntés à Luzzasco Luzzaschi
et à Alessandro Piccinni complètent et agrémentent le florilège vocal. Qui est
enluminé par le timbre expressif et corsé de Marc Mauillon,
évoluant entre ténor et baryton, peut-être le baryton Martin (ce qui l'autorise
à aborder prochainement Pelléas). On est frappé par
la fluidité et la pureté de l'ornementation, si essentielle ici. Et séduit par
une souveraine maîtrise de la prosodie a priori austère, quoique pas toujours.
Angélique Mauillon joue une arpa
doppia, harpe baroque à trois registres, aux superbes
harmoniques, prodiguant un idéal accompagnement à la monodie. Le chant d'Orphée
et de sa lyre.

Jean-Pierre Robert.
« Vertigo ».
Pièces de clavecin de Jean-Philippe RAMEAU et de Jean-Nicolas-Pancrace ROYER.
Jean Rondeau, clavecin. 1CD Erato : 0925646 974580. TT.: 72'23.
Pour son nouveau disque, Jean Rondeau a
rêvé un programme original : mise en miroir de deux musiciens qui se
partageaient les faveurs du public à l'époque, 1746, Jean-Philippe Rameau
(1683-1764), « le révolutionnaire traité de conservateur pendant la
''Querelle des Bouffons'' » et Pancrace Royer (c.1705-1755), « un
petit jeune qui vient challenger la génération d'avant ».
« Deux magiciens, architectes magistraux » de la musique. Il imagine
un parcours à trois Entrées : la Poésie, la Musique, la Danse, comme une
comédie du grand siècle. En lever de rideau, ce sera le Prélude en la mineur de Rameau et une Allemande de Royer, marche
majestueuse. La séquence de La Poésie est illustrée par des pièces de Rameau :
celle d'« un cœur dépouillé » (« les Tendres Plaintes ») et
d'un morceau d' « une fragilité intouchable »
(« l'Entretien des Muses », qu'entrecoupe le sautillant et joyeux
« Les Niais de Sologne », car « la poésie se fait aussi
jouissance ». Pour La Musique, qui est « la plus folle et la plus
fantaisiste », il fait appel à Royer. En fait, ce musicien rend hommage à
une époque sans doute révolue, dressant le « plus extravagant des Tombeaux
sans le savoir ». Dans les endiablés « Tambourins » le clavier
sonne comme un petit orchestre. « Le Vertigo » introduit tout un
théâtre d'opéra avec des oppositions thématiques et des modes inouïs : accords
assénés, courses folles, jeu labouré où l'instrument vrombit comme un roulement
de tambour ; puis soudain tout s'arrête pour folâtrer sur quelque inspiration
fulgurante. Le déferlement digital de « La Marche des Scythes » se
vit comme un rush insensé. Tout cela signale « le passage de la géniale
mascarade baroque à l'imaginaire infini de dix doigts et de quelques
sautereaux ». La Danse, quant à elle, est dévolue à Rameau avec la large
et expressive « Sarabande » de Zoroastre, magnifiant l'entier
registre du clavecin, des aigus sonnants aux graves ronflants en passant par un
médium bien tempéré. Ce seront encore « Musette en rondeau », tiré
des Fêtes d'Hébé, comme une guirlande de pierres précieuses,
« Menuets » (de Castor et Pollux),
pas si gracieux, espiègles plutôt. Et bien sûr les immanquables
« Sauvages » (des Indes Galantes) ,
adroitement scandés par Rondeau avec quelques trilles en forme de sourires en
coin. En guise d'Épilogue, emprunté à Royer, Jean Rondeau joue
« L'Aimable ». Le rideau se referme sur une belle inspiration, un
brin nostalgique. Serait-ce déjà fini ? On aura savouré, outre un don de pédagogue
conteur - les citations ci-dessus sont de lui -, un musicien de la plus fine
eau : une aisance innée dans le mode de l'agilité, une imagination débordante
dans les doigtés, le sens du discours, un éventail de nuances proprement
bluffant. Le don de faire sonner l'instrument surtout. Celui qu'il joue, un
clavecin du Château d'Assas, vaut le voyage : graves fabuleux, aigus
extrêmement clairs et résonance généreuse. Quel vertige en effet !

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé
MOZART : Quatuors pour pianoforte et cordes N° 1
KV 478 et N° 2 KV 493. La Petite Symphonie. 1CD Muso
: MU-010. TT.: 64'17.
Le genre du quatuor pour piano et cordes
est rare. Selon Brigitte Massin, chez Mozart c'est la
fusion du concerto et du quatuor à cordes : densité du premier, introspection
du second. Le quatuor KV 478 (1785), contemporain des Noces de Figaro,
se signale par un subtil équilibre entre le piano et les cordes, lequel appert dès l'allegro, au développement généreux et tendu. La
longue coda est allègre. L'andante, introduit par le clavier, qui jouera un
rôle essentiel au fil des deux parties du mouvement, est avenant mais non sans
présenter des instants de tristesse. Riche de mélodies, le rondo bénéficie
d'une souple articulation laissant éclater une joie bienvenue. Le dialogue
piano-trio à cordes est proche de l'esprit du concerto, alors que le clavier
s'avère virtuose dans sa ritournelle. Passé un effet de surprise en termes de
sonorité, on savoure le beau piqué du pianoforte de Daniel Isoir,
d'après un instrument de Johann Andreas Stein, et l'intensité des cordes. Le
Quatuor KV 493, de 1786, est de plus vastes dimensions et encore plus proche du
concerto car le piano est amené à se produire seul à certains endroits (début
du deuxième mouvement ou au troisième). L'allegro livre avec La Petite
Symphonie une exécution d'un beau raffinement et d'une tension soutenue. Le
larghetto cèle quelque mélancolie, oppressante presque. L'échange entre clavier
et cordes, initié par celui-ci, semble comme lancer une interrogation à
laquelle les trois autres répondent avec déférence, à moins qu'ils ne le
confortent dans sa réflexion suspendue en l'air. L'allegretto final est joyeux,
animé d'aucune arrière pensée. Le clavier déroule sa petite musique et les
cordes lui donnent une réplique empressée, comme se jouant d'elles-même. L'exécution de La Petite Symphonie (Daniel Isoir,
clavier, Stéphanie Paulet, violon, Diane Chmela, alto et Mathurin Matharel,
violoncello) est intime, presque trop ; peut-être un
effet d'une prise de son trop proche qui accentue le grave et la résonance du cello.

Jean-Pierre Robert.
Ludwig van BEETHOVEN : Sonate op. 106
« Hammerklavier ». Franz
SCHUBERT : Quatre Impromptus D 899.
Trois Klavierstücke D 946.
Johannes BRAHMS : Intermezzo op. 117 N°2. Jean-Philippe
RAMEAU : « Les tendres plaints », « Les tourbillons »,
« Les cyclopes », « La folette »,
« Les sauvages ». Grigory Sokolov, piano.
2CDs DG : 479 5426. TT.: 65'+73'.
Les prestations de Grigory
Sokolov sont rares au concert et au disque. Mais ce perfectionniste fait
enregistrer pour lui tous ses récitals. Le label DG a réussi cette fois encore
à se procurer les bandes de ces concerts Schubert et Beethoven. Chance car
voilà du très grand piano. Quoi de plus séduisant que les Quatre Impromptus
op 90, D 899 de Schubert. Au N° 1, le cheminement tragique passe par une
articulation sans concession et un contre chant de la main gauche souligné chez
Sokolov qui fait un sort à ces notes répétées lugubres. Le N° 2 offre les
charmes d'une guirlande de notes énoncées par la main droite sur un sobre
accompagnement de la gauche ; le 2 ème thème est très affirmé en rythme et puissance, encore
plus lors de la seconde volée, et les accords finaux sont fébriles. Avec le N°
3, c'est la suprême cantilène schubertienne que Sokolov distille sans
affectation. Là encore le travail sur l'accompagnement du thème est magistral
pour des graves somptueux et impressionnants. Au N°4, le premier thème dans
l'aigu du clavier sonne limpide, liquide, puis le contre chant dans le grave
semble lutter pour une partie inégale, car le deuxième thème passionné
l'emporte. Voilà un Schubert mâle qui sait sa dette à Beethoven. Et un pianisme visionnaire. Pareille félicité appert des Trois
Klavierstücke D 946 : course folle du premier,
résolue, Sokolov n'hésitant pas à presser le tempo, l'interrogation que pose le
thème s'en trouvant libérée d'autant. Douce mélancolie du deuxième, sur
laquelle il ne s'appesantit pas, en ne ralentissant pas sur la fin ; le
deuxième thème et sa répétition rageuse, il ne l'affaiblit pas, qui fait penser
à ce Lied tiré du Winterreise, effrayant
dialogue avec la mort ; le troisième thème, sorte de rêve éveillé, transporte
loin et la partie conclusive est d'une solide ardeur. Le troisième morceau est
d'une vie foisonnante sous les doigt du russe : il y a
un élément de fantastique dans ce discours qui ne cherche pas à simplement
coller à la mélodie mais s'appuie sur des traits répétés en forme
d'affirmations.

DR
La Sonate op 106, « Hammerklavier », cette « symphonie pour piano
seul » (Jean & Brigitte Massin) prend avec
Sokolov sa vraie dimension titanesque. Débuté dans un fortissimo d'une extrême
vigueur, l'allegro déploie ses accords vertigineux, ses incursions dans la
partie aiguë du thème, l'urgence absolue du discours, avec une augmentation de
la pression lors du passage en trilles avant la course finale. Du scherzo,
Sokolov exacerbe l'agitation, l'instabilité, et le trio est pris fortissimo et
preste. La reprise est encore plus effrayante, ses accords assénés dans un
paroxysme furieux. Pour l'adagio, Sokolov doit se souvenir de la phrase de
Romain Rolland, selon lequel « Quelque tentation que l'on ait, il ne faut
pas le jouer trop lentement. La passion brûle au fond. Il est toujours en
mouvement ». Le deuxième thème, sommet d'expressivité, est ici un modèle de
réflexion et le développement qui expose une interrogation, est conduit avec
une rare persuasion et une intensité presque insoutenable. Le finale, immense
« fantaisie », à travers ses tempos si instables, alterne véhémence
et calme, transfiguré là encore par un jeu visionnaire : formidable rigueur de
la fugue, furia des trilles, piqué des notes, puissance des accords, et ce son
symphonique balayant tout. Le surhumain beethovénien pour une interprétation
qui fera date. Une guirlande de bis conclut ce récital, généreux comme
toujours. Horowitz cultivait Scarlatti au début de ses concerts, Sokolov
fleurit la fin des siens avec Rameau !
Ces pièces sont un baume après les déluges beethovéniens. On adore la
douceur évanescente du trille de « tendres plaints », les mêmes dans
le registre grave pour « Les tourbillons » (même si on perçoit que le
piano a souffert avec le percussif du Beethoven précédent) dans une
irrésistible cascade d'ébouriffants arpèges. Que dire des
« Sauvages » ou de « La folette »,
ces « tubes » avant la lettre ! Il n'y a rien de mécanique bien sûr
chez Grigory Sokolov. Simplement une vraie joie de
faire de la musique, qu'il illustre encore par le bel Intermezzo op 117 N° 2
de Brahms. Quel concert, quel jeu ! Un disque must.

Jean-Pierre Robert.
Johannes BRAHMS : Quatuor
pour piano et cordes op. 60. Trio pour piano, et
violoncelle op. 8. Trio Wanderer. Christophe Gaugué, alto. 1CD Harmonia Mundi : HMC 902222. TT.:
73'54.
Les Wanderer
donnent dans la musicologie. Car leur interprétation du Trio op. 8 de
Brahms sur ce CD est la version originale de 1854 ; ce qui complète ainsi leur
intégrale des trios débutée dans un précédent disque (HMC 902032). Brahms
n'était jamais totalement satisfait de son ouvrage et modifiait à l'envi. Il
est sans doute intéressant de comparer ce premier jet à la version définitive
de 1890, de ce Premier trio. Les différences son majeures. Ainsi, si à
l'allegro molto, le premier thème fougueux est déjà là, le reste est de facture
bien différente de la version remaniée : place plus importante accordée au
piano, moindre concentration de l'inspiration, notamment dans le développement
qui offre des digressions inattendues dont une fugue fort loquace. Peu de
changements au scherzo, dans ce mouvement impétueux et son trio central très
expressif, sauf les dernières mesures pianissimo. A l'adagio, on est loin de la
limpidité de la version bien connue : un parcours sinueux plutôt, hésitant
entre rêve et délire, que le chant du piano rend encore plus angoissant. Le
finale, allegro molto agitato, l'est tout autant dans ce premier essai. Là
encore la pensée semble s'effilocher en moult
à côtés, et aller souvent dans des sens opposés. Encore que le thème
principal soit déjà bien allant, très affirmé, presque déclamatoire. La version
ultime est bien autre, plus concise et donc aboutie, mais cette première vision
témoigne d'une riche inspiration, même si pas toujours domestiquée. Les Wanderer lui rendent justice par une exécution instrumentalement
accomplie, comme toujours. Le Quatuor pour piano et cordes op. 60 a
connu une longue gestation (de 1855 à 1875) : peut-être est-ce la raison d'une
densité extrême de la composition, parmi les inspirations les plus tragiques de
Brahms. Ainsi le premier mouvement s'épanche-t-il comme une plainte, soit
héroïque, alors indomptable, soit rentrée, ici ésotérique, à moins que cryptée
: une passion inassouvie pour Clara Schumann, est-il souvent avancé. Le scherzo
est fébrile dans sa course effrénée, de
plus en plus emportée chez les trois cordes, encore que ce soit le piano qui
mène les débats : des vagues qui se font et se défont dans une ambiance presque
hystérique. Le moderato chante comme souvent chez Brahms, mais ici dans une
cantilène mélancolique initiée par le cello. Les Wanderer et leur collègue altiste Christophe Gaugué sont d'une retenue parfaite. Le finale est comme
démonstratif, d'une riche thématique, alternant vaillance et apaisement, avant
un curieux point d'interrogation ultime. Voilà encore une grande interprétation
du Trio Wanderer.

Jean-Pierre Robert.
Édouard LALO : Symphonie
espagnole op. 21. Pablo de SARASATE : Zigeunerweisen op.
20. Max BRUCH : Concerto pour violon N°1 op. 26.
Renaud Capuçon, violon. Orchestre de Paris, dir. Paavo Järvi.
1CD Erato : 0825646982769. TT.: 65'47.
Ces trois compositions sont chères au cœur
de Renaud Capuçon qui pour son 40 ème
anniversaire a choisi de les réunir. Lors de deux séries de concerts de
l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris, captés live pour ce disque. La
Symphonie espagnole de Lalo, dédiée à Pablo de Sarasate en 1875, est plus
qu'une symphonie et autre chose qu'un concerto : une suite rhapsodique pour
violon solo et orchestre où est célébrée une Espagne ardemment imaginée, ce que
feront aussi Bizet dont la Carmen allait être créée trois semaines plus
tard, Chabrier ou Ravel ; et dispensé un orchestre chatoyant, coloré,
souplement rythmé ici par Paavo Järvi.
L'allegro initial, de son rythme ibérique plus vrai que nature, est brillant
sous l'archet de Capuçon. Le scherzando affiche la
fantaisie de son envolée entrainante entrecoupée de lyrisme. L'orchestre
introduit ensuite l'Intermezzo qui devient au violon une habanera truffée de
force traits virtuoses du soliste. A l'andante, un choral de l'orchestre
installe la douce mélodie du violon, d'une belle intensité ici. De son rythme
de Malagena, le rondo final est bien chantant. Les
enjolivements de la partie soliste sont célèbres comme les longues phrases et
courses poursuites et sa fin en feu d'artifice. Renaud Capuçon
est royal : finesse du trait aigu, largeur du son dans le médium, souffle et
douceur de l'émission. Surtout, un naturel qui ne recherche pas l'esbroufe. Les
Airs bohémiens op. 20 de Sarasate (1878) proposent la fantaisie d'une
improvisation tzigane en plusieurs séquences tour à tour rêveuses et
passionnées. Capuçon fait son miel des traits inouïs
: glissandi, appogiature, arpèges fous, notes aiguës piquées, etc. Le premier
Concerto de violon de Max Bruch, dédié à Joachim, est sans doute une de ses
œuvres les plus connues. C'est là encore
une pièce du registre de la fantaisie, requérant du soliste une grande
expressivité : un florilège de modes pour celui-ci au premier mouvement avec, au
développement, un soutien orchestral digne des grands concertos de Brahms ou de
Mendelssohn. Renaud Capuçon est à son meilleur dans
ces intonations un brin nostalgiques toutes de tendresse émue. Cette sorte de
confidence se poursuit à l'adagio. Au finale, allegro energico,
l'éclatant jubilatoire ne le cède en rien à une souveraine maitrise de la
rythmique fière et brillante. Question technique d'enregistrement, force est de
constater que la réverbération excessive de la grande salle de la Philharmonie
de Paris ne permet pas une satisfaisante définition spatiale. Le son de
l'orchestre reste épais, en particulier dans les cordes suraiguës, et plus
large que nature. La balance violon-orchestre est plus adroite dans le Lalo et
le Sarasate que pour le Bruch (violon trop présent ici et curieusement placé à
droite du spectre).

Jean-Pierre Robert.
« En plein
air ». JS. BACH
: Capriccio BWW 992. Robert SCHUMANN : Waldszenen,
op.82. Leoš JANÁČEK : Dans les brumes. Béla BARTÓK : En plein air. David Kadouch, piano. 1 CD Mirare : MIR 274. TT. : 62'.
Le thème de ce CD, « En plein
air », pourrait être inspiré du titre de la pièce éponyme de Bartók. A
moins que le programme choisi ne cherche plus loin : le piano, instrument par
définition cloué au sol, à la différence du violon par exemple, qu'on peut emmener
sous le bras en promenade, « nous garde chez nous ». La notion de
plein air fait alors référence à « un lointain mental, celui de nos
rêves ». Quoi qu'il en soit, David Kadouch,
partant sans doute de la pièce de Bartók, a réuni d'autres compositeurs. Ainsi
JS Bach et son Capriccio BWV 992 « Sopra
la lontananza del fratello dilettissimo » (à
propos de l'éloignement du cher frère). Le Cantor l'aurait écrite pour marquer
le départ de son frère Johann Jakob pour aller guerroyer au service de Charles
XII. La pièce véhicule une grande mélancolie dans l'andante, qui fait place à
la tristesse à l'adagiossimo. Mais plus tard, le
motif du postillon rappelle quelque gaieté passée, avec ses notes martelées
tandis que le finale sonne comme un adieu. Belle interprétation bien marquée de
Kadouch. Les scènes de la forêt op. 82 (1849)
de Schumann, contemporaines du tragique opéra Genoveva,
offrent une atmosphère sylvestre pas si enchantée qu'on peut le penser
(« Chasseurs aux aguets », « Lieu maudit », voire même dans
l'énigmatique « Oiseau prophète »). Les moments idylliques ne le sont
pas tant (« Fleurs solitaires », « Paysage souriant »).
L'inspiration de Kadouch est ici très mesurée et le
jeu offre une certaine dureté. On le trouve mieux à l'aise dans le Janáček. Dans les brumes (1911) distille un
drame au fil de ses quatre mouvements : un paysage crépusculaire, d'une
irrépressible tristesse dans ses oppositions de violence et de douceur
(andante), de secrets épanchements (molto adagio) traversés de crises, et de
dureté dans le traitement pianistique. L'andantino conte quelque air populaire,
avec toujours des écarts de dynamiques qui ont quelque chose d'effrayant, ce
que ne cherche pas à restreindre l'interprète. Le dernier mouvement presto, de
son écriture brillamment arpégée, offre bien de la véhémence. Bartók écrit
« En plein air » en 1926, au même moment que sa Sonate pour piano. Il
y a ici, comme dans l'autre œuvre, un côté extrêmement percussif (« Avec tambours et fifres » par
exemple), associé à de aspects pseudo nocturnes (« Barcarolle »).
« Musiques nocturnes » et leurs bruits évocateurs de la nature
offrent un climat plus apaisé, et un jeu d'une étonnante vie, que David Kadouch mène adroitement. Comme les ruptures constamment
changeantes émaillant d'autres pages, telles que « Musettes ».

Jean-Pierre
Robert.
Béla BARTÓK : 44
Duos pour violons, BB 104. Sarah
& Deborah Nemtanu, violons. 1CD Decca : 478 8959.
TT.: 48'11.
Bartók compose ses 44 Duos pour violons en
1931, à la demande d'Erich Dolfein, musicologue et
pédagogue qui préparait une méthode de violon basée sur le jeu en duo. Inspirée
de chants populaires collectés in situ, hongrois, roumains, slovaques, serbes,
ruthènes, mais aussi ukrainiens et même arabes, ces très courtes pièces (entre 29
secondes et 2'46 pour la plus longue), sont réparties en quatre livres. Plus
que des transcriptions ou des adaptations desdits chants, les morceaux les réimaginent, tour à tour méditatifs, spirituels,
élégiaques, sauvages, témoignant de la formidable créativité de Bartók : de la
berceuse à la danse, et dans ce dernier cas, de toutes sortes. On admire l'art
de contraster (pièces 20 et 21), l'éventail fascinant des sonorités, la beauté
du langage harmonique et rythmique qui cultive la dissonance, la bitonalité
(Duo N° 33 « Harvest song »),
l'abolition des barres de mesure (N° 21 « Premier compliment du Nouvel
An »). Cela va du plus simple au très complexe, le musicien indiquant
avoir voulu expérimenter les modes les plus divers en termes de difficultés, et
ce de manière croissante, à des fins de pédagogique, pour enrichir l'expérience
des élèves musiciens : jeu en canon (N° 20 « Chant alterné »),
affrontement des deux voix, phrasé complexifié à l'extrême comme ces pizzicatos
rageurs de « Danse de Maramure », ou course
poursuite (N°39 « Danse serbe »), rythmique asymétrique (N° 42
« Chant arabe »). La technique violonistique requise est des plus
exigeantes, frôlant parfois le diabolique. Sarah et de Deborah Nemtanu,
Premier violon, respectivement, à l'ONF et à l'Orchestre de Chambre de Paris,
sont tout à fait à l'aise dans ce répertoire secret. L'engagement, pour ne pas
parler de la technique ébouriffante, des deux sœurs transcende cette langue
sévère mais combien captivante. On n'avait pas entendu ces pièces sonner de la
sorte depuis l'enregistrement légendaire de Perlman et Zuckermann,
il y a un quart de siècle ! Voici trois quart d'heure de violon qui vont bien au delà du didactique.

Jean-Pierre Robert.
« Berliner Philharmoniker - Claudio
Abbado - The last Concert ». Felix MENDELSSOHN
: Le songe d'une nuit d'été, extraits de la musique de scène. Hector
BERLIOZ : Symphonie fantastique. Deborah York, Stella Doufexis, sopranos. Damen des Chors
des Bayerischen Rundfunks. Berliner Philharmoniker, dir. Claudio Abbado. 2CDs & 1DVD : Berliner
Philharmoniker recordings : . TT.: 40'11+55'46 (audio),
Cette édition restitue le dernier concert
berlinois de Claudio Abbado. En fait, le fruit de la dernière prestation du
maestro, captée lors des trois soirées des 18, 19 et 21 mai 2013, à la tête de
l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qu'il dirigea pour la première fois en
1966 et dont il fut le directeur musical de 1990 à 2002. Des moments
d'exception, salués à l'époque comme triomphaux. Le programme réunit deux compositeurs
qui lui étaient chers : Mendelsshon qu'il aimait
jouer souvent et dont il grava l'intégrale des symphonies et de la musique de
scène du Songe d'une nuit d'été pour le label DG, et Berlioz et sa Symphonie
fantastique dont il réalisa aussi un enregistrement. Du Songe sont
donnés sept extraits représentatifs. L'Ouverture établit d'emblée une
atmosphère d'impalpable légèreté à travers son thème nocturne, dont ce voile
des violons pianissimos ponctués du basson et du cor dans le lointain sur des
timbales translucides. On note un léger précipité pour le retour du thème
scandé, légèrement martelé et ses traits de violon imitant le hoquet de l'âne.
Shakespeare est bien là. Et cette péroraison faussement grandiose avant
l'ultime reprise du premier thème, pour conclure sur un rallentendo,
bienfaisant apaisement. Le scherzo, « vivace », est mené confortable,
sans précipitation, laissant au thème joué par les bois tout loisir de bondir.
Le crescendo est juste poussé un peu pour une meilleure respiration. La suite vient
d'évidence avec un contrechant joliment enfiévré. La flûte d'Emmanuel Pahud est tout simplement sublime. Le « Song with chorus » ''You spotled snakes'' qui suit est piquant, les deux voix s'alliant avec
grâce sur l'accompagnement des chœurs de femmes. L'Intermezzo est habité de
quelque drame retenu, le thème de marche des bassons accompagnés par les altos
gentiment rustique. Entamé par les cors, le Notturno
(allegro tranquillo) installe un climat limpide et
les bois accrochés aux cordes aiguës dessinent de délicates arabesques. La
« Wedding March » sonne tout sauf pompeuse,
juste cérémonieuse avec ses diverses séquences surenchérissant le sens de
l'événement. Le développement s'étend peut-être largement, sans doute pour
mieux rebondir lors de la reprise de la fanfare. Avec le finale chanté, c'est
le retour du thème nocturne de l'Ouverture, cette fois bardé du chœur de ces
dames et du solo de la soprano I. La récapitulation est doucement conduite par
Abbado pour asseoir cette dernière phrase « Trip away
; make no stay ; Meet me all by break of day ».

Claudio
Abbado en mai 2013 à la Philharmonie de Berlin ©Cordula
Groth
De la Symphonie fantastique Claudio
Abbado et les Berliner donnent une interprétation
pareillement inspirée. A « Rêveries-passions », le largo installe un
climat onirique, cors et cordes immatérielles. Le deuxième thème plaintif est
animé d'une juste pulsation. L'allegro agitato progresse avec ses accélérations
et ralentissements, et ses crescendos
qui font sonner dru la petite harmonie, alors que le chef sollicite moins les
percussions que les contrebasses. La coda « religiosamente »
apparaît très apaisée. « Un bal » et sa valse distillée à la harpe
(de notre compatriote Marie-Pierre Langlamet), a une élégance toute française, sans temps retenu
excessivement comme souvent. La conclusion libère le tempo dans un tourbillon
prestissimo. La « Scène aux champs » signe un moment d'anthologie
orchestrale : depuis l'entame des deux hautbois en écho, l'atmosphère se charge
d'électricité, dont les altos en sourdine. La marche prend son essor doucement,
avec des cordes pianissimo à la sonorité lointaine et éthérée. L'amplification
sonore offre ceci d'intéressant qu'elle garde un aspect intimiste aux cordes
aiguës tout en laissant aux cordes graves un espace ouvert. Le grand climax
s'impose naturellement, les cordes graves fort sollicitées
jusqu'aux accords fortissimos, volontairement non spectaculaires. Le passage en
pizzicatos des cordes sur la mélopée de la clarinette et du hautbois dans le
lointain, se charge peu à peu sur un contrechant discrètement insistant. Du
grand art de direction d'orchestre ! « Marche au supplice » trace une
large dynamique et un tempo très mesuré - c'est un allegretto non troppo. Le tempo s'anime à la reprise dans un glorieux
forte jusqu'à l'effet de broiement des derniers pages. L'atmosphère de
« Songe d'une nuit de Sabbat » est de nouveau oppressante avec des
pianissimos extrêmes, une marche grotesque des bois et des ruptures de rythme.
Les cloches semblent réelles pour sonner le glas du Dies Irae, scandé puis
asséné aux cordes graves et aux trombones. La fièvre s'empare de l'orchestre
dans la fugue emportant le discours dans les affres d'une ronde infernale
qu'Abbado fouette jusqu'à l'incandescence. Quel raffinement sonore d'un
orchestre inouï ! Une exécution visionnaire, dégagée de toute sollicitation
textuelle. L'iconographie accompagnant ces disques et leur facette filmée
privilégie les années d'antan, avec force photos souriantes et le regard de
bien des collègues musiciens, des Berliner Phil et bien
sûr du public berlinois.

Jean-Pierre Robert.
Jacques LENOT « Et il regardait le vent » : Quintette pour
trompette et quatuor à cordes. Raphël Duchateau, trompète, Quatuor Tana. 1CD L'Oiseau Prophète :
OP001. TT.: 62'.
Jacques Lenot
(*1945) est un compositeur atypique. Son corpus est déjà impressionnant : sept
quatuors à cordes, plusieurs œuvres d'orchestre, un opéra (créé à Genève en
2007), de nombreuses pièces pour piano, des installations sonores pour l'IRCAM
en 2099 et 2014. Sa musique, d'origine sérielle, a vite installé un style qui
lui est propre : une écriture très pointilleuse dans le détail de la nuance, de
l'attaque et du rythme, une grande virtuosité instrumentale. Son quintette
« Et il regardait le vent » (2013-2014), pour trompette et quatuor à
cordes est original : constitué de 62 séquences d'une minute chacune -
« qui ne sont pas des mouvements », précise-t-il - réparties en cinq
sections « pour le confort de l'écoute sur CD ». Lambeaux de
souvenirs, fragments de vie, bribes de musiques, intuitions fugitives. Ce « monodrame pour trompette et quatuor à
cordes » est censé conter l'histoire tragique de Héro et Léandre, d'après
une légende mythologique de la Grèce antique : les amours malheureux de la
belle princesse du temple d'Aphrodite sur la rive Européenne et du jeune homme
d'Abylos sur la rive orientale de l'Hellespont, qui
traversait chaque jour le détroit pour la rejoindre, et se noya lors d'une
tempête. Quoique le titre de la pièce ait à voir avec la littérature
flaubertienne, celle de Salammbô.
La trompette est l'aède qui conte l'histoire. On est « à la fois
dans un récit et hors du temps ». La composition frappe par sa
singularité, les instruments étant traités par deux, trois ou quatre avec ou
sans la trompette. Les cinq protagonistes ne sont réunis que peu souvent. Les
sensations sont variées : le calme, l'enjoué, l'angoissé ou l'ineffable
tristesse. Le jeu mise sur la tension et la virtuosité, sans jamais que
celle-ci ne soit gratuite. On y trouve des nappes sonores presque figées à la
basse dont émerge la digression du ou des violons. Et un jeu sul ponticello, en pizzicatos, à
l'arraché, sur le fil de la corde, dans des tempos d'une rapidité vertigineuse
ou au contraire d'une extrême lenteur, insistante. Une musique austère, certes,
mais non sans expressivité, à la fois immobile et mouvante, intime et ouverte
sur l'espace. Les brèves séquences se succèdent soit en rupture, soit sans
solution de continuité. La trompette qui se voit assigner un rôle déclamatoire,
sonne nullement agressive, jouée souvent bouchée. Dans les mains expertes de
Raphaël Duchateau. Les Quatuor Tana, dédicataire des
quatuors de Lenot, est le serviteur choisi de cette
nouvelle et étonnante œuvre.

Jean-Pierre Robert.
« Le Voyage
d'Allemagne ». Emmanuelle Guigues, viole de
gambe. 1 CD l L'Encelade : ECL 1403. TT : 62'.
Bel album du label L'Encelade, spécialiste
de la musique baroque, centré sur le voyage d'Allemagne au XVIIe et XVIIe
siècle, comme un voyage d'exil, un voyage initiatique vers une terre de
rencontre de nombreux violistes virtuoses, terre où se trouvent condensées les
influences anglaises, italiennes, allemandes, autrichiennes ou encore
françaises, terre natale de nombreux compositeurs majeurs et célèbres comme Bach
ou Telemann. Mais également d'autres moins connus comme Johann Schenck (1660-1712). Tout cela favorisant une formidable
émulation musicale dont Emmanuelle Guigues et sa
viole de gambe à 6 cordes attribuée à Edward Lewis nous donne superbe un
aperçu. Au travers des œuvres de Schenck (l'Echo du Danube, Sonata
V et VI), de Telemann (Sonate en Ré
majeur) et de J. S. Bach (Transcription
de la Suite V pour violoncelle). Johann Schenck,
né en 1660 à Amsterdam, compositeur de musique instrumentale, religieuse et
d'opéras, fut musicien et chancelier du prince électeur du Palatinat Johann
Wilhelm II à Düsseldorf. Son opus 9, L'Echo
du Danube est un recueil de 6 sonates (1742) dont les deux dernières furent
écrites pour viole de gambe solo, la 5eme suit le schéma d'une Suite de danses,
la 6eme, ,
plus libre de ton, est composée dans le stylus fantasticus d'origine italienne. La Sonate en Ré de Telemann (1729) s'inscrit, quant à elle, dans un
large répertoire instrumental, incarnant la tradition virtuose allemande. Enfin
la transcription de la Suite n° 5
pour violoncelle (1720) traduit l'influence, auprès de Bach, des maitres de
l'école française de viole de gambe et trouve, ici, une parfaite légitimité
quand on connait la filiation étroite entre les deux instruments. Belle
interprétation d'Emmanuelle Guigues qui signe par
ailleurs un livret clair et didactique.

Patrice Imbaud.
Mauro
GIULIANI : .Sérénades.
Intégrale de l'œuvre pour flute & guitare. Vol 1. Berten D'Hollander, flûte.
Nicolas Lestoquoy, guitare. 1 CD Hortus : HORTUS
121. TT : 38'.
Nicolas Lestoquoy, guitariste toujours très
actif, jouant en solo, en quintette, est également avide de nouvelles
rencontres puisque c'est aujourd'hui avec le flûtiste Berten
D'Hollander qu'il se produit en duo dans ce superbe
enregistrement. Une réussite discographique indiscutable, mais également une
découverte avec ces œuvres du compositeur Mauro Giuliani
(1781-1829) encore inédites au disque. Une musique qui reflète par son style la
personnalité du duo, faite à la fois d'une grande virtuosité mais également de
rigueur, pour une interprétation requérant lyrisme et frivolité. Mauro Giuliani, né en Italie, nommé en 1814 Virtuose Honoraire de
la Chambre de l'Impératrice Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon, est un
compositeur prolixe du début du XIXe siècle, reconnu à l'époque à l'égal de
Beethoven, Rossini ou Paganini, et qui consacra de nombreuses partitions à la
guitare dont les quatre duos pour flûte et guitare présentés ici, Grande Serenata, Serenata, Variazioni sull'aria « Oh dolce contento »
di Mozart et Variazioni sull'aria
« La biondina in gondoletta ».
Une interprétation pleine d'allant, de dynamisme, de charme où la
complémentarité des timbres instrumentaux et la complicité évidente des
musiciens donnent à ces sérénades toute leur élégance et leur entrain
communicatif. On attend avec une impatience à peine contenue la publication des
volumes suivants, prévue pour l'année à venir…

Patrice Imbaud.
« Les
Donneurs de sérénades ». Carl Ghazarossian, ténor,
Françoise Masset, soprano. David Zobel,
piano. 1 CD Hortus : HORTUS 124. TT :
62'13.
Voilà un superbe album de mélodies
françaises sur des textes de Paul Verlaine, extraits des Fêtes Galantes et de La Bonne
Chanson. Deux recueils poétiques publiés respectivement en 1869 et 1870
traitant de l'amour dans toutes les acceptions du terme, badinage amoureux
entre les personnages de la commedia dell'arte pour le premier, histoire de la
rencontre amoureuse avec sa future épouse, Mathide Mauré, pour le second. Certains de ces poèmes ont été mis
en musique par différents compositeurs connus comme Fauré, Debussy, Hahn,
Gaubert, Aubert, ou Canteloube et par d'autres moins célèbres comme Laparra, Szulc, Diepenbrock, Poldowski, Radoux, et Bordes. 24 mélodies composent le présent
enregistrement, tout à fait emblématique de la mélodie française par l'élégance
de la ligne de chant, par une certaine
préciosité dans la prosodie, par la beauté des textes. La belle voix du ténor
Carl Ghazarossian, à la diction parfaite se coule
dans cette musique avec un naturel confondant, en magnifiant tout le charme et
la poésie, encore renforcés par l'accompagnement très expressif et pertinent du
piano de David Zobel, ou par la voix de Françoise Masset qui vient s'ajouter à la fête pour les quatre duos
inclus dans cet album. Un beau disque
vraiment ! Admirable et
indispensable pour tous les amoureux du genre !

Patrice Imbaud.
« D'un
continent, l'autre ». Pierre Lelièvre, guitare. 1
CD Ad Vitam Records : AV 151215. TT : 59'11.
La guitare a assurément trouvé avec le
label Ad Vitam un de ses plus fervents et inspirés défenseurs. Défricheur et
promoteur de talents nouveaux et de compositeurs parfois peu connus du grand
public, ce label redonne à la guitare tout son lustre d'antan quelque peu terni
ces dernières années par un oubli bien injuste. Dans ce dernier opus, le
guitariste Pierre Lelièvre, membre de l'éminent
Quatuor Eclisses, nous propose un voyage en compagnie des grands noms de la
guitare latine du XXe siècle à travers deux continents, Amérique du Sud et
Italie. Tres canciones populares mexicanas et le plus sérieux et austère Thème varié et Finale de Manuel Maria
Ponce, ami d'Andres Segovia. La Suite
populaire brésilienne d'Heitor Villa-Lobos
témoignant d'un étonnant métissage, aux accents languissants, entre musique
brésilienne et musique européenne. Tarentella et Capriccio diabolico
de Mario Castelnuovo-Tedesco comme un hommage à Nicolo
Paganini, autre grand maitre de la guitare. Un disque magnifique mêlant avec le
plus grand bonheur les intonations populaires de la guitare à l'élégance des
sonorités, la danse et la méditation, le bonheur et les pleurs, dans un
indicible syncrétisme chargé de charme et d'émotion. Une interprétation superbe
pour un disque qui s'adresse à un large public participant à la renaissance de
cet instrument si populaire. Indispensable !

Patrice Imbaud.
Joaquin
RODRIGO. Claude DEBUSSY. Joaquin TURINA. Mario CASTELNUOVO-TEDESCO : Harp Concertos.
Naoko Yoshino, harpe. Orchestre d'Auvergne, dir.
Roberto Forès Veses. 1 CD
Aparté : AP 113. TT : 57'.
Un bel album dont l'intérêt réside, d'une
part, dans le choix judicieux des œuvres, peu connues pour la majorité d'entre
elles, et d'autre part, dans la superbe interprétation de la harpiste japonaise
Naoko Yoshino bien soutenue par l'excellent Orchestre d'Auvergne. Une alchimie
parfaitement réussie entre le timbre clair et chaud de la harpe et les
sonorités riches de la phalange auvergnate. Quatre œuvres au programme de ce
disque dont trois aux accents espagnolisant. Le célèbre Concerto d'Aranjuez de Joaquin Rodrigo (1901-1999) dans cette
transcription pour harpe datant de 1964 qui donne à cette œuvre archiconnue (du
moins l'Adagio central s'ouvrant sur
une belle cantilène du cor anglais) un nouvel éclairage qui n'est pas sans
charme. Le Concertino pour harpe et
orchestre (1937) du compositeur Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
d'origine juive espagnole, d'une écriture plus moderne. Tema y variaciones (1945) de Joaquin Turina (1882-1949)
initialement composée pour harpe et piano, secondairement orchestrée par son
dédicataire, le chef d'orchestre Rafael Frühbeck de
Burgos en 1978. Danse sacrée et Danse
profane de Claude Debussy (1862-1918) bien différentes des œuvres
précédentes, complète le disque, rappelant les affinités étroites du
compositeur français pour la harpe, un œuvre de concours composée par Debussy
en 1914. Un bel hommage rendu à la harpe par Naoko Yoshino et Roberto Forès Veses qui participe du
renouveau récent de cet instrument parfois injustement négligé au fond de
l'orchestre. A écouter absolument !

Patrice Imbaud.
Henri
DUTILLEUX. Pages de jeunesse. Pascal Godart, piano. Daniel
Breszynski, trombone. Alexandre Gattet, hautbois.
Vincent Lucas, flûte. Marc Trénel, basson. 1 CD Indésens :
INDE087. TT : 58'42.
En cette année 2016 où l'on célèbre le
centenaire de la naissance du compositeur Henri Dutilleux (1916-2013) le label Indésens réédite ce passionnant album consacré aux pages de
jeunesse du compositeur français, œuvres de musique de chambre pour piano et
vents écrites à la demande de Claude Delvincourt, directeur du Conservatoire.
Une sorte de « Dutilleux avant Dutilleux » où l'on peut juger du
poids du passé puisque ces partitions portent encore les stigmates esthétiques
de la mouvance néo classique en
vogue à l'époque de leur composition
dans les années 1940-1950, mais où l'on sent poindre de façon claire toute la
modernité et toute l'originalité qui caractériseront le Dutilleux de la
maturité, celui des Métamorphoses et Métaboles à venir. A cet égard
la Sonate pour piano, opus 1, datant
de 1948, dédiée à Geneviève Joy, pianiste et épouse du compositeur, est tout à
fait emblématique de cette évolution pressentie qui mènera Henri Dutilleux
jusqu'aux Trois Préludes pour piano
(1973-1988). La Sarabande et Cortège pour
basson et piano (1942) est une pièce dédiée au bassoniste Gustave Dhérin, professeur au Conservatoire de Paris. La Sonatine pour flûte et piano (1943), Choral, Cadence et Fugato pour trombone et
piano (1950) et la Sonate pour
hautbois et piano (1947) complètent cet enregistrement. Toutes pages
porteuses d'idiomes musicaux caractéristiques de Dutilleux comme langage modal,
notes pivots, effets de résonance, variations et fugatos.
L'interprétation des ces œuvres confiée aux solistes de l'Orchestre de Paris ou
de l'Orchestre de l'Opéra de Paris dont on connait l'excellence dans le domaine
des vents est un modèle du genre. Un superbe disque et une réédition
particulièrement judicieuse.

Patrice Imbaud.
***
MUSIQUE ET CINEMA
ENTRETIEN
Jérôme
Lemonnier, un pianiste pour l'image

DR
C'est dans son studio du côté de la
Bastille qu'il nous a reçu aimablement et a répondu à nos questions tout en
avalant rapidement une salade car le temps lui était compté : dans quinze jours
sa dernière composition doit être prête ! Un film pour Cannes ? Le
livre jaune derrière lui est la partition de Pelléas
et Mélisande, une source d'inspiration pour ses compositions, comme toute
la musique de cette époque.
D'où
vient cette présence très importante du piano dans pratiquement toutes vos
compositions pour l'image?
Je dirais que c'est la juxtaposition de
deux raisons assez indépendantes. La première est que je suis pianiste, c'est
mon instrument naturel ; et la deuxième est que les films sur lesquels j'ai
travaillé sont majoritairement l'œuvre d'un réalisateur qui s'appelle Denis Dercourt qui lui, indépendamment de moi, utilise des pianos
dans ses films. Et accorde à cet instrument une place prépondérante, même
structurelle puisqu'il est souvent présent physiquement et que les acteurs ou
actrices en jouent. D'où la valorisation du piano dans mes musiques.
Avec
ce réalisateur vous êtes en couple depuis la Tourneuse de Pages. C'était la première fois qu'il utilisait de la
musique originale, car ses précédents films utilisaient de la musique de
répertoire. Comment vous a-t-il rencontré ?
Par une circonstance tout à fait
particulière. Il se trouve que nous sommes parrains de deux enfants d'un couple
ami, sans se connaître au départ. On se retrouvait ainsi autour de repas. A un
moment il y a eu un film expérimental en cours et on a ainsi fait connaissance
avant de participer sur la Tourneuse de
Pages.
Film pour lequel
vous avez été nommé au César 2007 !
C'était ma première musique de film et
c'est vrai que l'environnement de ce film était particulièrement favorable pour
un compositeur. L'histoire, le réalisateur qui est musicien, une actrice très
concernée... Du coup j'étais happé par toute cette ambiance du film !
Vouliez-vous
au départ, après vos études classiques, composer pour le cinéma ?
J'avais envie de composer ce genre de
musique mais paradoxalement je ne me donnais pas les moyens pour m'en
approcher. Il n'y avait pas une démarche volontariste de ma part. Du coup, la musique
de film s'est faite attendre.
Étiez-vous
interprète ?
Non, j'écrivais de la musique mais pour
d'autres supports comme le théâtre, la chanson, le documentaire ; des
habillages d'émissions mais pas de fiction.
Le théâtre n'a-t-il
pas des rapports avec la musique à l'image ?
C'est une bonne école mais la grande
différence est que c'est une musique vivante en ce sens qu'elle renaît tous les
soirs, alors que la musique pour l'image est enregistrée, figée par rapport à
une séquence filmée. Et puis les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Ils
sont très faibles. Il faut beaucoup d'énergie, de temps, de disponibilité.
Lorsqu'on
écoute vos musiques on ne sent pas de filiation, d'influence évidente par
rapport à des compositeurs de musique de film ?
La filiation est effectivement plus dans la
musique à programme, même dans la variété. Mais je suis très sensible à des
compositeurs de musique comme Gabriel Yared, Bruno
Coulais, ou certaines musiques de Desplat.
Je pense plus à des
compositeurs fin XIXème début du XXème...
Oui
bien sûr des gens comme Fauré, D'Indy mais aussi Bach !
Bach est souvent
cité dans les films de Dercourt
Oui
il est partout, c'est notre maître à tous !
En 2015 vous avez
composé pour deux longs-métrages
Oui, La
Volante de Christophe
Ali et Nicolas Bonilauri, et En Equilibre de Dercourt.
Et j'en ai fait un troisième Mobile Étoile de Raphaël Nadjari, qui sortira en avril.
Par
rapport à ces films on est dans un univers musical très différent de ce que
vous aviez composé, même avec le film de Dercout !
Pour La
Volante je ne connaissais pas les compositeurs, et le film En Equilibre, de par sa construction,
n'est pas dans la même veine que les précédents.
C'est un film plus
solaire
Oui plus d'extérieur, alors que les films
précédents sont plus sombres, destructeurs…
On
oublie qu'on est dans un film de Dercourt avec une
musique de Lemonnier...
Oui
il a fallu plusieurs films pour en arriver là !
Êtes-vous toujours au piano dans les enregistrements ?
En
général oui, mais dans En Equilibre, je n'avais plus les doigts
pour jouer la 12eme Étude transcendante de Liszt. C'est Vincent Adragna qui s'en est chargé !
Mais ne vous
demande-t-il pas toujours le même style de musique ?
Oui il y a une couleur qu'il aime bien et
que l'on retrouve à travers ses films. C'est comme un peintre ; ce sont
toujours les mêmes obsessions, travaillées différemment, éclairées
différemment, racontées différemment …
Dans La Chair de Ma Chair, le piano est
extrêmement important !
Ce n'est que cela. Parfois c'est guidé par
des considérations qui sont d'ordre matériel. Là on était dans une économie
nulle, volontairement assumée, et du coup cela excluait toute possibilité
instrumentale. On peut s'en sentir prisonnier à certains moments et avec le
recul cela donne une cohérence qu'il ne faut bien sûr pas éterniser, mais qui a
besoin de temps pour s'affirmer.
Parlez
moi de La Volante : ils sont venus
vous chercher à cause du climat à le Dercourt ?
Oui il y a un climat similaire : la notion
de vengeance, de perfidie, de perversité, de manipulation. En fait la
production ne voulait pas que je travaille sur le film parce que le producteur
est le frère de Dercourt ! Lui, sagement, ne
voulait pas m'appeler. Sauf qu'ils ont fait quelques essais qui ne les ont pas
satisfaits. Et du coup les réalisateurs ont dit pourquoi pas Lemonnier !
Je ne voulais pas faire du Dercourt tout en restant
dans les codes du genre.
Il y
a un film que j'apprécie énormément c'est Demain
dès l'Aube ! Comment avez-vous travaillé sur la musique ?
Je me mettais dans le point de vue de
Vincent Perez : il est perdu, il y a une sorte d'exaltation de son frère, c'est
un film très romantique, la musique est très épique…
Vous avez aussi composé la musique d'Au Delà des Cimes ?
Oui
c'est un documentaire somptueux de Remy Tezier avec Catherine Destivelle,
sur sa passion de la montagne, avec une musique très contemplative. Il passe
beaucoup dans les écoles, dans les festivals sur la montagne, les nuits de la
glisse…. Remy a l'idée formidable de toujours mettre
de la musique originale sur ses documentaires et j'ai la chance de
l'accompagner !
Comment
faites-vous pour composer ? Vous cherchez des thèmes au piano ?
Il n'y a pas de règle. Pour tout ce qui
émergence d'idées, de rythme, le piano est souvent là ; mais il y a un grand
danger avec son instrument ou avec l'ordinateur car on joue ce qu'on sait
jouer. C'est presque les doigts qui commandent, on est un peu prisonnier de son
instrument. Par contre sur la table, le travail abstrait, en dehors du contact
de l'instrument, fait émerger des idées plus structurelles, plus pensées. C'est
un mélange des deux en fait : le piano est le cœur et la table un exercice plus
rigoureux.
Vous faites
vous-même les arrangements ?
Oui, oui, avec le crayon et le papier, à
l'ancienne. Les ordinateurs servent après. On a l'impression qu'avec le papier
c'est plus lent mais ce n'est qu'une impression.
Ce travail vous
l'avez appris au conservatoire, je suppose ?
Oui rue de Madrid. Je n'ai pas connu le
nouveau conservatoire. J'ai fait les classes de contrepoint, de fugue,
d'orchestration…avec des pointures.
Et la variété, vous
l'avez pratiquée tout de suite ?
Juste à la sortie du conservatoire, je suis
entré dans un groupe de rock, le lendemain de mon prix de fugue ! J'ai
toujours apprécié la pop anglo-saxonne. A mon époque c'était Pink Floyd, David Bowie, la fin de Beatles. Je viens d'une
famille de mélomanes qui aimaient la chanson française. J'ai été baigné dans ce
style de musique, donc j'ai toujours apprécié la mélodie, la langue française
dans les chansons.
Vous aimez écrire
des thème et variations
Oui j'aime bien. Si je n'avais pas écrit de
la musique de film j'aurais aimé écrire des chansons.
Étiez-vous
cinéphile ?
J'allais au cinéma mais sans plus, mais
j'écoutais beaucoup de musique de films.
Vous vous souvenez
du premier
vinyle que vous avez acheté ?
C'était Le
Serpent, musique de Morricone, c'était un 45tours. J'avais aussi Sacco et Vanzetti, Il Était une Fois la Révolution…
Vous
parlez de Morricone qui a une grande culture musicale et qui a été le premier à
mettre dans ses musiques des instruments étranges et des sons très
particuliers, à salir ses musiques. Cela ne vous a jamais tenté de le faire ?
Vos musiques sont très limpides…
Les musiques de Morricone sont pourtant
assez simples à écouter. Oui je pense que j'y viendrai.
Une
de vos dernières compositions est pour le film de Raphaël Nadjari,
Mobile Étoile. Comment
vous-a-t-il connu ?
Il
se trouve que le producteur de La Chair
de Ma Chair est le producteur de Mobile
Étoile. Je suis arrivé sur le tard car le travail avait été commencé par un
autre compositeur et du coup j'ai repris le travail ; et nous nous sommes
très bien entendus avec le réalisateur.
Le film est un film sur la musique. J'ai tout écrit avant le tournage et ces
musiques ont été interprétées par les acteurs. Le film a été monté en fonction
des musiques. Ce sont des petites chorales où la musique est au centre de leur
vie, ils font des concerts, ils galèrent pour trouver des subventions. C'est
quasi documentaire, le matériel musical est dans le style de Fauré, Poulenc,
Milhaud. Je connais assez bien la musique française en général. C'étaient des
retrouvailles avec une grammaire musicale que j'avais côtoyée de près dans
l'écriture.
Vous travaillez actuellement sur un
nouveau film. Pouvez-vous nous en parler ?
C'est
un film d'Emmanuel Courcol, Cessez le Feu. C'est son premier film. Il est plus connu comme
scénariste de Philippe Lioret. La musique d'orchestre
est très éloignée de l'ambiance des films de Dercourt.
C'est une histoire qui se passe en 1925, après la guerre, en France et en
Afrique, et qui parle de la difficulté à se retrouver soi-même après les années
passées au front. On enregistrera en Belgique pour des raisons de production.
Le piano est moins présent ! C'est un très beau film avec Romain Duris. On le verra peut–être à Cannes. Dans tous les cas en
septembre.
Bonne composition alors !



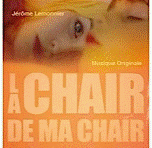
https://www.youtube.com/watch?v=-CbHI-PZYh8
Propos recueillis par Stéphane Loison.
BO en CDs
JÉRÔME LEMONNIER: PIANO WORKS 1
Musiques des films de
Denis Dercourt composées et
interprétées par Jérôme Lemonnier: La
Tourneuse de Pages (2006), Demain dès l'Aube (2009), La Chair de
ma Chair (2013), Pour ton Anniversaire (2013), En Équilibre
(2015). La Majeur LM-PW1-2015
Jérôme
Lemonnier en parle : « C'est pour moi une manière de
rendre hommage à une collaboration et une amitié entre un réalisateur et un
compositeur. C'est aussi l'occasion de prolonger l'existence de ces pièces
au-delà des contextes cinématographiques qui les ont inspirés, et retrouver
ainsi l'émotion de leur origine. »
Denis Dercourt souligne :« Il y a les
compositions écrites des mois avant le tournage, en général pour le piano.
Celles que les comédiens apprennent, qui nous influencent artistiquement,
celles qu'on murmure tout au long du tournage… jusqu'au premier montage. Et
puis, lorsque Jérôme Lemonnier commence à composer la bande originale sur les images,
je commence à comprendre dans quelle direction émotionnelle ira notre film. Ces
musiques jouent le rôle de "révélateur," comme au temps de la pellicule lorsque
celle-ci devait passer par un dernier bain chimique pour que les images
prennent pleinement leur sens... Comme lors des ciné-concerts où Jérôme
parvient à faire vivre dans un seul élan les partitions de tous nos films, ce
disque est pour moi un témoignage très émouvant. C'est une trace de notre
partage et de notre voyage. Comme si au fond, quelle que soit la forme, on
cherchait toujours la même chose, comme pour retrouver toujours une même
mélodie. »
Voilà tout est
dit ! Il n'y a plus qu'à apprécier ce voyage délicat qu'est la musique de ce
compositeur.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSDbgesIYCk
HEIDI
: Réalisateur : Alain Gsponer.
Compositeur : Niki Reiser. 1CD Milan Music 399 806-2
À l'âge de 9 ans, Niki Reiser savait jouer
de la flûte et composer. De 1980 à 1984, il étudie la musique, le jazz et la
composition au Berklee School
of Music à Boston, puis la musique classique à Bâle. Depuis 1986, il compose
principalement les musiques des films du réalisateur suisse Dani Levy. Heidi est la nième adaptation au cinema (il existe plusieurs series
de télévision et d'animation aussi) des romans de Johanna Spyri.
Shiley Temple, en 1937 dans le film d'Allan Dwan, a fait pleurer toute une génération. Luigi Comencini,
grand spécialiste de l'enfance, a réalisé un beau film en 1952. Ici, la petite
orpheline est jouée avec beaucoup de délicatesse par Anuk
Steffen, et Bruno Ganz en grand-père est étonnant.
Niki Reiser offre une belle musique inventive, très classique, avec de jolies
mélodies ("Homesick and sled
ride", "Happiness in the Mountains"…)
et un beau thème principal (avec différentes variations). Même si Niki Reiser
n'est pas très connu, il a été souvent récompensé en Allemagne et en Suisse. Un
disque qui sent bon les alpages suisses…En prime, la chanson en français
chantée par Barbara Pravi.
https://www.youtube.com/watch?v=v0d61JH_NJk
ESPION, LÈVE-TOI
: Réalisateur : Yves Boisset. Compositeur : Ennio Morricone. 1CD Music Box records :MBR-084
Immédiatement
après Le Professionnel (Georges Lautner, 1981), Ennio
Morricone illustre un autre film français, Espion, lève-toi
(1982), dirigé par Yves Boisset qu'il connaît depuis L'Attentat
(1972). Si les deux films ont des points communs, outre les dialogues
exceptionnellement sobres de Michel Audiard (espionnage, personnage menacé puis
broyé par le système, fin tragique), il n'en est pas de même pour la musique.
Autour de trois thèmes principaux, le compositeur installe un climat
particulier dont il a le secret, soit tendu, soit « nocturne » et
nébuleux, mais toujours abordable. La percutante Marche en la,
richement déclinée, soutient le film dans les moments d'action et de menace.
Sentimentaux et doux, les thèmes « Mélodie
pour Anna » et « Bugle pour Anna »
accompagnent la femme mais aussi la fragilité, l'aspect simplement humain et
conjugal du personnage central joué par Lino Ventura, en deux variations très
différentes. Le troisième thème, par son tempo lent et ses tons graves, semble
décrire le mystère, les méandres des services secrets, et de sourdes menaces.
Comme toujours avec Morricone, les timbres sont importants et chaque instrument
soliste apporte une couleur particulière qui se distingue dans un ensemble
pourtant cohérent. Ici l'atmosphère est signée d'abord par le bugle d'Oscar Valdambrini, puis par le pianoforte, le basson, les
percussions et les flûtes. Music Box Records propose la version intégrale
comprenant trois morceaux inédits et la chanson. Une occasion de redécouvrir
cette musique avec un son optimal.

https://www.youtube.com/watch?v=yEebK0HipDA
DEADPOOL : Réalisateur : Tim Miller.
Compositeur : Tom Holkenborg. 1CD Milan Music 399 795-2
Deadpool, est l'anti-héros le plus
atypique, sympathique, déjanté, de l'univers Marvel. Deadpool assène des
blagues à deux balles, est d'une grande vulgarité, se fout de la gueule des Xmen, de Liam Neeson qui ne doit
pas être un bon père après trois Taken, et a des pouvoirsinsensés. Pour les aventures « heroïcomiques » la musique de Holkenborg est à la hauteur du projet. Junkie Xl est le compositeur à la mode - cinq films en 2015. Il a
composé une musique
énergique comme à son habitude (on reconnaît le compositeur de MadMax), mais plus symphonique (The Punch Bowl, Back to life…) que les précédentes avec des accents
bien sûr à la Zimmer (Small Disuption).
Quelques titres additionnels viennent compléter cet album : « Angel
of the Morning » de Juice
Newton, « Shoop » de Salt-N-Pepa, « Calendar Girl »
de Neil Sedaka, « X Gon' Give
It To Ya » de DMX ou encore « Careless Whisper » de Wham, la
chanson débile que le couple Wade
Wilson / Vanessa Carlysle adore !

https://www.youtube.com/watch?v=4wD5tamhwXo&list=PLxu0LzNzvGmtzBKaJ2fxbcMg6WkD756sL&index=15
TREPALIUM : Réalisateur : Vincent Lannoo-Bourton. Compositeur : Thierry Westermyer.
1CD Cristal Records BOriginal BO-24
C'est la musique de la série d'anticipation diffusée sur
Arte. Dans un
futur proche, dans une société où 80% de la population est sans emploi, une
jeune femme, Izia, tente de survivre. Elle est née
dans "la Zone", du mauvais côté du Mur, un Mur qui a été dressé
pour séparer les Zonards des 20% d'Actifs de la Ville. Au fil du temps, les
tensions se sont accentuées entre les deux territoires : une rébellion est
née parmi certains chômeurs. Les Activistes multiplient les actes de sabotage
et de pression, et l'équilibre entre la Ville et la Zone se fragilise. Le
Gouvernement décide alors de mettre en place la mesure des "Emplois
Solidaires" pour calmer la situation : 10.000 habitants de la Zone vont
être sélectionnés pour travailler dans la Ville...Une série à la Hunger Game qui n'est pas réussie, avec des dialogues
d'une grande pauvreté, une fin assez convenue et des personnages principaux
inintéressants au possible. Ce
thème a été traité mainte fois au cinéma, de la comédie satirique italienne
dans les années 70 (le pôle emploi est en fait un lieu où les chômeurs
disparaissent !), au film terrifiant mexicain qui porte le le nom de Zone,
ou encore aux deux films de Carpenter, et dans une certaine mesure, dans Soleil Vert ou Bienvenue à Gattaca. Un mur existe en
vrai au USA et le documentaire sur le sujet est plus
terrifiant que cette série. Thierry Westermeyer, le
compositeur, a eu la lourde tâche d'écrire la musique. C'est un mélange
d'instruments acoustiques traditionnels et d'éléments électroniques. Il a une
formation classique au conservatoire de Lyon, il vient de la scène rock et a
surtout composé pour la télévision avec des réalisateurs comme Miguel Courtois,
Thierry Binisti. La seule écoute du CD nous plonge
dans un univers étrange et fascinant plus que les images du feuilleton. On
espère que cette BO sera un tremplin pour ce compositeur. Il le mérite. Par
contre, le « trepalium » des scénaristes et
du réalisateur est à revoir !

TRAVELLING
AVANT / ESCALIER C: Réalisateur : Jean-CharlesTacchella.
Compositeur : Raymond Alessandrini.
1CD Music
Box Records : MBR-085
Ce
nouvel album du label Music Box Records présente les deux premières bandes
originales de la longue collaboration entre le compositeur Raymond Alessandrini et le réalisateur Jean-Charles Tacchella : Escalier C (1985) avec
Robin Renucci, Jean-Pierre Bacri,
Jacques Bonnaffé, Catherine Leprince et Catherine Frot et Travelling
avant (1987) avec Thierry Frémont,
Ann-Gisel Glass et Simon de La Brosse. Escalier C tourne autour de la vie quotidienne et les
petits secrets des locataires d'un immeuble parisien. Le thème principal du
film s'ouvre sur un piano à la sonorité grinçante, écho musical au cynisme du
personnage principal. Le compositeur a écrit également pour le film des pièces
musicales mystérieuses et tendues, comme les peintures de Conrad et Bande-annonce. La bossa de L'expo amène une touche colorée dans l'univers aigre-doux du film.
La petite fille à l'arrosoir
renvoie à Robert Schumann et à la tendresse toute particulière contenue dans
l'écriture pianistique de ses « Scènes d'enfants ». Travelling
Avant permet à Raymond Alessandrini d'écrire une
partition nostalgique dominée par le saxophone, l'alto et l'accordéon,
accompagnés par un petit ensemble orchestral. Sa partition, entre émotion et
légèreté, part sur les traces nostalgiques de la Nouvelle Vague. Dans le Paris
de l'après-guerre, Nino, Gilles, Donald et Barbara partagent la même passion du
cinéma et rêvent de créer un ciné-club. Cette partition permet à Raymond Alessandrini de rendre un vibrant hommage à ses deux
mentors de la musique à l'écran, Georges Delerue et Maurice Jaubert.

LES
PREDATEURS (HUNGER) :
Réalisateur : Tony Scott. Compositeur : Michel Rubini
– Denny Jaeger. 1CD Milan Music 399 803-2
Il
s'agit de la première réalisation cinématographique de Tony Scott, réalisateur
issue de la publicité. Son esthétique sophistiquée, très mode, très pub, très
glacée, avec la fameuse « lumière anglaise », n'a pas eue prise sur
le public à son époque. Aujourd'hui son côté kitch avec ses voiles qui flottent
au vent, sa fameuse scène lesbienne entre Sarandon et
Deneuve - une première au cinéma, filmée derrière une moustiquaire, très porno
chic… - a trouvé son public. Hunger est devenu
culte à cause de la présence de Bowie face à la toujours froide Deneuve, et à
sa couleur gay. Milan a sorti ce disque en hommage à Bowie bien sûr. Schubert
et Bach sont de la partie mais l'intérêt de la musique du film et du disque est
dans les compositions de Rubini et de Jaeger. Elles
sont toute à fait passionnantes. Michel Rubini, de
formation classique, a travaillé avec de nombreux groupes de la pop des années
70-80. Son association avec Denny Jaeger, issu du
courant de la musique électronique anglaise, dû à la naissance des
synthétiseurs, offre une musique très sombre qui convient parfaitement à
l'ambiance mortifère du film. Elle a des réminiscences de compositions de
Penderecki ou même de Ligeti. La variation électronique du tube de Lakmé est sensuelle à souhait ! Voici un disque
qui fera sombrer dans une délicieuse mélancolie les auditeurs, hummm…
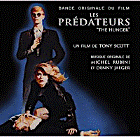
HAIL
CESAR ! Réalisateur : Joel & Ethan Coen. Compositeur : Carter
Burwell. Back Lot Music
Depuis
Blood Simple, Carter Burwell écrit
les musiques des frères Coen. Ici il s'est amusé
comme les deux frangins à faire des pastiches des films des années 50 : musique
à l'Alfred Newman pour le tournage d'un film sur le Christ, arrangement
de la Barcarole d'Offenbach sur la séquence Ester Williams / Scarlett Johansson à la manière de Busby
Berkeley, musique des films noirs pour la scène d'enlèvement de la star (George
Clooney plus débile que jamais) par les scénaristes communistes, maison qui
ressemble à celle du film Mildred Pierce,
musique d'Henry Krieger arrangée par Sam Davis façon 50, pour la scène des
matelots dansant à la Gene Kelly « No Dames » (et non « Dames »)
de Berkeley en tant que réalisateur, le western avec le cow-boy chantant à la
Ricky Nelson - Lazy Old moon de Walter G. Samuels
interprétée par Willie Watson - …On aura compris que ce film et sa musique ne
sont que des suites de scènes, hommage au cinéma des années des grands studios,
ces usines à rêve, avec ses
compromissions, ses mensonges, ses règles. Tout cela mis en scène avec brio par
les frères Coen, et avec beaucoup d'humour - la scène
du danseur de claquettes qui monte dans un sous marin soviétique accompagné par
tous les scénaristes et avec chœur russe (« Slavery
and Suffering » ; « Echelons
Song » interprété par les chœurs de l'armée rouge) est pompeusement
drôle ! Hail Cesar est un
film, et une musique, pour happy few. Les autres, malgré tout le talent des
frères Coen, risquent de s'ennuyer. La BO s'écoute
avec plaisir mais n'a aucun intérêt pour ceux qui n'ont
pas vu le film.

https://www.youtube.com/watch?v=j9rXT8YiZhU&list=PLeNErtgP0mU85vV-QdBcla_AqzDegYHj8&index=3
Stéphane Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Le site de l’Education Musicale
La librairie de L’éducation
musicale
Baccalauréat 2016. Épreuve de musique LIVRET DU CANDIDAT
192 pages Consulter le sommaire en cliquant ici |
| 1.STOCKHAUSEN JE SUIS LES SONS | ||
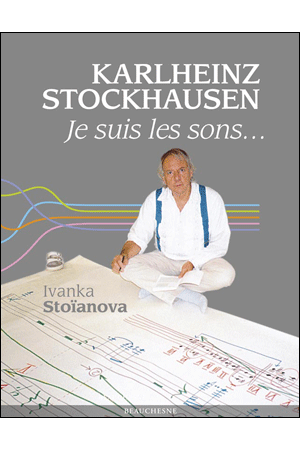 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite)
|
|
| 2. ANALYSES MUSICALES VIIIè SIECLE - Tome 1 | ||
 |
BACH Cantate BWV 104 Actus tragicus : Gérard Denizeau Toccata ré mineur : Jean Maillard Cantate BWV 4: Isabelle Rouard Passacaille et fugue : Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu : Janine Delahaye Phœbus et Pan : Marianne Massin Concerto 4 clavecins : Jean-Marie Thil La Grand Messe : Philippe A. Autexier Les Magnificat : Jean Sichler Variations Goldberg : Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale : Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses : Gérard Denizeau Apothéose Corelli : Francine Maillard Apothéose de Lully : Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus : Sabine Bérard Israël
en Egypte : Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile : Jacques Michon L’alleluia du Messie : René Kopff
Musique feu d’artifice : Jean-Marie Thill |
|
| 3. LE NOUVEL OPERA | ||
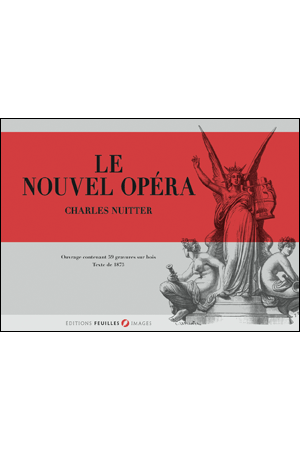 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
|
| 4. LEOS JANACEK, JEAN SIBELIUS, RALPH VAUGHN WILLIAMS - UN CHEMINEMENT COMMUN VERS LES SOURCES | ||
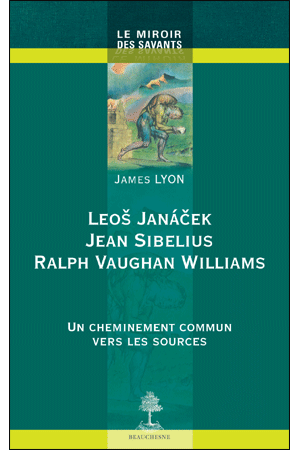 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque.
|
|
| 5. LA RECHERCHE HYMNOLOGIQUE | ||
 |
En plein essor à l'étranger, particulièrement en Allemagne, l'hymnologie n'a pourtant pas encore acquis ses titres de noblesse en France. |
|
| 6. JOHANN SEBASTIAN BACH - CHORALS | ||
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. |
|
| 7. LES 43 CHANTS DE MARTIN LUTHER | ||
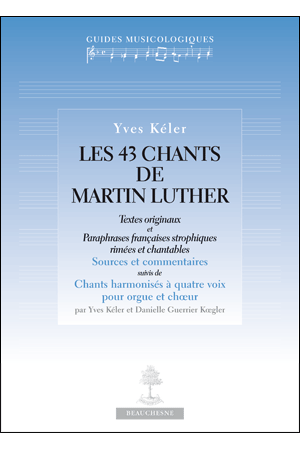 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. |
|
| 8. LES AVATARS DU PIANO | ||
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ?
Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ?
Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui.
Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ?
Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique. |
|
| 9. CHARLES DICKENS, LA MUSIQUE ET LA VIE ARTISTIQUE A LONDRES A L'EPOQUE VICTORIENNE | ||
|
|
Au travers du récit que James Lyon nous fait de l’existence de Dickens, il apparaît bien vite que l’écrivain se doublait d’un précieux défenseur des arts et de la musique. Rares sont pourtant ses écrits musicographiques ; c’est au travers des références musicales qui entrent dans ses livres que l’on constate la grande culture musicale de l’écrivain. Il se profilera d’ailleurs de plus en plus comme le défenseur d’une musique authentiquement anglaise, forte de cette tradition évoquée plus haut. Et s’il ne fallait qu’un seul témoignage enthousiaste pour décrire la grandeur musicale de l’Angleterre, il suffit de lire le témoignage de Berlioz (suite). | |
Les analyses musicales de L'Education Musicale