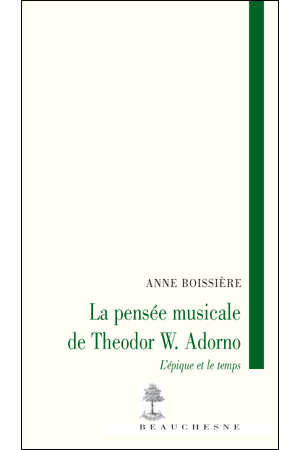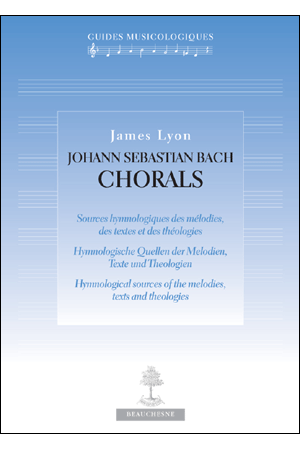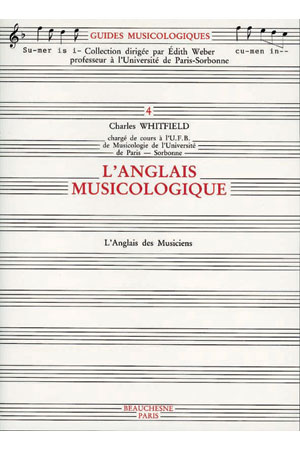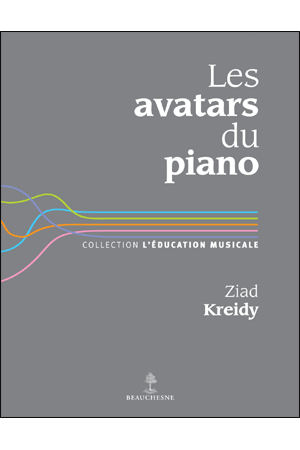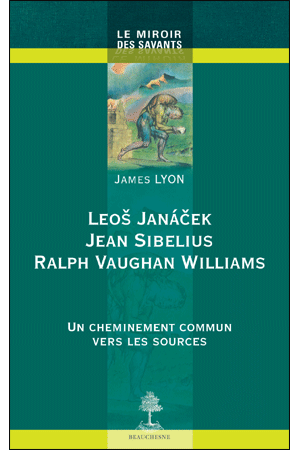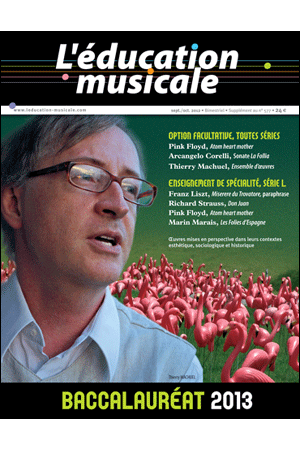Votre Lettre d'Information fait peau neuve !
Deux orientations
nouvelles se font jour : d'une part, un regard plus réactif porté sur
l'actualité, avec une rubrique « A réserver sur l'agenda », enrichie,
au fil de laquelle sont annoncés des évènements que la rédaction considère
comme essentiels. Et pas seulement parisiens ! D'autre part, la place faite à
la réflexion sur la théorie et la pratique musicales, élargissant ainsi le
champ d'investigation de la Lettre d'Information électronique. Vous trouverez
ainsi, dans chacune d'elle, un article de fond ou une interview de musicien, en
liaison directe ou indirecte avec l'actualité. Sans préjudice de l'ouverture
prochaine de nouveau(x) chapitre(s), à la musique de film, au jazz, par
exemple.
Vous retrouverez
vos rubriques habituelles : Recensions de spectacles et concerts, Édition
musicale, Bibliographie, et CDs & DVDs.
Puissent ces
informations, recensions et textes répondre, chères lectrices et chers
lecteurs, à vos aspirations !
Jean-Pierre Robert
redaction@leducation-musicale.com
À RESERVER SUR L'AGENDA
« Gaveau
Intime » : où l'on veut cultiver intensité et proximité !

©DR
La brillante saison de « Gaveau
intime », série de concerts organisés en partenariat avec la firme Naïve,
se poursuit, en février, avec des rencontres d'excellence. Ainsi, le 7 février,
le pianiste Nelson Goerner donnera un programme
Chopin, Debussy et Rachmaninov. Le 8, Isabelle Faust & Alexandre Melnikov, un duo de choc alliant finesse violonistique et
piano défricheur, s'illustreront dans des sonates de Mozart, Brahms et Bartók.
Enfin, le 12, Laurent Korcia jouera les six Sonates
d'Ysaÿe, un sommet du répertoire du violon, auquel
seuls les grands de l'archet osent se confronter. Trois événements à marquer
d'une pierre blanche. Dans un auditorium à taille humaine et à l'acoustique
flatteuse.

©DR
Salle
Gaveau, 45, rue de la Boétie, 75008 Paris ; par tél.: 01 49 53 05 07 ; http//www.GaveauIntime.com
Actualité
de Thierry Eschaich à Lyon

©Guy Vivien
En primeur de la création, le 27 mars 2013,
à l'Opéra de Lyon, de son opéra Claude (cf. NL de 12/2012), Thierry Eschaich doit voir reprendre, dans la cité des Gaules, les
14 et 16 février, son Concerto pour clarinette, créé en novembre dernier à
Paris. La pièce sera interprétée par son dédicataire, Paul Meyer, et
l'Orchestre national de Lyon, co commanditaire, sous
la direction de Alain Altinoglu.
Au programme également, la Symphonie Pastorale de Beethoven, et la suite
du Mandarin merveilleux de Bartók. Le concert sera encore donné à Chalon
sur Saône, le 15 février.
Auditorium de Lyon, les 14 février 2013 à
20 H, et 16 février à 18 H ; Espace des
Arts de Chalon, le 15 février à 20 H.
Location : Auditorium de Lyon, 149, rue
Garibaldi, 69003 Lyon ; par tél.: 04 78 95 95 95 ; http// www.auditorium-lyon.com
Espace des Arts, 5 bis Avenue Niepce,
711902 Chalon sur Sâone ; par tél. : 03 85 42 52 12 ; http//espace-des-arts.com
Les
solistes de l'Atelier Lyrique au Palais Garnier

© ONP/ Mirco Magliocca
Les solistes de l'Atelier Lyrique de
l'Opéra National de Paris, accompagnés par l'Orchestre de l'Opéra, sous la
direction d'Antony Hermus, donneront un concert
Mozart-Rossini, le 18 février 2013, sous les ors du Palais Garnier. Ils
interpréteront des extraits de La Flûte enchantée, Don Giovanni, Les
Noces de Figaro, La Clémence de Titus, Cosi
fan tutte, et du Comte Ory, Sémiramide et La Cenerentola, comme du Stabat Mater de
Rossini. Les études musicales de ce concert ont été confiées à Irène Kudela. L'occasion de découvrir de talentueux solistes, et
le remarquable travail effectué par cette institution.
Palais
Garnier, le 18/2, à 20H.
Location : angle des rues Auber et Scribe,
75001 Paris ; par tél. : 0892 89 90 90
; http//www.operadeparis.fr
L'Académie-Festival
des Arcs fête ses quarante ans

©DR
Depuis quatre décennies,
l'Académie-Festival des Arcs, en pays de Savoie, offre une programmation
exigeante et originale, permettant à des stagiaires venus du monde entier de se
perfectionner auprès des meilleurs pédagogues. Suivant l'exemple des grandes
Académies américaines, telles que Banff ou Malboro.
Des noms maintenant célèbres sont passés par ses rangs, Emmanuel Krivine, Renaud et Gautier Capuçon,
le Quatuor Ébène, et Éric Crambes, son actuel directeur artistique. L'édition
2013 aura lieu du 18 juillet au 4 août, l'Académie devant accueillir quelques
70 musiciens et artistes comédiens ou danseurs. Pour fêter le coup d'envoi des
festivités estivales, un concert sera donné à Paris, le 27 février prochain, à
la Salle Cortot. Une belle affiche retiendra l'attention : les violoncellistes
Xavier Gagnepain, Éric Levionnois,
Anssi Karttunen, la
chanteuse Ruth Rosique, les pianistes Jean-Frédéric Neuburger,
Jean-Michel Dayez, Antoine de Grolée, l'altiste Lise Berthaud, le contrebassiste Eckhard Rudolph, les
violonistes Éric Crambes et Svetlin Roussev. Ils joueront Mendelssohn, Schubert et Kaja Saariaho.
Salle Cortot, 78, rue Cardinet,
75017 Paris, le 27 février 2013, à 20H30. Entrée libre.
Le
Quatuor Borodine et Boris Berezovsky : une union pour
le meilleur

©DR
Une soirée de musique de chambre inédite,
et fort prometteuse, regroupera Boris Berezovsky et le Quatuor Borodine : un pianiste de talent,
le plus ancien quatuor à cordes en activité, et une institution. Pour
interpréter deux quintettes pour piano et cordes d'exception. L'opus 81 d'Anton
Dvořák atteint une rare perfection formelle et
une grande fluidité mélodique, toutes deux héritières de la tradition des
classiques viennois. La veine tchèque l'enlumine de joie rythmique et
d'embrasements sonores irrésistibles. Le quintette op. 57 est une des œuvres
majeures de Dimitri Chostakovitch, un succès quasi unanime lors de sa création
en 1940. Car très représentative de son langage, à la fois encore attaché à la
tradition classique russe, et tourné vers la nouveauté. L'inventivité y paraît
sans limite, tant dans la construction que dans la ligne mélodique.
Salle
Pleyel : le 28 février 2013, à 20H.
Location
: 252, rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris ; par tél : 01 42 56 13 13 ;
http://www.sallepleyel.fr
Evgeny Kissin à Pleyel

©Sheila Rock
Le pianiste russe Evgeny
Kissin est de l'étoffe des très grands. On se
souvient de sa fulgurante apparition sur les estrades de concert, il y une
quinzaine d'années. Depuis, le jeune prodige s'est mû en un artiste sensible et
réfléchi, offrant la quintessence d'un art qui ne cède pas à la virtuosité
ultra-démonstrative. Encore moins à quelque manière empruntée. Son répertoire
s'est diversifié, et enrichi des classiques viennois. En témoigne le programme
de son récital à la salle Pleyel, le 2 mars : Beethoven, avec la monumentale 32
ème sonate, mais aussi Haydn, et sa 59 ème sonate pour clavier. Et Schubert, avec un choix
d'Impromptus tirés des deux livres, de l'op. 90 et de l'op. 142. Enfin, la 12 ème Rhapsodie hongroise de Liszt, pour conclure sur une
note énergique. Un concert, à n'en pas douter, d'une haute tenue artistique, et
placée sous le signe de la générosité qui caractérise cet artiste.
Salle
Pleyel, le 3 mars 2013, à 20 H.
Location
: 252, rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris ; par tél : 01 42 56 13 13 ;
http://www.sallepleyel.fr
Tannhäuser
se donne à l'Opéra du Rhin

©DR
L'année Wagner s'illustre partout dans
l'hexagone. Ainsi l'Opéra national du Rhin a-t-il programmé une nouvelle
production de Tannhäuser, confiée au metteur en scène Keith Warner, déjà
bien connu dans la capitale alsacienne. Gageons que l'histoire du troubadour
torturé entre aspiration créatrice et quête de rédemption par l'amour, sera
illustrée de manière inventive. Tous les grands thèmes wagnériens sont déjà
présents dans cette œuvre charnière. La direction d'orchestre sera assurée par
Constantin Trinks, et la distribution s'avère
alléchante.
Opéra du Rhin, à Strasbourg, les 24, 30
mars 2013, et les 2, 5 et 8 avril 2013, à 19H (le 24/3, à 15H) ; à Mulhouse,
les 21 (15H) et 23 avril (19H).
Location : Strasbourg,19, Place de Broglie, BP 80320,
67008 Strasbourg cedex ; par tél.: 0825 84 14 84; caisse@onr.fr ; à Mulhouse, La Filature, 20 allée Nathan-Katz,
68090 Mulhouse cedex ; par tél.: 03 89 36 28 29.
Jean-Pierre Robert
L'Ensemble
InterContemporain joue Stravinsky, Varèse et Boulez.

©DR
Dans le cadre de la
saison centenaire, le TCE présente un concert rare, à la fois par la qualité
des œuvres présentées, toutes emblématiques de la création musicale du XXe
siècle (Huit miniatures instrumentales,
Concertino pour douze instruments de
Stravinsky, Le Marteau sans maître de
Boulez, Octandre, et Déserts de Varèse) mais, également, par
la qualité de l’interprétation. Peu de scandales auront marqué l’histoire
musicale du XXe siècle autant que celui provoqué par Déserts d’Edgard
Varèse, lors de sa première exécution, au Théâtre des Champs Élysées, en 1954.
L’œuvre frappa et divisa profondément l’auditoire par sa force tellurique,
l’âpreté de ses sonorités et son refus de tout compromis formel, poussant
jusqu’à ses conséquences ultimes « l’organisation » d’un son musical élargi aux
dimensions des bruits du monde. Le Marteau sans maître de Pierre Boulez,
un autre classique du XXe siècle, créé en 1955, offre un contrepoint saisissant
à l’univers de Varèse. Stravinsky, également au programme de ce concert,
déclarait en 1957 qu’il s’agissait de « la seule œuvre véritablement
significative de la nouvelle époque ». György Ligeti
évoquait, quant à lui, « l’univers félin, sensuel et coloré du Marteau »,
qui continue de fasciner et de surprendre par son extrême raffinement,
l’originalité de ses sonorités et le jeu subtil entre identité et différence.
Varèse/Boulez, une rencontre au sommet de l’histoire de la musique ! Ce
concert-événement sera dirigé par Matthias Pinstcher,
compositeur, et nouveau directeur musical désigné de l’Ensemble InterContemporain, qui saura révéler toute la modernité de
ces chefs-d’œuvre.
Théâtre des Champs-Elysées,
10 février 2013 à 20H.
Location : TCE, 15
avenue Montaigne, 75008 Paris. Tél. : 01 49 52 50 50. www.theatrechampselysees.fr
L’Opéra de quat’sous
au Théâtre des Champs-Elysées.

©DR
Le chef-d’œuvre de
Kurt Weill sera donné en version de concert, sous la baguette de Vladimir Jurowski à la tête du London Philharmonic
Orchestra, avec une distribution de qualité. C'est une plongée, haute en couleurs, dans les bas-fonds de Soho vers
1900, où brigands et bourgeois s’exploitent, rêvent et s’encanaillent. Kurt
Weill (1900-1950),
fils du Kantor de Dessau, grandit dans un milieu musical. A l’âge de 17 ans, il
est déjà chef de chant. Avant de connaître des succès notables, il travaille
comme critique à la revue Der deutsche Rundfunk. Il
fait, à Berlin, la connaissance de la cantatrice Lotte Lenya,
sa future épouse, et de Bertolt Brecht. A l’âge de 28 ans, il connaît un succès
mondial avec cet Opéra de quat’sous. Il créé,
ici, une musique volontairement populaire, influencée par le jazz, marquée par
un art mélodique évocateur et une importante rythmique, et aussi par un grand
savoir-faire artistique et une construction raffinée. Mélodie chantante, son
divertissant et rafraîchissant, donnent à cette œuvre aboutie une place
inamovible dans l’histoire de l’opéra.
Un concert à ne pas manquer !
Théâtre des Champs-Elysées, 28 février 2013
à 20H.
Location : TCE, 15 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tel. : 01 49 52 50 50. www.theatrechampselysees.fr
Zubin Metha de retour à la tête de l'Orchestre Philharmonique de
Vienne.

©DR
Dans le cadre de leur traditionnelle résidence
parisienne, les Viennois donneront un programme autrichien, avec la monumentale
Symphonie n° 8 d’Anton Bruckner. Certains ont pu la considérer comme le
« couronnement de la symphonie romantique ». Elle est, à l’évidence,
beaucoup plus que cela. Le « ménestrel de Dieu » s’y donne pour
mission de révéler une vérité divine, faite à la fois de lutte et d’espérance : une symphonie comme
une poignante prière. Composée entre 1884-1887, dédiée à l’empereur
François-Joseph Ier, elle donna lieu à plusieurs remaniements, et éditions, par
Robert Haas et Leopold Nowak.
Quelle que soit la version que choisira Zubin Mehta, la soirée se promet d'être mémorable, à n’en pas
douter !
Théâtre des Champs-Elysées, Le 12 mars 2013
à 20H.
Location : TCE, 15 avenue
Montaigne, 75008 Pari,; par tel. :01 49 52 50 50
; par mail : www.theatrechampselysees.fr
Patrice Imbaud
***
L'ARTICLE DU MOIS : MESSIAEN ET L’ORIENT
Olivier Messiaen s’intéressa très tôt aux
musiques extrêmes orientales (Consulter : Olivier Messiaen, Technique de mon langage musical, Paris, Leduc, 1944, 71 et 61 p.). Il s’en inspira
dans son discours musical, soit sous forme d’éléments théoriques, soit sous
forme de sonorités ou de principes compositionnels. Il a transmis cet exotisme
sonore et conceptuel à plusieurs de ses élèves, dont Yannis Xenakis (ainsi de l'évocation du gamelan indonésien
dans Pléiades), Pierre
Boulez (cf. Le marteau sans maître, Rituel…), François‑Bernard
Mâche, Jean-Louis Florentz,
et bien d’autres.
Pour lui, l’appel de l’Orient est avant
tout spirituel et mystique. Compositeur croyant et idéaliste, il se montre pessimiste
devant l’Occident du XXe siècle : cette
Europe chrétienne en crise entre dans une ère apocalyptique. À travers des
études à la fois théorique (modes et rythmes hindous), et sensibles (rencontre
avec la civilisation japonaise), Olivier Messiaen revivifie son inspiration
musicale et spirituelle. Cette rencontre avec l’Autre prend deux
apparences chez le compositeur :
la première est livresque. Il s’agit de l’étude des théories
rythmiques et modales de l’Inde ;
la seconde, qu'on peut appeler
« Orient vécu », est la parfaite adéquation entre la personnalité du
compositeur et la civilisation japonaise.
Des principes rythmiques
empruntés à l'Inde.
Un élément important dans la musique
d’Olivier Messiaen est le rythme. La maîtrise de ce paramètre est souvent
associée à une volonté de maîtriser le temps. Pour le croyant, la notion de
temps renvoie à celles d’éternité et d’infini. Le
compositeur des Sept Haïkï s’intéresse aux
théories indiennes et hindouistes du rythme, mais ne se rend jamais en Inde. Ce
cas n’est pas unique dans le monde intellectuel et artistique. En effet,
l’impact de la dernière exposition coloniale de 1931 est suffisamment fort pour
que certaines personnalités en subissent
l'influence. Cette manifestation est l’une des plus populaires de
l’histoire moderne. Les Français sont fascinés et conscients de leur empire.
Huit millions de visiteurs viennent faire le tour du monde en un seul jour.
Certains artistes, comme Antonin Artaud, seront marqués de façon définitive par
cette rencontre avec l’Autre. La réflexion de ce dernier dépasse la simple
opposition Orient/Occident. La perception métaphysique des danses balinaises
lui révèle une nouvelle approche du théâtre éliminant l’acteur au profit du
metteur en scène :
« L’enthousiasme d’Artaud témoigne
du choc de cette rencontre. Antonin Artaud ne s’est jamais rendu à Bali mais
les spectacles, auxquels il assiste à l’exposition, sont une révélation qui le
hante tout au long des années 30. Il écrit l’intégralité de son article « Sur
le théâtre balinais » en 1931. Une première partie de ce texte paraît
dès le 1er octobre 1931 dans La nouvelle revue
française sous le titre « Le théâtre balinais à l’exposition
coloniale » […]. Il fait une relecture en 1937 de l’ensemble de ses
textes sur le théâtre qu’il envisage de réunir depuis 1935. Son livre « Le
théâtre et son double » paraît dans la collection Métamorphoses
chez Gallimard le 7 février 1938. Les descriptions qu’il donne, dans son style
si personnel, éveillent la curiosité d’une grande partie des artistes
français. » (Patrick Revol, Influences de la musique indonésienne sur la musique française du XXè siècle, Paris, L'Harmattan, 2000, p.281).
Tout comme Artaud n’a pas étudié les danses
balinaises dans leur lieu d’origine, Messiaen n’a pas étudié la musique
Indienne dans son « milieu naturel », mais
uniquement dans les livres. En effet, il prend connaissance des théories
rythmiques et modales indiennes, d’après l’Encyclopédie de Lavignac, parue en 1913. De
ce fait, il ne s’agit pas d’un travail d’ethnomusicologue, mais d’une recherche avant tout livresque. Ce
travail théorique consiste à utiliser des éléments de langage
« exotiques » dans une musique contemporaine européenne. Par
ailleurs, avant même de s’approprier les fondements de la musique indienne,
Messiaen utilise instinctivement certains de ses éléments. Le compositeur Alain
Louvier le remarque et s’en étonne fortement :
« Comment
ne pas être intrigué par cette étrange correspondance avec Cârngadeva,
l’auteur des fameux cent vingt Deçi-tâlas. Messiaen
qui déclare avoir intuitivement utilisé les principes de la rythmique hindoue
avant même de la connaître, dialogue par-delà des siècles, avec Cârngadeva,
« poète-musicien-rythmicien-théoricien »… esprit aussi universel que
lui, et qu’il ne peut qualifier d’un seul mot. » (Alain Louvier "Olivier Messiaen, le rythme et la couleur", dans Catherine Massip (dir.), Portrait(s) d'Olivier Messiaen, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1996, p.47-60).
Cette étude mystique des rythmes et des
principes rythmiques hindous sera
complétée par la découverte du traité de Cârngadeva.
À ce propos, le compositeur
déclare :
« C’est un coup de chance. J’ai eu par hasard dans les mains le traité de « Cârngadeva » et la fameuse liste des cent vingt deçi-tâlas ; cette liste fut une révélation, j’ai senti immédiatement que c’était une mine extraordinaire, je l’ai regardée et copiée, contemplée et retournée dans tous les sens pendant des années afin de parvenir à en saisir les sens cachés. […].Par une nouvelle chance, un ami hindou m’a donné la traduction de ces mots (sanskrits), ce qui m’a permis de découvrir les symboles cosmiques et religieux qui sont contenus dans chaque deçi-tâlas. »(Olivier Messiaen, Musique et Couleur, Nouveaux entretiens avec Claude Samuel, Paris, Belfond, 1986, p.82-84 cité dans Pascal Arnault, Messiaen... les sons impalpables du rêve, Lillebonne Lillénaire III Editions, 1999, p.31).
La théorie indienne
selon Lavignac, et
l’instinct n’ont pas suffi à Messiaen. Le hasard lui a donc permis d’accéder à
ce traité très ancien nommé le Cârngadeva. Le
compositeur s’est imprégné de son contenu où sont mêlés rythmes, échelles
musicales ainsi que symboles cosmiques et religieux.
Sans entrer dans les détails techniques de
ce traité, les dimensions de cet article ne le permettant pas, on ne peut faire
l’impasse sur la notion de rythmes non rétrogradables.
Succombant au charme des impossibilités, le compositeur utilise, très tôt dans
ses œuvres, des formules rythmiques et des structures pouvant être lues dans
les deux sens. A titre d’exemple, voici la
structure non rétrogradable de Couleurs de la Cité
Céleste (1963) :
a b a c a c a
b a
Ce procédé s’applique autant à de toutes
petites cellules, qu’à l’architecture complète d’une œuvre. Bien sûr, l’auditeur, même averti, n’entend pas ces phénomènes structurels. Ils restent du domaine de l’intellect et du
mystique. La lecture « dans les deux sens » d’une œuvre a toujours
éveillé de l’intérêt chez les compositeurs croyants et mystiques. L’exemple le
plus célèbre dans l’histoire de la musique reste,
bien sûr, celui de Jean-Sébastien Bach dont
l’œuvre regorge d’organisation symétrique de toutes sortes. Par ces tours de
passe-passe assez extraordinaires, l’homme touche au mystérieux, au mystique et
se rapproche du Divin. L’architecture et la symétrie occupent une place
prépondérante dans la musique savante européenne, mais il est indéniable que cet aspect est plus ou
moins important dans l’esprit des grands compositeurs. D’une contrainte
formelle peut naître un plaisir intellectuel et/ou mystique. Olivier Messiaen
appartient à cette catégorie de musiciens pour qui satisfactions formelle et
mystique se rejoignent.

©DR
Mais pourquoi ce grand voyageur, passionné
par l’Inde et l’hindouisme, qui a largement utilisé les techniques musicales
indiennes, n’a jamais cru devoir visiter ce pays ? À la lecture de sa biographie, de nombreux voyages sont
mentionnés : États-Unis, Allemagne, Italie, Japon, Argentine, Finlande,
Espagne, Canada… L’objet de ces
déplacements ne se résume pas uniquement à des concerts et des
conférences : Messiaen note les chants d’oiseaux et s’imprègne de la
culture musicale de chacun de ces pays. Les entretiens du compositeur avec
Claude Samuel (Journaliste, producteur d'émissions radiophoniques, créateur de festivals et de concours internationaux, Claude Samuel a été directeur de la musique à Radio France de 1989 à 1996) laissent entrevoir un début
d’explication. Les grandes différences sociales de l’Inde le mettent mal à
l’aise. En effet, face à la misère de ce pays, ce fervent catholique, cet homme
de cœur, se sent impuissant :
« J’aurais voulu connaître l’Inde.
Et l’Inde me suggère aujourd’hui une autre réflexion. Je suis compositeur de
musique, j’ai écrit de nombreuses œuvres, j’ai connu des échecs et aussi des
succès, mais je considère que tout cela n’est rien à côté de la mission que
remplit la Mère Teresa à Calcutta. Vous savez qu’en Inde des gens meurent de
faim. La mère Teresa va à leur secours, elle soigne les malades, elle console les
mourants, elle relève les prostituées. C’est une action admirable. Moi qui ne
suis pas doué pour cela, je ne pourrais pas être infirmier ou médecin, et je ne
suis pas un saint. Mais j’aurais donné toutes mes œuvres musicales pour être la
Mère Teresa. » .
Un Orient vécu, le
Japon.
La
rencontre « physique » avec une culture orientale se fera avec
un autre pays, lui aussi très riche en symboles mystiques, mais d’une qualité
de vie semblant plus acceptable aux yeux de Messiaen : le Japon. Le Japon
revêt deux visages, celui d’un pays riche en traditions, mais également
moderne. Cette ambivalence plait à Messiaen et, contrairement à l’Inde, il
se rend dans ce pays qui, à ses yeux, est à la fois un jardin d’Eden et un
temple de la modernité.
Au cours d’un entretien avec Claude Samuel,
le compositeur avoue qu’il n’a jamais fait le voyages aux Indes, et que le
Japon est le pays d’Orient qui l’a le plus fasciné :
« Curieusement, toute ma vie j’ai
désiré aller aux Indes, et je n’ai jamais fait le voyage. Je me suis contenté
d’étudier les deçî-tâlas. Peut-être est-ce mieux
ainsi : j’ai connu l’Inde antique dans ses manifestations les plus
profondes et, sur place, je risquais d’être déçu. Mais il y a un pays d’Orient
que je connais bien, qui m’a totalement fasciné dès mon premier séjour, c’est
le Japon. » (Claude
Samuel, op. cit.,
p.142.)
Curieusement, l’Orient pour Messiaen c’est
le Japon. Nous l’avons vu, les Indes « modernes » inquiètent le
compositeur. Il ne se sent pas capable d’affronter la pauvreté qui accapare ce
pays et avoue également avoir eu peur d’être déçu. Par l’influence
coloniale ? Le compositeur ne dit rien à ce sujet. Peut-être a-t-il peur
de ne pas trouver, dans l’Inde contemporaine, l’Orient qui le fait rêver. C’est
à dire son propre Orient, cet Orient mystique qu’il a rencontré en étudiant les
deçï-tâlas. Cet Orient, il ira le chercher et le
trouvera au Japon.
Dans ce même entretien avec Claude Samuel,
Olivier Messiaen explique que le Japon est un pays noble, sans ivrognes ni
mendiants. Selon lui, l’homme japonais « respire la noblesse », et
l’on ne peut que s’incliner devant son goût au travail. Cette rencontre
« heureuse » avec cette « autre » culture semble être une
réponse au malaise occidental de nombreuses personnalités du XXe siècle. En effet, par son code moral et ses convictions
religieuses, Messiaen ne peut approuver certains comportements de ses
contemporains. Cette sensibilité se manifeste par le
rejet de certains genres musicaux, dont l’exemple le plus connu est son
aversion pour le Jazz. Son jugement, assez sévère, à propos de cette musique,
n’est pas que d’ordre esthétique. Pour Messiaen, ses lieux de diffusion ne sont que des lieux
de perdition, voire de prostitution. Ce n’était pas sans naïveté qu’il faisait
l’amalgame : « société permissive - liberté sexuelle - drogue - boîte
de nuit jazz ». (Op. cit., p.92.)
Cet enthousiasme pour le Japon,
chez Messiaen, n’est pas uniquement d’ordre social et moral, mais également
d’ordre musical. Grand admirateur de musique japonaise, le compositeur aime
particulièrement le nô et le gagaku. Ce dernier genre, notamment,
l’interpelle. En effet, cette musique du VIIIè siècle de notre ère, présente des accords
joués par l’orgue à bouche « contredisant »,
pour nos oreilles occidentales, une ligne mélodique jouée, elle, par le ryuteki, sorte de flûte traversière. Ce procédé fait
preuve d’un modernisme audacieux comparé à la musique européenne de la même
époque, qui ignore alors les règles de l’harmonie.
Mais l’« audace » ne s’arrête pas
là. Cet ensemble est complété par deux instruments à cordes pincées, le koto
et le biwa, et par trois percussions, le shoko,
le taîko et le kakko.
Cette section rythmique accélère progressivement le mouvement de l’œuvre
jusqu’à un mouvement rapide, puis recommence à nouveau lentement pour à nouveau
accélérer, et ainsi de suite, un grand nombre de fois. Sans doute difficile à
concevoir pour une oreille européenne non exercée, cette pratique est cependant
typique du gagaku.
Le dernier élément caractéristique de cette
musique, extraordinaire pour nos oreilles, est l’harmonie produite par l’orgue
à bouche. Celle-ci n’est pas placée au-dessous de la mélodie, comme dans la
musique occidentale, mais au-dessus, comme le ciel au-dessus de la Terre. Ce
dernier élément ne laissera pas indifférent Olivier Messiaen. Dans ses Sept Haïkï (1962), il s’inspirera de ce principe
compositionnel en harmonisant « par le haut ». Le principe de l’orgue
à bouche sera transposé à l’orchestre. Cette œuvre fut composée en France, au
retour d’un voyage au Japon, comme il le confie à Claude Samuel :
« […] Et c’est en pensant à toutes
ces choses merveilleuses que, revenant du Japon, j’ai composé mes Sept Haïkï, où l’on entend les échos du gagaku, où
sont décrits le parc de Nara et le paysage de Miyajima. »
(Op. cit., p.144.)

©DR
Ce Japon, évoqué par le compositeur, est
celui des traditions. Mais il ne faut pas oublier que le Japon est aussi un
pays moderne. Dans son entretien avec Claude Samuel, le compositeur évoque un
Japon idyllique : un Japon des paysages, des traditions et des oiseaux. Sur le
plan social, il décrit un pays parfait à ses yeux, sans pauvreté et sans
oisiveté. Mais il existe un autre Japon ; celui du modernisme, des grandes
villes polluées et des traditions affaiblies.
Messiaen, bien sûr, est conscient de ce
paradoxe. Il reconnaît volontiers qu’au Japon, le Moyen Âge côtoie en
permanence le XXème siècle. Mais cette double identité ne doit pas être ressentie comme un
drame. Dans sa classe de composition, au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris, Olivier Messiaen a reçu de nombreux étudiants japonais. Ces
jeunes compositeurs étaient souvent déchirés entre leurs traditions et la
musique occidentale. Le conseil du professeur était : « Restez
japonais ! » Autrement dit, « utilisez vos connaissances
modernes, mais restez dans la ligne des traditions japonaises ! » (Op. cit., p.146.)
x
x x
De nombreux compositeurs de XXè siècle s’intéresseront aux formes musicales
d’autres cultures et les intégreront dans leurs œuvres. L'impact d’une
« autre » culture sur la création musicale du XXè prend diverses formes. En 1889, lors de
l'Exposition universelle, Claude Debussy est émerveillé devant le gamelan
javanais et la musique du théâtre annamite. Cette rencontre avec une
« autre » musique aura une incidence sur son langage musical :
emploi de modes pentatoniques, jeux de polyrythmie… Ce goût de l’exotisme se
retrouve chez d'autres musiciens :
Maurice Ravel et ses « chinoiseries », dans Ma mère l’Oye,
Béla Bartók et l’exploration, de façon plus
rigoureuse et plus musicologique, des musiques
d’Europe centrale. Ces compositeurs ne retiennent des musiques
« exotiques » que des caractéristiques techniques étayées par des
éléments musicaux assez rudimentaires (modalité, rythme…).
Mais ce qui différencie Messiaen de ses
illustres prédécesseurs, est son rapport au religieux. Sa relation avec la musique
indienne ne se veut pas « folklorisante », mais avant tout
mystique. Il ne cherche pas à donner une couleur « orientale » à sa
musique. Ce sont les valeurs symboliques,
mystérieuses, qui lui importent avant tout.
Cet exemple de dialogue des
cultures, Orient/Occident, tel que décrit, se limite à une vision uniquement
européenne. En effet, la majorité des compositeurs occidentaux, s’inspirant des
« autres cultures », le font majoritairement dans le cadre officiel
de compostions écrites et de concerts. Autrement dit, la notion d’œuvre finie,
en tant qu’entité, l’emporte sur toute idée de performance liée à un besoin
social. Nos usages culturels glorifient le compositeur et l’interprète, et non
l’« utilité » de la musique. Des échanges plus vivants existent dans
le domaine des musiques dites « improvisées » ou
« libres », mais ces appellations en disent déjà beaucoup sur notre
manière de catégoriser et donc de juger ce qui nous échappe…
Dominique
Arbey
Dominique Arbey est Docteur en musicologie (Paris IV – Sorbonne).
Depuis 1994, il enseigne le piano (classique et jazz), l’histoire de la
musique, l'analyse musicale, l'harmonie et l'accompagnement. Il est
l'auteur d'articles publiés dans diverses revues (L'Éducation Musicale,
Euterpe, Les Cahiers de Francis Poulenc), et d’un ouvrage, Francis Poulenc et la musique populaire
(Editions l’Harmattan, 2012). En tant que pianiste,
il se produit dans plusieurs formations (Jazz, chanson française, musique
de chambre).
***
SPECTACLES ET CONCERTS
William
Christie illumine Belshazzar à Pleyel

© Anna Bloom
Parmi les nombreux oratorios de Haendel, Belshazzar
occupe une place particulière. Il est écrit sur un livret de Charles Jennens, qui lui avait déjà fourni le sujet de Saül et
du Messie. Pour cette belle tranche d'Histoire Sainte, le poète offre un
texte d'une belle langue, et hautement dramatique, puisée aux sources
bibliques, mais aussi aux grecs. Au point que la dramaturgie de l'œuvre, plus
proche du théâtre que de la veine religieuse, a conduit naturellement à la
mettre en scène. Ainsi d'une intéressante production donnée au Capitole, captée
en DVD ( cf. NL de 9/2011). Dans la présente exécution
de concert, la force de la trame n'est pas pour autant laissée dans l'ombre.
Bien au contraire, on ressent à chaque instant combien le saxon se montre
visionnaire, en particulier dans les scènes animées telles le détournement du
fleuve Euphrate, le banquet chez
Balthazar, ou encore le passage où le prophète Daniel décrypte les hiéroglyphes
tracées par la main divine. Descriptive, la partie musicale pourvoit en
elle-même à l'imagination. Haendel a beaucoup travaillé à sa mise au point, la
remaniant plusieurs fois, en fonction de ses interprètes, au fil des reprises,
entre et 1744 et 1758. Elle se signale par ses vastes proportions, se composant
de trois parties. Elle requiert cinq solistes, et un chœur figurant tour à tour
juifs, babyloniens, et Perses, intimement partie à l'action. William Christie
impose d'emblée une lecture sereine, et aristocrate. Le silence entre les
diverses séquences accentue cette impression, comme les infinies nuances
apportées au discours, tel l'Amen final triple pianissimo. Elle est surtout
animée d'une intense vie intérieure : l'osmose avec les musiciens des Arts
Florissants n'est plus un secret. Les cordes sonnent chambristes, les bois
résonnent d'une étonnante limpidité. Surtout, il fait des diverses
interventions du chœur des moments de pure lumière. On admire la clarté de la
diction, la quasi transparence de l'élocution.
L'effectif est de quelques 26 chanteurs, et comme cela sonne ! Ils sont,
d'ailleurs, disposés de manière originale, hommes et femmes étant alternés, et
non pas alignés en deux groupes compacts. Leurs diverses interventions sont
fascinantes, dans des séquences aussi différentes que le chœur d'imploration
des juifs (« O grand Dieu, toi qu'on ne connaît qu'obscurément »), ou
celui, extraverti, des invités au festin royal. Les solistes sont superbes. A
commencer par Rosemary Joshua, Nitocris, la reine à
la fois prophétesse de la décadence de Babylone, et pathétique devant le destin
tragique de son fils : interprète choisie du rôle, qu'elle défendait déjà dans
la production toulousaine de René Jacobs, elle s'impose par la beauté de
l'intonation, et l'émotion retenue dont elle pare ce caractère attachant. Le
ténor Allan Clayton, hier Albert Herring chez Britten, s'avère lui aussi un fin
handélien, de sa voix naturelle, justement ménagée
avec une éloquente simplicité. La prestation de Iestyn Davies est pur régal. Ce jeune contre-ténor,
à qui Christie a choisi de confier le rôle de Daniel, figure en bonne place
dans la constellation nombreuse de ses pairs : son chant est aussi immaculé
qu'empreint d'ébranlement intérieur. Le personnage de Cyrus, confié ici à une
mezzo-soprano, trouve en Caitin Hulcup
une sûre musicienne, et la basse Jonathan Lemalu
apporte noblesse de ton à celui de Gobrias. Tous font
des récitatifs expressifs et des mirifiques arias du saxon un florilège de
chant assuré et ému.
Hänsel et Gretel entre fantasmes et saveur d'enfance
Engelbert HUMPERDINCK : Hänsel et Gretel. Opéra romantique
en trois actes. Livret de Adelheid
Wette, d'après le conte homonyme des frères Grimm.
Eléonore Pancrazi, Charlotte Plasse, Paul-Alexandre
Dubois, Anne Rodier, Christophe Crapez, Claire Lairy. Maîtrise des Hauts-de-seine.
Ensemble Musica Nigella, dir. Akénori Némoto.
Mise en scène : Mireille Larroche.

© Mathilde
Michel
Nouveau titre, nouvelle aventure, Hänsel et Gretel
n'est-il pas un choix naturel pour La Péniche Opéra, qui aime tant faire voguer
nos imaginations ? Un conte où une
ogresse gave les enfants de pain d'épice, comme la télé gave nos
cerveaux addictifs, pour mieux les dévorer. Plus qu'un programme, une réalité !
Cet après-midi du 23 décembre, devant un auditoire remuant de jeunes pousses,
on donnait la version française de l'opéra de Humperdinck.
La proximité de l'histoire n'en est que plus évidente, illustrant le second
degré d'un conte aussi drôle qu'effrayant : « des enfants insupportables,
enfermés dans un espace trop petit », nous dit Mireille Larroche, « des adultes qui hurlent leur misère (un
peu trop bruyamment cependant, du point de vue vocal), une forêt rendue stérile
par une société qui n'a plus aucun respect de la nature, proche du terrain
vague, habitée par une sorcière anthropophage qui règne sur un fast food de friandises ».
On est près de la vision iconoclaste d'un Laurent Pelly
à Glyndebourne. Mireille Larroche
dit s'être inspirée du style graffiteur percutant de Basquiat,
apte à « véhiculer un message spontané, à la fois enfantin et
effroyablement sérieux ». A deux pas de la ville, qui s'éveille, durant
l'Ouverture musicale, pour se refermer sur un intérieur étriqué, où rien ne
manque de la médiocrité d'une famille de laissés pour compte, pas même le
frigo, désormais vide de victuailles. Les deux gamins, fort bien appareillés,
sont on ne peut plus hystériques. On les retrouve dans la forêt aux couleurs
bariolées, traversée de visions oniriques, telles le marchand de sable, ou le
la fée aux cheveux bleus, robe à panier transparent. Andersen revient à lui, et
le surgissement d'une collection de petits Hänsel et
d'adorables Gretel nous montre que le rêve n'est pas
loin. Mais voilà la maison de pain d'épice, au détour d'une allée : alors le
fantastique grinçant reprend ses droits. Comme Pelly,
Larroche la voit telle une montagne de friandises.
Celles-ci entourent un écran de télé, qui projette un visage androgyne de femme
aux cheveux blondasses, costume ajusté.
Aguichante ou ensorcelante. A voir ! Les futaies alentour se font sucres
d'orge scintillants comme des néons coloriés. Les deux
loustics emmènent en caddy des lots de sucettes et autres sachets de gâteaux.
La charge est sévère, entre fantasme et angoisse, quoique pas si féroce que
cela, tous comptes faits. La poésie du conte
triomphera dans le happy end joyeux d'une ronde enfantine. Cette approche créative
se satisfait parfaitement de la transcription musicale : une habile réduction,
opérée et dirigée par Takénori Némoto,
pour une formation d'une dizaine de musiciens, dont trois bois (superbes de
gracilité lors du passage du coucou/marchand de sable), et quatre cordes
enjouées et épicées. Tout cela fonctionne de main de maître, les scènes
parfaitement enchaînées mêlant illustratif et figuré, vérisme cru et fin clin
d'œil. La troupe se dépense sans compter, dont les deux protagonistes, auxquels
il n'est pas difficile de prédire un bel avenir. La salle est conquise, nous
aussi !

© Mathilde
Michel
Les
Brigands font pétiller le champagne Offenbach
Jacques OFFENBACH : Croquefer
ou le dernier de paladins. Opérette bouffe en un acte. Livret de Adolphe Jaime
et Étienne Tréfeu. L'île de Tulipatan.
Opéra bouffe en un acte. Livret de Alfred Duru et
Henri Chivot. Flannan Obé, Emmanuelle Goizé, Loïc Boissier, Lara Neumann, François Rouguier,
Olivier Hernandez. Compagnie Les Brigands, dir.
Christophe Grapperon. Mise en scène : Jean-Philippe Salério.

© Claire
Besse
Les Brigands ont encore frappé, et
l'Athénée n'est qu'un immense éclat de rire. On donne un « double
bill » effarant de drôlerie, puisé dans le vaste fond de l'auteur de La
Belle Hélène. Celui-ci n'a pas son pareil pour trousser en un acte une
intrigue déjantée, où l'anachronisme le cède à l'invraisemblable. Ainsi de
l'histoire moyenâgeuse tarabiscotée de Croquefer (1857),
qui met aux prises un matamore de salon, bardé de son écuyer Boutefeu, et leur
ennemi Mousse-à-Mort, dont la fille est courtisée par Ramasse-ta-tête, un
fidèle du premier. La bouffonnerie est si délirante qu'on a pu demander
« grâce pour tant d'absurdités » ! Une scène d'empoisonnement
collectif aura raison des ardeurs belliqueuses de tout un chacun : les embarras
digestifs, à peine figurés, entraîneront tout le monde à terre, dans la
position qu'on imagine ! Cela a du piquant, en particulier lors d'un endiablé
« galop du postillon ». Les six gars et filles des Brigands se
dépensent sans compter. Et si on reste, par moments, un peu à la surface des
choses, la faute en revient, sans doute, à la minceur de la trame. En tout cas,
l'immense miroir, disposé de biais, autorise d'amusants effets, les
personnages, souvent vautrés au sol, apparaissant en pied, grâce à cet artifice
visuel. Mais ce n'est rien à côté de la seconde pochade, L'île de Tulipatan. Quelques dix ans ont passé, et Offenbach, au
faîte de la gloire, se prépare offrir La Périchole.
Le schéma est plus rôdé, le quiproquo plus dévastateur, l'apologie du non-sens
réjouissant à son meilleur : un chassé-croisé inter sexes, où une jeune fille,
garçon manqué, en réalité le vrai fils du monarque Cacatois XXII, courtise un
garçon si efféminé et timide, qu'il se révèle être la douce mais pas farouche
fille du grand sénéchal de la cour... Un triomphe de la gente féminine,
audacieuse pour l'époque, et une utilisation du travesti dans un sens inattendu
! Au-delà de l'incongruité des situations, c'est la banalité des faits et
gestes de tous les jours, montés en épingle, qui déchaîne l'hilarité. Au fil de
quelques morceaux d'anthologie, tels les « couplets du canard », et
leurs désopilants « coins coins », en forme
de refrain. Le formidable bagout des interprètes, dont Flannan
Obé, dans la fille-garçon Hermosa,
ou Lara Neumann, Théodorine, l'homérique maman jouant à merveille de son
physique enveloppé, ne laisse pas de marbre. La régie de Philippe Salério est habile, plus resserrée ici, à travers cet
incessant jeu de retournement, pas si innocent que cela. Les neuf musiciens,
conduits prestement par Christophe Grapperon,
démontrent que la musique d'Offenbach ne perd pas une once de son mordant, bien
au contraire, exécutée de manière chambriste.

© Claire
Besse
Immersion
dans le monde symphonique de Chostakovitch
Affluence record à la Salle Pleyel pour les
deux premiers concerts de la série consacrée par Valery Gergiev
aux symphonies et concertos de Dmitri Chostakovitch !
Un public de tous âges, d'une discrétion rare, complètement immergé dans un
monde sonore, pourtant inhabituel. Gergiev impose le
silence, dès avant de lever la baguette. En fait, il dirige sans ce sésame,
pétrit la pâte sonore, en gestes amples, voire très physiques. Sa gestuelle,
lisible, fait respirer la musique pour l'auditeur-spectateur. Son orchestre du Mariinsky est tout bonnement prodigieux de transparence et
d'homogénéité. Il n'est que d'écouter cette pédale de basse (finale lent de la
13ème), ou ces unissons des cordes, sans parler
de la brillance des percussions, tant sollicitées par Chostakovitch, pour
comprendre la qualité d'ensemble de cette formation. Que de chemin parcouru
depuis une 4ème symphonie du même auteur, demeurée
pourtant haute dans le souvenir, donnée, il y a plus d'une dizaine d'années, au
Châtelet, en contrepoint du Démon d'Anton Rubinstein ! Le travail
accompli est phénoménal, car Gergiev a su exploiter
au mieux le potentiel de musiciens, déjà excellents. Les bois sont pure
merveille. Et que dire des cuivres ! Tous sont fascinés par leur chef, pour qui
ils sont prêts à donner le meilleur, et même au-delà. Leur fréquentation de
l'opéra et du ballet est pour quelque chose dans la souplesse du trait, le
chant inné, lesquels ne sont pas forcément l'apanage
d'autres grandes formations exclusivement symphoniques. Le chef a fait le choix
de présenter les œuvres de sorte à rapprocher les premiers opus des derniers,
et à confronter ainsi les différentes manières du compositeur, engagé sans
relâche dans le combat d'idées : un soumis par réflexe de survie, d'abord, d'où
émerge peu à peu « une personnalité influente » (V.Gergiev),
qu'on ne cherchera pas à bousculer, encore moins à bâillonner.

© Julien Mignot/Salle Pleyel
La 1ère symphonie, op. 10,
créée à Leningrad en 1923, démontre d'emblée l'incroyable maîtrise du jeune
compositeur de 19 ans. Et déjà un style très personnel, ne serait-ce que dans
l'originalité de l'orchestration. On peut imaginer l'effet que sa «
modernité » produisit sur ses premiers auditeurs. Ainsi du scherzo
grotesque, où le piano joue un rôle essentiel. Gergiev
en souligne toute la désinvolture. Le lento distingue une cantilène intensément
lyrique, introduite par le hautbois solo, rejoint par le violoncelle, puis la
trompette bouchée. Si le finale s'avère plus classique, il est d'une étonnante
facture, avec les interventions du piano et du cello.
Sa richesse surprenante est magnifiée par Gergiev et
ses fabuleux musiciens. Pour commémorer le 10ème
anniversaire de la Révolution d'octobre, la 2ème symphonie (1927), s'articule autour d'un texte d'Alexandre Bezymenski, dont Chostakovitch déplorait "l'indigence de la poésie ampoulée". Mais il fallait faire avec. Il la relèguera d'ailleurs en seconde partie. Une longue introduction orchestrale grave s'enfle en une course haletante, dominée par la stridence de la petite flûte, jusqu'à une section scherzo grotesque. Suit un fugato à 13 voix, créant un effet sonore curieux, un tutti linéaire mouvant, dont on retrouvera maints exemples ultérieurement. Le choeur intervient alors, sur une orchestration grandiloquente, pourvue de sirène d'usine. Gergiev ne cherche pas à enjoliver ce qui se veut rudimentaire, de l'ordre de la proclamation. Le Choeur du Théâtre Mariinsky s'y montre convaincant. Si le concerto pour piano N°2 ne passe pas pour une oeuvre majeure, du moins est-il un beau faire valoir pour le soliste. Ecrit en 1957, dans une période de creux créatif, par un Chostakovitch qui n'en fut jamais satisfait, il sera créé par son dédicataire, son fils Maxime. Les premier et troisième mouvements sonnent avec humour, et ce style "mécaniciste" cher à l'auteur. Le lyrisme serein du mouvement lent médian est bien différent de la manière d'un Rachmaninov. Denis Matsuev s'y révèle tout sauf affecté, lumineux, d'une superbe légèreté, et d'un humour fou. Le bis, emprunté à Rachmaninov, montre précisément tout ce qui sépare cette manière de celle de Chostakovitch. de la 15ème symphonie, créée
en 1972, le maître dira que ce fut « une œuvre qui m'a tout simplement
emporté ». Il y a là quelque chose de l'ordre du spirituel. Ce chant
d'adieu n'est en rien triste, à peine nostalgique dans ses mouvements lents.
Ceux-ci alternent avec deux allegrettos. Le premier développe un langage joyeux
et concis, dont n'est pas absente la plaisanterie : il est rythmé par la citation
d'un thème du Guillaume Tell de Rossini, confié aux cuivres, sonnant
comme une fanfare. Le bref scherzo verra dominer de nouveau les vents. L'adagio
médian, mêlant choral et thème dodécaphonique joué par le violoncelle solo, est
méditatif. Il se fait pessimiste dans la vision de Gergiev.
Le finale, de nouveau adagio, s'ouvre par un thème
emprunté au Ring de Wagner, celui du destin, et se poursuit dans une
vaste Passacaille. Sa coda est ponctuée de percussions concertantes, façon
batterie légère. Si la pièce reste étrange dans l'étirement de ses deux parties
lentes, ce que Gergiev ne cherche pas à amoindrir,
elle marque le triomphe d'un lyrisme prenant, agissant comme quelque chose de
magnétique.

© Julien Mignot/Salle Pleyel
Le second concert présentait un choix tout
aussi révélateur. La 3ème symphonie, op. 20,
« Le Premier mai », commémore la fête du travail, et « entend
décrire un moment pacifiste », dira l'auteur. Donnée d'un seul trait,
cette demi-heure de musique apparaît telle une mosaïque de courtes séquences,
qui sans cesse se font et se défont, usant du processus de renversement et de
rétrogradation dans lequel Chotakovitch est déjà
passé maître. Mais sans qu'aucun thème ne puisse s'accrocher à la mémoire. Un
peu selon le procédé du montage cinématographique. Gergiev
parvient à lui donner une unité. Il déchaîne cette étonnante pédale de
percussions, mêlant timbale et caisse claire, et ponctuée de cluster de la
grosse caisse et du gong. Le 2ème Concerto pour violoncelle, op 126, dédié à et créé par
Slava Rostropovitch, en 1966, est moins directement abordable que le premier.
Il a été écrit en hommage à la poétesse Anna Akhmatova, décédée peu avant. D'où
un sens de désolation et de mélancolie, perceptibles dès le largo introductif,
où le soliste se fait plus discret qu'emphatique. Une manière qui colore les
deux autres mouvements, marqués allegretto. Ils n'ont cependant pas la même
signification, le premier étant, en fait, voisin d'un adagio. Le finale, en
apparence plus enjoué, voire humoristique, cèle une grande nostalgie, que
souligne son large lyrisme s'éteignant dans un quasi silence et un trait abrupt
du violoncelle. Le morceau renferme trois mini
cadences, où curieusement le soliste évolue sur un accompagnement presque
incongru, respectivement, de la grosse caisse, du tambour de basque, et de la
caisse claire. Mario Brunello le joue avec brio. Et
si la sonorité est, nul doute, moins grandiose que celle du dédicataire, sa
force toute intérieure n'est pas moins convaincante. Puis vint la 13ème
symphonie (1962), sous-titrée « Babi Yar »,
du nom de ce village ukrainien qui vit, en septembre 1941, l'extermination de
ses habitants juifs. Monument dressé à l'encontre de l'antisémitisme, c'est
l'opus symphonique le plus désespéré de son auteur. Ses cinq mouvements sont
tracés à partir de poèmes d'Evgueni Evtouchenko, confiés au chœur de basses et
à la basse solo. La simplicité du langage frappe dans le premier mouvement,
évoquant la tragédie de Babi Yar, mise en regard de
celles de l'affaire Dreyfus, ou d' Anne Frank. Un
scherzo fait suite, titré « l'Humeur », ou le caractère indomptable
de celle-ci, malgré toute répression. « Au magasin » évoque la vie
des femmes russes, piliers de la vie familiale, mais aussi économique, au fil
de la mélodie, simplement évocatrice, du violoncelle solo, sur une pédale des
cordes graves, et de la voix de basse s'exprimant jusqu'au murmure. « Les
Peurs », qu'il faut prendre aussi bien au premier degré que, plus
largement, par référence à celles du manque de courage ou du mensonge, sont
l'occasion de combinaisons sonores étonnantes des vents et des percussions,
d'un traitement particulier du chœur, chantant sur une seule note, ou encore du
dialogue du soliste et de la clarinette basse. Le finale, « La carrière »,
celle de l'artiste réprimé pour ses convictions, mais demeurant fidèle à ses
idéaux, est introduit par la bouleversante mélopée d'un thème joué à la flûte,
relayée par les cordes ppp. Puis s'établit un climat de Pastorale, avant
de s'achever en une sorte d'anéantissement pianissimo. Cette symphonie, Gergiev la soutient avec la foi de celui qui possède en lui
cette narration effroyable. Les musiciens du Mariinsky
la façonnent aussi comme un seul homme. La voix lisse de Mikhail
Petrenko, visiblement préférée à un organe plus
charnu, exprime la nostalgie insondable de ces pages mémorables.
La série de concert se poursuivra la saison
prochaine, l'espace de six autres concerts, donnés en deux temps : du 1er au 3
décembre 2013, et du 16 au 18 février 2014. D'autres CD sont prévus sous le
label Mariinsky.
...
Une
grande voix au firmament des contre-ténors.

© DR
Bonheur du temps, la voix de contre-ténor
passionne de nouveau les foules. Et une saine émulation se fait jour. Aux côtés
du succès faramineux, et combien mérité, de Philippe Jaroussky,
ou de Emmanuel Cencic, une
nouvelle étoile se lève, celle de l'argentin Franco Fagioli.
Comme révélé dans l'enregistrement récent de Ataserse, de Leonardo Vinci (cf. NL de 01/2013),
et lors des représentations nancéennes de cet opéra (cf. NL de 12/2012), Fagioli se distingue, parmi ses pairs, par un timbre à
propos duquel le mimétisme avec la voix féminine est frappant. Son récital à la
salle Gaveau, devant un public dense et enthousiaste, aura confirmé un talent
hors du commun, dans un programme sur mesure, intitulé, un peu facilement,
« Virtuosités baroques », célébrant l'amour, bien sûr, de mille
manières. Le chanteur est accompagné par un petit ensemble instrumental
(violoncelle, archiluth, clavecin), de fort belle facture, qui contribue à
faire de la partie purement instrumentale autre chose qu'un simple
divertissement de remplissage. Un début, sagement précautionneux, qui donne à
entendre un des « Arie musicali » de
Frescobaldi, et un des « Scherzi musicali » de Monteverdi, laisse à peine présager de
la suite : la brillance mordorée et la plénitude que Fagioli
va instiller dans une aria du vénitien Benedetto Ferrari. Sur un rythme
balancé, et des affetti soigneusement dosés, sont roucoulées des phrases
scintillantes, enrobées d'écarts vocaux inattendus, dont d'impressionnantes
« cocottes » dans le grave. A l'issue du morceau, qui manie aussi
bien l'hyperbole que l'humour, le chanteur quitte la scène, suivi par chacun de
ses musiciens. Comme dans la Symphonie « les adieux » ! Fagioli différencie avec tact les divers styles de chant,
si notables dans l'univers baroque. Dans Haendel, par exemple, et ses cantates
de chambre, si rarement jouées, Fagioli offre la
quintessence de son art : une ligne immaculée, un souffle inépuisable sur la
note tenue, notamment dans le pianissimo, qui n'est pas sans rappeler la
manière de son illustre consœur, Cecilia Bartoli. Et, bien sûr, un festin
inépuisable de fioritures. Chez Vivaldi, et sa cantate RV 676, le discours se
fait autre : les contrastes, imaginés par le Prete rosso, requièrent de l'audace. Le contre-ténor n'en est pas
dépourvu. Les notes délivrées pppp, avec un
relief rare, les douces inflexions sont, là aussi, parfaites. Comme les longues
vocalises et les trilles d'enfer, dans une sorte d'idéal. Une autre facette de
la personnalité du chanteur est révélée avec une cavatine tirée de l'opéra L'amor contrasto ossia La Molinara, de
Giovanni Paisiello. Introduite par le seul clavecin, alors que les deux autres
instrumentistes jouent en pizzicatos, la voix se fait enjouée, et enjôleuse.
Puis trois variations, quasi bel cantistes, vont
conduire l'interprète à éblouir, voire étourdir, l'auditeur, devant tant de
beauté. L'aria sera couronnée par une quinte aiguë, digne d'une soprano colorature.
Décidément, le contre-ténor à mille cordes à son arc. Il le démontre encore
durant trois bis : un expressif lamento de Monteverdi, un air de l'opéra Artaserse, chanté a capella, à la demande d'une
spectatrice, décidément exigeante, avant de prendre congé par l'aria d'un
Anonyme, devenu célèbre avec ce « tube », qui met en avant toutes les
qualités déjà exposées, l'aisance scénique en plus.
David
et Jonathas A l'Opéra Comique
Marc-Antoine CHARPENTIER : David et Jonathas. Tragédie Biblique en cinq actes et un
prologue. Livret du Père François de Paule Bretonneau. Pascal Charbonneau, Ana Quintans, Arnaud Richard, Frédéric Caton, Krešimir Špicer, Dominique Visse,
Pierre Bessière. Les Arts Florissants, dir. William Christie. Mise en scène : Andreas Homoki.

© P.Victor/artcomart
La reprise, à l'Opéra-Comique, de David
et Jonathas confirme l'excellence de la
production vue à Aix-en- Provence, l'été dernier (cf. NL de 09/2012), co produite par les deux maisons, et le Théâtre de Caen.
Elle l'amplifie même, car dans ce cocon acoustique qu'est la salle Favart, la
musique de Charpentier respire mieux. Chère à son cœur, elle trouve chez
William Christie ampleur et chaleur. C'est un plaisir de le voir peaufiner ces
phrases emplies de douceur, suaves même, aborder ces transitions brusques,
fortes de contrastes dynamiques, magnifier les rythmes incisifs. L'orchestre de
Charpentier est riche, développant, selon le chef, « un langage à la fois
plus personnel et cosmopolite » que celui de Lully, auquel on le compare,
du fait de leur proximité historique. Un orchestre moyennement fourni dans les
cordes, où les bois jouent un rôle décisif, les quatre flûtes, en particulier,
deux traversières, deux flûtes à bec, pour des traits saisissants. L'effusion
mélodique, un brin italianisante, ajoute une finesse extrême, soutenant
agréablement le chant, car Charpentier possède « un sens exquis du
texte ». L'ensemble des Arts Florissants en restitue idéalement toutes les
facettes. Le maestro leur laissera même la bride sur le cou dans les
interventions du continuo. Mais il ne lâche pas des yeux ses chers choristes,
dont chacun est un soliste à part entière, au point que plusieurs d'entre eux
interprètent des rôles épisodiques. L'œuvre, sortie de son caractère hybride
originel, le texte de la tragédie latine, qui lui était accolé, ayant été
perdu, trouve dans cette interprétation un continuum musical calqué sur la
dramaturgie./ Elle ne comprend en effet que les seules
parties musicales, le texte de la tragédie latine qui lui était à l'origine
accolé, ayant été perdu/. Elle n'en est que plus resserrée. Dans la présente
production, la musique fait fonction d'élément unificateur : la continuité
entre les scènes est assurée par la symphonie. La régie conçue par Andreas Homoki enserre les diverses péripéties de l'action dans un
cadre, lui-même en constante mutation : une succession de courts tableaux qui
s'effacent dans le déroulement musical proprement dit, certains utilisés tels
des flash back.

© P.Victor /artcomart
Elle est plus percutante qu'à Aix. On a
adapté, en le façonnant aux dimensions plus restreintes du plateau de Favart,
le dispositif en forme de boîte de bois, imaginé par Homoki.
L'impression de dilatation de l'espace prend toute sa signification, enserrant
ou libérant les personnages, dans un champ claquemuré ou au contraire élargi. Homoki voit dans cette œuvre un drame psychologique, une
tragédie familiale, un conflit dû à l'incapacité de Saül à surmonter sa
jalousie envers David. Il transporte l'action dans quelque contrée
méditerranéenne, baignée de lumière chaude. Même si l'horizon reste limité,
dans une sorte d'enfermement, on perçoit des échappées vers l'extérieur. Sa
mise en scène, d'une intelligence pointue, décortique l'interaction entre les
deux héros, bien sûr, mais aussi entre ceux qui, autour d'eux, vont façonner
cette destinée tragique, pourtant ancrée, pour ce qui est de David, dans le
triomphe guerrier. Adulé, presque à son corps défendant, David semble refuser
la gloire militaire, tout comme il dédaignera finalement la couronne royale qui
lui est tendue. Il est déchiré à l'idée de perdre un ami. Jonathas
désespère de voir ne pas perdurer une amitié profonde. La dramaturgie est
émaillée de moments de vrai théâtre : les retrouvailles des deux amis, qui se
cherchent dans un jeu de colin-maillard, le dialogue crispé opposant Saül et Achis. On encore la scène de la Pythonisse, objet du
Prologue, mais placée au milieu de la pièce : celle-ci évolue au milieu d'une
cohorte de ses semblables, en un affolant va et vient, à travers trois pièces
en enfilades. Une vision hardie, combien accomplie esthétiquement. Mais aussi
la scène des adieux de David à Jonathas. Comment
interpréter les rapports unissant les deux amis ? Que n'en a-t-on pas dit et
fait l'exégèse ? Au XVII ème siècle, chez les
jésuites qui plus est, une relation d'ordre érotique était impensable, et il
est vain de vouloir reporter sur cette époque le ressenti de la nôtre. David
est intègre et son amitié pour Jonathas est pure,
idéale. Comme le souligne Régis Courtray, dans son
ouvrage « David et Jonathas histoire d'un
mythe » (Editions Beauchesne), aux termes d'une analyse fouillée des
textes latins, « tout le contexte ici est poétique et théologique, et non
érotique ; ce serait donc forcer les textes que de parler
d'homosexualité ». L'attrait éprouvé par chacun envers l'autre, qui va
jusqu'à l'élégie et les pleurs, doit être vu comme un modèle d'amitié
vertueuse. L'option, assumée par Christie, de distribuer le rôle de Jonathas à une chanteuse, participe de cette analyse, et
s'avère plausible ; outre le fait que l'assemblage vocal paraît homogène.
Celle-ci, Anna Quintans, est d'une totale
crédibilité, et son soprano, inextinguible, domine presque les débats. Pascal
Charbonneau, David, renouvelle sa performance aixoise. Si les premiers moments
restent précautionneux, la voix claire de ténor aigu épouse le chant de
Charpentier, souvent délicat, en voix de tête notamment, comme la fragilité du
jeune homme. Surtout, la juvénilité des deux personnages prend son exact
relief, tandis qu'ils usent de ce que Christie appelle « l'extraordinaire
sophistication du texte chanté ». La régie porte aussi l'emphase sur des
interjections quasi parlées, pour renforcer l'impact dramatique. Les basses, le
remarquable Arnaud Richard, Saül, le sonore Frédéric Caton, Achis,
livrent un chant impressionnant. Krešimir Špicer prête à Joabel de vrais
accents de dépit, et une prestation vocale assurée. Dominique Visse renouvelle ses exploits
histrions dans la Pythonisse. Une indéniable réussite !
Quand
Charpentier met en musique Molière

© Accent
Tonique
Dans le cadre du « festival »
entourant la production de David et Jonathas,
l'Opéra-Comique présentait une soirée intitulée « Musiques pour
Molière », déjà offerte au Festival de La Chabotterie
(cf. photo ci-dessus). Après la brouille intervenue avec Lully, mettant fin à
une fructueuse collaboration, qui a donné naissance au genre de la
comédie-ballet, tel Le Bourgeois gentilhomme, Molière se tourne vers
Marc-Antoine Charpentier. Au sommet de son art, le grand dramaturge allait
travailler avec un jeune musicien d'à peine trente, qui n'était alors connu que
par sa musique sacrée. Mais Charpentier était passionné de théâtre. Il saura
affronter Lully et ses édits. Et offrir aux Comédiens français de somptueux
intermèdes et ouvertures, pendant une bonne décennie. Hugo Reyne,
chef de la Simphonie du Marais, a eu l'idée de réunir
quelques-uns de ces titres en un concert, mis en espace, présenté et commenté
par ses soins. L'homme a de l'esprit tout autant qu'il est un remarquable
flûtiste. Autour de lui, six collègues, deux violons, un alto, une basse de
violon, un archiluth et un clavecin. Autrement dit, une formation restreinte,
telle que celle fonctionnant à l'époque. Car Charpentier en était réduit à
jouer avec seulement une poignée de musiciens, du fait de la vindicte de Lully
qui n'avait de cesse d'obtenir du Roi une réduction, de plus en plus drastique,
des effectifs alloués aux autres. Mais cela ne gêne guère la façon de jouer ces
musiques délicates et vives. On commença par un hommage posthume à Molière,
avec Orphée descendant aux enfers, belle cantate, pas triste malgré les
circonstances de sa création. Suivaient l'Ouverture et deux intermèdes du
Dépit amoureux, avec extraits chantés et parlés empruntés à la
pièce, puis l'Ouverture de La Comtesse d'Escarbagnas,
dans une version remaniée, par rapport à la musique naguère écrite par Lully.
Il en sera de même pour celle du Mariage forcé, dont Reyne
donnait les « intermèdes nouveaux », en particulier un hilarant trio
grotesque « Amants aux cheveux gris », chanté par ce fou de
Sganarelle, qui la cinquantaine passée, ose convoiter le beau sexe, ou la
fameuse bastonnade ; le tout couronné d'un finale titré « Ô, la belle
symphonie! ». On entendra encore quelques morceaux choisis du Malade
imaginaire, création, cette fois, de l'auteur de David et Jonathas, dont l'air des Archers, et la sérénade
italienne, qui n'a rien à envier à quelque maître italien. Et enfin des
morceaux choisis de la comédie Le Sicilien, dont Charpentier travaillera
à la reprise après la mort de Molière. Avec Reyne et
ses complices, on entend un Molière baigné de musique, et un Charpentier fier
de son talent dramatique. Ce que démontrent les trois comédiens-chanteurs, et
leur solide faconde. Au beau milieu de ces musiques dédiées à Molière, Hugo Reyne ne résiste pas au plaisir de la plaisanterie
musicale, et offre un intermède d'une toute autre veine. Le beau janvier
obligeant, il trousse une brève réplique du concert du Nouvel An, transporté
chez quelque ami baroque français : une mini Marche de Radetsky,
que la salle s'empresse derechef de scander des deux mains, comme à Vienne,
suivi d'un « trio des peluches » (sic), singeant la gimmick de
l'édition viennoise 2013, du chef Welser-Möst
distribuant oursons et chatons à ses Viennois de musiciens. A ceci près que la
chose avait bien plus d'esprit salle Favart !
Jean-Pierre Robert
Le succès de Mikko Franck à l'Orchestre de Paris

© DR
Pierre Boulez souffrant, c’est
au chef finlandais, Mikko Franck, pour un soir, que fut confiée la direction de
L’Orchestre de Paris, dans un programme exclusivement Ravel. Programme
ambitieux pour une première rencontre, puis qu'associant Une barque sur l’océan, l’Alborada del gracioso, Shéhérazade et Daphnis et Chloé. Une barque
sur l’océan, composée en 1904, initialement pour piano, orchestrée
secondairement en 1906, toute en balancement chaloupé et fluidité, laisse à la
musique une impression de liberté, de flux et reflux, évoluant en grandes
vagues orchestrales animées de chatoiements debussystes. L’Alborada del
gracioso, composée également pour le piano, orchestrée en 1918, faisant
partie, comme la précédente pièce, du recueil intitulé Miroir, est, sous couvert
d’hispanisme, l’occasion d’un jaillissement orchestral, cru et expressif, sur
une pulsation rythmique très marquée. Shéhérazade,
témoignant de l’orientalisme de Ravel, a été composé en 1903, sur des poèmes de
Tristan Kingsor, de prosodie difficile, sans
rhétorique ni éloquence. La voix, comme une simple parole, y évolue dans un
écrin musical tout en climats et raffinements. La mezzo-soprano Nora Gubisch en était l'interprète. Enfin Daphnis et Chloé, musique de ballet en trois parties, donnée sans
chœur, a été commandée à Ravel par Diaghilev pour ses Ballets russes (1912). Un
magnifique programme, une magnifique musique, un magnifique orchestre
parfaitement en place, dégageant des timbres et couleurs ciselés, et une magnifique direction de Mikko Franck,
précise, qui sut d’emblée recueillir l’empathie de l’orchestre, adaptant le
langage musical aux différents climats par un phrasé d’une rare intelligence.
Seul, Daphnis et Chloé sembla, par
moments, manquer quelque peu de souffle, peut-être par l’absence de chœur, mais
surtout par l’absence de support visuel, dans cette version purement
orchestrale. Une très belle soirée, conclue par l’hommage rendu par l’orchestre
et la salle au contrebassiste solo, Bernard Cazauran,
qui officia à l’Orchestre de Paris depuis son concert inaugural en 1967. Bravo
Messieurs !
...
Marek Janowski et l’Orchestre
Philharmonique de Radio France ouvrent magistralement l’année Wagner !

© DR
Une salle Pleyel comble fêtait les
retrouvailles entre le « Philhar » et le
chef allemand Marek Janowski, qui en fut le directeur
musical entre 1984 et 2000, à l’occasion du premier concert de l’année 2013,
célébrant le bicentenaire de la naissance de Richard Wagner. Un programme grand
public associait l’Ouverture du Vaisseau fantôme, le Prélude
et les scènes 1 et 2 de l'acte III de Lohengrin,
puis l’Ouverture et le Venusberg de
Tannhäuser, et enfin Prélude et Mort d’Isolde. Un magnifique
concert, magistralement interprété par l’orchestre, au mieux de sa forme,
dirigé de main de maître par un Marek Janowski qui
connaît son Wagner sur le bout des doigts ! Dès l'Ouverture du Vaisseau
fantôme, saisissante d’expressivité, on
sentit le vent dans les voiles, la tourmente toute imprégnée d’un sentiment
d’urgence, un sentiment de danger imminent, parfaitement maîtrisé par une direction
claire et engagée, tenant bon la barre au milieu de la tempête orchestrale. A
l’inverse, le Prélude de Lohengrin parut très intériorisé,
chargé de ferveur et d’émotion. Tandis que le merveilleux duo de l’acte III,
entre Elsa (Annette Dasch) et Lohengrin (Stephen
Gould), s’achevait dans un climat de désolation palpable. Stephen Gould parut
dans le rôle-titre tout à fait honorable, au timbre moins éthéré qu’un Klaus
Florian Vogt, mais plus assuré qu’un Jonas Kaufmann, associant une présence
scénique imposante, une puissance vocale et une diction de qualité. En
revanche, Annette Dasch sembla un peu en-dessous dans
sa vocalité habituelle, malgré une implication certaine. En seconde partie, Janowski donnait le début de Tannhäuser, dans la version dite « de Paris », révisée
sur le modèle du grand opéra français, à la demande de Napoléon III, pour la
création à l’Opéra de Paris, le 13 mars 1861. Une version, dont la seule
concession, acceptée par Wagner, en matière de ballet, fut l’élaboration de la Bacchanale,
dans la grotte de Venus, enchaînée désormais à l’Ouverture. Modèle du genre,
l'interprétation, totalement inspirée, témoignait de l’importance du travail
préparatoire effectué sous la direction obstinée et méticuleuse du chef
allemand, ainsi que de la qualité d'un orchestre transcendé, tous pupitres
confondus. Enfin, le chromatisme du Prélude
de Tristan et Isolde, retrouva tout son pouvoir d’évocation
dramatique, et sut maintenir les spectateurs dans une attente haletante, avant
que ne s’élève, dans une salle Pleyel recueillie, la Liebestod, magnifiquement chantée
par Violeta Urmana. Une très belle soirée !
Lionel Bringuier, le Magnifique !

©
DR
A seulement 26 ans, le français Lionel Bringuier, actuel directeur musical du prestigieux Tonnhalle Orchester de Zürich,
s’affirme, assurément, comme un des chefs d’orchestre les plus prometteurs et
doués de sa génération. Comme tous les ans, depuis 2008, il était invité à
diriger le « Philhar », salle Pleyel, avec
un plaisir, à l’évidence partagé par les musiciens, et lui-même…Il avait
concocté un programme particulièrement intéressant, et original, associant des
œuvres de Saint Saëns (Concerto pour
violoncelle & orchestre), Albert Roussel (Symphonie n° 3), Maurice
Ravel (La Valse), et une composition contemporaine, en création
mondiale (Eclipse) d’Eric Tanguy
(°1968). Cette dernière, composée en 1999, à l’occasion de la dernière éclipse
solaire du millénaire, est une œuvre faite d’ombre et de lumière, à la fois
chatoyante, rythmée et expressive. Elle réunit une grande formation de 86
musiciens, qui déploie une masse orchestrale dense et sombre, d’où émergent,
tour à tour, des solos de flûte, de hautbois, de clarinette, et du premier
violon, avant que ne réapparaisse, définitivement, la lumière dans un trio à
cordes d’une grande sérénité. Voilà une très belle œuvre, complexe, magnifiant
l’orchestre, tous pupitres confondus. La direction limpide et juste de Lionel Bringuier y était pour beaucoup : une vraie symbiose entre
chef et orchestre, et un sûr plaisir de jouer ensemble. Ce que confirmera
l’interprétation magistrale, parfaitement en place, de la Symphonie n° 3 d'Albert Roussel, si peu jouée, et pourtant si
attractive dans ses rythmes et ses contrastes. Comme celle La Valse de Ravel. Cerise sur le gâteau, Gautier Capuçon livra une sublime vision, à la fois intériorisée et
virtuose, de l’élégiaque Concerto pour
violoncelle de Saint Saëns. Un concert d’exception qui fait regretter que
Lionel Bringuier n’ait pas pris la direction de ce
bel orchestre…Ce sera peut-être pour un peu plus tard…

© DR
Une première rencontre euphorique.

©
DR
Ce concert marquait la première collaboration
entre l’Orchestre de Paris et le chef italien Nicola Luisotti,
actuel directeur de l’Opéra de San Francisco, et directeur musical du Teatro di San Carlo de Naples. Un programme ambitieux
réunissait des œuvres rarement jouées comme le Concerto pour violon et orchestre de Stravinski, le Capriccio Italiano de Tchaïkovski, et la
Symphonie n° 3 de Prokofiev. En
soliste, le merveilleux violoniste israélo-américain Gil Shaham,
qui poursuit, depuis plusieurs saisons, son exploration des concertos pour violon
des années 30, jouait le concerto de
Stravinski, composé en 1931, d’une redoutable difficulté, où toutes les
possibilités techniques et acoustiques de l’instrument sont exploitées. Gil Shaham, comme à son habitude, en livra une interprétation
d’un brio extrême, témoignant d’un grand plaisir de jouer, sollicitant en
permanence le chef et les musiciens ravis. Le Capriccio Italiano de Tchaïkovski, composé en 1880, est également
une œuvre contrastée, pleine de charme, comme un hymne à l’Italie et à ses
couleurs. Nicola Luisotti sembla parfois se perdre
dans une gestique quelque peu clownesque. La Symphonie n° 3 de Prokofiev, inspirée de l'opéra L'Ange
de feu, a été composée en 1928. Elle est un des derniers témoignages de
l’utopie révolutionnaire finissante, s’inscrivant dans la continuité du motorisme de la Symphonie
n° 2, et du ballet Le pas d’acier.
Elle fut, en revanche, l’occasion d’une direction appliquée et attentive,
rendant compte de la richesse de l’orchestration, et en développant les
différents climats, tels que violence, lyrisme, méditation, obsession,
attirance fantastique, avant la dissolution finale dans une ambiance
cataclysmique, ponctuée de sons de cloches. Une œuvre complexe, qui réalise une
difficile fusion entre symbolisme, futurisme et expressionnisme, dans une
atmosphère envoûtante et surnaturelle. Elle sembla un peu dérouter le public,
malgré la parfaite lisibilité de l’interprétation…Une première rencontre
réussie, et euphorique à en juger par le sourire permanent qui ne quitta pas les
lèvres du chef italien !

© DR
Patrice Imbaud
***
L’EDITION MUSICALE
PIANO
André
Mathieu : Concerto de Québec. L’œuvre
pour piano vol. 5. Version abrégée pour piano solo. Anthologie de la musique
québécoise. Nouveau Théâtre Musical http://www.laplanteduval.com/NTM_edi.html : NTM 1569.
Nous avons le plaisir de recenser pour la
première fois des partitions provenant de cette jeune maison d’édition
québécoise.
La version abrégée de ce concerto a été
réalisée par le compositeur lui-même. Celui-ci, né en 1929, est disparu
prématurément en 1968. Cette composition de 1942 laisse à penser ce qu’était la
maturité de ce tout jeune homme. L’œuvre est lyrique et passionnée et sera,
espérons-le, au répertoire de nos grands pianistes. Bien qu’il n’ait pu, dans
sa courte vie, donner le meilleur de lui-même, les œuvres qui nous restent
méritent amplement d’être connues et jouées.

Charley
BOURNEL-BOSSON : Répertoire dédié à
une petite histoire du Piano. 19 pièces originales, clins d’œil à la
musique de la période baroque à nos jours. 1 vol. 1 CD. Van de Velde : VV
402.
Le propos est, au premier abord, assez
étonnant, mais se révèle en fait fort intéressant. Souhaitons simplement que ce
recueil, qui peut intéresser les amateurs éclairés mais non pianistes grâce au
CD inclus, donne envie aux étudiants pianistes de découvrir l’ensemble des
différents instruments, des différents styles et des différents répertoires que
l’auteur illustre par des « à la manière de » assez réussis. L’auteur
laisse le lecteur auditeur interprète sur sa faim, mais c’est volontaire :
les « étudiants pianistes à partir de la 4ème année »
considèreront peut-être ainsi le déchiffrage non plus comme le pensum
obligatoire pour les examens mais comme un parcours-découverte indispensable du
répertoire pour un instrumentiste qui veut devenir un vrai musicien…

Emmanuel
CHABRIER :
Habanera
pour piano. Bärenreiter : BA 10839.
On ne peut que se féliciter de cette
nouvelle édition d’une pièce fort belle qui a souffert
d’une appréciation très injuste de Cortot. On en connait davantage la version
orchestrale qui lui est légèrement postérieure. La note :
« Transcrite pour le piano » apposée sur sa partition par Chabrier
lui-même est trompeuse : elle veut simplement suggérer qu’il s’agirait
d’une pièce originale espagnole antérieure transcrite par lui pour le
piano. Préface et notes critiques sont
intéressantes. On regrettera seulement que pour une pièce française, l’éditeur
ne nous ait pas donné, comme il le fait habituellement, une traduction dans la
langue de Molière…

Ludwig
van BEETHOVEN : Grande Sonate
pathétique en do mineur op. 13. Bärenreiter :
BA 10851.
L’intérêt de cette nouvelle édition de la Sonate Pathétique tient à la fois à la
qualité de la gravure et surtout aux préfaces, commentaires et fac-similés qui
accompagnent le texte. Jonathan Del Mar, qui a procédé à cette édition, a fait
appel aux plus récentes recherches musicologiques et permet ainsi aux
interprètes de s’approcher au mieux des intentions de Beethoven dans cette
œuvre majeure.

Antonin
REICHA : 30 fugues pour le
piano-forte. Bärenreiter : BA 9541.
Cette édition des fugues d’Anton Reicha est
une actualisation et une correction de celle déjà parue en 1973. On sait tout
le travail sur la fugue qu’a entrepris ce musicien tchèque naturalisé français
en 1829, élu membre de l’académie des Beaux-Arts et qui a eu comme élèves
Berlioz, Liszt, Gounod et Franck… Le propos de Reicha est présenté en détail
dans la préface. On trouvera aussi au début de l’ouvrage le vibrant poème en
hommage à Haydn qu’Anton Reicha a écrit pour figurer en tête de cette œuvre.

Jean-Claude
WOLFF : Crépuscules pour piano. Delatour : DLT0783.
Né en 1946, Jean-Claude Wolff est un
compositeur aussi original qu’attachant. Ces Crépuscules nous sont proposés sous leur forme manuscrite. Comme il
est parfaitement lisible, c’est certainement un choix qui confère à
l’interprétation de cette œuvre un caractère particulièrement intime, intime
comme cette musique qui parle au cœur. Et non pas
« intimiste » : l’ensemble ne manque en rien ni de contraste ni
de vigueur. Souhaitons que malgré sa difficulté cette œuvre figure au
répertoire de beaucoup de pianistes.
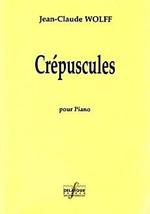
ORGUE
Daniel
ROTH : Christus factus
est pour orgue. Compositeurs Alsaciens vol. 28. Delatour :
DLT2117.
Ecrite pour un orgue romantique comportant
deux claviers, dont un récit expressif, et pédalier, cette Fantaisie sur le Graduel de la Messe du Jeudi Saint in memoriam Albert
Schweitzer est une véritable méditation qui suit de très près l’admirable
pièce grégorienne. C’est une œuvre à découvrir absolument, à méditer et à faire
partager…
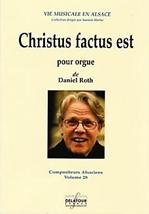
CHŒUR
Charles
GOUNOD : La liberté éclairant le
monde. Réduction pour chœur mixte et piano. Editions du Nouveau Théâtre
Musical : NTM 501.
Cette œuvre de 1876 écrite sur une poésie
d’Emile Guiard, auteur dramatique, fut composée à
l’occasion d’une campagne de financement de la statue de Bartholdi. Ecrite pour
chœur d’hommes et orchestre, elle est ici transcrite pour chœur mixte. Exécutée
de nouveau en 2004, en même temps que la cantate Fernand, également de Gounod, elle est disponible également dans sa
version originale pour chœur d’homme et orchestre aux mêmes éditions (NTM 502
pour le chœur et 503 pour l’orchestre). Œuvre de circonstance, elle n’est pas
sans contenir quelques échos de la Marseillaise…

Raymond
DAVELUY : Noëls anciens. Vol. 1.
Nouvelle édition révisée par l’auteur et augmentée. Chœur à voix mixtes et
orgue. Collection : Anthologie de la musique québécoise. Nouveau Théâtre
Musical : NTM 2004.
Quel plaisir de retrouver ces neufs noëls
dont beaucoup sont trop oubliés aujourd’hui dans leur pays d’origine. Les
harmonisations sont à la fois simples et délicates, bien dans la tradition de
ces chants joyeux. La partie d’orgue tient pleinement sa part dans le
concert : bien loin d’être une réduction des voix, elle forme avec elles
comme un commentaire apportant sa note spécifique à l’ambiance générale.

Jean-Jacques
WERNER : L’arbre perché pour
chœur mixte (SATB) a cappella sur des poèmes de Jean-Luc Moreau. Delatour : DLT0751.
Cette allusion vengeresse à la stupide
remarque de Jean-Jacques R. critiquant les fables de La Fontaine, est bien
réjouissante, autant que la musique qu’a distillée notre autre Jean-Jacques sur
ces délicieux et humoristiques poèmes. Si on ajoute que ces quatre chœurs sont
d’un abord facile, on ne peut que conclure que, selon le souhait de l’auteur,
ils « apporteront du bonheur à chanter ensemble, gaiement et de
vive-voix ! ».

Jean-Baptiste
PERGOLESE : Stabat mater. Bärenreiter :
Chœur et réduction de piano : BA 7679-90, conducteur : BA 7679.
Cette nouvelle édition se justifie
pleinement par les progrès faits ces dernières années dans la connaissance du
texte le plus proche possible de la création. Malcom Bruno, qui a réalisé ce
travail d’édition, expose ces nouveautés dans une préface et un commentaire
critique tout à fait passionnants. On saluera au passage la qualité pianistique
de la réduction de piano réalisée par ce même Malcom Bruno pour la partition
vocale : outre sa fidélité à l’original, elle est manifestement écrite
pour… piano, ce qui n’est pas toujours le cas, hélas !


CHANT
Charles
GOUNOD : Fernand. Scène lyrique
à 3 voix. Premier Grand Prix de Rome – 1839. Nouveau Théâtre Musical : NTM
101.
On ne peut pas dire que le poème du Comte
Amédée de Pastoret soit un chef d’œuvre de littérature. On sent d’ailleurs que
lui-même ne croit pas trop à cette improbable histoire… Il fallait donc
beaucoup de talent à Gounod pour obtenir avec ce texte le Premier Grand Prix de
Rome. Mais l’œuvre n’en est pas moins intéressante à découvrir, car la musique
vaut beaucoup mieux (comme souvent dans les œuvres lyriques) que le livret.
C’est déjà du vrai Gounod, avec toutes les qualités mélodiques et les
inventions harmoniques que lui reconnaissait Berlioz. Cette première édition
mondiale est présentée fort judicieusement par Jean-Pierre Gounod,
arrière-petit-fils du compositeur. Les trois personnages sont Fernand,
basse-taille, Zelmire,
soprano et Alamir, ténor.
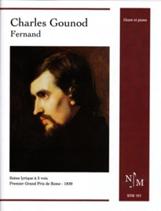
Ernest
CHAUSSON : Huit mélodies inédites. Chant
et piano. Première édition mondiale. Nouveau Théâtre Musical : NTM 1200.
Ce ne sont pas des œuvres mineurs que ces
huit mélodies sur des poèmes de Maurice Bouchor,
Alfred de Musset, Charles Baudelaire (L’Albatros).
Jean Richepin et Paul Fort. On appréciera beaucoup les notes biographiques
et surtout la notice sur ces œuvres rédigée par François Le Roux, le baryton
bien connu, directeur artistique du Centre International de la Mélodie
française. Ajoutons que cette édition a été faite d’après les manuscrits
originaux. Souhaitons que ces mélodies intègrent très vite les récitals de nos
chanteurs.

Lionel
DAUNAIS : Quatre poèmes de Paul
Fort. Chant et piano. Ton original. Nouveau Théâtre Musical :
NTM 1711.
Lionel Daunais
est un chanteur, compositeur, metteur en scène québécois né en 1901 et disparu
en 1982. On découvrira avec plaisir et intérêt ces mélodies pleines de charme,
d’entrain et d’humour, à l’image des poèmes de Paul Fort. Francis Poulenc
avait, en son temps, apprécié ces qualités.

Sophie
LACAZE : Archéologos I pour voix et support audio. 1 vol. 1
CD. Delatour : DLT1213.
« Archèologos »
est une série de courtes pièces pour instrument ou voix solo et support audio.
Cette série se base sur des enregistrements effectués lors de chantiers de
fouilles archéologiques aux pieds des Pyrénées. Dans « Archèologos
I », la voix réagit aux sons collectés sur le chantier de fouilles. On peut y
voir des rythmes de danse rituelle. L’ambiance est assez étonnante.

FLÛTE
Johann
Sebastian BACH : Suite en ut mineur BWV997. Adaptation pour flûte et clavier par
Gabriel Fumet. Delatour : DLT0763.
En publiant cette nouvelle adaptation de la
Suite en ut mineur, Gabriel Fumet
s’attache surtout à compléter les précédentes versions déjà publiées, notamment
par une nouvelle répartition des voix de la fugue. On sent dans cette nouvelle
édition toute l’expérience du remarquable flûtiste et musicien qu’est Gabriel
Fumet, issu d’une lignée de musiciens et compositeurs trop oubliés mais qu’il
s’efforce de faire redécouvrir.
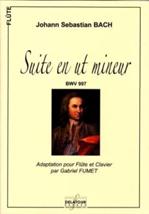
Sophie
LACAZE : Archéologos II pour flûte basse et support audio. 1
vol. 1 CD. Delatour : DLT2110.
Comme Archéologos I, cette œuvre fait partie d’une série de courtes pièces pour
instrument ou voix et support audio. Elle est également basée sur des
enregistrements effectués lors de chantiers de fouilles archéologiques aux
pieds des Pyrénées. On en appréciera l’ambiance envoutante.

FLÛTE
A BEC
Thierry
BLONDEAU : Interlude. Quatre
pièces pour flûte à bec : Jodel, Raksat, Pavillon bouché, Niwa. Dhalmann : FD0244.
Ces quatre interludes ne doivent pas être
interprétés à la suite mais sont destinés à être intercalés dans un programme.
Il s’agit, puisque nous sommes dans la collection « Musique d’aujourd’hui
sur instruments anciens » de musique contemporaine utilisant toutes les
ressources de l’instrument. Si Jodel fait
référence à la tyrolienne, Raksat, qui signifie « danse arabe » renforce le
caractère non tempéré de l’instrument tandis que Pavillon bouché, comme son nom l’indique, fait appel à un jeu tout
à fait particulier. Quant à Niwa, jardin en
japonais, c’est une évocation de la flûte japonaise en bambou qui porte ce nom.

HAUTBOIS
Gaston
LITAIZE : Trois Pièces pour
hautbois et piano. Delatour : DLT0872.
Ces trois pièces datent de 1937 (et non
1957 comme indiqué semble-t-il par erreur à l’intérieur du recueil). Le
catalogue de Gaston Litaize comporte encore de
nombreuses œuvres inédites et il faut se réjouir que les éditions Delatour continuent de combler cette lacune. Prélude, Menuet et Finale, telle sont ces trois pièces pleines d’intérêt et qui
enrichiront significativement le répertoire du hautbois. Saluons au passage le
remarquable travail effectué sur ces pièces par Olivier Latry
et Yannick Merlin.

Gilles
SILVESTRINI : Cinq Études Russes pour
hautbois seul. Delatour : DLT2110.
Destinées aux étudiants confirmés, ces cinq
études font suite au six déjà publiées. Hommage à Chostakovitch, Rachmaninov,
Scriabine, Prokofiev et Stravinsky, elles ne répugnent pas au pastiche dans une
virtuosité redoutable poussant l’instrumentiste et l’instrument à leurs limites
extrême. Pour « Etudes » qu’elles se présentent, elles feront bonne
figure dans une salle de concert !
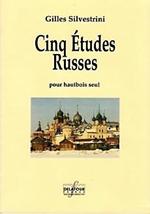
CLARINETTE
Christine
MARTY-LEJON : Berceuse russe pour
clarinette sib et piano. Lafitan : P.L. 2208.
« Quand l’enfant vient, la joie arrive
et nous éclaire » (Victor Hugo). Cette
citation du célèbre poème Lorsque l’enfant
paraît… traduit bien l’atmosphère de cette délicate berceuse écrite en
forme A-B-A (mineur-majeur-mineur) et aux accents slaves. De niveau
préparatoire, elle charmera, espérons-le, ses jeunes interprètes.

Marcel
JORAND : Civelle-Mélodie pour
clarinette sib et piano. Lafitan : P.L.2473.
Ecrite pour le niveau préparatoire, cette
pièce comporte un dialogue entre la clarinette et le piano qui en fait un
véritable petit mouvement de sonate. Si on veut que l’imaginaire des
interprètes puisse s’exercer, il sera sans doute nécessaire de leur rappeler
(ou de leur apprendre) le fabuleux voyage des bébés-anguilles… Il s’agit en
tout cas d’une œuvre variée et pleine d’intérêt pour la formation à la musique
de chambre.

Claude-Henry
JOUBERT : Dagobert a perdu ses
clefs ! pour clarinette avec accompagnement
de piano. Lafitan : P.L.2373.
De quelles clés s’agit-il ? L’auteur
ne nous en dit rien. Mais on pourra se raconter plein d’histoires en
interprétant cette pièce pleine d’humour avec des parties très classiques et
d’autres où le clarinettiste épanche ses états d’âme sur les accords longs du
piano… En résumé, voici une œuvre faussement mélancolique et vraiment
réjouissante.
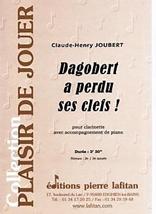
SAXOPHONE
André
TELMAN : Un vent de liberté pour
saxophone alto et piano. Niveau préparatoire. Lafitan :
P.L.2444.
Ce vent de liberté souffle vigoureusement
sur toute cette pièce variée par ses mesures, ses rythmes, ses nuances et qui
se termine par un fortissimo triomphant. Le piano n’a pas une part négligeable
dans ces vigoureux et souvent poétiques élans.
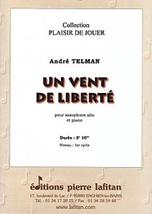
Jean-Michel
TROTOUX : L’infini pour
saxophone alto et piano. Niveau moyen. Lafitan :
P.L.2399.
D’abord soutenu par des croches, puis par
des doubles croches avant de l’être par des triolets, le saxophone s’élance
vers l’infini dans des phrases lyriques et berçantes par leur rythme répétitif
pour aller vers les sommets, puis laisse quelque temps son partenaire chanter
en l’accompagnant à son tour par des triolets. Voici une fort jolie pièce qui
demandera aux interprètes beaucoup d’écoute et d’expressivité.

TROMPETTE
Pascal
PROUST : Cornet surprise pour
cornet en sib (ou trompette en ut ou sib) et piano. Sempre più : SP0038.
Pascal Proust nous offre une mini-sonate en
trois mouvements : un C à
l’allure un peu syncopée, brillant et joyeux, un Adagio où le charme de
l’interprète pourra s’exprimer ainsi que sa capacité à faire de belles phrases.
Quant au troisième mouvement, c’est une valse entrainante et triomphante en
même temps qui se termine en apothéose. La pièce est écrite pour un niveau 2ème
cycle.

Max
MÉREAUX : Bluette pour trompette
ou cornet ou bugle et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2411.
Cette jolie pièce au début un peu
mélancolique se termine par une page en majeur qui semble indiquer que la
supplique du galant a été entendue. Une cadence ponctue cette pièce délicate
tout en finesse autant pour le trompettiste que pour le pianiste.

Jérôme
NAULAIS : A la recherche de Franz pour
trompette ou cornet ou bugle et piano. Préparatoire. Lafitan :
P.L.2435.
Quel Franz ? Certainement pas Liszt.
Alors, devinez… La pièce se déroule comme un lied à la fois mouvementé et
poétique qui demandera aux interprètes de faire la preuve de leur sens de la
musique et du phrasé. Il leur demandera aussi une écoute mutuelle : de
quoi les former bien agréablement à la musique de chambre.

CONTREBASSE
Pascal
PROUST : Un accent grave pour
contrebasse et piano. Sempre più : SP0037.
Cet « accent grave » est plein de
tonicité et d’humour. A la treizième mesure, on a même l’impression qu’il va
évoquer « Les gars d’Ménilmontant » toujours remontants. Seul
l’auteur pourrait nous dire si la citation est volontaire ou non… Bref,
pianiste et contrebassiste devraient prendre beaucoup de plaisir à cette pièce
qui n’est difficile pour aucun des deux interprètes.
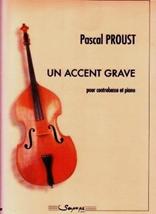
PERCUSSIONS
Bruno
GINER : Mémoires de Peaux pour
six percussionnistes. Dhalmann : FD0358.
Cette œuvre pour six percussionnistes
utilise les instruments à peaux de base : toms échelonnés, bongos, caisses
claires et grosses caisses. C’est une œuvre difficile créée à Montréal en
novembre 2011 par l’ensemble dédicataire Sixtum. Elle
utilise tous les procédés mis en œuvre habituellement par son auteur, notamment
la spatialisation.

Daniel Blackstone
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
François-Henri-Joseph CASTIL-BLAZE :
Histoire de l'opéra-comique. Ouvrage présenté par Alexandre Dratwicki
et Patrick Taïeb. Editions Symétrie & Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique
française, collection Symétrie Recherche, 2012, 1Vol 24x17 cm, 339 p. 47 €.
Cet ouvrage étudie le genre, et non
l'institution. Encore que l'histoire du premier se confonde avec l'évolution de
la seconde. Castil-Blaze (1784-1857), était un
critique musical influent et un historien de la scène lyrique française. Après
l'opéra et le théâtre italien, son attention devait se porter sur
l'opéra-comique, des prémisses, le théâtre de foire, au vaudeville, qui cédera
la place à l'opéra-comique, et s'illustrera dans des lieux tels que la Comédie
italienne, l'Opéra Comique, ou le Théâtre de
Monsieur. Le Bal bourgeois de Favart, sera, en 1738, une des premières
de ces « pièces composées exprès par des auteurs d'un talent reconnu », à
couplets sans accompagnement d'orchestre, car « quelques archets donnaient
le ton à l'acteur qui gouvernait l'air à sa fantaisie ». L'histoire se
décline jusqu'en 1837, le manuscrit restant inachevé. On y croise Zémire et Azor,
comme Zampa, ou encore L'Amant
jaloux, titres récemment tirés de l'oubli par l'actuelle direction de l'Opéra Comique ! L'intérêt du livre est de restituer un
texte demeuré dans les bibliothèques spécialisées, en une édition moderne,
moyennant quelques corrections, une adaptation de la ponctuation, souvent
aléatoire chez Castil-Blaze, et un travail
scientifique complémentaire, permettant de le resituer dans une perspective
plus générale. Un texte à bien des égards irremplaçable, même si parcellaire.
Sait-on que l'opéra-comique, tout comme les autres spectacles dramatiques,
puise à une origine commune : la religion. Les mystères médiévaux, la
pantomime, étaient déjà des opéras-comiques, où le
dialogue parlé se mêle au chant et à la danse. Même si cet improbable mélange
« tourmente, cahote, écorche notre oreille par l'adoption de deux langages
incompatibles ». On reste stupéfait par le luxe de détails sur les œuvres,
leurs caractéristiques, mais aussi par le récit menu des faits et gestes
pittoresques qui en accompagnent la première exécution, de l'auditoire, des
interprètes. Castil-Blaze n'a pas de mots trop durs,
par exemple, pour le trial, du nom de son premier interprète, sorte de ténor
très aigu, exécutant des rôles bouffes, et « glapissant à côté des
ténors », ruinant de ce fait l'édifice harmonique, au détriment du
registre de basse. C'est que la langue est vive, libérée dirait-on aujourd'hui,
le vocabulaire fort achalandé, le trait acéré. Les descriptions croustillantes
de spectacles de foire le cèdent à peine aux commentaires peu amènes sur les
auteurs. Et haro sur le parolier et ses misérables versicules,
responsables de ce que la musique française est réputée inchantable et son
texte littéraire incompréhensible ! Que dire encore de l'autorité de décision
qui, « toutes les fois qu'il s'agit de produire un drame lyrique »,
accumule « accrocs, barrages, arguties, empêchements, querelles, embargos,
chicanes, blocus, chaînes, carcans, inhibitions et défenses, ignobles
taquineries, perfidies stupides ». Ce texte foisonnant cache la modernité
certaine des conceptions esthétiques de l'auteur, vilipendé par certains, dont
Berlioz, porté au nues par d'autres. Des index des
personnes, des œuvres, des incipit, des lieux et institutions, enfin des
notions, ajoutent à l'attrait de l'ouvrage.

Jean-Pierre Robert
***
CDs et DVDs
Johann
GRABBE : Madrigals.
1CD CPO (Lübecker Str. 9 – D 49124 Georgsmarienhütte) : CPO 777 662.
TT :
77’ 34.
L’Ensemble
Weser-Renaissance (Brême), évoluant depuis 1993 non seulement autour du fleuve
(la Weser) mais bien au-delà, a acquis, grâce à Manfred Cordes — musicien
d’Église, chanteur, musicologue spécialisé dans la musique religieuse des XVIe
et XVIIe siècles — une réputation internationale reconnue de longue date. La
présente réalisation est particulièrement originale : elle permet de découvrir
Johann Gottlieb Grabbe (1585-1655), né la même année que
Heinrich Schütz, dont M. Cordes est aussi l’ardent défenseur.
Déjà à l’âge de 11
ans, J. G. Grabbe est membre du Chœur de la Cour de Bückeburg ;
formé par Cornelius Conradus, il lui succèdera comme
organiste. Il obtient une bourse d’études auprès de Giovanni Gabrieli, à Venise
où il publie son recueil : Il Primo
Libro de Madrigali A Cinque Voci
(1609). De retour dans son pays, il y est organiste, gambiste et vice-maître de
chapelle, puis premier maître de chapelle à la Résidence princière. Ce
programme de 24 pièces comporte des Madrigaux
italiens extraits du Premier livre ; il symbolise l’Italie dans l’espace
géographique de la Weser, ainsi que des pages instrumentales.
L’Ensemble
Weser-Renaissance comprend 2 Sopranos, 1 Alto, 2 Ténors et 1 Basse, ainsi que 2
violons, 2 violes de gambe, Dulzian, harpe et orgue
positif. Les œuvres instrumentales s’inspirant de la danse sont intitulées : Intrada (entrée
solennelle cultivée notamment en Allemagne dès le XVIe siècle), Canzon a 4 (sur le modèle de Gabrieli), Paduana a 5 (Pavane, danse de cour pratiquée en
Italie dès 1508), mettant les sonorités des instruments anciens en valeur. Les
sujets des Madrigaux sont
essentiellement l’amour, quelque peu dans la mouvance du Cantique des Cantiques, mais aussi la fidélité, la mort, la
douleur, les larmes, les soupirs... J. G. Grabbe fait appel au style note
contre note pour une meilleure intelligibilité du texte, aux entrées
successives pour créer une certaine animation, aux dissonances et chromatismes
de tension pour évoquer la misère, les larmes, la langueur (Ahi, misera mia vita). L’interprétation s’impose par la justesse et la
pureté des voix, la plénitude vocale (Viva fiamma del seno),
la transparence des lignes mélodiques (Felici amanti…), la profondeur de l’expression (Cor mio, deh, non languire). Une
excellente réalisation de plus à l’actif de Manfred Cordes.

« Früheste Orgelmusik bis J. S. Bach ». 1CD SYRIUS (Distribution CODAEX): SYR 141459. TT : 70’ 57.
Helga Schauerte, organiste titulaire de l’Église Allemande
(Paris), a, pour son dernier disque (2012) — bref panorama de la musique
d’orgue des origines à J. S. Bach —, retenu l’instrument de l’Église abbatiale
d’Oelinghausen (en Westphalie) fondée en 1174. Les
œuvres enregistrées se situent entre 1599 et 1717, allant du Bicinium de Caspar Othmayr à celui de J. Ph. Telemann. La première partie
regroupe, en outre, deux pièces dont une Estampie
(extraite du Robert’s Bridge Codex) qui, avec A Hornepype de
Hugh Aston (v. 1485-1558) constituen le volet
anglais. L’Allemagne est représentée par deux danses : Der Zeuner Tanz (Danse des
Tziganes) et Der Judentanz
(Danse des Juifs) de Hans Neusiedler, ainsi que par la Toccata in e de J. Pachelbel et le Praeludium in e de Nicolaus Bruhns.
La deuxième partie,
particulièrement intéressante, est conçue dans une optique comparative autour
de la mélodie Vater unser
im Himmelreich (Notre Père), d’après la paraphrase de
Martin Luther. Ce cantus firmus bien connu est traité par C. Othmayr, J. Decker comme un
choral, et par Jakob Praetorius en 7 versus
(versets) pour claviers, claviers et pédalier, puis par D. Buxtehude, G. Böhm,
J. Ph. Telemann et, surtout, J. S. Bach dans ses brefs Préludes de Choral pour orgue
BWV 245/5, 636 et 737.
Ce disque bénéficie
de l’excellent enregistrement de Bernard Neveu ; de la solide technique de
H. Schauerte, de son remarquable sens du rythme (Danses, plages 6-10), de son phrasé
précis et de la clarté de la structure. Représentant à la fois un document
sonore historique et comparatif, ce disque a sa place dans toute discothèque de
mélomane et d’organiste.
« Trésor de
joie ». 1CD
JADE (www.jade-music.net ) : 699772-2. TT : 45’ 10.
La Cathédrale
Notre-Dame de Strasbourg possède son école maîtrisienne
qui renoue avec la tradition de l’« office cathédral » remontant au
IVe siècle. Affiliée à la Fédération Française des Petits Chanteurs, elle
assure l’animation liturgique lors de nombreuses célébrations ainsi que des
stages, des voyages et des enregistrements. Depuis 2009, elle est dirigée par
Cyprien Sadek, disciple d’Ariel Alonso et de
Dominique Vellard, entre autres. La présente
réalisation concerne la musique religieuse du XXe siècle, avec 17 pièces, entre
autres de : P. de Bréville, A. Caplet, Fr.
Poulenc, M. Duruflé, J. Langlais, J. Alain, d’esthétiques très différentes à la
fois très simples mais aussi très complexes, peu importe, car ces chanteurs
sont rompus aux divers styles contemporains. La Fantaisie-Hommage à Frescobaldi (plage 5) de Jean Langlais est très
bien enlevée à l’orgue et avec virtuosité par Gilberto Scordari.
Pierre Onfroy de Bréville
(1861-1949), musicien lorrain, est représenté par les Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei bénéficiant
des voix cristallines, pures et homogènes des jeunes choristes. À
signaler un hommage local à l’ancien Directeur du Conservatoire de
Strasbourg (après la Première Guerre mondiale), puis de l’Orchestre
Philharmonique : Guy Ropartz qui a mis en musique la prière d’Henri Perreyve :
Vierge Sainte (plage 3) ; une brève introduction à l’orgue sensibilise
les discophiles à l’atmosphère discrète et mystérieuse, avec des inflexions
mélodiques si typiques de Ropartz, un débit assez étal, très bien rendue par
les excellentes voix si bien formées. À noter également le musicien
alsacien : Pascal Reber, né en 1961, organiste titulaire du Grand Orgue Kern de la Cathédrale et compositeur d’œuvres pour orgue,
chœur, piano, musique de chambre, dont l’Ubi caritas (plage 15) particulièrement
émouvant, est d’un modernisme quasi classique avec une facture mélodique
recherchée. Tous les interprètes contribuent largement au rayonnement
liturgique et artistique de la Cathédrale de Strasbourg.

Édith
Weber
Jean Sébastien BACH « Sonates &
Partitas pour violon seul, volume 2 » : Sonata I
BWV 1001, en sol mineur. Partita I, BWV 1002, en si mineur. Sonata
II, BWV 1003, en la mineur. Isabelle Faust, violon. 1
CD Harmonia Mundi : HMC 902124. TT.: 60'22.
Les « Sei
Solo â Violino senza Basso accompagnato » sont un
de monuments de la musique. La fascinante beauté architecturale, la grande
maîtrise de la forme, à l'intérieur d'un processus auto limité, sont synonymes
de liberté, de jaillissement
inépuisable. On a pu dire que dans ces pièces, « le violon est
moins utilisé comme instrument à mélodie chantante que comme interprète de
l'expression harmonique et polyphonique » (Karl Geiringer),
Bach utilisant pour le violon, comme il le fera aussi pour le violoncelle, dans
ses Suites, des procédés techniques déjà expérimentés au clavier. Ces pièces
offrent autant de difficultés à l'interprète qu'elles sont exigeantes pour
l'auditeur, dont elles requièrent une extrême attention, pour ne pas dire
qu'elles en sollicitent l'imagination : le triomphe de l'esprit sur la matière.
Finalement, selon Isabelle Faust, « c'est le cheminement lui-même qui est
le but ». Pour les revisiter, en l'occurrence les Sonates I et II, et la
première Partita, elle s'en est retournée aux sources même du manuscrit, « un
monde de beauté et de perfection calligraphiques...une œuvre d'art semblable à
une cathédrale ». Sa vision ménage un équilibre parfait entre tension et
sérénité. Les Sonates I et II, BWV 1001 et 1003, adoptent la forme de la sonate
d'église, en quatre mouvements, selon le schéma lent-vif-lent-vif. La fugue,
placée en deuxième position, est introduite par le prélude que constitue
l'Adagio initial de la Sonata I (ou le Grave de la Sonata II). Dans cette dernière pièce, l'andante requiert
de l'interprète qu'il dissocie ce qui ressort de la cantilène et de la basse
figurée. La pulsation du presto final de la première Sonate est, avec Isabelle
Faust, habitée d'une allégresse intérieure, et l'allegro de la deuxième Sonate,
sorte de perpetuum mobile, livre d'étonnants traits
grisants. La première Partita, BWV 1002, de ses huit mouvements, en fait ceux
d'une suite en quatre parties, dont chacune est elle-même doublée, est un
parangon de subtilité expressive. Là encore, la riche texture harmonique
déploie un monde sonore inouï. La « Corrente »
(Courante) dépasse de loin la véloce virtuosité, pour bondir d'une incroyable
légèreté. Et on admire la souplesse du contrepoint, et la finesse des
transitions, telle celle entre la Sarabande et son « Double ». La
plénitude sonore, presque charnue, achevée par la violoniste, de son
stradivarius « La belle au bois dormant », est tout simplement
magique. Voici, en tout cas, l'indispensable et digne successeur du volume 1,
regroupant les Partitas II et III, et la Sonate III, BWV 1004-1006, publié en
2010 (HMC 90 2059). Pour l'île déserte !

« Clarinet classica ». Félix MENDELSSOHN : Concertstück
op. 113 & op. 114, pour clarinette, cor de basset et piano. Geog Philip TELEMANN : Concerto en ré mineur pour deux
clarinettes (chalumeaux ), quatuor à cordes et
clavecin. W.A. MOZART : 4 Duos pour clarinette et cor de basset, KV 487, Quintettsatz en fa
majeur, K 580b, pour clarinette et cor de basset. Franz KROMMER : concerto pour
deux clarinettes, op. 35. Philippe Berrod, Calogero Palermo, John Kruze, Michel Lethiec, Olivier Derbesse, clarinette/cor de basset. Olivier Triendel, piano. Trio et quatuor à cordes, membres de
l'Orchestre de Paris. Catherine Latzarus, clavecin.
1CD Cristal records classique : CRC 1007. TT. : 63'11.
Cet intéressant CD illustre combien est
attractif le répertoire de la clarinette, le plus jeune des instruments à vent
de l'orchestre classique. De Mozart, qui lui a donné ses lettres de noblesse à
Mendelssohn, l'illustrant de manière fort plaisante, cette anthologie ne déçoit
pas, surtout jouée par d'éminents musiciens, dont plusieurs issus de
l'Orchestre de Paris. Surtout, l'instrument et décliné dans ses diverses
acceptions, dont le chalumeau, ou ce qui s'en rapproche en facture moderne, ou
encore la petite clarinette. Ainsi le concerto pour deux clarinettes
(chalumeaux) de Telemann, de 1730, transcrit ici dans une version pour quatuor
à cordes et clavecin. Cette réduction permet aux deux solistes de déployer une
douce sonorité dans les parties lentes, et de faire montre, dans les mouvements
rapides, d'un ton vif et entraînant. Franz Kommer
(1759-1831), contemporain de Mozart, est tout autant explicite dans son
concerto pour deux clarinettes. Écrit selon la coupe classique en trois
parties, on y savoure une belle faconde thématique, magnifiquement illustrée
par les deux présents solistes, jouant en répons, à
moins que les phrases ne s'imbriquent les unes dans les autres, comme si les
protagonistes ne faisaient qu'un. Cela roucoule, tel le face à face de deux
voix humaines, élégiaques ou enjouées. Bien sûr, Mozart est immanquable ici,
quoique représenté par des œuvres plus rares que le quintette ou le concerto
pour clarinette. Des 12 duos pour deux cors de basset, quatre sont offerts,
joués pour clarinette et cor de basset, dont un beau larghetto, d'harmonie
maçonnique. Le Quintettsatz KV 580 b,
pour clarinette et cor de basset, et trio à cordes, propose un harmonieux
dialogue entre le « grand frère » qu'est le second par rapport à la
première. Enfin, les deux Concertstück (pièce
de concert) de Mendelssohn, op 113 et op 114, écrits en 1832, à l'intention du
compositeur interprète Carl Baermann et de son père
Heinrich, sont des plaisanteries musicales, amusantes et pleines de charme.
Sans prétention, elles sont aussi courtes que brillantes. Toutes ces pièces
sont jouées avec tact, emphase et joie, par un brelan de clarinettistes
talentueux, agréablement accompagnés.

Bela BARTÓK : concerto
pour violon N°2 . György
LIGETI : concerto pour violon. Peter EÖTVÖS
: Seven. Patricia Kopatchinskaya, violon. Frankfurt Radio Symphony
Orchestra. Ensemble
Modern (Ligeti), dir. Peter Eötvös. 2CDs Naïve : V
5285. TT.: 89'.
Deux artistes engagés nous entraînent dans
un passionnant voyage au cœur de la
Transylvanie. C'est dans cette contrée roumaine, où les influences
hongroises ont toujours été très présentes, que Bartók a mené ses recherches
d'ethno musicologie, et que sont nés les compositeurs György
Ligeti et Peter Eötvös. Ce dernier et la violoniste Patricia Kopatchinskaya ont eu la bonne idée de rapprocher trois
pièces violonistiques représentatives
Avec son Concerto pour violon N° 2, Bartók écrit l'une de ses pièces les
plus spectaculaires, de proportions quasi symphoniques. Créé en 1939, par son
dédicataire, Zoltàn Szekely,
quatre ans après le Concerto de Berg, il s'en rapproche par sa facture générale
foisonnante et l'utilisation de la série des 12 notes de la gamme chromatique.
Il s'en distingue, bien sûr, par son esprit éminemment hongrois, à travers une
rythmique assurée, apparente dès l'allegro initial. S'y mêle une thématique
calme et lyrique. Ces deux aspects trouvent leur résolution dans une cadence
aux mélismes expressifs, et d'une grande aspérité technique. L'andante tranquillo, en forme de lied, introduit par le soliste, est
constitué de sept variations d'intensité différente et de tempos variés. Tout
Bartók est là, tour à tour enjoué et méditatif. Le finale s'ébroue de nouveau
de rythmes d'une vitalité presque sauvage, qu'interrompent de brèves sections expressionnistes,
poussées jusqu'à l'extrême par Kopatchinskaya. Là
comme ailleurs, la violoniste ne cherche pas à amoindrir la rugosité, et joue à
fond le ton populaire, maniant aplomb et intimité. Le Concerto pour violon de
Ligeti, créé en 1992, sous la direction de Peter Eötvös, est écrit pour un
petit ensemble de 23 musiciens. Ses cinq sections, selon le schéma
rapide-lent-rapide-lent-rapide, nous immerge dans des mondes sonores
différents. Les deux parties lentes révèlent une profondeur d'accent quasi religieux,
le soliste évoluant parmi les accents curieux de la flûte lotus, dans
l'Aria-Choral, ou au sein d'éclatements orchestraux dans la Passacaille,
laissant ici au violon le devoir de s'imposer par des traits volontairement
agressifs. Les arabesques inouïes du soliste, dans l'intermezzo central
(« presto fluido »), brochent sur un tissu
orchestral tout sauf aisé. Et le finale est époustouflant, notamment lors de la
cadence, d'une diabolique virtuosité, laissant loin derrière elle celles
hautement capricieuses d'un Paganini. Patricia Kopatchinskaya
n'est nullement intimidée par cette effarante difficulté. Enfin, Seven, ou « Memorial
for the Columbia Astronauts », destiné à
commémorer l'accident de la navette Columbia, créé sous la direction de Boulez,
au Festival de Lucerne 2007, est articulé en deux phases : une première partie
animée, renfermant quatre cadences du violon, aux sonorités voilées, voire
orientalisantes par un recours à un ample vibrato de l'instrument ; et une
section plus réflexive, ouvrant un espace sonore encore plus vaste, inter
sidéral presque, quoique traversée de violents clusters d'orchestre. L'autre
caractéristique de l'œuvre réside dans son aspect formel : elle est constituée de 7 groupes d'instruments, le
soliste étant soutenu par six autres violons, eux-même
répartis dans l'auditorium, et une importante section de percussions, le
métallophone en particulier, dont les longues résonances établissent un climat
envoûtant. La prestation de Kopatchinskaya est, là
encore, impressionnante, en particulier lors de la péroraison méditative,
l'intensité diminuant jusqu'au quasi silence.

Claude DEBUSSY : Quatuor à cordes en sol
mineur, op. 10. Maurice RAVEL : Quatuor à cordes en fa majeur. Quatuor Talich. 1CD La dolce volta : LDV08. TT.: 52'59.
Ce couplage de quatuors français est un
challenge. Les Italiano, hier, ont été une référence, et les Ebène, récemment,
s'y sont révélés excellents. Le Quatuor Talich n'est
pas moins passionnant. Cette formation, fondée en 1964, par Jan Talich, en est à sa deuxième génération, emmenée par son
fils, Jan Talich junior, avec une équipe renouvelée.
Leur vision du quatuor de Debussy, une œuvre de la première manière, écrite en
1872, est limpide, n'hésitant pas à accélérer dans le premier mouvement,
« animé et très décidé ». Les effets de rétrogradation et de
modulation n'en sont que plus éloquents. Si la rythmique du deuxième mouvement
est sans concession, avec de superbes pirouettes de l'alto, l'andantino,
marqué « doux et expressif », n'est, ici, pas un vain mot, tant la
poésie affleure à chaque inflexion. Le deuxième sujet, introduit par l'alto,
s'enlace tendrement sur le balancement des trois autres voix. Là encore, la
légère accélération est bénéfique. Comme le refus de toute sollicitation. Une
pointe de mélancolie ne messied pas dans les premières mesures du finale, qui
tranche avec la manière décidée qui va suivre, préférée, comme souvent, au
« très modéré » marqué par l'auteur. Quoique le cheminement soit plus
nuancé qu'il n'y paraît. Le quatuor de Ravel frappe par son évident équilibre :
une approche sincère dans le moderato, qui révèle un charme un brin théâtral,
notamment lors des passages ou violons et alto jouent en trio, d'un doux
balancement. Au deuxième mouvement, « assez vif et très rythmé », les
pizzicatos introduisent une danse fière, en même temps d'une extrême souplesse
dans son expression chaloupée. Le second thème lyrique est abordé très
chantant, faisant fonction du trio au milieu d'un scherzo, ses effets
impressionnistes délicatement ménagés. La beauté mélodique du « très
lent » ne le cède en rien à une rigoureuse construction interne. La
justesse de ton est confondante : évitant le pathos, la ligne progresse
naturellement, épousant les diverses séquences accidentées d'un parcours génial.
L'attaca du « vif et agité » conclusif contraste, dégageant l'énergie intérieure
d'un discours resserré. Le geste se fait de plus en plus urgent, la pulsation
presque rugueuse dans les forte, avant que l'ultime presto ne s'installe. Là
comme ailleurs, les Talich saisissent le cœur de
l'idiome gallique, et la plasticité instrumentale, dominée par la franche ligne
du 1er violon et la sonorité envoûtante de l'alto, est admirable. Ils ont
captés par une prise de son claire, suprêmement équilibrée, même si un brin
résonnante.

Igor STRAVINSKY : L'Oiseau de feu. Le
Chant du rossignol. Transcriptions pour piano. Lydia Jardon, piano. 1CD AR
RE-SE : .TT. : 63'15.
En dehors des Trois mouvements de Petrouchka,
et de quelques courtes pièces, Stravinsky a peu écrit pour le piano solo. Mais
il a commis des transcriptions de pièces d'orchestre, dont celle de L'Oiseau
de feu. En fait, l'œuvre a été couchée sur le papier, en 1910, d'abord dans
une version pianistique, sans doute pour aider les danseurs dans leur travail
de préparation. Son fils Soulima transcrira aussi
pour l'instrument, en 1973, trois des mouvements du ballet. Lydia Jardon a
puisé à ces deux sources, qu'elle a unies dans sa propre version, destinée à
être exécutée en concert. Enhardie par l'intérêt suscité, elle l'a ensuite
gravée. Le résultat est, au-delà du tour de force, proprement révélateur.
« Une musique solaire et régénératrice », dit-elle. Certes. Et c'est
un quasi orchestre que l'on entend, au fil de traits incandescents ou d'un lyrisme
habité. Le recours au spectre le plus large possible du piano traduit, avec une
rare justesse de ton, les divers climats de la pièce, la fluidité du discours,
comme les changements brusques de séquences ou les transitions quasi
fusionnelles. La polyphonie, si dense, de la version orchestrale est restituée,
non pas en usant de la technique du re recording, mais par les seules deux mains, moyennant un
travail de compression du matériau et un usage extrêmement modulé de la pédale.
Ce qui conduit à un nécessaire décalage, réduisant légèrement le timing de la
pièce. Dans ce que l'interprète qualifie de « musique solaire et
régénératrice », la magie envoûtante ne perd nullement ses droits. La
« Danse infernale », dans la version de Soulima,
préférée à celle d'Igor Stravinsky, est incandescente, avec un formidable
travail de la main gauche (comme le montrait un concert donné récemment à
l'Institut Goethe). Et les accord finaux de
« l'Allégresse générale », de son judicieux balancement de volées de
cloches, s'avère d'une force peu commune. Lydia Jardon a choisi d'ajouter Le
Chant du rossignol, dans la transcription, là encore de Stravinsky, de la
version pour orchestre. L'expérience est tout aussi fascinante, voire même plus
étonnante encore, tant la maîtrise de la mécanique rythmique en perpétuel
changement est asservie à une rigueur extrême du tempo. Là encore, la rutilance
sonore n'est pas moindre qu'à l'orchestre. La poétique du thème mélancolique de
l'oiseau prend une coloration troublante. Le « jeu du rossignol mécanique »
livre une gymnastique ardue, et la péroraison, si bien chantante, est emplie de
mystère. Voilà un quasi idéal complément ! On est subjugué par ce que Lydia
Jardon appelle, avec humilité, « une virtuosité sereine », éminemment
mise en lumière par l'instrument joué,
un piano japonais Shigeru Kawai,
clair dans le médium et dépourvu d'épaisseur dans le grave, loin du son
clinquant du clavier de la firme de Hambourg. Un disque rare !

Georges ENESCO : Intégrale des œuvres pour
violon et piano. Sonates pour piano et
violon N° 1, en Ré majeur, op.2, N°2, en fa majeur, op. 6, N° 3, en la mineur,
op. 25, « dans le caractère populaire roumain ». Sonate Torso, en la mineur, op. Posthume. Impressions
d'enfance, op. 28. Amiram Ganz,
violon, Alexandre Paley, piano. 2CDs Saphir
Productions : LVC 1114. TT.: 70'10+58'.
Violoniste
virtuose, Georges Enesco a composé pour son instrument diverses pièces de
chambre, toutes de belles proportions. Créée en 1898, par l'auteur, et Cortot
au piano, la Sonate N° 1 se situe dans l'orbite des romantiques : deux
allegros, l'un fougueux mais aussi chantant, l'autre vif et fugué, aux accents
brahmsiens, encadrent un quasi adagio, dont les inflexions au violon déploient
un bel ambitus, déjà tourné vers le futur. La deuxième sonate, de 1899, dédiée
à Jaques Thibaud, ouvre de nouveaux horizons. « A
dater de cette sonate, je fus moi-même » dira-t-il à Bernard Gavoty ( in « Les souvenirs
de Georges Enesco », Flammarion). La première séquence, marquée
« assez mouvementé » est fantasque par la ligne sinueuse du violon,
sur un accompagnement prolixe du piano. Le « tranquillement » qui
suit, évoque la tradition populaire des lautari,
ces violonistes ambulants de Moldavie, et leurs mélopées mélancoliques. Enfin,
le « vif » tranche par sa verve et sa liberté rythmique. La Sonate N°
3 (1926), « dans le caractère populaire roumain », exactement
contemporaine de la deuxième de Bartók, passe pour un des chefs d'œuvre du
genre au XX ème. Elle utilise la gamme des lautari, intégrant quarts de ton et formules mélodiques
ornementées, pour mettre en relief une cadence médiane. Le « moderato malinconico » réserve une étonnante fluidité des deux
instruments, le violon notamment, à travers des mélismes roumains, où le violon
sonne quasi tzigane. Au maestoso, le violon suraigu, rappelant la petite flûte
roumaine, et le piano, avec force pédale, imitant le cymbalum, évoquent les
contrées de Moldavie, par une métrique preste et une harmonie allusive. Le
finale, bardé de rythmes de danses rustiques, déborde de vie, quoique y pointe quelque mélancolie. La Sonate dite Torso, inachevée, de 1911, hésite entre influence
brahmsienne, là encore, et improvisation chaotique, où domine l'étrangeté. Ces
pièces bénéficient d'exécutions très pensées. Par ses origines moldaves, le
pianiste Alexandre Paley ressent cet idiome comme
personne, et Amiram Ganz,
chambriste reconnu, est un archet éloquent. Ils illuminent tout autant les
« Impressions d'enfance » (1940), ultimes pièces de chambre confiées
au violon par l'auteur d'Oedipe. Ces dix
vignettes, jouées d'un seul tenant, certaines par le seul violon, sont des
évocations de la vie domestique, où Enesco porte un regard attendri sur sa
jeunesse. Le musicien revient à une écriture plus sage, simplifiée, mais
combien habitée, d'une suprême poésie raffinée. Dans le ton de la musique
française, qu'il chérissait tant.

Dmitri CHOSTAKOVITCH :
Symphonie N° 7, en ut majeur, op. 60, « Leningrad ». Mariinsky Orchestra, dir. Valery Gergiev. 1 CD
Mariinsky : MAR 0533. TT.: 82'.
La 7 ème
symphonie, dite « Leningrad », occupe une place particulière parmi
l'ensemble des 15 œuvres symphoniques de Chostakovitch. Composée, pour ce qui
est de ses trois premiers mouvements, en 1941, durant les premiers mois du
siège de la ville, dans laquelle le musicien était resté, malgré ses efforts
pour rejoindre l'armée, elle sera achevée peu après, à Kouïbychev, sur les
bords de la Volga, où il avait été évacué par les autorités. Ses vastes
proportions témoignent de l'ambition du dessein, un
hymne à la résistance contre le nazisme. Sa création, dans cette ville, puis à
Leningrad, en août 1942, en plein blocus, sera un triomphe attendu. Lequel se
prolongera des années durant, en Union soviétique et partout dans le monde. Si
la réappréciation contemporaine a tendance à la situer moins haut, par rapport
à d'autres pièces symphoniques du maître, Valery Gergiev
lui redonne assurément son lustre, dans cette nouvelle interprétation captée
live, en juin 2012, à Saint Saint-Pétersbourg. Dans l'immense mouvement initial,
le second thème, dit « de l'invasion », lui-même largement développé,
est abordé pppp, et s'enfle au fil de diverses
variations, pour atteindre un terrifiant crescendo, vrai appel à la résistance.
Le douloureux solo de basson, en forme de requiem, est impressionnant, que
relaie une belle courbe lyrique, en guise de péroraison. Le moderato suivant,
sorte de scherzo, ne sombre pas dans le motorique
d'autres compositions du même genre. Un « intermezzo lyrique, très
tendre » dira l'auteur. Gergiev le suit au pied
de la lettre, n'hésitant pas à ralentir le débit, et allier lent et piano.
Avec lui, l'adagio a rarement autant fait figure d'hymne de foi dans l'homme.
L'optimisme des accords des cordes, façon JS. Bach et du solo de flûte, le
grand climax de rythmes syncopés, typiques, l'intensité de la dernière
séquence, tout cela est bouleversant. On admire l'amplitude sonore extrême, en
particulier dans le finale. L'originalité de ce dernier est d'introduire un
nouveau matériau musical et des idées inédites, dont une sarabande. Une extrême
tension unit l'épique et le méditatif, où l'on retrouve quelques réminiscences
de l'opéra Lady Macbeth de Mtzensk. La fière
apothéose conclut un geste qui a dû donner chaud au cœur de l'auditoire, lors
de la première exécution pétersbourgeoise. Elle dispense tout autant le grand
frisson, à l'écoute de cette magistrale exécution. L'enregistrement, d'une
grande présence dans l'infiniment discret comme dans le déchaînement
démonstratif, magnifie la plasticité d'un orchestre que le chef a conduit au
premier rang des grandes phalanges mondiales. Ce qui place cette version au-dessus de celle qu'il
a réalisée, il a quelques années, avec l'Orchestre de Rotterdam combiné à celui
du Kirov.

« Martha Argerich Lugano concertos » .
WA. MOZART : Concerto pour trois pianos,
K 242, « Lodron ». Ludwig van BEETHOVEN : Concertos N° 1, op.
15 & N° 2, op. 19. Robert SCHUMANN : Concerto pour piano, op. 54, en la majeur. Franz LISZT : Concerto pour piano N° 1, en mi
bémol majeur. Béla BARTÓK : Concerto pour piano N° 3, Sz
119. Igor STRAVINSKY : Les Noces. Serge PROKOFIEV : Concertos N° 1, op.
10 & N° 3, op. 26. Francis POULENC Concerto pour deux pianos. Darius
MILHAUD : Scaramouche, suite pour deux pianos, op. 165b. W A. MOZART :
Andante et Variations pour quatre mains, K 501. Franz SCHUBERT : Divertissement
à la hongroise, pour piano à quatre mains, D 818. Johannes BRAHMS : Liebeslieder, op. 52, pour chœur et piano à quatre
mains. Martha Argerich, piano. Avec Alexander Gurning, Paul Gulda, Rico Gulda, Akane Sakai, Alexander Mogilvesky, Gabriela Montero,
Julia Azaichkina,
Karin Merle, piano. Coro della Radiotelevisione
svizzera. Orchestra della
Svizzera italiana, dir :
Diego Fasolis, Gabriel Chmura,
Alexander Rabinovitch-Barakovsky, Erasmo
Capilla, Alexander Verdernikov,
Ion Marin, Charles Dutoit. 4CDs Universal
DG : . TT: 79+75+76+73' environ.
Voici qui sort des sentiers battus : loin
des intégrales de tout poil, c'est un regard porté sur un interprète, en
l'occurrence Martha Argerich. A été rassemblée une
jolie collection de concertos, saisis durant son festival, « Progetto Martha Argerich »,
organisé chaque mois de juin à Lugano. Il s'agit de captations différentes
(2004-2010) de celles effectuées, chaque année, par EMI, lors du festival, depuis
sa création en 2002. Faire de la musique ensemble, entre amis, est le but de
cette manifestation, comme ouvrir la programmation au spectre le plus large
possible en est l'épine dorsale. Mais toujours, ou peu s'en faut, avec le
concours de Martha Argerich. La présente anthologie
focalise, évidemment, sur elle. De quoi éclairer toutes les facettes d'un
talent immense, célébré depuis quelques 50 ans, et d'une étonnante diversité.
Si Argerich a depuis longtemps délaissé le récital,
fuyant son éprouvant isolement, elle privilégie la musique de chambre et le
répertoire concertant, dans une poignée de lieux choisis, dont celui-ci. Pour
ce faire, elle s'entoure de partenaires amis, les anciens, et surtout, les
jeunes pousses, qu'elle aime à soutenir ; ses protégés, dit-elle. Mais au-delà
de l'aide appréciable apportée, c'est, pour elle, l'occasion de cultiver le
contact, de s'offrir une cure de renouveau. De rechercher l'émotion aussi, et
la fraîcheur du geste, qui ne doit pas s'habituer à l'acquis, encore moins à la
routine. Son jeu, on l'a tant décrit et loué ! Il est engagé, et en cela
moderne, et non affecté, dans les pièces romantiques. Son Premier Concerto de
Liszt est tout sauf bardé de clinquante virtuosité. Le Schumann, son cheval de
bataille, sans cesse remis sur le métier, a la force de l'évidence de qui
redécouvre, s'il se peut, de nouvelles idées. La puissance percussive du
toucher, qui s'est largement apprivoisé au fil des ans, fait merveille dans
Bartók. Le 3ème concerto du maître hongrois offre un équilibre
quasi idéal entre ce percutant et la profondeur du toucher, comme dans l'adagio
reliogoso, qui révèle une veine subtile dans sa
partie médiane. Si on a pu déceler du démoniaque dans la manière de la pianiste
argentine, c'est plus par référence à quelques traits, certes excessifs
(illustrés ici par un Ier concerto de Beethoven d'une énergie plus que
débordante, dans ses mouvements extrêmes), montés en épingle par ses
détracteurs, que par une analyse spectrale de sa façon de concevoir la musique,
sans s'encombrer de préjugés. Là où on ne peut que s'accorder, c'est sur la
sincérité du propos, essentielle pour cette interprète. Ces quatre disques
couvrent un large panorama de concertos qu'Argerich
joue et rejoue sans relâche, le Schumann, en particulier, les premiers
Beethoven aussi, et bien sûr les Prokofiev, dont le fameux troisième, naguère
immortalisé avec le complice Abbado. Son esprit curieux lui fait aussi aborder
Poulenc et son espiègle Concerto pour deux pianos, chef d'œuvre de légèreté et
de mordant, mais aussi des pièces plus improbables, telles Les Noces de
Stravinsky, qui alignent quatre pianistes. La musique de chambre n'est pas
absente de cette anthologie, représentée par Mozart, dont la fine fluidité
maintient la forme, ou Schubert et son délicat Divertissement à la hongroise,
d'une douce joie teintée de mélancolie. On trouve encore Scaramouche de
Milhaud, ou comment illustrer l'esprit français, tempéré de samba brésilienne ;
un petit joyau sous les doigts de la pianiste et de sa partenaire Karin Merle.
S'ils sont de qualité variable, Les accompagnements d'orchestre sont toujours
adéquats.

« MISSION »
Cecilia Bartoli chante la musique de Agostino
STEFFANI. Extraits des opéras Henrico Leone,
I Trionfi del fato, Tassilone, Niobe, regina di Tebe, La Libertà
contenta, La superbia d'Alessandro, La lotta d'Hercole con Acheloo, Marco Aurelio, Alarico il Baltha.
Stabat Mater. Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. Avec Philippe Jaroussky,
contre-ténor, et Franck Delage dans le rôle de Agostino Steffani.
Coro della radiotelevisione
svizzera. I Barocchisti, dir. Diego Fasolis. Réalisateur :
Olivier Simonnet. 1DVD Universal
Decca : 074 3604. TT.: 1H02.
Décidément, le château de Versailles prête
son cadre et ses fastes à bien des productions de prestige. C'est Cecilia
Bartoli qui a eu l'idée du tournage de ce film d'hommage à Agostino Steffani (1654-1728), objet de toutes ses attentions, comme
le démontre déjà le formidable CD paru il y a peu (cf. NL de 11/2012). Si le
récital est le prétexte, le regard porté sur un compositeur inconnu, mais
intéressant, en est le but ultime. Car le film, capté dans divers lieux du
domaine de Versailles, tant en extérieur (Cour de marbre, Colonnade, Parterre
du Midi) qu'en intérieur (salon de Vénus, salle des Hoquetons, Chapelle,
Galerie des Glaces), est articulé autour d'une brève trame de la vie du
musicien sulfureux, où celui-ci se met lui-même en scène. On a triché avec la
chronologie, car si Steffani a joué, un jour de 1679,
pour le Roi Soleil, ce ne le fut pas à Versailles, qui n'était pas encore sorti
de terre. La mise en scène filmique, due à Olivier Simonnet,
reste intimiste, misant sur la proximité des interprètes et du spectateur, en
cherchant à dépasser la virtuosité requise d'une musique d'une incroyable difficulté
technique. Le destin du musicien, prêtre, diplomate et espion, est enjolivée,
et « self indulgent », et ce nonobstant la belle prestation de
l'interprète, Franck Delage. Les différentes atmosphères de la balade poétique
sont agréables à l'œil, saisies dans des perspectives chatoyantes et de beaux
plans rapprochés, ou encore avec d'évocateurs contre jours. Mais cela manque de
spontanéité, pour ne pas dire paraît factice. La grande Cecilia, quoique
remarquablement portraiturée par la caméra, est souvent empruntée, en
particulier lors des duos avec Philippe Jaroussky. Ce
dernier, affublé d'un curieux costume rouge sang, la couleur de l'amoureux
transi sans doute, ne paraît pas moins étudié. Tout cela est d'une froide
beauté, distant, et finalement peu émouvant. Heureusement, le chant est là qui
réchauffe l'âme. Et pour détailler les fabuleuses arias ornementées par Steffani, Bartoli n'a pas son pareil : modulation infinie
de la voix, par exemple accompagnée du seul luth, dans « Animi, e vederai », tiré de
l'opéra Niobe, reine de Thèbes, notes
pianissimos, tenues à en perdre haleine, fils de voix inouïs, différenciation
des climats, ou encore vocalises effrénées dans les « arias di furore », tel « Non prendo
consiglio » de La superbia
d'Alessandro. Philippe Jaroussky lui donne une
réplique qu'on sent affectueuse. Surtout, c'est un plaisir de voir Diego Fasolis, l'âme musicale de l'affaire, tour à tour chef,
tenant l'orgue ou le clavecin, voire même choriste, se mêlant au Chœur de la Radiotelevisione swizzera. Ses
musiciens de I Barocchisti sont d'une folle
classe.

Jean-Pierre Robert
« Retour de Bayreuth » Onze
improvisations sur des thèmes wagnériens. Loïc Mallié,
orgue. 1CD Editions Hortus : HORTUS 917.
TT : 63’47.
Une idée originale que cet enregistrement,
sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’église de La Madeleine à Paris, d’improvisations
sur des thèmes wagnériens. Un disque qui trouvera sans doute son public parmi
les amateurs d’orgue, ce que ne fut pas, semble-t-il, Richard Wagner. Mais
également parmi les mélomanes curieux, qui s’attacheront à découvrir dans ces
improvisations nombre de leitmotivs wagnériens, parfois évoqués de façon
allusive ou fugitive. Loïc Mallié, titulaire du grand
orgue de la Trinité à Paris et de Saint Pothin à Lyon, déploie, ici, tout son
talent qui n’a d’équivalent que son admiration, partagée par de nombreux
organistes, pour le grand Richard. Un clin d’œil musical indispensable en cette
année Wagner.

« Musique française pour
quatuor de clarinettes ». Karol BEFFA : Feux d'artifice. Thierry ESCAICH
: Ground IV. Guilllaume CONNESSON : Prelude
and funk. Bruno MANTOVANI : Face à face. Quatuor Vendôme. 1CD
INDESENS : INDE044. TT : 46’18.
Ce disque remarquable présente quatre
œuvres contemporaines pour quatuor de clarinettes, commandes du Quatuor Vendôme
à quatre compositeurs actuels, enregistrées en premières mondiales. La
clarinette y apparait dans tous ses états, clarinette en Sib, clarinette basse,
petite clarinette en Mib et clarinette en La, dans un
véritable feu d’artifice de virtuosité, mais surtout de magnifiques sonorités,
changeantes en fonction des œuvres et des combinaisons d'écriture. Feux d’artifice, de Karol Beffa (°1973), développe quatre mouvements, tour à tour
houleux, ténébreux, obstiné ou frénétique. Dans Ground IV, de Thierry Escaich (°1965),
l’aboutissement, après maintes transformations, retrouve le bouillonnement de
la passacaille. Prelude and funk de Guillaume Connesson (°1970), se vit comme une étrange symbiose entre
musique baroque et musique pop. Enfin, Face
à Face, de Bruno Mantovani (°1974), est
probablement la pièce la moins réussie, s’épuisant dans un vain et inutile
combat, aux dissonances agressives et suraiguës. Frank Amet, Nicolas Baldeyrou, Alexandre et Julien Chabod
donnent au quatuor de clarinettes ses lettres de noblesse. Les œuvres sont
servies, qui plus est, par une belle prise de son. Un CD original et
incontournable pour tous les amateurs d’instruments à vent. Bravo et bon
anniversaire, messieurs !

Giuseppe
VERDI, César FRANCK, Charles GOUNOD; Gaetano DONIZETTI : chœurs d'opéras.
Chœurs de Franz SCHUBERT, Étienne-Nicolas MÉHUL, Lili BOULANGER, Rudi GOGUEL,
Camille ROBERT, William STEFFE, Anna MARLY. Chœur de l’Armée Française, dir. Aurore Tillac. Catherine Stagnoli,
Jean-Christian Le Coz, Adriano Spampanato,
piano. 1CD Indésens : INDE033. TT : 50’38.
Voilà un florilège de chœurs d’hommes,
célèbres, comme ceux inclus par Verdi, Donizetti, ou Gounod, dans leurs opéras,
et ceux composés par Schubert ou Lili Boulanger, pour le concert, mais aussi
moins connus, comme ceux de Rudi Goguel (1908-1976)
ou de William Steffe (1830-1890)…Sans oublier La
Madelon, de Camille Robert (1872-1957), ou Le Chant des
partisans, d'Anna Marly (1917-2006), ou encore celui du départ,
écrit par Méhul. Il sont interprétés par le
Chœur de l'Armée française, formation de la Garde Républicaine, avec accompagnement
de piano. Pour les inconditionnels !

Patrice Imbaud
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
A découvrir :
***
Informations générales :
Livres et CDs sont à envoyer à
la rédaction de l’Education musicale : 7 cité du
Cardinal Lemoine 75005 Paris
Passer une publicité. Si
vous souhaitez promouvoir votre activité, votre programme éditorial ou votre
saison musicale dans L’éducation musicale,
dans notre Lettre d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me
contacter au 01 53 10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
Laëtitia Girard.
l.girard@editions-beauchesne.com
Tous les dossiers de l’éducation musicale